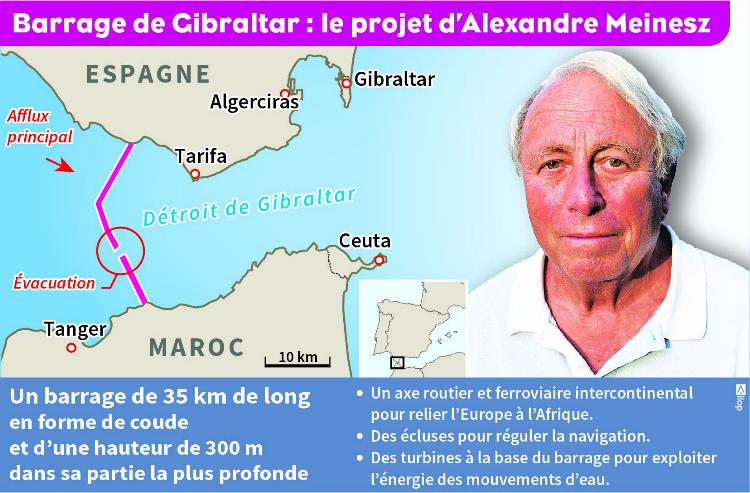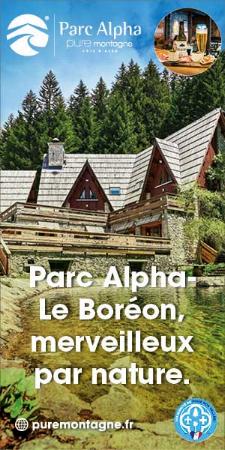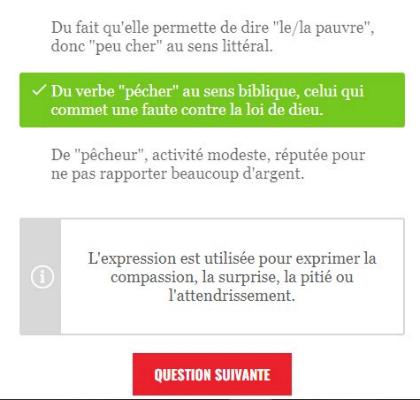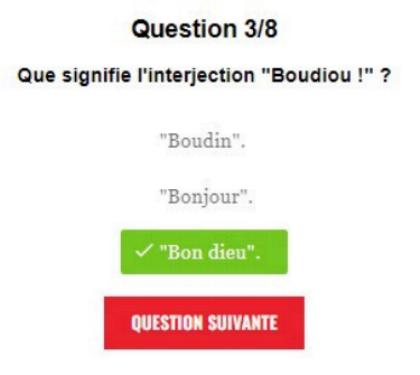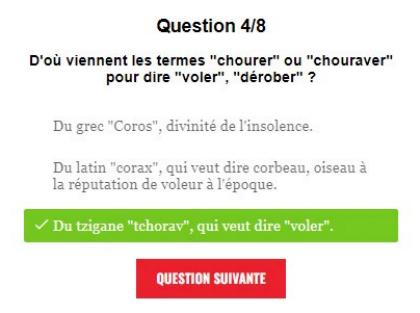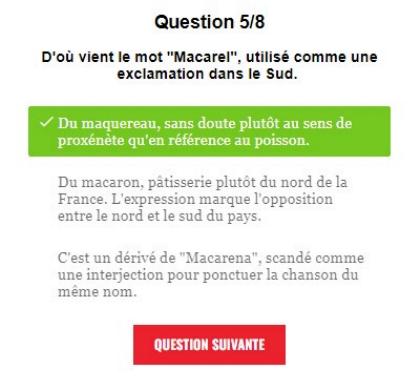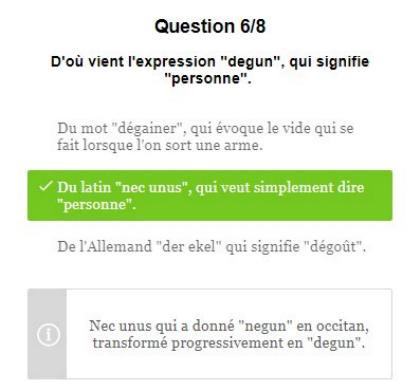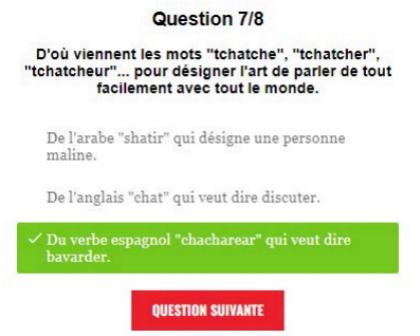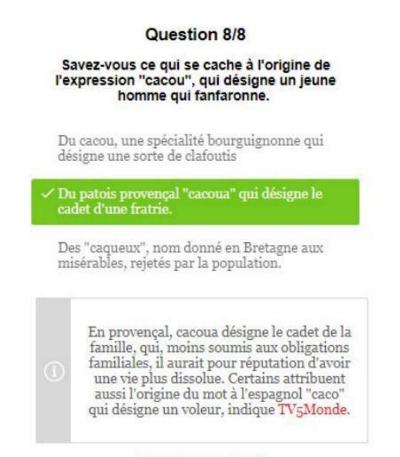|
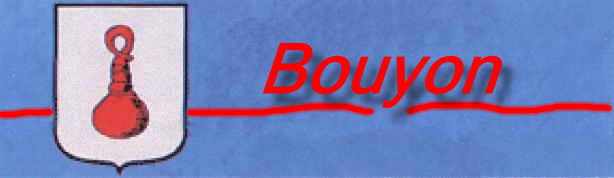
..
Les applications mobiles du Département...
Le Département, dans sa volonté de proximité et de service à
l'usager, propose différentes applications sur environnement mobile.
Retrouvez dans cet espace un descriptif des téléchargements
disponibles.

REGIONS
Sources :
articles parus dans divers journaux
ou liens vers d'autres sites
..
Découvrir
Tempête Alex -
JO Paris 2024
Nice
- Nouvelles
de Nice -
Nice ancien -
Menton
- Riviera - Merveilles
Les Alpes-Maritimes -
En France et dans le
Monde
Le Carnaval de Nice
Avec France Bleu Azur le "pourquoi" de monuments ou emblèmes niçois
Christian Maria
- Romancier niçois auteur d'une saga de polars historiques au
XVIe siècle à travers le Comté de Nice, la Provence et les Etats de
Savoie...

Découvrir Nice

..
DÉCOUVRIR LES PARCOURS DU
PATRIMOINE UNESCO
Depuis juillet 2021, Nice est inscrite par
l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial en tant que ville de villégiature
d’hiver de Riviera.
Un peu d’histoire
En 1706, sur ordre du roi de France Louis XIV, le château et les fortifications
niçoises sont détruits. Ancienne place forte, la ville doit trouver une nouvelle
vocation. Les États de Savoie, auxquels Nice appartient, entretiennent des
relations étroites avec les Anglais. C’est alors qu’en 1764-1765, Tobias
Smollett, un écrivain Écossais, décide de venir séjourner à Nice. Lors de son
voyage, il écrit ses “Lettres de Nice” qui vont faire permettre de populariser
la ville auprès de ses compatriotes anglais et plus largement encore. Nice
devient alors une étape du Grand tour puis une destination à part entière.
Les premiers étrangers séjournant à Nice viennent passer la saison d’hiver. Ils
appartiennent à l’aristocratie ou aux grandes familles fortunées. Ils viennent
particulièrement pour les bienfaits du climat et la beauté des paysages. Au fil
du temps, l’origine géographique des hivernants s’élargit et la destination se
démocratise.
Dès l’origine, les villégiateurs s’installent, à l’écart de la ville existante,
sur la rive droite du Paillon. Les premières villas sortent de terre sur les
collines et la promenade des Anglais, suivies par les hôtels. La ville est un
chantier permanent, les constructions sont modifiées en fonction des changements
de propriétaires et de la mode. Tous les styles cohabitent, des plus sobres aux
plus excentriques. Ville de plaisirs, Nice s’équipe de lieux de déambulation
(promenades, jardins) et d’édifices dédiés aux loisirs (opéra, casinos,
théâtres, hippodrome, patinoire…). Nice devient alors une ville tournée
principalement sur le tourisme.
..
Les parcours du patrimoine UNESCO
..
Expositions et Musées
.. ..
Musées de Nice
Grâce à une offre
muséale exceptionnelle, Nice se positionne en
deuxième place après Paris en terme de
fréquentation de ses 17 musées.
..
..
JO Paris 2024
Paris 2024 : Les temps forts de la
cérémonie de clôture en images
Cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 : les
anneaux olympiques s'assemblent dans le Stade de France avant de prendre
leur envol
Calendrier et programme des épreuves des
JO Paris 2024
Hommage, taille, visites : trois choses à
savoir sur la montgolfière qui porte la vasque olympique au-dessus
de Paris
Paris 2024 : Les moments marquants de la
cérémonie d'ouverture en images
L'affiche des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024 a été dévoilée au Musée d'Orsay
Des nouvelles de Nice et de la Métropole
D’où vient-il, à quoi sert-il,
remplace-t-il du sable... 8 questions pour tout savoir sur le
célèbre galet de Nice
De 717 millions à 59 millions
d'euros: comment la Métropole a fait fondre le budget de la tempête
Alex
"Il faut siffler la fin de la partie":
contre le béton et la spéculation, le préfet des Alpes-Maritimes
veut "redonner sa place à l’agriculture" dans la plaine du Var
Une nouvelle ligne de bus pour desservir
le Vieux-Nice
Prolongation de la voie Mathis à Nice:
une étape stratégique a été franchie
À quoi va ressembler, en 2028,
Nice-Aéroport, la première "gare bioclimatique" d’Europe ?
Les femmes n’étaient pas les bienvenues
aux JO : un parcours à découvrir au Musée national du sport à Nice
Tempête Ciaran à Nice : les galets de
la promenade des Anglais ont disparu
Quels hôpitaux de Nice vont
disparaître pour laisser place au méga hôpital dans la plaine du Var
?
Comment sont nés les grands
magasins sur la Côte d'Azur ?
A Nice, la promenade du Paillon
fête (déjà) ses 10 ans : son passé, son futur, sa vie cachée...
Tandis que la mer monte, l'aéroport
Nice Côte d'Azur s'enfonce
Tram, palais des
congrès, gare, voie rapide… On fait le point sur les grands travaux
à Nice
Gérald Darmanin annonce une
nouvelle brigade antidrogue : Nice première ville à la tester en
France
Tramways, bus... On fait le point
sur les nouveautés du réseau Lignes d'Azur en vigueur dès lundi
New York, Philadelphie, Paris... Des
tableaux de Matisse "jamais venus à Nice" visibles lors de
l’exposition exceptionnelle au musée cet été
Abonnements, cartes, tickets...
On fait le point un mois après les changements survenus au sein du
réseau Lignes d'Azur
Voici comment la
Métropole de Nice va financer le projet titanesque de la nouvelle
station d’épuration (et on sait si le prix de l’eau va augmenter)
Risque d’inondations
à Nice: le Paillon est-il le "grand oublié" des Alpes-Maritimes ?
Trois raisons de ne (surtout) pas
manquer le Nice Jazz Festival 2023
Lutte contre les
incendies : une nouvelle caméra de détection des feux expérimentée à
Nice
Voilà que le maire de Nice annonce
qu’un troisième "poumon vert" est déjà en projet.
A quoi ressemblerait Nice avec le
casino de la Jetée-Promenade ? La réponse... en réalité virtuelle
On vous
rappelle l'histoire extraordinaire du casino de
la Jetée-Promenade
L’idée paraît folle... le
comité de quartier propose de reconstruire le casino de la
Jetée-Promenade à Nice
Création d'un
pôle d’excellence nationale en santé
respiratoire à Nice, ça change quoi ?
Les Bains de la Police rouvrent à Nice : l'histoire de ce site
historique de la Promenade des Anglais
Les chauves-souris ne sauveront
finalement pas le palais des congrès Acropolis de la démolition à
Nice
Le palais des congrès Acropolis de Nice
sauvé de la démolition par des chauves-souris ?
De couvent à hôtel 5-étoiles: on
vous fait visiter le gigantesque chantier de la Visitation, dans le
Vieux-Nice
Du nouveau sur le réseau de tramway:
la future ligne 4 change de tracé, les lignes 2 et 3 aussi
Dijon et Poitiers forment plus
d’internes que Nice, Christian Estrosi écrit au ministre de la Santé
Nice bientôt à la pointe sur la
réutilisation des eaux usées avec un projet à 540 millions d’euros
Pont pédestre, amphithéâtre, navettes...
Voici à quoi pourrait ressembler le port de Nice pendant (et après)
le Sommet des océans
Le chantier d'Iconic entre dans sa
dernière ligne droite à Nice, on a demandé aux riverains ce qu'ils en pensaient
Où en est le tunnel raccordant la
voie Mathis à l'A8 à Nice
C’est le plus grand chantier de la Côte
d’Azur: on fait le point sur le projet Joia à Nice
Surprise,
Christian Estrosi annonce la création d’un
palais des congrès... sur le port de Nice
Nice accueillera la conférence des
Nations unies sur les océans en juin 2025
À la découverte des 5 monuments les
plus insolites de Nice
AVANT/APRÈS. Dix photos pour vous
montrer la métamorphose du quartier depuis la démolition du TNN
Nice, Cannes et Antibes veulent
recycler les eaux usées pour faire face à la sécheresse
Voies de
circulation en moins, stationnements supprimés: l'impact des travaux
d'extension de la promenade du Paillon dans le centre-ville de Nice
Christian Estrosi lance les
travaux sur les gravats du TNN, première étape de l'extension de la
promenade du Paillon de Nice
On vous explique
pourquoi les chenilles processionnaires sont une calamité pour les humains et
les animaux
Les écologistes dénoncent "le saccage
environnemental" de l’estuaire du Var, voici la réponse de la préfecture des
Alpes-Maritimes
.“C’est
Beyrouth!”: les écologistes dénoncent le “saccage” de l'estuaire du Var, la
petite Camargue azuréenne
Voilà à quoi ressemblera la future
"forêt urbaine" de Nice entre le TNN et Acropolis
Près de 71.000 visiteurs pour
découvrir Hokusai et sa vague au Musée des arts asiatiques de Nice
L'impressionnante démolition du
Théâtre National de Nice en images
Le chantier s'accélère: les images
impressionnantes de la destruction du Théâtre national de Nice
3 000m²
supplémentaires, parking de 700 places, aménagement routier... On
vous explique le méga chantier de Leroy Merlin à Nice
Des pingouins aperçus à Nice, Antibes,
Villefranche-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var
A quoi pourrait ressembler la
future salle de spectacle annoncée par Christian Estrosi aux Arènes de Cimiez ?
Coup de théâtre: la Ville de Nice
abandonne la salle de spectacle d’Iconic au profit des Arènes de Cimiez !
Quand le tramway révolutionnait le
quotidien des Niçois... au XIXe siècle
Repreneur, travaux, nouveaux restaurants... On sait
quand la gare du Sud pourrait rouvrir à Nice
Du retard sur le chantier du raccordement de la
voie Mathis à l’autoroute A8 à Nice ?
La célèbre vague d'Hokusai exposée au
Musée des arts asiatiques de Nice
Mort d'Elizabeth II : les trois histoires qui
ont rendu la Côte d'Azur anglaise
L'histoire de Nice... A toute Berzingue
!
Nice : Musée de Préhistoire de Terra
Amata
Nice : les
arènes de Cimiez
Nice : la colline du
Château
La vraie histoire du "canoun de
Miejour "
Avant le Méridien, c’était l’hôtel Rhul,
un bijou architectural
L'histoire du
splendide casino municipal
Saviez-vous qu’au XVIIIe
siècle, Nice et Hyères se disputaient les premiers touristes
hivernaux de la Côte d'Azur ?
Nice : le Vieux Nice ou le "Babazouk" dans tous
ses états ! (1ère partie)
Nice : le Vieux Nice ou le "Babazouk" dans tous
ses états ! (2ème partie)
Nice : Une Histoire du Vieux-Nice à travers les noms
de ses "carriera" !
Qui était
Catherine Ségurane ?
Nice : L’église du Jesù
dans le Vieux-Nice
Nice : le Palais
Lascaris, un symbole de l’Histoire niçoise
Nice : Vieux Nice, les
Franciscains, de Lympia à la Place Saint-François
Nice : Une visite "aérienne" du
Vieux Nice à la Belle Epoque… en deux photos !
Nice : l'histoire du
port
Nice : le port, de l’anse
Saint-Lambert au port Lympia
Nice : l’ancien Bagne du Port
Nice : Le passage du Var à travers les âges
Nice :
l’église abbatiale Saint-Pons : un joyau restauré
Nice : Fort du
Mont - Alban
Nice : la place
Garibaldi
Nice : Un site
emblématique, la place Garibaldi
Nice : la place
Masséna
Nice :
le quartier des Musiciens
Nice : la rue Lépante
La chaise bleue de
Nice tombe dans le domaine public : connaissez-vous sa vraie
histoire ?
Nice : le quartier
de la Croix de Marbre
Nice : Magnan :
Fragments d’une ville
Nice : l’avenue
Borriglione : de la Belle Epoque au XXIe siècle
La santé à Nice de
1820 à la Grande Guerre
Nice : Le Quartier
Saetone
Nice-Liserb, de la folie Belle Epoque au lotissement des années 1970
Je me souviens… des Studios de la
Victorine (1ère partie)
Je me souviens… des Studios de la
Victorine (2e partie)
Nice, un été 1944
: l’avion-fantôme
Nice : 3 mars 1952. Une
tragédie aérienne en plein Carnaval !
Nice : St Etienne, du village
d’autrefois au quartier moderne d’aujourd’hui
Nice : Saint-Maurice,
Chambrun, l’Assomption, un quartier plutôt préservé
Nice : Les funiculaires
(Cimiez, Carabacel)
Nice : Carabacel... il n’y a pas que les
funiculaires !
Nice : le Ray, des cressonnières aux
HLM…
Nice : Saint-Barthélémy (1ère
partie)
Nice : Saint-Barthélémy (2ème
partie)
Nice
Saint-Sylvestre, de l’ancien hameau campagnard au quartier moderne
Nice : l'histoire de la Gare du Sud
On vous dit tout sur la future ligne 5
du tramway entre Nice et Drap via la Trinité
32
établissements ont été labellisés "CUISINE
NISSARDE
On vous dit à quoi va
ressembler le nouveau port de Nice présenté ce
jeudi soir par Christian Estrosi
Vent, mer,
géographie, ruelles... On vous explique pourquoi
il fait toujours bon dans le Vieux Nice
Entrée
majestueuse au Mamac, forêt urbaine, rues
piétonnisées... Découvrez les nouvelles images
de la future promenade du Paillon
Nice : la célèbre Tête
Carrée va devenir un lieu ouvert au public à Nice
700 ans d'histoire et un futur théâtre... On a visité
le chantier du futur TNN sur la place Saint-François à Nice
On vous dévoile
les premières images de la future promenade du
Paillon de Nice
Nice et sa Promenade des Anglais
classées au Patrimoine mondial de l'Unesco
A Nice,
votre rue est-elle inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ?
9
raisons d'aimer les galets de la Promenade des Anglais...
"La Prom" - Découvrez
le documentaire exclusif, 5 ans après l'attentat du 14 Juillet à Nice
..
 Découvrir les Alpes-Maritimes
Découvrir les Alpes-Maritimes
Toutes les randonnées présentées sont consultables sur le
site
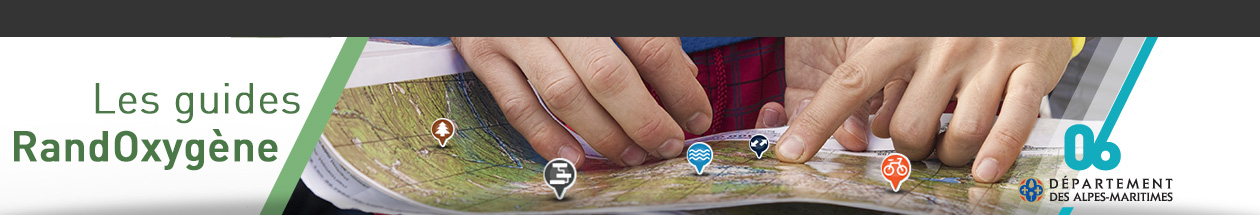 . .
.
Les nouvelles du 06
Les forts des
Alpes-Maritimes
Il y a 400 ans, Coursegoules
devenait ville royale...
"Des sources qui étaient taries
coulent de nouveau" : à la suite des fortes pluies dans les
Alpes-Maritimes, état des lieux avec un hydrologue
Fondateur de l'AS Monaco, chercheur d'or...
Sept choses que vous ignorez sur Marcel Pagnol
L’olivier millénaire de
Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes
“A Musées Vous !” : (re)découvrez les
trésors artistiques et culturels de la Côte d’Azur
Où aller skier à la journée et à quel
prix cet hiver dans les Alpes-Maritimes ?
La carte des sites
pour la candidature des Alpes françaises pour les JO 2030
Tout ce qu'il faut savoir sur les
candidatures de Nice et de la région Sud Paca pour les JO d'hiver
2030
Liste des communes des
Alpes-Maritimes dans lesquelles les équipements d'hiver pour les
véhicules sont obligatoires
La vallée de la
Roya, trois ans de reconstruction depuis le passage de la tempête
Alex
Chantiers
post-Alex dans les vallées: où en est-on? On fait le point
Tempête
Alex, trois ans après : les chiffres fous de la reconstruction
Jean-Michel Ribes, Max Boublil, Tété... la riche
saison des Arts d’Azur au Broc
Île Sainte-Marguerite: retour sur les
mystères autour du Masque de fer
À Villefranche-sur-Mer il existe une
chapelle entièrement décorée par Cocteau
Nombreuses méduses sur la Côte d'Azur :
découvrez sur une carte où elles se trouvent
La fin des travaux au nouveau tunnel de Tende
prévue pour juin 2024, mais...
Cinq forts à visiter dans les
Alpes-Maritimes pour se mettre au frais cet été
Vallée de la Roya : sur la haute route du
sel, des visiteurs de toute l'Europe viennent admirer les paysages
Trois nouveaux ponts reconstruits après
la tempête Alex inaugurés dans la Roya
30 ans d'histoire de la réintroduction du
Gypaète barbu, ce fragile oiseau qui ne fait qu'un œuf par an
Lutte contre les incendies:
les postes de secours sont de nouveau en service aux Ferres
Pour désengorger des sites naturels, le
Mercantour et la Métropole de Nice proposent des navettes pour rejoindre les
départs de rando
Avec la sécheresse comment préserver
la biodiversité du Mercantour ?
La disparition du lac de Broc
serait-elle vraiment une catastrophe alors qu'il est artificiel ?
Près d’une centaine de membres
dans un village de 500 habitants... Comment l’association culturelle
de Coursegoules dynamise la commune
Visite médicale réussie pour 15
bouquetins du Parc national du Mercantour
Sécheresse dans les Alpes-Maritimes :
alerte renforcée pour certains secteurs
La sécheresse dans les Alpes-Maritimes
en avril 2023 est digne d'un mois de juin selon Météo France
Nouvelles
perquisitions à la mairie de Nice : soupçons de détournements de
fonds sur les chantiers dans les vallées
Victoire du maire de Conségudes :
l'unique liaison de bus de son village est rétablie par la région
PACA
Sécheresse: l'inquiétude monte face à
l'arrivée de l'été dans les Alpes-Maritimes
Bientôt des méga-bassines dans le parc
du Mercantour pour faire face à la sécheresse ?
Alpes-Maritimes : le combat du maire
de Conségudes pour rétablir l'unique liaison de bus de son village
Dans la vallée de la Roya, le pont d'Ambo
a ouvert à la circulation ce week-end de Pâques
La Corniche d’Or, cette route entre
Saint Raphaël et Cannes à travers l'Estérel, fête ses 120 ans
Cinquantenaire de la mort de
Picasso : en images, le parcours du peintre sur la Côte d'Azur
Le nouveau tunnel de Tende devrait
être percé mi-mai
Alpes-Maritimes et Var, sur le
podium des départements les plus boisés de France
Sur les traces de
Baptiste, "le sorcier des Merveilles" dans La Roya
Les travaux de la construction du
viaduc pour relier la route au tunnel de Tende ont commencé
L'incroyable découverte d'un
site préhistorique dans les Alpes-Maritimes
La Madone d'Utelle
"Toute la population de
poisson est en train de s’effacer": situation
"gravissime" au lac du Broc
Menton - Riviera -
Merveilles
La Madone de Fenestre, dans le
Mercantour, à nouveau accessible en voiture
La "Bataille de Gilette" : 19 octobre 1793
Dans la Roya, deux nouveaux ponts installés et un
accès à Casterino qui avance
Réouverture de la route des Gorges de
la Vésubie
"Il ne reste plus rien": les images hallucinantes
du lac du Broc quasiment à sec
Tunnel de Tende : "les travaux vont
monter en puissance", selon le ministère de la transition écologique
Bruit et vitesse sur la route de la
Bonette : le Parc National du Mercantour veut protéger sa faune
Sécheresse : le lac du Broc presque à sec,
des oxygénateurs installés pour sauver les poissons
Des traces de pas, datant d'avant les dinosaures,
ont été découvertes dans les Alpes-Maritimes
On sait ce qui est arrivé à la
madone mystérieusement disparue près de la frontière italienne dans
le Mercantour
Il reste moins d'un kilomètre à
creuser au tunnel de Tende
A découvrir dans les Alpes-Maritimes :
les
fresques énigmatiques de Notre-Dame des Fontaines
A découvrir dans les Alpes-Maritimes : le mont
Gélas, point culminant du Mercantour
A découvrir dans les Alpes-Maritimes :
le lac de Fenestre, une étape sur "la route du sel"
A découvrir dans les
Alpes-Maritimes : le Baus de la Frema, un sommet légendaire
La Pyramide de Falicon
Le Saut des
français, lieu de mémoire…
A découvrir dans
les Alpes-Maritimes : la Madone d'Utelle, un
sanctuaire perché à 1194 mètres d'altitude
Le
canal de la Vésubie
Sur les traces
du célèbre sorcier des Merveilles
Alex,
des vestiges exceptionnels découverts lors de
travaux à Roquebillière
“Les explorateurs des parcs” : le tout nouveau jeu
digital pour parcourir les parcs des Alpes Maritimes
Tempête Alex :
1 an après...
“Sans la tempête Alex, la ligne de train s’éteignait comme une bougie.”
Retour sur l'incroyable histoire du train de la Roya, tiraillé entre la
France et l'Italie"
La Côte d’Azur vue depuis l’espace !
A 1
heure de Nice, au cœur du Mercantour... Les
Vallées de la Vésubie et du Valdeblore proposent
une offre inédite d’activités en toutes saisons.
..
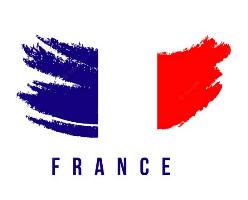
En France... et dans le monde

..
Les différentes cartes de projection
des effets du dérèglement climatique ont été dévoilées
Le
1er avril ?
Le mystère du monstre Loch Ness enfin résolu ? Un
spécialiste du lac écossais pense avoir solutionné l'énigme
Mais quel est ce mystérieux sanglier
mutant photographié dans le Var ?
La "Femme à la montre"de Picasso,
un chef-d'œuvre adjugé près de 130 millions d'euros
Cette nouvelle planète du système solaire intrigue
les scientifiques : on vous présente Sedna, qui ressemble à la Terre
Qu'est-ce que Oweynagat surnommé la "Porte de
l'enfer", cette grotte dont il ne faut pas approcher à Halloween ?
L'étrange scénario autour de la mort
d'Edith Piaf le 10 octobre 1963
On vous explique la différence
entre la fourmi de feu et la fourmi électrique
La liste des 51 sites d'exception classés au
patrimoine mondial de l'Unesco en région Occitanie et en France
Arthrose : "Demain, avec un film hydrogel
enrichi en cellules souches, on régénérera le cartilage"
Coupe du monde de rugby 2023. Pourquoi
les rugbymen, dont les Bleus, portent-ils ces drôles de casquettes ?
Coupe du monde de rugby 2023 : "caramel",
"cuillère", "chistera"... le glossaire des gestes pour comprendre un match
Coupe du monde de rugby 2023 : durée, barème
de point, tirs au but... tout ce qu'il faut savoir pour comprendre un match
"Une bonne partie des glaciers sont
déjà condamnés" : comment le réchauffement climatique accélère leur
fonte
En quête de "l'ADN environnemental", ce
premier inventaire du vivant en Méditerranée pour préserver la biodiversité
La Méditerranée, une mer sous pression: "Non,
ce n’est pas foutu, c’est à nous de bosser"
"On n'a jamais vécu ça, c'est incroyable" :
les pontes des tortues caouannes ont explosé et c'est une bonne nouvelle
Congelé pendant 46 000 ans dans le
permafrost, un ver a été ressuscité : quels enjeux, quelles inquiétudes ?
Piqûres de
tiques, de frelons, morsures de vipère...
Profiter de la nuit des étoiles en
pratique
Nuit des étoiles : on vous explique ce qui se
passe vraiment dans le ciel ce week-end et comment en profiter au mieux
Nuit des étoiles 2023 : étoile
filante, météorite, astéroïde... ne les confondez plus grâce à notre lexique
Nuit des étoiles 2023 : cinq
applications pour vous aider à lire et comprendre le ciel
Les abeilles aussi souffrent de
la canicule et de la sécheresse l'été
Fourmis : espèces, organisation,
agressivité... 10 questions pour tout savoir de cet insecte fascinant
Pourquoi la glace de
l'Antarctique n'a jamais autant fondu et ne parvient pas à se reconstituer ?
Le baliste, ce poisson parfois mordeur venu
des mers chaudes, bien présent en Méditerranée
Requins près des plages : un
biologiste dénonce la "psychose bleue" et la désinformation
Peuchère, Macarel, fada ou cacou...
Connaissez-vous la véritable origine de ces expressions du Sud ?
Festaïres, rouméguer, avoir la cagne...
êtes-vous incollable sur les mots et expressions du sud ?
"Le plus grand état des lieux
jamais réalisé dans le monde" : la biodiversité de la Méditerranée va être
cartographiée
Missions, matière noire... que va chercher le
télescope européen Euclid, parti explorer le côté sombre de l'Univers
"Épidémies et mortalités
massives" en mer Méditerranée : les conséquences effrayantes du
réchauffement de l'eau
Déclin des papillons en Europe : pourquoi
il est important de protéger ces insectes pollinisateurs
Moineaux, mésanges... pourquoi la population
d'oiseaux s'est effondrée en Europe depuis quarante ans
Notre-Dame de Paris : "Nous la reconstruisons pour
850 ans au moins", dit le directeur de l'établissement publique
Le noyau interne de la Terre se serait
mis à tourner à l'envers : faut-il s'inquiéter du phénomène ?
Un jeu pour la
sensibilisation au milieu marin, bientôt sur plateau
Décryptage : le vin de garde ou le
mystère d’une alchimie, de la vigne au jour de l'ouverture de la bouteille
Sergio Calderon, sommelier chez Bras : "Le
vin ce ne sont pas des mathématiques, il faut une part de hasard"
Pour Amandine Marshall, "on est
tellement admiratifs de l'Egypte antique qu'on refuse d'en voir les côtés
sombres"
"Des abeilles pour demain" : le
documentaire à voir pour comprendre pourquoi (et comment) protéger les
abeilles
Il pêche un silure record de plus de 2 mètres au lac
de Saint-Cassien
Espace : les images des Piliers de la
création prises par le télescope spatial James Webb
Hérault : l'incroyable
odyssée de la tortue de Valras et ses 110 œufs pondus sur la plage
Trois bonnes raisons de voir ou revoir
le documentaire "Alaïs, tortue sauvage de Provence"
Frontignan : Ann, le plus vieux flamant rose connu du monde,
photographié dans l'étang d'Ingril
Méditerranée : un barrage à Gibraltar, l'idée folle
d'un chercheur pour empêcher la montée des eaux
Avec Lady Sapiens, une autre histoire de la
femme à la Préhistoire, active, sportive, artiste et chasseresse
Carrières de lumières : Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait
Les Baux -
Carrières de lumières - Un voyage au coeur des oeuvres de Cezanne
.
..
Menton
- Riviera - Merveilles
Toutes les infos :
rendez-vous sur le site de
l’Office de Tourisme Menton - Riviera - Merveilles..


Le patrimoine fortifié des Alpes-Maritimes
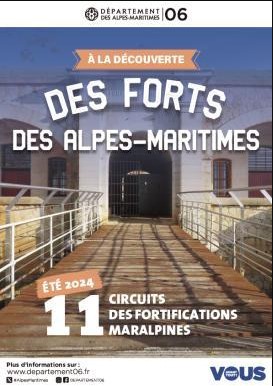


Paris 2024 : Les temps forts de la cérémonie de clôture en images



Cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 : les
anneaux olympiques s'assemblent dans le Stade de France avant de
prendre leur envol
Après une cérémonie d'ouverture qui a décoiffé la planète, Thomas
Jolly remet le coup, dimanche, pour un spectacle de clôture tout
aussi grandiose.
Ce qu'il faut savoir...



Calendrier et programme des épreuves des JO Paris 2024



Hommage, taille, visites : trois choses à savoir
sur la montgolfière qui porte la vasque olympique au-dessus de Paris
Depuis vendredi soir, la vasque olympique flotte au-dessus de Paris,
et ce, pendant toute la durée des Jeux olympiques, puis
paralympiques.
Et le choix de la faire voler dans un ballon dirigeable n'est pas un
hasard...



Paris 2024 : Les moments marquants de la cérémonie d'ouverture en
images



Il y a 400 ans, Coursegoules devenait ville royale...
En janvier 1623, avec effet en juin 1624, le village de Coursegoules, dont
les droits ressortissaient au baron de Vence, connaît une destinée
imprévisible : le roi de France Louis XIII l’érige en ville royale et la
réunit au domaine royal.

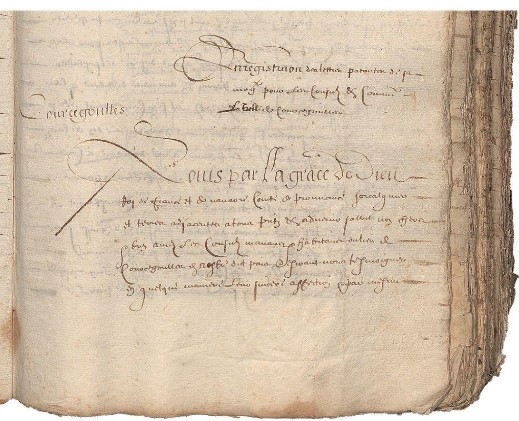


Avant le Méridien, c’était l’hôtel Ruhl, un
bijou architectural
Tout Niçois qui se respecte visualise parfaitement l’hôtel Méridien,
au tout début de la promenade des Anglais, entre le jardin
Albert-Ier et le palais de la Méditerranée. Mais combien ont connu –
et se souviennent – de ce qu'il y avait avant ?
Avant, c'était déjà un hôtel. Un hôtel au nom resté mythique à Nice
– et pas pour le confort de ses chambres : l'hôtel Ruhl. Ce bâtiment
à la façade coloniale avait été imaginé par Henry Ruhl, un
Britannique qui possédait déjà de nombreux hôtels à Nice. Mais pas
seulement : on lui doit également l’hôtel Carlton de Cannes.
Pour édifier l’hôtel qui portera son nom, le jeune homme d'affaires
(il n'a pas 30 ans) décide, en 1909, de mettre au tapis un phare de
l'hôtellerie de luxe sur le bord de mer. Un édifice imposant,
majestueux même, mais jugé vieillissant et dépassé : l'hôtel des
Anglais.
Il faut dire que l'emplacement, pile en face du somptueux casino de
la Jetée-Promenade, est idéal. L'un des plus en vue et des plus
prisés de la ville...
La conception est confiée au célèbre architecture niçois Charles
Dalmas, qui imaginera plus tard, juste à côté, le palais de la
Méditerranée. En 1913, il livre un édifice Belle-Époque dont les
coupoles ne sont pas sans rappeler le Negresco, achevé quelques mois
plus tôt.
Mais la Seconde Guerre mondiale aura raison de l’établissement,
désaffecté, placé sous séquestre et quasiment laissé à l'abandon
pendant des années, son propriétaire (un riche Russe) ayant
"mystérieusement" disparu à la Libération.
Funeste destin pour le
joyau, qui finira exproprié pour utilité publique en 1963 avant
d'être démoli quelques années plus tard.
Mais le Méridien, imaginé par Honoré Toscan et sorti de terre en
1974, n'a pas fait table rase de son prédécesseur : au
rez-de-chaussée subsiste le casino au nom mythique.
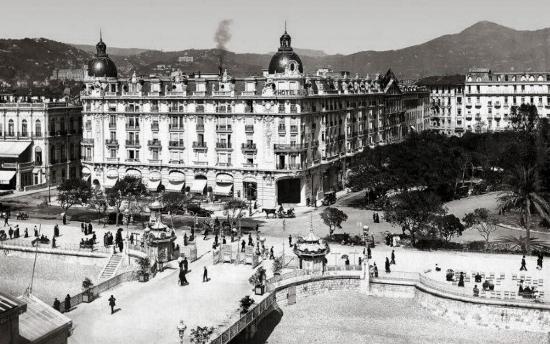


Les différentes cartes de projection des effets
du dérèglement climatique ont été dévoilées.
Elles sont instructives.
C’est "un phénomène qui s’accélère", soulignait, jeudi soir,
Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires.
Selon les cartes du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), commandées
par le gouvernement et publiées vendredi, sous l’effet du recul du
trait de côte, amplifié par le changement climatique, l’érosion qui
menace les logements concerne désormais 20 % du littoral français,
soit 900 km.
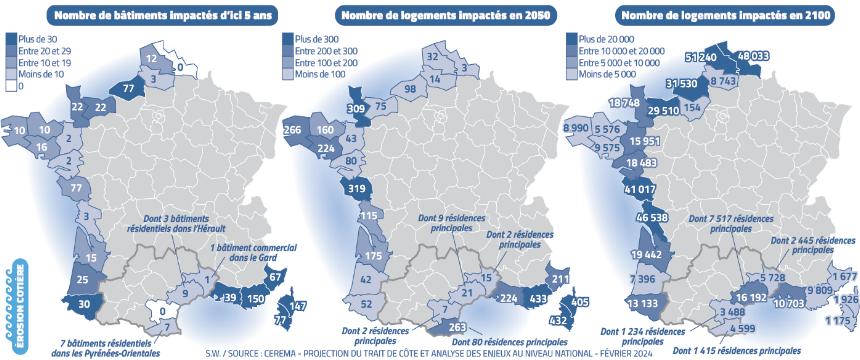



Le 1er avril
Depuis près d'un demi-millénaire, le 1er avril donne lieu en France et
dans quelques autres pays à d'aimables farces surtout pratiquées par les
enfants et leurs parents.
Cette tradition remonte au roi Charles IX. Avant
son édit de Roussillon (9 août 1564), en France, l'année calendaire
commençait le 25 mars, et, de ce jour jusqu'au 1er avril, les
Français avaient coutume de se faire des cadeaux pour célébrer le
passage à l'année nouvelle.
En souvenir des temps anciens, les Français et les autres
francophones n'en continuent pas moins à se faire des cadeaux "pour
rire" à l'occasion du 1er avril.
Comme le 1er avril coïncide aussi avec la
fermeture de la pêche, le mois d'avril étant la période de
reproduction pour beaucoup de poissons de rivière, on qualifie ces
amusements de "poissons d'avril " car ils sont aussi peu sérieux que
de pêcher un poisson en avril !...


"Des sources qui étaient taries coulent de
nouveau" : à la suite des fortes pluies dans les Alpes-Maritimes,
état des lieux avec un hydrologue
Les fortes pluies de ce début d'année ont permis
de reconstituer en partie nos réserves. En certains endroits, il est
déjà tombé plus d'eau en trois mois que toute l'année dernière. Le
point sur le niveau de nos nappes phréatiques et les explications de
Jean-Pierre Ivaldi, hydrogéologue.



L'affiche des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024 a été réalisée par le dessinateur Ugo Gattoni et a été
dévoilée au Musée d'Orsay, à Paris, le 4 mars 2024. (Paris 2024)

Plus d'infos sur l'affiche officielle complète des Jeux de Paris
2024


Fondateur de l'AS Monaco, chercheur d'or...
Sept choses que vous ignorez sur Marcel Pagnol
Lionel Paoli
Un demi-siècle après sa mort, vous croyez tout savoir sur
l’auteur de "La Gloire de mon père"? On fait le pari que ce n’est
pas le cas.
Suivez le guide !
1. Il a participé à la création de l’AS Monaco
Eh oui! Un document, exhumé des archives du Palais princier, atteste
que "Monsieur Pagnol Marcel " a participé à la fondation de
l’équipe professionnelle de football en 1948.
Une attestation lui a été faite "en témoignage de l’intérêt qu’il
porte aux couleurs sportives monégasques". Fort heureusement,
ses amis marseillais ne l’ont jamais su.
2. Il a été un ami intime de Rainier III
Rainier vouait une admiration sans borne à Pagnol. Il était capable
de réciter par cœur des scènes entières de Marius. Lorsque le
cinéaste décide de s’installer avec sa famille à Monaco, en 1947, le
jeune prince fait tout pour lui faciliter la vie.
Le 20 mai 1949, à peine installé sur le trône, il lui réserve sa
toute première ordonnance, l’autorisant officiellement à "exercer
les fonctions de consul du Portugal à Monaco".
La correspondance entre les deux hommes, ininterrompue jusqu’à la
mort de l’écrivain, témoigne de l’affection et de l’estime
réciproque qui liaient le monarque et l’académicien.
3. Il a créé Ugolin en s’inspirant d’un paysan de La Gaude
Si le personnage de Manon des sources est directement inspiré de
Jacqueline Pagnol, celui d’Ugolin, selon l’épouse de Marcel, est
calqué sur un paysan gaudois.
"C’était un fermier qui travaillait chez nous, confiait-elle.
Il était fou! Il parlait à ses œillets, les insultait s’ils ne
poussaient pas assez vite. C’était un homme incroyablement
maladroit. Un jour, il a tué son meilleur ami d’un coup de fusil de
chasse."
4. Il a cherché de l’or près de Cagnes
Au début des années cinquante, pendant que son fils Frédéric taquine
le cochonnet avec un copain nommé Michel… Sardou, Marcel devient
chercheur d'or.
"Il était persuadé que les Romains avaient caché un trésor dans
sa propriété, raconte son petit-fils Nicolas. Il pensait que
le coffre, rempli de joyaux, était enterré au pied du plus vieil
olivier du domaine – un arbre vieux de deux mille ans que mon
grand-père avait baptisé l'olivier du Christ."
Pagnol creuse. Ne trouve que de la terre et des racines
enchevêtrées. Alors il retourne à ses premières amours et couche sur
son cahier d'écolier les premières lignes d'une histoire d'œillets,
de sécheresse et de vengeance qui va s'appeler Manon des sources.
5. Il a contribué à lancer une mode aux États-Unis
Selon Jean-François Saluzzo, Marcel raconta au maire de Le Gaude,
André Féraud, qu’à l’été 1955, un "Américain" était venu lui
rendre visite au Domaine.
"Pagnol lui fit visiter sa magnifique oliveraie et lui présenta
des objets en bois réalisés par des artisans locaux, indique
l’auteur gaudois. Impressionné, le visiteur recontacta [le maître
des lieux] en lui indiquant qu’il souhaitait lancer l’artisanat du
bois d’olivier aux Etats-Unis et lui demanda s’il était possible
d’acheter ses arbres."
Le cinéaste lui expliqua qu’il était interdit – et quasiment
sacrilège – d’abattre les oliviers, sauf s’ils étaient morts.
Quelques mois plus tard, en février, "le terrible hiver 1956 et
son redoutable gel détruisirent de nombreux oliviers, poursuit
l’ancien élu gaudois. En Provence, environ cinq millions d’arbres
ont été coupés." Ce qui permit à l’ami américain de faire son
marché… et de lancer outre-Atlantique la mode des objets artisanaux
en bois d’olivier.
6. Il a failli tourner avec Cary Grant
En 1948, Pagnol imagine le scénario d’un film ayant pour cadre la
Principauté. Tombola est l’histoire d’une jeune institutrice qui
gagne un séjour dans un hôtel de luxe monégasque. Un milliardaire
américain tombe amoureux d’elle.
Pour incarner ce dernier, Marcel veut Cary Grant. Il écrit – en
anglais – à la star d’Hollywood qui lui répond le 30 mars 1949: "Oui,
je serais intéressé de lire votre nouveau scénario."
Enthousiaste, Pagnol planche tous les matins sur son ouvrage.
Jusqu’au jour où, insatisfait des dialogues qu’il a repris dix fois,
il abandonne. Cary Grant viendra bien tourner à Monaco. Mais ce sera
devant les caméras d’Alfred Hitchcock, au côté de Grace Kelly, pour
La Main au collet (1955).
7. Il a inspiré des cinéastes dans le monde entier
Les remakes sont consubstantiels de la filmographie de Pagnol.
Marius, son premier triomphe mis en images en 1931 par Alexander
Korda, a été tourné simultanément en versions allemande (Zum
goldenen Anker) et suédoise (Längtan till havet).
Sept ans plus tard, Hollywood s’empare des deux premiers volets de
la trilogie marseillaise condensés dans Port of Seven Seas, avec
Maureen O’Sullivan – la "Jane" des Tarzan avec Johnny
Weissmuller – dans le rôle de Fanny, rebaptisée Madelon pour ne pas
heurter les spectateurs!
Pagnol, ancien professeur d’anglais, apprit ainsi qu’en
Grande-Bretagne et en Australie, "fanny" est un mot d’argot
qui désigne l’organe sexuel féminin, alors qu’aux États-Unis, ce
joli prénom désigne une paire de fesses.


La chaise bleue de Nice tombe dans le domaine
public : connaissez-vous sa vraie histoire ?
Les droits concernant le modèle installé sur la Promenade des
Anlgais Nice sont tombés.
Mais d'où vient la chaise bleue ? Cannes, Nice ? Qui a créé ce
symbole ?
Tordo, Jean‑Michel Wilmotte ? Qui pour la remplacer ?
On déroule et démêle l'histoire de la chaise la plus connue de
France... Et au-delà !
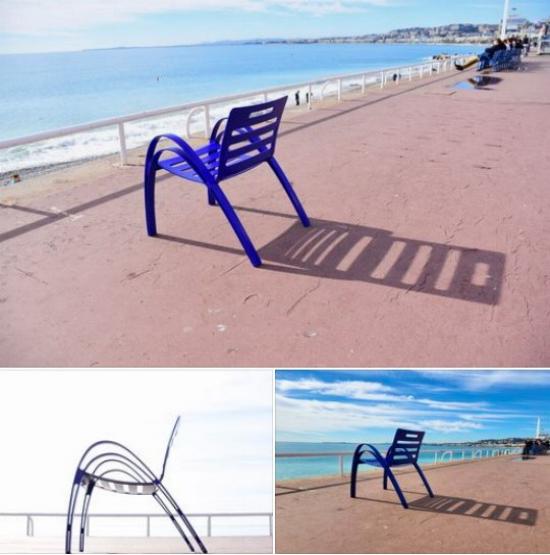


L’olivier millénaire de Roquebrune-Cap-Martin dans
les Alpes-Maritimes
Daniel Biso - Adjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin :
"La place de cet arbre est dans nos cœurs.
Aujourd’hui, je vous parle mais généralement c’est le silence qui
s’impose."



“A Musées Vous !” : (re)découvrez les trésors
artistiques et culturels de la Côte d’Azur
Du 27 au 28 janvier, l'événement “A Musées Vous !” promet un
week-end exceptionnel qui célèbre la richesse culturelle du
territoire.
De nombreux musées ouvrent leurs portes, offrant au public des
ateliers exclusifs et des animations gratuites pour une immersion
totale dans l'âme artistique de la Côte d'Azur.
Suivez le guide !
..

.
Pour cette première édition, dix-neuf musées de la Côte d’Azur vous
invitent à un voyage culturel inoubliable. Des musées d'art
contemporain aux lieux dédiées à l'histoire naturelle, en passant
par les collections d’ici et d’ailleurs, chacun offre une expérience
enrichissante et ludique pour découvrir le patrimoine culturel de la
Côte d'Azur en famille ou entre amis. Du littoral à l’arrière-pays,
chaque musée participant propose ainsi des animations et des
ateliers basés sur ses collections permanentes. Que vous soyez un
passionné d'art, un amateur d'histoire ou un curieux avide de
connaissances, la programmation de l'événement "A Musées Vous !"
promet de marquer les esprits.
A la découverte des grands peintres de la Côte d’Azur
Plongez-vous dans l'univers captivant de Fernand Léger au Musée
National de Biot ! Au travers d’une visite guidée, laissez-vous
entraîner dans l'œuvre de ce pionnier de l'art moderne, dont la
collection du musée constitue d’ailleurs la seule au monde à
embrasser l'intégralité de la carrière de l’artiste. Les enfants ne
sont pas en reste puisqu’ils auront l'occasion d'explorer le geste
créatif du Maître et de découvrir la technique des contrastes, ou
encore de tester un atelier dessin et peinture autour du thème de
l’architecture.
Au Musée Pierre Bonnard du Cannet, la visite se fait à la lampe
torche à la nuit tombée. Une découverte exceptionnelle qui va vous
permettre de percer les secrets d’une sélection d'œuvres
emblématiques de Pierre Bonnard et d’explorer ces dernières dans le
moindre détail. Et si vous tentiez la visite olfactive ? Parfums
poudrés, odeurs de pins et d’aloès sont au rendez-vous de cette
expérience sensorielle.
Quant au Musée national Marc Chagall de Nice, vous pouvez y
découvrir quatre œuvres remarquables et rares entrées dans les
collections en 2023 pour le 50e anniversaire du musée. Laissez-vous
également tenter par la visite exclusive du centre de documentation
pour découvrir des ouvrages rares autour de la vie et l’œuvre de
l’artiste. Les enfants vont pouvoir s’immerger dans son univers
onirique et coloré et ainsi exercer leur odorat en humant des
parfums, puis leur ouïe avec une séance d’écoute en dialogue avec
les œuvres et enfin composer un dessin accompagnés de leurs parents.
Immersion dans le savoir-faire de la Côte d’Azur
Labellisé "Musée de France", le célèbre Musée International de la
Parfumerie de Grasse offre, quant à lui, une exploration complète de
l'histoire, des matériaux, et des techniques de la parfumerie, de
l'Antiquité à nos jours. Ne manquez pas les visites combinées des
réserves du musée et des coulisses de la médiation olfactive. Rose
centifolia, jasmin ou encore oranger… Selon les souvenirs qui vous
lient à une odeur, cette escale sensorielle ne vous laissera pas
indifférent !
Dans la capitale mondiale du parfum, partez également à la
découverte du Musée Provençal du Costume et du Bijou qui met en
scène de fabuleuses pièces dans cette noble demeure chargée
d’histoire, ainsi que du Musée d’Art et d’Histoire de Provence qui
abrite notamment des collections retraçant la vie quotidienne en
Provence orientale, soulignant des traditions ancrées jadis dans la
vie quotidienne et qui ont forgé l’identité locale.
Venez explorer la richesse et la diversité des collections céramique
du Musée Magnelli, Musée de la Céramique de Vallauris Golfe-Juan !
De la céramique utilitaire aux créations artistiques des années 1950
d’artistes comme Suzanne Ramié ou Pablo Picasso, vous pourrez
parcourir l’histoire de ce matériau avant de découvrir les
céramiques contemporaines. Petits et grands découvriront des
céramiques de Picasso réalisées à Vallauris et partageront un moment
familial en décorant une plaque d’argile fraîche. Les plus joueurs
testeront l’escape game intitulé “Au secours, on a volé un Magnelli
!” Un beau moment à partager en famille.
Passage obligé au Musée Escoffier de l’art culinaire à
Villeneuve-Loubet pour une visite avec audioguide offerte et une
dégustation de chocolat chaud à l’ancienne qui rappellera à coups
sûrs des souvenirs d’antan !
Pour les gourmands et les gourmets, direction l’Espace de l’Art
Concret de Mouans-Sartoux pour profiter d’une balade-dégustation
lors de l’animation “une œuvre/un vin” orchestrée par un expert
vigneron en dialogue avec un médiateur. Un moment rare pour
s’initier à l’œnologie et à l’art concret, tandis que les enfants
profiteront des lectures animées multi-sensorielles afin d’éveiller
leur curiosité et de stimuler leur imagination.
Du côté du Musée Lou Ferouil de Gilette, plongez-vous dans
l'artisanat d'un ferronnier d'art qui partagera les secrets de la
fabrication de roses ou de boules de Noël en fer forgé. Une
transmission passionnée donnant naissance à des créations qui vont
susciter l'admiration tant des petits que des grands.
A la Villa des Camélias au Cap d’Ail, partez à la découverte d’un
incroyable piano pneumatique dans une démonstration ludique et
découvrez l’antre de cet objet rare et unique. Vous pourrez
également suivre un commentaire composé autour d’une œuvre du
peintre Ramiro Arrue.
Voyage culturel et artistique autour du monde
Au Musée Départemental des Arts Asiatiques de Nice, optez pour la
visite guidée et découvrez à la fois les collections permanentes du
lieu et l’exposition-événement “Tintin et Tchang”. Envie de vous
imprégnez de culture traditionnelle millénaire ? Essayer un cours le
Tai chi chuan ou de Kung Fu, des professeurs seront présents pour
vous initier.
Explorez les activités sensorielles et ludiques proposées au Musée
des Explorations du Monde de Cannes lors de ce week-end spécial. Que
ce soit à travers des moments des ateliers de coloriage, de
costumes, des jeux ludiques, cette expérience, adaptée à tous,
promet une immersion captivante dans la culture polynésienne.
Naviguer à travers les époques depuis la Côte d’Azur
Destination Monaco, au Musée d’Anthropologie préhistorique, pour
profiter d’une visite guidée VIP des nouvelles expositions et du
laboratoire de recherche habituellement fermé au public, suivi par
un atelier de découverte des techniques d’allumage du feu. Durant
cet atelier, petits et grands vont pouvoir apprendre à allumer un
feu par friction et percussion à la manière des hommes
préhistoriques ! Du côté du Musée Océanographique de Monaco, c’est
une véritable aventure en famille qui vous attend ! Les enfants,
accompagnés des grands, deviennent de petits reporters en herbe au
travers du jeu Mission Polaire. Le parcours est également une façon
ludique d’en apprendre davantage sur les Inuits, les animaux des
pôles ou encore les différences entre l’Arctique et l’Antarctique.
Un beau moyen de transmettre aux jeunes générations le goût de la
nature tout autant que les grands enjeux et défis actuels.
Au Musée Départemental des Merveilles de Tende, découvrez une
expérience immersive à travers une visite tactile des galeries
permanentes. En touchant et en manipulant de fidèles reconstitutions
d’objets archéologiques, vous pourrez explorer les matières
premières et les techniques utilisées par les hommes et les femmes
de notre lointain passé pour la fabrication des objets
indispensables au quotidien.
L’atmosphère de la Belle Époque est au cœur du Château de La Napoule
à Mandelieu-La Napoule. La visite de l’ancienne forteresse médiévale
surgissant de la mer avec ses pierres rouges et ses tours vous
dévoile la demeure de ce couple d’américains à la fois artistes et
fantasques. Profitez de l’atelier d’art plastique sur les terrasses
du château et laissez-vous séduire par la beauté de ses jardins.
Face à la Méditerranée, le lieu est une oasis de verdure où règne
calme et volupté.

.
Escale fleurie ou sportive, à vous de choisir !
Parmi les balades insolites à faire sur la Côte d’Azur en ce
week-end spécial, destination Saint-Jean-Cap-Ferrat et plus
précisément, la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild. Entourée de
magnifiques jardins dominant la Méditerranée, ce bijou niché sur les
hauteurs de la presqu’île accueille les collections d’art de la
baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild. Mimosa, aloès, figue de
barbarie ou encore oiseau du Paradis, vous aurez l’opportunité de
partir sur les traces des plantes admirées par les hivernants à
l’époque de la baronne au travers d’une balade unique avec le chef
jardinier. Anecdotes et astuces garanties ! Sans oublier la visite
guidée pour les amateurs de la décoration d’intérieur et des arts
décoratifs. A la recherche des cygnes d’Europe centrale, des
perruches et perroquets d’Amérique et d’Asie ou encore du coq qui
habitent les salons du musée Ephrussi de Rothschild, la visite
guidée “Drôle d’oiseaux” est un bon moyen de découvrir le peuple
disparate des oiseaux représentés dans les objets des arts
décoratifs du musée.

.
Enfin, le Musée national du Sport à Nice offre non seulement une
visite libre gratuite, mais également une visite guidée de
l'exposition "les Elles des Jeux" à tarif préférentiel, explorant
l'événement inédit des Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers le
regard des femmes olympiques. Ne manquez pas l'occasion de vous
arrêter au photobooth spécial Jeux Olympiques d'Hiver pour
immortaliser un souvenir inoubliable et le partager sur vos réseaux
sociaux !
Retrouvez le programme complet :
www.cotedazurfrance.fr


Saviez-vous qu’au XVIIIe siècle, Nice et Hyères
se disputaient les premiers touristes hivernaux de la Côte d'Azur ?
Nice Matin - André Peyregne
Au XVIIIe, les deux villes se disputent les touristes d’hiver.
Les célèbres voyageurs qui y ont séjourné n’ont pas manqué
d’écrire sur ces contrées.
Morceaux choisis.
.

Nice au XVIIIe, gravure d’Albanis Beaumont, 1787 - Bibliothèque
municipale de Nice. (DR)
Voici venu l’hiver. À notre époque, c’est la saison du froid et des
sports de neige. Il y a deux ou trois siècles, c’était, pour notre
région, la saison du tourisme, celle où les voyageurs des pays du
Nord venaient chercher la chaleur sur nos côtes. Une fois l’été
arrivé, ils délaissaient nos rivages pour aller à l’intérieur du
continent vers les villes de cure.
Ce tourisme d’hiver a commencé au XVIIIe siècle. Quelques voyageurs
célèbres ont laissé leur témoignage. Allons à leur rencontre.
L’un des premiers visiteurs célèbres de notre région fut l’abbé
Jean-Joseph Expilly. Son Dictionnaire géographique, publié en 1762,
fit autorité à cette époque. Il y traite "Hières" (sic) de "contrée
délicieuse où règne une espèce de printemps continuel "
Peu après vint l’Écossais Tobias Smollett. à 42 ans, en 1763, il
effectua un voyage vers l’Italie. Arrivant aux abords de Nice, il
fallait franchir le fleuve du Var. Il n’y avait pas de pont à
l’époque. La traversée se faisait grâce à des hommes qui
franchissaient le fleuve à gué.
On les appelait les "gueyeurs": "Six de ces hommes, les
pantalons retroussés jusqu’à la ceinture, avec de longues perches en
main, prirent soin de notre voiture et, par mille détours, nous
conduisirent sains et saufs à l’autre bord."
Nice, ville des fleurs
Tobias Smollett resta deux ans à Nice. À son retour, il publia
Travels through France and Italy. Il fit rêver les lecteurs qui
lisaient l’ouvrage sous les brumes londoniennes: "Nice est la
ville des fleurs. Les roses et les œillets sont envoyés à Turin,
Paris et même Londres. On les emballe dans une boîte de bois,
pressés les uns contre les autres, sans aucune préparation. Qui les
reçoit coupe le bout des tiges et les plonge pendant deux heures
dans de l’eau vinaigrée, redonnant leur fraîcheur et leur beauté."
Le physicien genevois Jean-André Deluc, lui, vint hiverner à Hyères
en 1770: "Les orangers sont la gloire du pays", écrit-il.
À la suite, son collègue mathématicien suisse Johann Sultzer,
célèbre lui aussi à l’époque, se partagea entre Hyères et Nice au
cours des hivers 1775-1776.
Il y décrit la présence des Anglais venus après avoir lu les écrits
de Smollett: "Les Anglais qui, à l’automne, se transportent tous
les ans en grand nombre dans les pays méridionaux les plus chauds de
l’Europe ont mis Nice à la mode et je crois que cette vogue est
méritée."
Jean-Baptiste Dupaty, homme de lettres de la fin du XVIIIe, fait un
constat semblable dans ses Lettres sur l’Italie en 1785: "J’ai vu
des Anglaises touchantes et même charmantes: à leur arrivée, elles
mouraient; au départ, elles avaient refleuri. Nice, pendant l’hiver,
est une espèce de serre pour les santés délicates."
.

Le romancier écossais Tobias Smollett. DR.
Le frère et le fils du roi
Les Anglais étaient à Nice mais aussi à Hyères. Au cours de l’hiver
1784, un frère du roi George III, le duc de Gloucester, y séjourna,
puis en 1788 et 1789 un de ses fils, tous deux accompagnés de leur
famille et de leur abondante domesticité.
En 1791, l’écrivaine anglaise Charlotte Smith publia un roman à
succès "Célestine", en quatre volumes – l’histoire d’une
jeune orpheline élevée à Hyères par une famille anglaise qui y
résidait pendant l’hiver. Elle finit par retrouver ses vrais
parents.
Les Anglais voulurent voir à Hyères les lieux imaginaires où avait
vécu Célestine.
Mais, pour cela, ils attendirent que la Révolution soit passée! Car
on était à la fin du XVIIIe. Et la Révolution fit du tort, on s’en
doute, aux activités touristiques. Celles-ci reprirent lors du
Premier Empire. Le retour d’Égypte de Bonaparte et le départ de
Napoléon pour l’île d’Elbe attirèrent l’attention sur les petits
ports de Fréjus et Saint-Raphaël.
Hyères plus chaude que Nice ?
Il n’empêche, les deux grandes stations touristiques demeuraient
Hyères et Nice. Le médecin Jean-Emmanuel Fodéré, qui faisait
autorité, considéré comme le père de la "médecine légale" en
France, avait un faible pour la première: "La ville d’Hyères, qui
est éloignée d’une lieue de la mer, pourrait, sous certains
rapports, obtenir la préférence et paraîtrait même être un peu plus
chaude en hiver et moins exposée que celle de Nice aux variations de
température".
Mais le Suisse Horace de Saussure, "inventeur " de
l’alpinisme et "découvreur " du Mont-Blanc, pensait le
contraire: "L’air en hiver est un peu moins doux à Hyères qu’à
Nice. Les orangers en présentent la preuve: les hivers rigoureux
leur font beaucoup plus de mal à Hyères" (Extrait des "Voyages
dans les Alpes", cité par Marc Boyer dans L’Hiver dans le Midi). Qui
croire?
La rivalité entre Nice et Hyères dura jusqu’à ce qu’en 1834, une
autre ville touristique, découverte par le Lord anglais Brougham,
vienne s’intercaler entre les deux. Cette ville? Cannes. Le XVIIIe
siècle était alors révolu...
Nice vue par l’Académicien Antoine-Léonard Thomas
L’Académicien français Antoine-Léonard Thomas (1732-1785) est parmi
les écrivains français qui vinrent séjourner à Nice, au XVIIIe
siècle. Il en fait une description idyllique dans un texte écrit en
décembre 1780.
"Il n’y a nulle part, ni un plus beau ciel, ni des promenades qui
présentent de plus beaux points de vue qu’ici à Nice, où je jouis
d’un magnifique spectacle ; il est vrai qu’il faut aller les
chercher à travers les montagnes et des sentiers pénibles, mais on y
rencontre partout l’olivier, le myrte, le citronnier, l’oranger et,
sous ses pieds, le thym, le romarin, la lavande et la sauge, que la
nature a semés dans des déserts et au milieu des rochers. On y voit
du même coup d’œil tout ce que la nature a de plus sauvage, et le
luxe des jardins de plus précieux. Dans ces lieux élevés, l’air
semble composé d’aromates et de parfums. On a, sur la tête, un ciel
resplendissant d’azur, un soleil aussi brillant que dans les plus
beaux jours d’été..."


D’où vient-il, à quoi sert-il, remplace-t-il du
sable...
8 questions pour tout savoir sur le célèbre
galet de Nice
Les plages de Nice ont reçu leur quota de galets printanier: 5.350
m3 achetés en Provence et répartis le long du littoral pour protéger
le trait de côte.
Et s’ils n’étaient pas là, à quoi ressemblerait la grève ?
Chaque printemps, c’est le même refrain géologique: on engraisse les
plages niçoises. Cela veut dire que la Métropole Nice-Côte d’Azur,
gérant l’environnement, remet une bonne couche de galets pour
combler les coups de mer de l’hiver et l’érosion naturelle. Deux
phénomènes engloutissant de grandes quantités de ces cailloux
devenus l’emblème gris et lisse du littoral de la baie des Anges,
entre Rauba-Capeù et Carras.
À Nice, le galet fut, est, sera.
Pour tout savoir sur cette pépite roulée, usée, polie par les
rivières, nous avons interrogé deux experts : Richard Chemla,
adjoint au maire délégué à la Transition écologique et énergétique,
et Rémi Dumasdelage, chef du service études et travaux à la
direction des activités portuaires et maritimes de la Métropole.
Aux années 60. D’une année sur l’autre, on perd environ 6.000m3 de
galets. Cette saison, 5.350m3 de galets de 2 à 8cm de diamètre ont
été répartis sur les plages de Nice. L’opération, commencée le 10
mars au niveau de la rampe de la plage du Centenaire, s’est terminée
le 24 mars à Carras. Restait alors à aplanir, niveler correctement
le sédiment sur 4,5km afin de dégager les infrastructures
d’arrière-plages et de faciliter l’accès à l’eau. Une tâche
effectuée par un bulldozer et une pelle mécanique, qui peuvent
intervenir à nouveau en été.
D’où viennent les galets ?
La majeure partie (4.000m3) provient des Alpes-de-Haute-Provence, le
reste des Hautes-Alpes. On privilégie les galets issus des carrières
locales afin de favoriser le circuit court. Une majorité est issue,
en effet, d’une carrière proche du fleuve Var. Ces galets se
seraient donc retrouvés, à terme, à l’embouchure du fleuve.
Depuis qu’il a été assaini et a fait l’objet d’opérations de curage
pour amoindrir le risque d’inondation, le Paillon n’a plus de galets
en quantité suffisante.
Comble-t-on de manière égale partout ?
Non. Des relevés topographiques ou par drone sont organisés pour
estimer la quantité nécessaire à recharger et cibler les zones les
plus touchées.
On engraisse selon le retrait du trait de côte, que l’on recrée de
façon harmonieuse.
Quel est le coût de l’opération ?
Entre 70 et 80 euros le m3, prix comprenant extraction, lavage,
criblage, transport…
Et si on n’engraissait pas, qu’adviendrait-il ?
On aurait des creux, des trous très importants et donc une atteinte
sévère de la bordure de la promenade des Anglais, qui pourrait
potentiellement être victime de submersions marines. La plage agit
comme un ouvrage de protection et permet de faire déferler les
vagues le plus loin possible du mur perré de la Prom’. Se rajoutent
à ce dispositif une dizaine d’épis rocheux, dont le rôle est de
casser les plus grosses vagues. Eux aussi sont vérifiés avant l’été.
En outre, comme on plonge rapidement au bord de mer, on replace des
cordes – très prisées des seniors – pour sortir aisément de l’eau
sur cinq plages: Ponchettes, Beau Rivage, Centenaire, Blue Beach,
Sainte-Hélène.
Les galets sont-ils là depuis toujours ?
Oui. C’est un vieux processus géologique. Il s’agit d’un cordon de
galets existants depuis très longtemps de par les fleuves Var et
Paillon. On les retrouve d’ailleurs dans nos vallées avec les zones
de poudingue, roche constituée de cailloux, dont les galets, liés
entre eux par un ciment naturel. À l’époque où l’embouchure du Var
n’était pas fermée par l’aéroport, ces galets arrivaient sur les
plages. On retrouve, très loin sous l’eau, le tracé des rivières. À
Nice, le plateau continental fait de 150 à 200m. Après, on descend
immédiatement dans les grands fonds pouvant plonger à 1.500m. Les
galets se projettent sur les 150 premiers mètres.
Et s’il n’y avait pas de galets à Nice ?
Difficile de répondre. Le galet est naturel. Originel. Dans les
temps reculés, le niveau de l’eau était beaucoup plus haut sur la
plage.
Sous les galets ? Du sable. On le voit lors des coups de mer: le
sable est soulevé par les déferlements et recouvre la plage. Les
galets sont alors dessous. Et lorsque le sable sèche, il s’infiltre
et les galets réapparaissent.
Pourquoi n’y a-t-il pas de sable comme à Juan-les-Pins ou Cannes
?
Parce qu’ici, on n’a pas les mêmes rivières.
À Nice, nos fleuves érodent du poudingue qui charrie des galets. À
l’ouest du département, les sédiments sont sablonneux.
Il reste encore du sable naturel vers La Bocca, mais le sable de la
Croisette est importé.
Et puis, c’est mieux ainsi, car les galets sont plus hygiéniques
:
on se débarrasse plus vite des parasites!
De 717 millions à 59 millions d'euros: comment
la Métropole a fait fondre le budget de la tempête Alex
Nice Matin - Antoine Louchez
Contrairement à ce que soutient la Métropole Nice Côte d’Azur,
les budgets alloués à la reconstruction des vallées ont fondu entre
2022 et 2023. Quelques mois avant Aline.
Oui, la Métropole Nice Côte d’Azur a bien raboté les budgets alloués
à la reconstruction post-tempête Alex en 2023, quelques mois avant
Aline. Beaucoup. Malgré les alertes en interne sur les risques que
ça comportait.
La colère de certains habitants et élus de la Vésubie couvait depuis
des mois, depuis l’arrêt de nombreux chantiers menés et promis par
la Métropole. Jugés prioritaires. Elle a explosé le 20 octobre,
lorsque la tempête Aline a emporté des ouvrages laissés en friche.
La faute à l’ampleur de cette nouvelle catastrophe climatique, selon
Christian Estrosi, mais aussi, et surtout, aux procédures imposées
par le droit et l’État qui bloquaient les travaux. Ainsi qu’aux
enquêtes ouvertes pour détournement de fonds publics par le parquet
de Nice en avril. Mais surtout pas à l’état des finances de sa
puissante Métropole, comme le dénoncent des opposants de droite et
de gauche.
"Des enjeux sécuritaires en cas d’intempéries"
Et puis, il y a les documents. Notamment cette note, évoquée jeudi
en conseil métropolitain par la Ciottiste Christelle d’Intorni, que
Nice-Matin a également pu consulter. Dans ce document interne à la
Métropole, daté du 9 novembre 2022, il est question du budget
tempête Alex, pour la période 2023-2026.
Les fonctionnaires écrivent au directeur général des services (DGS)
de l’époque, Olivier Breuilly, alarmistes sur les contraintes
budgétaires. Ils affirment avoir proposé trois scénarios pour ces
quatre années: un budget à 146,3 millions d’euros, un autre à 123,2
millions et un à 91,3 millions "pour ne réaliser que les opérations
jugées prioritaires". Le minimum vital, selon eux.
Le DGS, lui, n’accorde qu’une enveloppe de 50 millions d’euros. Ce
qui "nécessiterait alors des arbitrages politiques assez lourds
compte tenu du volume de travaux jugés prioritaires qui ne seraient
pas réalisés, menacent ses subordonnés. Avec des enjeux sécuritaires
et de préservation de certains ouvrages réalisés qui ne seraient pas
complètement assurés en cas d’intempéries importantes." Avant de
lister les chantiers à réaliser, coups de rabot compris, et ceux à
mettre de côté.
Le budget passe de 717 millions d’euros à... 59 millions d’euros
Cette note du 9 novembre a forcément évolué. Dans quel sens ? "La
Métropole n’a pris aucune décision visant à réduire le budget dédié
à la reconstruction des vallées", affirme la collectivité. En
dépit de ses propres documents. Le 11 mars 2022, le conseil
métropolitain prévoyait de dépenser 717,3 millions d’euros pour 2023
- 2026 (dont 65 millions pour 2023).
En mars 2023, quatre mois après la note interne, les élus votent
finalement un budget de… 59,5 millions d’euros pour ces quatre
années (dont 27,43 millions pour 2023). Un montant très proche de
celui évoqué dans la note. "Le budget de la tempête Alex est en
diminution, bien sûr, avait déclaré le maire de
Saint-Martin-Vésubie. Mais je pense que c’est normal puisque
depuis deux ans et demi nous avons quand même été pas mal soutenus".
Le projet d’un tunnel à 400 millions d’euros pour relier la Vésubie
à la Tinée avant les gorges de Paganin, envisagé pour 2026, est
passé à la trappe. Avec quels autres arbitrages ?
Les 80 millions d’euros "d’affichage"
Depuis les dégâts d’Aline, Christian Estrosi répond à l’explosion de
la polémique avec un autre chiffre: 80 millions d’euros. Comme il
l’a fait en conseil métropolitain, jeudi :
"En septembre, avant la tempête Aline, il a été décidé de créer
une affectation spécifique à la reconstruction de la vallée de la
Vésubie, dotée de 80 millions d’euros, permettant de couvrir les
travaux restant à réaliser."
Cette décision, datée du 29 septembre, n’attribue pourtant pas de
financements. "Ils ont modifié l’autorisation de programme, mais
pas les crédits de paiements, traduit l’élu d’opposition
écologiste, Jean-Christophe Picard. Ils ont modifié le plafond de
ce qu’ils veulent dépenser mais pas le chéquier. C’est de
l’affichage."
À l’heure actuelle, le budget est donc toujours officiellement de 59
millions d’euros alloués jusqu’en 2026.


"Il faut siffler la fin de la partie": contre
le béton et la spéculation, le préfet des Alpes-Maritimes veut
"redonner sa place à l’agriculture" dans la plaine du Var
Nice Matin - Rafael Perrot - Sébastien Bottella

Le préfet Moutouh
entend bien "redonner sa dimension agricole à la plaine du Var
"
Depuis dix ans l’établissement public d’aménagement applique un
référentiel qualité aux constructions de l’Ecovallée pour "concilier
développement et environnement".
Depuis près de dix ans et le lancement de l’opération d’intérêt
national (OIN) de Nice-Ecovallée, ce sont surtout les grues et les
immeubles qui ont poussé dans la plaine du Var. En marge de l’OIN,
un comité de pilotage avait pourtant été constitué, dès 2013, afin
de préserver l’agriculture sur ces terres "les plus fertiles du
département ". Durant près d’une décennie, les experts de ce groupe
de travail ont beaucoup expertisé... Mais peu agi.
Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes le reconnaît: "Au cours de
ces 10 ans, beaucoup d’études ont été produites. Elles nous ont
permis d’acquérir une connaissance fine des zones à intérêt pour
l’agriculture. Mais il faut reconnaître que l’État n’a pas vraiment
pris l’initiative en la matière. Nous n’avons pas beaucoup bougé",
concède Hugues Moutouh avant d’annoncer que ce temps-là est révolu.
Traque aux détournements d’usage
"Celui de l’action est arrivé ", prévient-il avec le ton
direct qui le caractérise: "Il y a un moment où il faut siffler
la fin de la partie, rappeler les règles et utiliser la boîte à
outils qui est à notre disposition pour agir ". Le préfet
Moutouh entend bien le rappeler aux collectivités concernées lors du
prochain comité de pilotage, le 5 décembre. Mais aussi aux
propriétaires privés. Tout au moins ceux qui "trop souvent "
s’arrogent le droit de "détourner l’usage" de ces terres à
vocation agricole. "Je vais envoyer mes agents de la DDTM,
pénaliser et verbaliser ", promet-il.
Création d’une zone agricole protégée
De sa "boîte à outils", le représentant de l’État dégaine
aussi l’arme administrative de la ZAP. Une zone agricole protégée va
voir le jour. Même si ses contours sont encore à l’étude, elle
devrait inclure une grande partie des 271 hectares de friches
agricoles, répartis sur dix secteurs d’intérêt, identifiés par le
groupe de travail. Hugues Moutouh compte également solliciter la
commission départementale d’aménagement foncier pour trouver des
exploitants et "remettre en culture les terres agricoles incultes
ou sous-exploitées".
Stopper la spéculation, pas le développement
Pour que ces terres fertiles ne succombent pas "à la spéculation
immobilière" au détriment d’enjeux que le nouveau préfet des
Alpes-Maritimes estime supérieurs. Comme celui de
l’artificialisation des sols ou encore de l’autosuffisance
alimentaire "qui est ici bien malmenée". "Notre taux
d’autonomie est de 1%, autant dire rien du tout ",
souligne-t-il. Alors que la remise en cultures des friches de la
plaine du Var "pourrait alimenter en légumes de l’ordre de 25.000
familles".
Bref, le préfet Moutouh entend bien "redonner sa dimension
agricole à la plaine du Var "... Et stopper du même coup son
aménagement foncier ? Pour le représentant de l’État "les deux ne
sont pas incompatibles". "Ce ne sont pas les mêmes surfaces
qui sont concernées. Les terres agricoles que nous avons identifiées
sont plutôt dans la partie nord de la vallée et en rive droite,
alors que celles visées par l’EPA sont en rive gauche."
Un établissement public d’aménagement qui, rappelle-t-il, couvre à
peine 2% des 10.000 hectares du périmètre de Nice-Ecovallée. Sauf
que la spéculation immobilière, elle, avait tendance à s’étendre
bien au-delà. L’État veut donc y mettre un terme et que "les
agriculteurs retrouvent des prix normaux pour des terrains qui
seront désormais clairement identifiés comme réservés à
l’agriculture".
L'Ecovallée tire son bilan environnemental
"Concilier développement et environnement c’est toute l’ambition
du projet d’opération d’intérêt national Nice-Ecovallée",
martèle Xavier Latour, le président de l’établissement public
d’aménagement qui depuis 15 ans préside aux destinées foncières de
la basse vallée du Var. Certains n’y voient qu’une "bétonisation"
de ces anciennes terres agricoles. Xavier Latour assure que l’OIN a,
au contraire, mis un terme à "l’artificialisation massive" et
à "l’urbanisation anarchique" qui a prévalu des années
cinquante aux années quatre-vingt-dix.
10 ans de référentiel qualité
À cette époque, avance-t-il, ce sont "90 hectares par an" qui
disparaissaient en moyenne chaque année. Dix fois moins depuis le
lancement de l’opération d’intérêt national en 2008. Une opération
d’aménagement qui se voulait écoresponsable. C’est pourquoi dès
2013, un référentiel qualité a été mis en place. Il est devenu
obligatoire en 2019 pour toutes les constructions dépassant 500m2 de
surface de plancher. Dix ans après l’EPA en tire un bilan positif.
Ce sont plus de 200 projets qui ont été accompagnés dans le cadre de
ce référentiel qualité. Soit un million de mètres carrés créés au
total. Mais pas que du béton, puisque ces programmes immobiliers
intègrent en moyenne 40% d’espaces végétalisés dès leur conception,
350.000m2 en pleine terre et 100.000m2 secondaires.
Tous ont recours aux énergies renouvelables pour couvrir plus de 50%
de leurs besoins et affichent pour 80% d’entre eux des performances
énergétiques supérieures aux normes en vigueur. Pour leur
construction ce sont 3.400 tonnes de matériaux biosourcés,
l’équivalent de 116 rames de tramway, qui ont été utilisés.
Les déchets de ces chantiers ont été recyclés à hauteur de 85%,
contre 50% en moyenne nationale. Ils ont permis d’économiser 40%
d’eau, assure encore l’EPA qui a présenté un bilan très vert de son
action depuis 10 ans dans la plaine du Var.

Le référentiel qualité de l’aménagement de l’Ecovallée a tiré son
bilan environnemental. (Photo E. G.).


L'histoire du splendide casino municipal

C'est aujourd'hui le miroir d'eau de la promenade du Paillon.
Hier, quand la coulée verte n'était pas encore
un embryon d'idée, une esplanade sans charme mais prisée des
skateurs.
Et avant-hier ?
C'est un temps que les moins de 50 ans ne
connaissent qu'en photo. Là s'est dressé, pendant un siècle, un de
ces bâtiments disparus qui ont fait la renommée de Nice: le casino
municipal.
Son histoire commence quelques années après le
rattachement du comté de Nice à l'Empire de France. Fin des années
1870: le maire Alfred Borriglione veut poursuivre la couverture du
Paillon, entamée une décennie plus tôt. Mais les travaux envisagés,
de la place Masséna à la mer, coûtent cher. Un promoteur propose
d'en assumer les frais à condition d'y édifier un casino. La
bâtisse, majestueuse, est inaugurée en 1884.

Outre les jeux d'argent, le bâtiment (qui
dissimule, à l'ombre d'une verrière, un somptueux jardin d'hiver)
abrite plusieurs salles de spectacle accueillant banquets, récitals,
concerts, représentations théâtrales, projections
cinématographiques…
En 1939, des travaux extérieurs sont entrepris: la
toiture est démolie, les ornements disparaissent et la façade est
peinte en rose pour l'accorder à l'environnement. Mais l'endroit ne
retrouve pas son lustre d'antan.
En 1969, le casino ferme.
Dix ans plus tard, il est détruit par le maire
Jacques Médecin qui envisage de construire à sa place un palais des
congrès... finalement bâti quelques centaines de mètres plus loin,
sous le nom d'Acropolis.


Une nouvelle ligne de bus pour desservir le
Vieux-Nice
Nice Matin - Claire camarasa - Cyril Dodergny

Une nouvelle ligne de bus, la 98, va voir le
jour à compter du 4 décembre. Elle reliera La Réserve au Vieux-Nice,
en passant par le port de Nice.
La ligne 98 sera en circulation à partir du 4décembre prochain.
Elle reliera La Réserve au Vieux-Nice, en
passant par le port de Nice
Faire le tour du Vieux-Nice en bus sera désormais possible à compter
du 4 décembre. Pour remédier à une ligne 38 jugée trop longue par
les usagers, la Ville lance la ligne 98.
En effet, lors d’une enquête publique, les usagers de Lignes d’azur
ont été plus de 1.000 à s’exprimer pour la modification de cette
ligne qui s’étendait de La Réserve aux Baumettes et qui n’était pas
utilisée sur toute sa traversée.
"C’est une décision issue du dialogue avec nos administrés du
quartier des Ponchettes, souligne le maire de Nice, Christian
Estrosi. Une seule ligne n’apportait pas toutes les satisfactions
sur les voies de desserte. De cette façon nous rendons des
destinations atteignables en bus mais nous permettons aux habitants
d’être connectés avec l’ensemble du réseau et notamment les lignes 1
et 2 du tramway."
Un bus toutes les 15 minutes
La ligne 98 partira donc de La Réserve pour rejoindre le port. Elle
longera ensuite le bord de mer en passant par Rauba Capeù, le cour
Saleya pour tourner direction Albert-1er. Elle longera le Vieux-Nice
jusqu’à la place Garibaldi pour retourner au port et finir à La
Réserve.
La ligne sera composée de trois minibus électriques qui passeront
toutes les 15 minutes entre 6h28 et 21h06. Les tarifs seront ceux
appliqués à l’ensemble des bus de la Métropole Nice Côte d’Azur,
soit 1,70 euros par voyage.
Qui dit nouvelle ligne, dit nouveaux arrêts. Le parcours desservi
par la ligne 98 en comportera quatre situés après l’arrêt du port de
Nice: Monument aux Morts, Château-Tour Bellanda, Saleya et Sulzer.
La ligne 38 conservée
La ligne 38 ne disparaît pas pour autant. Cette dernière aura un
itinéraire réduit entre les Baumettes et Jean-Médecin pour mieux
respecter les usages de ceux qui empruntent la ligne.
"Elle ne donnait pas satisfaction, précise Gaël Nofri,
président de Régie Ligne d’azur et adjoint délégué aux Transports, à
la Circulation et au Stationnement. Nous avons choisi de
renforcer la desserte du quartier des Musiciens ainsi que les
squares Durandy et Wilson." La fréquence des bus sera inchangée,
tout comme ses tarifs.
.


Prolongation de la voie Mathis à Nice: une
étape stratégique a été franchie
Nice Matin - Eric Galliano - Photo Patrice Lapoirie
Une étape stratégique a été franchie dans le chantier de la
sortie ouest de la voie Mathis à Nice: le passage de la trémie sous
les rails du tramway.
On vous en dit plus alors que Christian Estrosi a fait visiter ce
chantier tant attendu par les usagers de la route.

La prolongation de la voie Mathis, à l'ouest de Nice, le mercredi
22 novembre 2023. Le chantier est passé sous les rails du tramway
"Nous avons franchi les étapes les plus complexes et les plus
difficiles de ce chantier." Par 12 mètres sous le niveau de
l’avenue Giscard-d’Estaing, au ras du radier sur lequel sera coulé
dans quelques mois le bitume de la nouvelle sortie ouest de la voie
Mathis (SOVM), Christian Estrosi ne cache pas sa satisfaction. Et
peut-être, aussi, un peu de soulagement.
Le maire de Nice a effectué une visite d’étape, ce mercredi 22
novembre, sur le chantier de cet équipement majeur. "L’un des
plus attendus par les Niçois qui, depuis 2008, le place en tête de
leurs priorités dans les enquêtes d’opinion que nous réalisons
régulièrement ", assure-t-il. Mais pour fluidifier la sortie
Grinda où viennent butter chaque jour 35.000 véhicules il a d’abord
fallu percer un tunnel de 850 mètres qui passe sous les rails du
tramway. Cela s’est fait sans interruption de service ou presque.
"Mise en service fin 2024"

Christian Estrosi, visite le chantier du raccordement de la voie
Mathis à l'autoroute A8, à Nice, le mercredi 22 novembre 2023
"Le défi de ce chantier a consisté à dévier la voie de tram’ en
un temps record, c’est-à-dire en un week-end, une première fois en
septembre 2021 avant de le rebasculer sur son tracé initial en
juillet 2022 ", détaille Laure Erbisti, cheffe du projet SOVM
pour la Métropole. Dans l’entre-deux, des parois moulées et une
épaisse dalle de béton ont été coulées sous la ligne pour en
soutenir l’assise. Pour éviter les remontées d’eau dans cette zone
alluvionnaire du Var, les ouvriers ont également eu recours à une
technique très particulière. Celle du "jet grounting" qui
consiste à injecter un bouchon de béton pour sécuriser et stabiliser
le fond de fouille.
C’est donc choses faites. Ces étapes stratégiques franchies, le
maire de Nice promet une mise en service dès "fin 2024 ".
Raccordement à l’A8: "Pas avant 2027 ou 2028"

Le chantier du raccordement de la voie Mathis à l'autoroute A8, à
Nice, le mercredi 22 novembre 2023
Au premier semestre de l’année prochaine les aménagements de surface
vont pouvoir débuter. Le transfert d’une partie du trafic dans cette
nouvelle trémie souterraine va permettre de réduire le nombre de
voie de circulation en surface. Elles seront remplacées par des
espaces verts : 150 arbres, 10 000 arbustes et 2 500 m2 de gazons et
sols perméables vont être implantés le long de l’avenue
Giscard-d’Estaing.
Cette "verdisation" combinée à la fluidification du trafic
permettra, assure Christian Estrosi, "d’améliorer de 30 % la
qualité de l’air dans le quartier en réduisant 60 000 tonnes les
émissions de CO2 ". Notamment grâce à la suppression des feux
rouges entre l’avenue Grinda et l’entrée de l’autoroute qui
devrait faire gagner "entre 4 et 9 minutes de temps de parcours"
aux usagers du futur tronçon.
À terme cette nouvelle sortie ouest de la voie Mathis doit se
raccorder directement à l’A8. Même si cette "deuxième phase"
est actée, reste à savoir quand elle sera réalisée. "Pas avant
2027 ou 2028 ", a annoncé, ce mercredi, Christian Estrosi.
.


À quoi va ressembler, en 2028, Nice-Aéroport,
la première "gare bioclimatique" d’Europe
Découvrez les images
Nice Matin - Joëlle Deviras
Point de convergence de tous les transports en commun et
véhicules individuels, la future gare Nice-Aéroport est conçu pour
tendre à autosuffisance énergétique. On vous explique tout
Une immense canopée triangulaire truffée de capteurs
photovoltaïques, 4.200m2 de jardins avec 90 arbres et 300 arbustes
méditerranéens, des espaces aérés pour une ventilation naturelle...
La gare Nice-Aéroport, anciennement Nice Saint-Augustin, qui
s’étendra sur 4.000m², s’apprête à faire sa mue pour devenir "la
première gare bioclimatique d’Europe", selon les termes du maire
de Nice, également président de la Métropole et président délégué de
la Région PACA, accompagné de la directrice générale de SNCF Gares
et Connexions.
Et lundi, Christian Estrosi et Marlène Dolveck ont dévoilé la
maquette de ce complexe architectural multimodal qui sera livré en
2028.
À pied, en tram’ ou à vélo
Christian Estrosi a souligné que, de la Gare Nice-aéroport, seront
connectés pistes cyclables, tramways, bus, cars et parkings relais.
Sont également prévues 700 places de stationnement voitures et 900
places de stationnement pour les vélos. À 200mètres de l’aéroport
Nice Côte d’Azur, le quartier du Grand Arénas dessiné par François
Leclercq est pensé pour conjuguer tous les modes de transports.
Une gare "bioclimatique", c’est quoi ?
"C’est avant tout une gare-jardin avec des espaces de pleine
terre où la pluie va être récupérée", souligne Raphaël Ménard,
architecte et président de l’AREP, filiale de la maîtrise d’œuvre de
SNCF Gares et connexions. "Les toitures qui ne sont pas
solarisées vont récupérer les eaux pluviales. Et sur la canopée,
l’eau sera récupérée par de grands chéneaux. La surface est composée
de plusieurs couches avec d’abord un système de production solaire
en couverture composé de panneaux photovoltaïques et de membranes
transparentes. En dessous s’appuiera une structure en acier. Puis un
tressage de bois fera le filtre lumineux."
600mégawatts/heure d’électricité par an seront générés. "Peut-être
que l’on arrivera à ce que cette gare soit autosuffisante. C’est le
défi de faire des mobilités à énergie positive."
Marlène Dolveck promet
"une neutralité carbone en sept ans."
Pour combien de voyageurs ?
En déplaçant la gare Saint-Augustin de 500mètres à l’Ouest de Nice,
le nombre de voyageurs est passé de 2.900 à 7.000 par jour. "Nous
espérons 10.000 à 12.000 passagers quotidiennement dès 2028",
souligne Christian Estrosi.
Prochaine étape
En janvier 2024, la gare routière sera livrée pour les bus de la
Métropole et de la Région.
Ringard la gare ?
"Tout le monde s’accorde à dire que le ferroviaire est une
réponse à l’urgence climatique car le train est un moyen de
transport décarboné,
a noté Marlène Dolveck. Nous avons voulu
une gare Nice Aéroport qui donne envie d’être fréquentée avec de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 1.500m2 de
service et de commerces et 600m2 de salle d’attente."

Une immense canopée solarisée doit protéger "naturellement" de la
pluie et du soleil


Où aller skier à la journée et à quel prix cet
hiver dans les Alpes-Maritimes ?
Écrit par Juliette Pommier

Les remontées mécaniques à la station d'Auron attendent les
skieurs (Archives) • © ERIC OTTINO / MAXPPP / Nice-Matin
Plus que quelques semaines avant l'ouverture de la saison de ski
2023-2024. Pour profiter au maximum des pistes, France 3 Côte d'Azur
fait le point sur les tarifs à la journée dans les stations des
Alpes-Maritimes.
Ski alpin, marche nordique, course de luge ou randonnée en
raquettes. Les aficionados de la montagne en hiver vont bientôt
pouvoir retrouver les pistes enneigées des stations des
Alpes-Maritimes.
Et il y a de quoi faire : 460 km de pistes de ski alpin et 153 km de
pistes de ski de fond. Cette année, la haute saison devrait
s'étendre du samedi 23 décembre au samedi 6 janvier 2024, puis du
samedi 10 février au samedi 3 mars 2024.
La basse saison est prévue entre l'ouverture de la saison et le
vendredi 22 décembre 2023, puis du dimanche 7 janvier au vendredi 9
février 2024, et du dimanche 10 mars 2024 à la fin de la saison. À
quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2023-2024, France 3
dresse la liste des offres à la journée proposées par les stations
du département.

La station Isola 2000 ouvrira ses portes le 2 décembre prochain.
Ici en 2022. • © Frantz Bouton - Nice Matin - MaxPPP
Isola 2000
Située à 1800 m d'altitude, la station ouvrira ses portes à partir
du 2 décembre prochain. Elle dispose de 7 pistes vertes, 22 pistes
bleues, 13 pistes rouges et 3 pistes noires. Pour y accéder, les
skieurs pourront souscrire, entre autres, à un forfait journée.
Compter 40 € par adulte (26 à 61 ans) ; 33,60 € pour les seniors (62
à 71 ans), les jeunes (18 à 25 ans) et les adolescents (12 à 17 ans)
; 30,70 € pour les enfants de 5 à 11 ans. Les enfants de moins de 5
ans et les personnes de 72 ans et plus pourront accéder gratuitement
aux pistes.
Tous les skieurs devront s'acquitter des frais de vignette assurance
ski, soit 3,50 € par jour et par personne. Plus d'informations à
retrouver sur le
site web de la station.
Valberg - Beuil
Installée à moins d'une heure quinze de Nice, la station Valberg
propose 65 km de pistes, de 1700 m à 2100 m. Au total, elle compte 7
pistes vertes, 6 pistes bleues, 24 pistes rouges et 5 pistes noires.
À partir du 16 décembre, les skieurs pourront venir profiter de leur
forfait jour.
Tarifs : 37 € pour les adultes (16 à 61 ans), 18,50 € pour les
adolescents (5 à 15 ans), 29,50 € pour les étudiants et les seniors
(62-69 ans) sur justificatif, gratuit pour les moins de 5 ans et les
plus de 70 ans.
Précision : un forfait offert pour un forfait acheté sur les
forfaits journée, du lundi au vendredi, hors vacances scolaires.
Turini Camp d'Argent
Nichée à 1920 m d'altitude, la station de Turini Camp d'Argent
propose aux skieurs 3 km de piste (1 verte, 2 bleues, 1 rouge).
Côté tarifs, les adultes devront débourser 14 € pour un forfait jour
; les moins de 18 ans, les étudiants et les seniors de plus de 63
ans bénéficieront d'un tarif réduit à 11 € ; les enfants jusqu'à 3
ans et les seniors de plus de 73 ans pourront accéder gratuitement
aux pistes de ski.
La Colmiane-Valdeblore

La station de Colmiane-Valdeblore ouvrira ses portes le 2 décembre.
Les skieurs pourront profiter des 30 km de pistes de la station : 5
pistes vertes, 6 pistes bleues, 8 pistes rouges et 2 pistes noires,
de 1400 m à 1800 m d'altitude.
Compter 25 € pour les adultes (à partir de 18 ans) ; 21€ pour les
étudiants, les 12-17 ans et les seniors ; 19 € pour les enfants de 5
à 11 ans ; 12,50 € pour les débutants (accès limité au TK du Col et
TK Banane) ; 18€ pour une personne avec une carte d’invalidité ; 11
€ pour le Handiski et Handiski accompagnant.
L'accès aux pistes est gratuit pour les moins de 5 ans et les plus
de 72 ans, sur justificatif.
Auron

À la station d'Auron, la saison d'hiver commencera le 9 décembre
Au programme, 135 km de pistes, de 1600 m à 2450 m : 3 pistes
vertes, 17 pistes bleues, 15 pistes rouges et 8 pistes noires.
Le forfait jour s'élève à 40 € pour les adultes de 26 à 61 ans ;
33,60 € pour les seniors de 62 à 71 ans, les jeunes de 18 à 25 ans,
et les adolescents de 12 à 17 ans ; 30,70 € pour les enfants de 5 à
11 ans.
L'accès aux pistes est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et
les adultes de 72 ans et plus. À noter : aucun forfait ou abonnement
ne sera remboursé.
Si les skieurs n'ont pas de Carte Neige, ils devront payer une
assurance journalière, d'un montant de 3,50 € par personne et par
jour. Pour plus d'informations,
cliquer ici.
Roubion - Les Buisses

Ouverture prévue le 16 décembre.
La station Roubion - Les Buisses propose 30 km de pistes de ski (2
vertes, 5 bleues, 12 rouges et 2 noires), entre 1410 m et 1920 m
d’altitude.
Pour les adultes, l'accès aux pistes coûte 20 € en caisse et 18 € en
réservant au préalable sur internet. Pour les enfants (moins de 12
ans), les tarifs sont de 15 € en caisse et 14€ par internet.
Pour les étudiants, les familles nombreuses et les détenteurs de la
"carte vermeil" (de 62 à 70 ans), la station propose un tarif unique
à 18 €.
Les moins de 5 ans et les plus de 70 ans peuvent bénéficier de la
gratuité sur présentation d'un justificatif.
Un journal autrichien vient de positionner la station en tête des
sites de ski européens au meilleur rapport qualité/prix devant
notamment Réallon ou Lans en Vercors.
Gréolières-les-Neiges
Le top départ de la saison pour Gréolières-les-Neiges sera le 16
décembre prochain.
Trente kilomètres de pistes, de 1400 m à 1800 m d'altitude (4 pistes
vertes, 4 pistes bleues, 14 pistes rouges et 2 pistes noires).
Pour la saison 2023-2024, le forfait jour s'élève à 25 € pour les
adultes et 18 € pour les moins de 12 ans.
Les moins de 5 ans et les plus de 75 ans peuvent accéder
gratuitement aux pistes.
L'Audibergue - La Moulière
Pour l'Audibergue - La Moullière, la saison des sports d'hiver
débutera le 7 janvier 2024 (selon la météo).
Située à 1642 m d'altitude, la station offre aux skieurs 27 km de
pistes de ski : 7 pistes vertes, 5 pistes bleues, 10 pistes rouges
et 1 piste noire.
Le forfait jour est de 18€ par adulte, 15€ par enfant (moins de 12
ans) et gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.


Qui était Catherine Ségurane ?
Réponse en français et nissart pour tout savoir
sur la Frema de Nissa, la femme de Nice
Écrit par Anne Le Hars

Catherine Ségurane. Une héroïne de Nice qui a bien existée.
Depuis 480 ans, cette femme est toujours présente à Nissa, pardon à
Nice. Catherine Ségurane. Qui était cette héroïne locale ? À
l'occasion de la semaine des langues régionales, Cristòu Daurore,
passionné de Nice au point de consacrer sa vie à la promotion de
l'identité niçoise, signe pour France 3 Côte d'Azur un portrait
bilingue de la "femme de Nice".
A Nice, Catherine Ségurane a sa rue, son collège, son monument, la
tribune principale du stade de l'Allianz Riviera, un morceau de son
bastion sur un quai souterrain de tramway et même son billet de
monnaie locale.
Qu'a-t-elle bien pu faire pour devenir un personnage emblématique
de Nissa ?
Elle participa à la défense de la ville en 1543, lorsque qu'elle fut
assiégée par les troupes françaises de François 1ᵉʳ et celles
ottomanes de Soliman 1ᵉʳ, qui dura de juin à septembre. Elle se
battait avec son battoir de lavandière, sur le bastion Sincaire.
Elle représente tous les civils et en particulier les femmes qui se
battirent pour Nissa.
Un premier monument lui fut dédié à la porte
Pairolière, à la fin du 16e siècle.

Ce bas-relief lui rend hommage à Nice

Que représente ce monument ?
Une femme portant une robe, avec une ceinture de tissu et un
tablier. Elle a dans sa main droite un battoir et dans sa main
gauche un drapeau ottoman, arraché à un janissaire ennemi.
Il est écrit en dessous, en nissart (graphie de Rancher) :
A Catarina Segurana eroina nissarda
Lou coumitat dei tradissioun nissardi
a elevat acheu mounumen per souscrissioun publica
moussu Peire Gautier essen mera de Nissa
siege de Nissa 15 aoust 1543. Inaugurassioun dou mounumen 25
nouvembre 1923
Traduction :
À Catherine Ségurane héroïne niçoise - Le comité des traditions
niçoises a élevé ce monument par souscription publique. Monsieur
Pierre Gautier étant maire de Nice. Siège de Nice 15 août 1543.
Inauguration du monument 25 novembre 1923
Qui était-elle ?
Elle était mariée car Segurana est un nom d'épouse, son mari
s'appelait Seguran et à cette époque les épouses portaient le nom de
famille du mari avec la marque de féminisation du nom, en y ajoutant
la lettre A.
Elle était lavandière, ce qui signifie qu'elle lavait le linge dans
l'eau du Paillon.
Nous n'avons pas son état civil qui disparut,
comme de nombreux documents à cette époque, c'est pour cela que
certains historiens contestent son existence. Cependant,
Jean-Philippe Fighiera vient de publier le livre "Apologie de
Catherine Ségurane" qui répertorie une grande partie des écrits
la concernant et justifie sa réalité.
Une exposition lui est dédiée au Musée Masséna, visible jusqu'au 7
janvier 2024, intitulée "Héroïque Catherine Ségurane. Figure
légendaire de Nice".

Pourquoi l'honorer encore aujourd'hui ?
Segurane est devenue un symbole fort de Nissa, nous nous faisons
appeler Segurans, enfants de Catarina. Elle représente la
résistance, le courage, la force, la fierté, la femme ...
Le samedi 25 novembre, un moment sera organisé pour fêter le 100 ans
de la construction de la stèle par le Comité des Traditions
Niçoises, grâce à une souscription publique.
Menica Rondelly, qui a écrit l'hymne Nissa la bella est un des
initiateurs de ce monument et de cette association. D'autres
associations s'associent à cet anniversaire comme la República de
Nissa, la Remembrança Nissarda, Nissa Pantai, lou Caïreu Niçart, la
Ciamada Nissarda, Nice La Belle, l'Acadèmia Nissarda et d'autres.
Version en Nissart
A Nissa, Catarina Segurana a la sieu carriera, lo sieu collègi,
lo sieu monument, la tribuna principala de l'estadi de l'Allianz
Riviera, un tròç dau sieu bastion sus una riba sotrana dau trambalan
e finda lo sieu bilhet de moneda locala.
Cen qu'a ben poscut far per devenir emblemàtica de Nissa ?
Participèt a la defensa de la vila en lo 1543, quora siguèt
assediada dai chormas francesi de Francés 1ᵉʳ e aqueli otomani de
Soliman 1ᵉʳ, que durèt de junh a setembre.
Si batia emé la sieu massòla de bugadièra, sus lo bastion Cinc
caires.
Representa toi lu civils e en particular li fremas que si batèron
per Nissa.
Un promier monument li siguèt dedicat a la poarta Pairolièra, a la
fin dau sècolo setze.
Aquesto bas-relèu que li rende omatge a Nissa :
Cen que representa aquesto monument ?
Una frema portant una rauba, emb una talhòla e un faudiu. A dins la
sieu man drecha una massòla e dins la sieu man seneca una bandièra
otomana, arrancada a un janissari enemic.
Es escrich sota, en nissart (grafia de Rancher) :
A Catarina Segurana eroïna nissarda
Lou Coumitat dei Tradissioun Nissardi
a elevat acheu mounumen per souscrissioun publica
moussu Peire Gautier essen mera de Nissa
siege de Nissa 15 aoust 1543. Inaugurassioun dou mounumen 25
nouvembre 1923
Transcrich en nissart, grafia clàssica :
A Catarina Segurana eroïna nissarda
Lo Comitat dei Tradicions Nissardi
a elevat aqueu monument per soscripcion pública
monsur Pèire Gautier essent cònsol de Nissa
assèdi de Nissa, lo 15 d'aost dau 1543. Inauguracion dau monument lo
25 de novembre dau 1923
Cu èra ?
Èra maridada perque Segurana es un nom d'esposa, lo sieu espós si
sonava Seguran e en aquesta epòca li esposas portavan lo nom de
maion de l'espós emé la marca de feminizacion dau nom, en li jonhant
la letra A.
Èra bugadièra, cen que significa que lavava lo linge en l'aiga de
Palhon.
Avèm pas lo sieu estat civil que despareissèt, coma de numerós
documents en aquesta epòca, es per aquò que certans istorians
contestan la sieu existéncia. Pura, Joan-Felip Fighiera ven de
publicar lo libre "Apologia de Catarina Segurana" que repertòria una
grana part dei escrichs la tocant e justifica la sieu realitat.
Una moastra li es dedicada au Musèu Massèna, da veire fins au 7 de
genoier dau 2024, titolada "Eroïca Catarina Segurana. Figura
legendària de Nissa".
Perqué l'onorar encara encuèi?
Segurana es devenguda un simbòlo foart de Nissa, si fèm sonar
Segurans, enfants de Catarina. Representa la resisténcia, lo
coratge, la foarça, la fiertat, la frema...
Dissabta, lo 25 de novembre, un moment serà organizat per festejar
lu 100 ans de la bastison dau sieu monument dau Comitat dei
Tradicons Nissardi, gràcias a una soscripcion pública.
Menica Rondelly, qu'a escrich l'ímno Nissa la bèla es un dei
iniciators d'aquesto monument e d'aquesta associacion. D'autri
associacions si ligan en aquest anniversari coma la República de
Nissa, la Remembrança Nissarda, Nissa Pantai, lou Caïreu Niçart, la
Ciamada Nissarda, Nice La Belle, l'Acadèmia Nissarda, la Federacion
dei Associacions de la Contea de Nissa e d'autri.
Par Cristòu Daurore


Le mystère du monstre Loch Ness enfin résolu ?
Un spécialiste du lac écossais pense avoir
solutionné l'énigme
Midi Libre - Thomas Lorentz

Le lac du Loch Ness lors des recherches en août 2023
En Écosse, le mystère autour du monstre du Loch
Ness fascine toujours autant et laisse libre cours à l'imagination
de certains.
Au fur et à mesure des années, la présence d'un monstre dans le lac
écossais du Loch Ness a nourri l'imagine du public. Légende ou
réalité ?
Depuis la photographie prise il y a 90 ans, les
hypothèses autour de la légende se multiplient.
Une espèce de silure
Bien que certaines personnes se veulent plus rationnelles et réfute
la présence de créatures dans le lac, d'autres continuent de chasser
ce fameux monstre. C'est le cas de Steve Feltham, qui s'y intéresse
depuis plusieurs décennies. Et ce dernier aurait une explication.
Selon lui, le célèbre Loch Ness Monster ne serait autre qu'un silure
glane, aussi appelé Wels Catfish. Il s'agit de l'espèce de poisson
d'eau douce la plus grande d'Europe, selon The Sun.
Le chasseur explique que ces poissons auraient été introduits dans
le lac au 19ème siècle. "Ils correspondent à la description.
S'ils avaient été introduits à l'époque victorienne, ils auraient
atteint leur maturité dans les années 1930. La population serait en
diminution, ce qui explique le nombre moins élevé d'observations",
a-t-il déclaré.
Une chasse au monstre
Au mois d'août dernier, les chercheurs et les plus passionnés par
cette légende ont lancé la plus importante chasse au monstre
écossais depuis 50 ans, nous apprennent nos confrères de BFMTV.
Drones équipés de scanners thermiques, bateaux avec caméras
infrarouges, hydrophone... Tous les moyens sont dépêchés pour tenter
de percer le mystère qui captive le monde entier depuis des
générations.
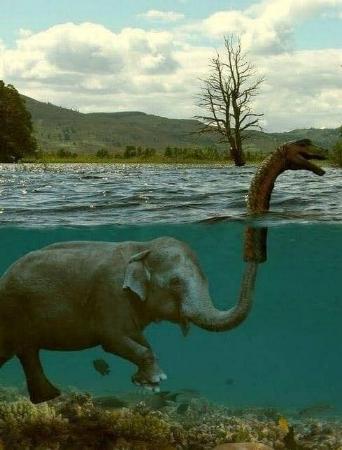
"Notre objectif a toujours été d'enregistrer, d'étudier et
d'analyser toutes sortes de comportements et de phénomènes naturels
difficiles à expliquer ",
explique Alan McKenna, de l'équipe de
recherche bénévole Loch Ness Exploration.


La vraie histoire du "canoun de Miejour ".
On connaît tous la légende: un noble écossais, Sir Thomas
Coventry-More, qui aime déjeuner à heure fixe, une épouse trop
bavarde lors de sa balade matinale, et un coup de canon à midi
pétante pour prier la pipelette de rentrer faire la popotte.
Tout ceci n'est que calembredaine…
"Coventry-More s'appelait seulement Coventry, n'était pas
Écossais mais Anglais, et pas lord ou Sir mais seulement juriste,
rétablissent les historiens Robert Levitt et Judit Kiraly. Sa femme,
héritière d'une grosse fortune, ne préparait pas les repas. D'autant
qu'ils séjournaient à l'hôtel Chauvain, le plus luxueux de la ville
au milieu du XIXe siècle."
Coventry, fondu d'astronomie et de météo, se passionne en réalité
pour la mesure du temps. Finance même un cadran solaire et une
horloge. Verdict : pas assez précis. Alors, le 10 novembre 1861, il
demande au maire (un certain François Malausséna) l'autorisation de
faire résonner un coup de canon à midi pile. Requête acceptée. Reste
alors à établir l'heure exacte. Coventry installe à ses frais une
boule horaire sur la terrasse de l'hôtel.
Et ainsi fut fait... jusqu'en 1867. Le juriste, affaibli, lègue son
matériel à la Ville et meurt deux ans plus tard. Mais les habitants
réclament que sa tradition lui survive : le canoun de Miejour est
devenu un marqueur de la vie de la cité. En 1875, le conseil
municipal cède et en rétablit l'usage.


Les femmes n’étaient pas les bienvenues aux JO
: un parcours à découvrir au Musée national du sport à Nice
Écrit par France Montagne

Le parcours scénographique se présente comme une histoire semée
d’embûches transcendant les époques. Au fil de l’exposition, le
visiteur remonte le temps pour découvrir les combats menés sur plus
de 130 ans. • © FTV
C'est parti pour l'exposition temporaire "les elles des jeux" au
musée national du sport de Nice.
Une exposition consacrée aux femmes
dans les jeux olympiques, de l'antiquité à nos jours, ou pour être
plus explicite de la quasi-exclusion des femmes à la lutte pour la
parité tant souhaitée. Un parcours olympique ! A voir jusqu'au 22
septembre prochain.
Du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août, Paris et la France
accueilleront les 30e Jeux Olympiques d’été, puis du mercredi 28
août au dimanche 8 septembre, les 17e Jeux Paralympiques d’été (sa
flamme passera d'ailleurs par Antibes).
C’est la troisième fois, dans l’histoire olympique, que la France
accueille les Jeux d’été, après ceux de Paris en 1900 et 1924, mais
la première fois qu’elle organise les Paralympiques. La première
fois aussi, que la parité hommes femmes devrait être totalement
assurée. La moitié des 10 500 athlètes engagés devraient être des
femmes. C’est ce qui est annoncé. Des jeux hautement symboliques
donc !
Aujourd’hui cela semble "normal ", pourtant, il a fallu des siècles
pour en arriver là !
Une compétition qui rime avec combat
Les femmes et les Jeux Olympiques ont longtemps noué des destins
contradictoires, voire hostiles. Exclues, de fait, du mouvement
olympique à sa renaissance moderne il y a 130 ans. Ainsi, en 1896, à
Athènes, les femmes n'étaient pas autorisées à participer aux
compétitions, le baron Pierre de Coubertin restant ainsi fidèle à la
tradition des Jeux antiques.
Baron Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes
:
"Les JO doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait
être avant tout de couronner les vainqueurs."
Les propos de ce dernier, qui datent de 1912, sont sans ambiguïté :
"Une olympiade femelle serait peu pratique, inintéressante,
inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est, à mes
yeux, l’adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux
hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les
vainqueurs".
Du néant à la parité, tel pourrait être résumé, pourcentage à
l’appui, la présence des femmes au sein de l’organisation olympique,
que ce soit au niveau des athlètes ou au sommet de la hiérarchie
institutionnelle.
Si on comptait une femme sur dix sélectionnées aux jeux de Berlin en
1936 et seulement encore une sur sept, quarante ans plus tard à
Montréal (1976), depuis deux olympiades elles font quasiment jeu
égal avec les hommes. Mieux, désormais, tous les sports du programme
leur sont ouverts sans exception.
Marie Grasse, directrice générale du Musée national du sport de Nice
: "Cette thématique de société nous apparaissait comme une évidence.
Cette exposition permet de mettre à l'honneur des personnalités,
qu'elles soient célèbres ou non, qui le méritent et qui ont permis
de casser les lignes, par leurs exploits sportifs ou leurs actes
forts."
"Toutes ces pionnières ont chacune leur propre histoire mais toutes
peuvent inspirer les jeunes sportives, qu'elles soient les
championnes de demain ou tout simplement passionnées de sport"
précise Marie Grasse, directrice générale Musée national du sport de
Nice.

Les sportives ont mis des décennies à acquérir, peu à peu, la place
qui leur revient dans le sport en général et plus particulièrement
dans le mouvement olympique. Un parcours longtemps bordé de préjugés
et d’interdictions mais heureusement semé de grandes premières.
C’est ce que retrace, sur plus de 500 m², l’exposition "Les Elles
des Jeux".
Une expo immersive et interactive en 6 actes
Dans une scénographie toute particulière, en forme d'infini, le
parcours de cette exposition retrace plus de 130 ans de notre
société contemporaine à travers les histoires de femmes
emblématiques au destin exemplaire.
Le parcours est divisé en 6 parties découpées à la fois de manière
chronologique et thématique.
Elles ne sont pas les bienvenues
Avec "Elles ne sont pas les bienvenues" l’exposition entame son
voyage dans le temps par les premiers Jeux Olympiques de l’ère
moderne et un petit rappel de l'époque antique, où, non seulement
les femmes n'avaient pas le droit de participer, mais pas le droit
non plus d'être spectatrices !
Elles prennent leur destin en main
Dans "Elles prennent leur destin en main" le chemin se poursuit en
rendant hommage aux femmes, qui depuis un siècle, ont essayé de
jouer un rôle de premier plan dans le monde du sport.
Elles sont à jamais les premières
Des pionnières dirigeantes, comme Alice Milliat créatrice de Jeux
mondiaux féminins en 1922, aux grandes athlètes françaises et
étrangères telles que Christine Caron, Marie-José Pérec, Laure
Manaudou ou plus récemment Clarisse Agbegnenou ou Simone Biles.
Elles sont parvenues, par leur voix ou leurs performances à
s’octroyer toute la place qu’elles méritent dans la grande légende
du sport mondial.
Pour mémoire, Alice Milliat est la première femme dirigeante dans
l’histoire du sport. Cette Nantaise de naissance a vécu en
Angleterre, où elle découvre tant le sport que les revendications
féministes. Elle devient Présidente du "Femina Sport ", le premier
club féminin en 1917.
Elle y ouvre aux femmes la pratique de nombreux sports. Fin 1921,
elle fonde la Fédération sportive féminine internationale et lance
le combat pour donner une vraie place au sport féminin. A l’été
1922, elle organise ses Jeux féminins à Paris et se consacre alors à
essayer de convaincre le CIO d’ouvrir ses Jeux Olympiques aux
femmes.

Anny Courtade qui a fait briller la destinée du Racing Club de
Cannes, en volley féminin, jusqu'au plus haut. Sous sa présidence
(1993-2016), le club devient la meilleure équipe d’Europe (deux
Ligues des champions) et surclasse le volley hexagonal (vingt titres
en championnat et dix-neuf Coupes de France). • © FTV
Hommage particulier, également, à Anny Courtade qui a brillé dans
l’univers sportif en portant la destinée du Racing Club de Cannes,
en volley féminin, jusqu'au plus haut. Sous sa présidence
(1993-2016), le club devient la meilleure équipe d’Europe (deux
Ligues des champions) et surclasse le volley hexagonal (vingt titres
en championnat et dix-neuf Coupes de France).
Elles imposent leurs choix
Outre celui d'être sportive et de vouloir participer aux J.O., autre
argument et non des moindres plaidant en défaveur de la sportive :
l’exposition de son corps et les mouvements supposés inappropriés
qu’elle lui fait subir pour conjuguer l’inconciliable : liberté de
mouvement et convenances révolues.
Ainsi en faisant fi des us et des coutumes vestimentaires ou
réglementaires pour imposer leurs droits quand ne leur demandait pas
l’impossible, voire le pire : être non seulement expertes mais de
rester qui plus est féminine.
Elles imposent leurs choix également pour être libres dans leur vie
privée. En amours ou dans le fait d'être mères. Des histoires
exceptionnelles de celles qui ont osé afficher leurs différences et
leurs audaces sans tenir compte du regard d’autrui. Grâce à ces
pionnières, les sportives dans leur ensemble ont gagné de nombreuses
batailles de manière parfois si exemplaire que leurs luttes ont
servi la cause des femmes au sens large.
Elles font face aux limites du corps
Cette thématique permet d’interroger le visiteur sur un autre
symbole sociétal : la femme doit être belle en toutes circonstances,
se taire et faire fi de sa condition de physiologique de femme !
Pour exemple emblématique, jusqu'en 1969, les sportives étaient
sexuellement contrôlées avec l'exigence d'un certificat de féminité
pour participer aux J.O. ! Outre les soucis d’égalité conjoncturels,
la sportive est au cœur de représentations de beauté et doit
répondre aux normes qui sont celles de son sexe biologique.
Elles nous attendent aux jeux de 2024
La route se termine à Paris où, pour la première fois, 50 % des 10
500 athlètes engagés, originaires de 206 pays, devraient être des
femmes. L’exposition se termine par l’histoire à écrire.
Des chiffres qui ne mentent pas
1896 JO d'Athènes, 14 pays engagés, 0 femme pour 245 hommes
1900 JO de Paris, 28 pays engagés, 27 femmes pour 1121 hommes
1904 JO de Saint-Louis, 12 pays engagés, 6 femmes pour 644 hommes
1908 JO de Londres, 22 pays engagés, 37 femmes pour 1 934 hommes
1924 JO de Paris, 44 pays engagés, 135 femmes pour 2 819 hommes
1936 JO de Berlin, 49 pays engagés, 328 femmes pour 3 738 hommes
1972 JO de Munich, 121 pays engagés, 1059 femmes pour 6 075 hommes
1992 JO de Barcelone, 169 pays engagés, 2704 femmes pour 6 652
hommes
2008 JO Pékin, 204 pays engagés, 4 746 femmes pour 6 282 hommes
2020 JO de Tokyo, 206 pays engagés, 5 409 femmes pour 5 910 hommes
90 : C’est le nombre d’années qu’il a fallu attendre pour qu’une
femme soit élue membre du CIO (Comité International Olympique).
Hé oui, ils l’ont dit !

Parmi les petites phrases lues lors du parcours de l'exposition,
certaines méritent d'être relevées... • © FTV
Parmi les petites phrases lues lors du parcours de l'exposition,
certaines méritent d'être relevées...
En 1922, le journal, "LE FIGARO" publie : "Voilà la leçon du 400 m
cette épreuve terrible pour le corps féminin et qui le rend si peu
aimable. Quelles sont ces furies toutes possédées par une sombre
folie ? Leurs yeux sont hagards, leurs bouches sont crispées et je
préfère ne pas parler de leurs poitrines ... ".
En 1935, Siegfried Edström le président du CIO déclare : "Vous savez
combien Alice Milliat et son mouvement nous a causé de problème, et
je souhaite que toute cette chose disparaisse de la surface de la
terre".
1987, Marc Madiot, cycliste, à Jeannie Longo, cycliste : "Je suis
contre le cyclisme féminin. Une femme sur un vélo, c'est moche"
En 1998, David Douillet : "Pour moi une femme qui se bat au judo ou
dans d’autres disciplines, ce n’est pas quelque chose de naturel, de
valorisant (…) Pour l’équilibre des enfants, je pense que la femme
est mieux au foyer ".
2013, Pierre Ménès, journaliste, à propos des premières
footballeuses : "De grosses dondons qui étaient certainement trop
moches pour aller en boîte le samedi soir."
2018, Denis Balbir, journaliste : "Une femme qui commente le foot
masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter
dans les aigus".
Ce fut long et lent, mais l'évolution est tout de même spectaculaire
même si, évidemment, il reste encore tant à faire !
A vous de vous faire une opinion avec cette exposition, ouverte du
mardi au dimanche, de 10h à 17h (jusqu'en mai), puis de juin à août
tous les jours, de 10h à 18h.
Fermetures annuelles : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
Attention : les jours de match à l’Allianz Riviera, le musée ferme
exceptionnellement ses portes une heure avant le coup d’envoi du
match.


Mais quel est ce mystérieux sanglier mutant
photographié dans le Var ?
Un Six-Fournais pensait tenir là son "yéti", version sanglier.
Mais l’animal n’est en réalité que le fruit d’une rencontre qui ne
recevra jamais la bénédiction des humains.

"Je n’ai jamais rien vu de comparable. Un corps tout blanc, comme
un mouton, et la tête noire"
Daniel est féru de randonnée et d’animaux. Au gré de ses balades, il
pose des appareils photos thermiques sur des arbres puis continue
son chemin et repasse deux ou trois jours plus tard pour relever son
dispositif, impatient de savoir ce qu’il a pu "capturer ".
Souvent
"des renards, des fouines parfois grandes comme des
chats..."
Et des sangliers, bien sûr.
Mais, en découvrant celui qui, mardi vers 8h30, a pris la pose sans
le savoir quelque part à Six-Fours, il a ouvert grands les yeux: "Je
n’ai jamais rien vu de comparable. Un corps tout blanc, comme un
mouton, et la tête noire". Étonné, aussi, par la taille du
bestiau qui, à vue de groin, doit bien taquiner les 80kg. "J’ai
pris pas mal de sangliers en photo par ici, mais jamais de cette
taille-là. Sa tête est beaucoup plus aplatie que d’ordinaire et elle
doit mesurer dans les 30 centimètres de diamètre".
La chose avec un cousin de Chine
Malgré son pelage si voyant et sa taille hors-norme, l’animal,
visiblement d’un certain âge, a eu la chance de ne croiser aucun
chasseur. D’autant plus chanceux que l’endroit où il a été vu n’est
pas le plus boisé de la commune, ni le plus fréquenté par ses
congénères. Et si Daniel a souhaité partager sa découverte, c’est
avant tout dans l’espoir que soit préservé cet animal singulier, qui
plus est en pleine période de chasse.
Pour percer le mystère de telles particularités physiques, une
enquête s’imposait. Internet, d’abord. En vain: aucun cas ne répond
au signalement. Pas mieux du côté de quelques associations
susceptibles de s’y connaître en esthétisme ongulé.
Et puis nous avons contacté la société de chasse Le Lièvre. Qui a
l’explication, surprenante: "La bête en question est un croisement
entre un sanglier et un cochon de Chine, révèle Hervé Fabre, adjoint
au maire et président des chasseurs six-fournais. Sans aucun doute.
Certains particuliers possèdent des cochons de Chine chez eux, du
côté de Janas et des Barrelles. Et parfois, ils s’échappent..."
On imagine la suite: au gré d’une errance, l’apparition d’une
superbe créature à poils drus près d’un sous-bois paisible, le bruit
du vent dans les feuilles, la mousse accueillante...
D’autres individus aperçus
Mais la conséquence de ces rencontres coquines est un poil moins
romantique: "Les cochons de Chine sont considérés comme des
animaux domestiques. C’est interdit de les tuer, précise M.
Fabre. Contrairement aux animaux issus de croisement ". Que
les chasseurs ont donc pour mission de réguler.
Cela fait deux ans environ que le phénomène est connu et qu’il est
pris très au sérieux, pour éviter une prolifération incontrôlable.
Sur ce dossier, les chasseurs six-fournais travaillent d’ailleurs
avec un lieutenant de louveterie de la préfecture. Mais jusqu’à
présent, aucun spécimen n’a encore été prélevé.
"Un tout blanc avait déjà été aperçu aux Playes et, il y a quinze
jours, cinq jeunes ont été vus sur la route du Mai ".
N’en déplaise à Daniel l’ami des animaux, aucun de ceux-là, aussi
extravagant soit-il, ne finira en mascotte officielle de la ville de
Six-Fours...


La "Femme à la montre"de Picasso, un
chef-d'œuvre adjugé près de 130 millions d'euros
Écrit par Gregory Bustori et AFP
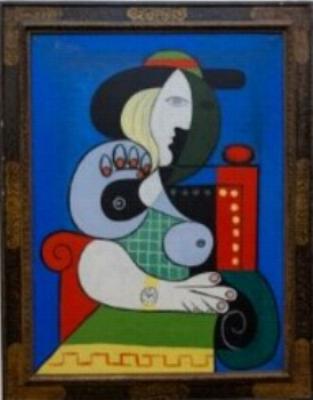
C'est presque un record de vente pour une oeuvre de Picasso.
Adjugé à 139 millions de dollars, la peinture "Femme à la montre" a
été vendue en quelques instants seulement. • © ALEXI J. ROSENFELD /
GETTY IMAGES NORTH AMERICA
L'un des chefs-d'œuvre du maître espagnol Pablo Picasso, "Femme à
la montre", a été vendu aux enchères mercredi 8 novembre dans la
soirée. Il a été adjugé à 139 millions de dollars par la maison
Sotheby's à New York, le deuxième prix jamais atteint pour cet
artiste mort il y a 50 ans.
À 40 millions de dollars près, c'eût été un record. Depuis sa mort
il y a 50 ans, Picasso garde la cote. L'oeuvre de l'artiste
espagnol, qui a résidé sur la Côte d'Azur de très nombreuses années,
s'est vue adjugée à New York, aux États-Unis.
La vente s'est déroulée chez Sotheby's, à Manhattan, et constitue
presque un record pour le maitre du Cubisme.
En salle des ventes, les enchères n'auront pas duré longtemps. La "Femme
à la Montre" n'a fait l'objet de quelques minutes d'enchères au
téléphone avant que le tableau ne parte sous les applaudissements :
139,36 millions de dollars, frais compris, sous le marteau du
commissaire-priseur.
"La Mona Lisa de Picasso"
La toile date de 1932. Une dirigeante de Sotheby's, Brooke Lampley,
a comparé la toile celle d'un autre grand maitre. "La Mona Lisa de
Picasso" a-t-elle expliqué, en référence au chef-d'œuvre de Leonard
de Vinci exposé au musée du Louvre, à Paris.
La "Femme à la Montre" représente l'une des compagnes de
l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter, et
avait été estimée à plus de 120 millions de dollars.
Le tableau appartenait jusqu'à hier à la richissime New-Yorkaise
Emily Fisher Landau. Elle est décédée cette année à 102 ans. Cette
passionnée d'art a laissé derrière elle une collection qui comprend
des œuvres de Mark Rothko et d'Andy Warhol, notamment. Une partie
passe sous le marteau de la maison Sotheby's, propriété du
milliardaire français et israélien Patrick Drahi.
Presque un record
La vente de "Femme à la montre" est la deuxième plus chère
pour les œuvres de Picasso, l'artiste ayant dorénavant au moins six
tableaux valorisés au-dessus de 100 millions de dollars. Il avait
peint cette même Marie-Thérèse Walter en "Femme endormie", en 1934.
C'est cette fois la maison Christie's qui vendra l'œuvre, ce jeudi
soir. Une vente qui pourrait ramener entre 25 et 25 millions de
dollars.
Le record absolu pour Picasso reste "Les femmes d'Alger (Version
"O")" à 179,4 millions de dollars. Cette huile sur toile peinte
en 1955 est l'œuvre d'art moderne la plus chère jamais vendue aux
enchères.
Au moment de sa vente, le 11 mai 2015 également chez Christie's à
New York, il s'agissait même du record absolu pour une enchère
d'art, dépassé en 2017 par le "Salvator Mundi ", attribué à
Léonard de Vinci, pour 450 millions de dollars.
Le marché de l'art se maintient depuis quelques années à des niveaux
très élevés. Picasso, décédé il y a 50 ans, reste l'une des valeurs
sûres des collectionneurs capables de dépenser ces sommes folles.
.


La carte des sites pour la candidature des
Alpes françaises pour les JO 2030

La piste de Courchevel pourrait accueillir le ski alpin lors des
JO 2030 si la candidature des Alpes françaises était retenue. (S.
Boué/L'Équipe)
Présentée mardi au comité international olympique (CIO), la carte
des sites pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030 ressemble à ce à
quoi on pouvait s'attendre avec pour les épreuves de glace dans la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et celle de neige dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Bâti autour de quatre pôles (Haute-Savoie, Savoie, Briançonnais et
Nice Côte d'Azur), le dossier correspond aussi à une logique
politique avec les épreuves équitablement partagée entre les deux
régions, Auvergne-Rhône Alpes devant accueillir la cérémonie
d'ouverture si les Alpes françaises étaient choisies,
Provence-Alpes-Côte d'Azur celle de clôture à Nice.
Elle répond aux fondamentaux d'une candidature telle que souhaitée
par le CIO. Autrement dit, pas de constructions de nouveaux
équipements. C'est ainsi que le tremplin de Courchevel et la piste
de bob de La Plagne seront être utilisés à nouveau après avoir été
bâtis pour les Jeux d'Albertville 1992. Il est hors de question
également de construire un anneau pour le patinage de vitesse. Il
s'agira donc soit d'un équipement temporaire, soit l'épreuve sera
délocalisée à l'étranger. Un choix qui devrait également être ceux
de la Suisse et de la Suède puisque ces deux pays ne disposent pas
non plus d'un équipement digne de ce nom en la matière.
Courchevel et Méribel pour le ski alpin, Méribel pour le biathlon
Les épreuves de neige auront lieu pour l'essentiel en Savoie et
Haute-Savoie. Souvent dans des lieux habitués à organiser des
grandes épreuves. Les pistes de Courchevel et de Méribel qui ont
accueilli les derniers Championnats du monde de ski alpin serviront
donc à nouveau ainsi que Val-d'Isère, alors que Le Grand Bornand,
familier des Coupes du monde de biathlon, accueillera les héritiers
de Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet. La Clusaz organisera
le ski nordique, Serre-Chevalier et Montgenèvre le free, le ski
accro et les bosses, Isola 2000 le snowboard cross et le skicross.
Pour les épreuves de glace, Nice se taillera la part du lion avec le
hockey, le patinage artistique, le curling et le short track. Une
future résidence universitaire en construction servira de village à
Nice, rien n'étant décidé pour les trois autres clusters.
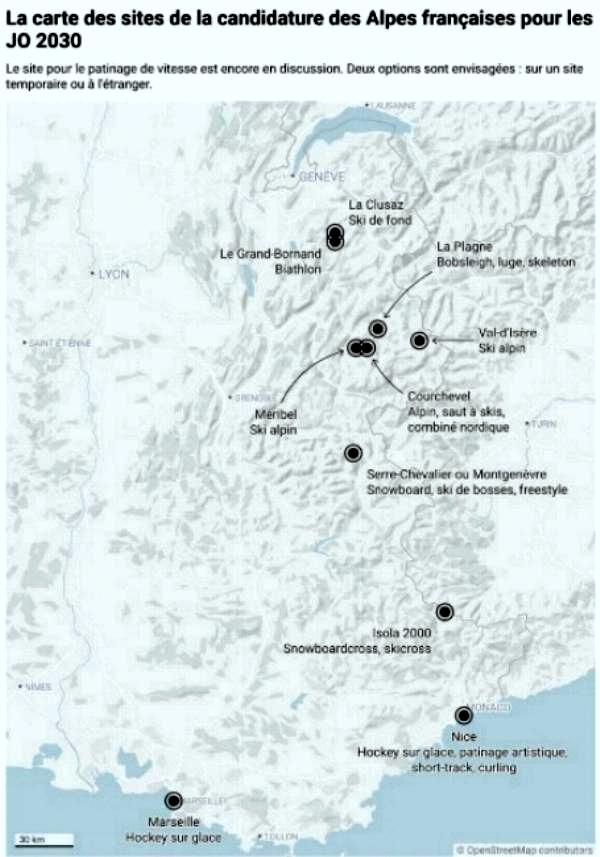


Tout ce qu'il faut savoir sur les candidatures
de Nice et de la région Sud Paca pour les JO d'hiver 2030
Nice Matin - Romain Laronche
Le dossier des Alpes françaises, porté par la Région, est déposé
puis détaillé aujourd’hui à une commission chargée d’étudier les
candidats.

Guy Drut, Marie-Amélie Le Fur, Renaud Muselier, David
Lappartient, Laurent Wauquiez et Martin Fourcade. Si le dossier
tricolore va au bout, une patinoire pourrait être construite à Nice.
Après les Jeux olympiques d’été à Paris en 2024, la France va-t-elle
accueillir une deuxième olympiade rapprochée ? C’est en tout cas ce
que souhaitent Renaud Muselier, le président de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Laurent Wauquiez, celui de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont uni leurs forces pour postuler à
l’accueil des Jeux d’hiver 2030.
Leur dossier va être remis ce mardi à une commission des programmes
du Comité international olympique (CIO), composée de neuf membres
chargés d’étudier en profondeur les candidats.
Cet après-midi (15h30), les deux hommes politiques, accompagnés de
David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) et de Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité
paralympique et sportif français, présenteront en détail à la maison
du sport français à Paris cette candidature française.
A-t-elle une chance de gagner ?
En janvier 2022, Renaud Muselier annonçait son intention de
candidater avec les Alpes du Sud pour l’accueil des Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver en 2034 ou 2038. À cette époque, les Jeux
2030 semblaient promis à Vancouver (Canada), Sapporo (Japon) ou Salt
Lake City (États-Unis).
Mais les rivaux ont tous jeté l’éponge. Les Canadiens et les
Japonais purement et simplement alors que les Américains, qui
organiseront les Jeux d’été 2028 à Los Angeles, préféreraient
obtenir les Jeux d’hiver en 2034.
Le champ était libre pour la France. Renaud Muselier et Laurent
Wauquiez ont su mettre leurs divergences politiques de côté pour
unir leur force et donner de réelles chances à la candidature des
Alpes françaises de s’imposer. "Nos Alpes du Sud sont le deuxième
domaine skiable de France, avec le Nord nous devenons le premier
domaine skiable du monde", avance Renaud Muselier, pour donner
du poids au projet.
Qui sont les rivaux ?
Ils sont deux et Européens (Suisse, Suède). La candidature suédoise
semblerait celle qui part avec un léger avantage. Elle s’articule
autour de Stockholm (avec Falun, Are et probablement Sigulda, en
Lettonie). "Stockholm s’est lancée la première et ils auraient dû
tuer le match, or ils ne l’ont pas fait ", déclarait un expert cité
dans le journal L’Equipe le mois dernier.
La Suisse attend les Jeux d’hiver depuis 1948 et Saint-Moritz. Elle
postule avec ses principaux atouts (Lenzerheide, Laax,
Crans-Montana, Lausanne) mais doit répartir les épreuves sur huit
cantons, ce qui complexifie les relations.
Quant à Vancouver, Sapporo, Salt Lake City, mais aussi le Québec ou
Barcelone, ils se sont retirés pour diverses raisons (coût,
impopularité dans le pays, polémique sur un scandale de corruption).
Quel est le calendrier ?
En janvier 2022, Renaud Muselier s’est lancé dans la bataille avec
les Alpes du Sud. Un an et demi plus tard, la candidature est
officiellement devenue celle des Alpes françaises.
En septembre dernier, une délégation de six représentants (le
président du CNOSF David Lappartient, la présidente du Comité
Paralympique Français Marie-Amélie Le Fur, les deux présidents de
Région Renaud Muselier et Laurent Wauquiez, ainsi que Martin
Fourcade et Guy Drut, membres du CIO et champions olympiques) s’est
rendue en Suisse, à Lausanne pour rencontrer Thomas Bach, le
président du CIO.
Aujourd’hui, elle va déposer officiellement le dossier de
candidature. Un grand oral devant le CIO est prévu le 21 novembre.
Quelques jours plus tard, une commission exécutive du CIO se réunira
(du 28 novembre au 1er décembre) et apportera une première réponse
le 7 décembre.
Si elle est positive, la France entrera dans une phase de "dialogue
ciblé", ce qui veut dire que l’aventure continuera. Mais le
choix officiel du CIO n’interviendra pas avant l’été 2024.
Cela aurait dû se finaliser lors de 141e session du CIO prévue à
Paris, en juillet prochain, mais si la candidature française reste
en lice, cela devra impérativement se dérouler dans un pays qui ne
postule pas.
La candidature est-elle populaire ?
Un sondage Ifop réalisé pour la Région Sud Paca vient d’être
dévoilé.
Il annonce que 75% des habitants des Alpes-Maritimes sont
favorables à cette organisation (30% tout à fait favorables, 45%
plutôt favorables) contre 62% dans les Hautes-Alpes. Des chiffres
flatteurs bien que, dans cette même étude, 50 % des sondés dans les
Alpes-Maritimes assurent n’avoir jamais entendu parler de ce projet.
Au niveau politique, les écologistes de la Région se sont opposés à
cette candidature et ont même demandé un référendum "pour que les
habitants puissent se prononcer ", à propos d’une compétition
qu’ils jugent "irresponsable", évoquant des "conséquences
désastreuses pour nos montagnes et nos territoires en termes de
biodiversité, de pollution d’artificialisation, d’émissions de gaz à
effet de serre...".
Quelles épreuves dans les Alpes-Maritimes ?
C’est encore l’incertitude, qui sera levée en milieu d’après-midi.
Après cette mutualisation, Renaud Muselier a parlé de "logique
d’égalité" entre les deux territoires. Mais avec un domaine
aussi vaste, il y a de fortes chances que les épreuves de ski alpin
se déroulent dans les plus grandes stations des Alpes du Nord
(Courchevel ?), habituées à accueillir les championnats du monde et
les Coupes du monde.
Laurent Wauquiez a promis de "s’appuyer sur des infrastructures
existantes", ce qui veut notamment dire que La Plagne devrait
réutiliser sa piste de bobsleigh, l’équipement le plus coûteux des
JO d’Albertville.
Nice, candidat malheureux aux Jeux d’hiver de 2018, sera l’un des
atouts majeurs du pôle des Alpes du Sud. Christian Estrosi a
toujours accompagné la candidature de Renaud Muselier, ce qui
signifie que plusieurs épreuves pourraient avoir lieu dans les
Alpes-Maritimes.
Si le dossier tricolore va au bout, une patinoire pourrait être
construite à proximité du centre d’entraînement de l’OGC Nice dans
la plaine du Var.
"Si on était choisi, Nice, où il y a déjà un projet de nouvelle
patinoire, serait naturellement positionnée pour accueillir les
épreuves de patinage artistique. Politiquement, ce choix
s’imposerait ", évoquait dans nos colonnes il y a quelques jours
Gwenaëlle Noury, la présidente de la Fédération française des sports
de glace.
Mais la capitale azuréenne pourrait également accueillir une
cérémonie d’ouverture ou de clôture grâce aux 36.000 places de
l’Allianz Riviera.
Et les stations du Mercantour (Isola 2000 ?) ne seraient pas
totalement écartées. Des épreuves spectaculaires (skicross,
snowboard ?) pourraient y avoir lieu.


Cette nouvelle planète du système solaire
intrigue les scientifiques : on vous présente Sedna, qui ressemble à
la Terre
Midi Libre - Elise do Marcolino

Quelles sont les caractéristiques de Sedna ? Illustration
Unsplash - AhsanAVI
Le 24 octobre 2023, les médias américains ont relayé l'étude d'un
journal d'astronomie : une planète a été découverte dans le système
solaire. Baptisée Sedna, elle ressemblerait beaucoup à la Terre.
Un astre semblable au nôtre graviterait-il non loin de nous ? À
l'échelle de l'univers, une planète semblable à la Terre baptisée
Sedna se trouve à la porte d'à côté.
L'existence de cet élément requalifié en planète par The
Astronomical Journal en août dernier remue la communauté
scientifique. Et pour cause : Sedna a des airs de planète bleue.
"Le scénario de la planète de la ceinture de Kuiper"
C'est par ce scénario que naît en 2003 l'hypothèse d'une telle
planète. L'astronome américain Michael Brown observe alors un astre
rougeâtre et glacé qui apparaît dans le champ des télescopes.
Sedna se trouve sur la ceinture de Kuiper, une région en forme de
disque située au-delà de l'orbite de la dernière planète reconnue du
système solaire, Neptune. Cet espace abrite d'autres astres
sphériques qui ont longtemps fait l'objet de débats quant à leur
dénomination, Pluton en tête de liste, rétrogradée en 2006.
La découverte de Michael Brown marque le début d'une intrigue
scientifique : il faut d'une part réussir à observer cet astre
manifestement très lointain et d'autre part parvenir à en déterminer
les principales caractéristiques. C'est ici que le travail de la
société américaine d'astronomie publié cet été ajoute plusieurs
éléments.

Semblables
Les phénomènes gravitationnels constatés dans la ceinture de Kuiper
donnent de riches indications quant aux caractéristiques les plus
probables de Sedna. Au regard des mouvements observés, sa masse
serait semblable à celle de la Terre.
Effectivement, les théories de la gravité élaborées depuis trois
siècles posent que la masse des éléments situés dans l'espace
influence l'attraction qu'ils exercent entre eux. Il faudrait que
Sedna soit aussi massive que la Terre pour produire les phénomènes
de la région.
Cette planète serait 1,5 à 3 fois plus lourde que la planète bleue,
posent les auteurs de l'étude Patryk Sofia Lykawka et Takashi Ito,
issus d'universités japonaises.
"Nous devrions affiner la définition d’une planète, car une
planète semblable à la Terre située bien au-delà de Neptune
appartiendrait probablement à une nouvelle classe de planètes"
présument-ils. Reste à trouver un ensemble d'objets dans la
périphérie de Sedna, stigmates de sa force gravitationnelle.
Une cousine (très) éloignée
Sedna mettrait 11 400 ans à faire le tour du soleil, un laps de
temps nettement plus long que celui de la Terre qui donne leurs
rythmes à nos années. Son orbite, excentrique et allongée, fait de
sa trajectoire une longue ovale distante de la Terre de 250 à 500
fois la distance Terre-Soleil.
C'est le principal motif pour lequel elle intrigue tant, raison pour
laquelle elle est si difficile à observer. La Terre se situant à 149
millions de kilomètres du soleil, Sedna est éloignée de 37 à 74
milliards de kilomètres, sept millièmes d'année-lumière.
Et si la découverte peut sembler anecdotique, l'œil des chercheurs
pétille : "La découverte d’un seul ou de quelques nouveaux objets
transneptuniens pourrait révolutionner nos théories sur la formation
du système solaire".


Tempête Ciaran à Nice : les galets de la
promenade des Anglais ont disparu

La plage Beau rivage de la promenade des Anglais à Nice ce jeudi
2 novembre a des allures de Normandie ! • © Denise Delahaye FTV
Ce jeudi 2 novembre, alors que la France est touchée par la
tempête Ciaran, que les côtes des départements des Alpes-Maritimes,
des Bouches-du-Rhône et du Var sont placées en vigilance orange "vagues-submersion",
la célèbre plage de galets de la promenade des Anglais de Nice est
méconnaissable !
La puissante tempête Ciaran qui souffle notamment sur l’ouest de la
France, ce jeudi 2 novembre 2023, a des répercussions jusque dans le
Sud-est.
Les côtes des départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône
et du Var sont placées en vigilance orange "vagues-submersion" et la
promenade des Anglais à Nice à des allures... normandes.
Rien ne va plus !
Où sont passés les galets ?
La plage de la promenade des Anglais sans ses galets ! Ce n'est pas
possible ! Ce n'est pas Nice ! Et pourtant si ! Depuis ce matin, la
plage de Nice prend des allures de Normande ou de Bretonne, c'est
selon ses affinités. Incroyable ? Pas tant que cela en fait !
Si l'image est insolite, elle n'en est pas moins réaliste. En effet,
ce phénomène se produit parfois lors de grandes intempéries. Comme
c'était le cas en janvier dernier par exemple.
Ou encore le 20 octobre dernier, lors du passage de la tempête Aline
sur les côtes méditerranéennes :

A Nice, avec le passage de la tempête Aline, les galets sur la
plage ont disparus. • © Michel Bernouin / FTV
Selon Guillaume Duclaux, maître de conférences en géologie à
l'Université Nice Côte d'Azur, auprès d'Actu.fr en janvier dernier :
"A priori, les galets restent en majorité sur la plage. Ils ont été
recouverts par des matériaux plus fins. Ils ont été poussés contre
le mur, vers l'arrière. Les galets sont en général pas mal déplacés
à cause de la houle, mais pas spécialement avalés par la mer "
poursuit-il.
D'ici à quelques jours, la plage devrait retrouver l'aspect que nous
lui connaissons tous.
Selon l'universitaire azuréen : "cela dépend essentiellement de la
météo, du niveau d'ensoleillement et de la fréquentation du littoral
et si des gens vont marcher dessus, ou pas".
Mais d’où viennent les galets de Nice ?
Vous pensiez que les galets de la plage de Nice étaient apportés par
la mer ? Pas tout à fait…
À chaque fin de printemps, la ville de Nice ajoute plusieurs
milliers de mètres cubes des galets sur la plage car, au fil du
temps et des saisons, la mer les emporte. Ne reste alors que le
sable sur la plage.
Logique somme toute !
Pour pallier ce phénomène, le ballet des camions et des tractopelles
qui préparent la plage avant l’arrivée des touristes et déversent
des tonnes de galets s'appelle l'engraissage ou l'engraissement de
la plage.

Chaque hiver à Nice on engraisse les plages pour lutter contre
l'érosion naturelle. • © France3Côtedazur
Les galets proviennent des fleuves des Alpes-Maritimes, le Var et/ou
le Paillon. Mais ils peuvent aussi provenir de la Durance, dans les
Bouches-du-Rhône. Sans l'intervention de la municipalité la plage
perdrait ses galets et le littoral reculerait avec le temps.
Et s’il n'y avait plus de galets... il n'y aurait plus de plage.
L’espace entre la mer et la promenade disparaîtrait. Tout
simplement.

Le site au bout de la promenade des Anglais offre une vue
imprenable sur le bord de mer niçois. • © Marylène Iapichino/ France
Télévisions
Des galets synonymes de stabilité et de pérennité
Et oui, les fameux galets de la page de Nice, ne sont pas là que
pour faire jolis, ou se tordent les pieds ou, encore, rendre
parfaitement inconfortable une sieste bien méritée...
Ils sont là, car ils permettent de stabiliser et de préserver la
plage de la Promenade des Anglais. Les galets maintiennent la plage.
Sans eux, la mer serait au niveau des murs.
Autre avantage des galets, ils permettent un meilleur drainage de
l'eau de mer et de pluie. Ce qui, à terme, peut empêcher la
formation de zones boueuses et marécageuses.
Un sujet sérieux le galet à Nice ! D'ailleurs, un suivi scientifique
a été mis en place pour permettre de mettre en évidence le parcours
d'un galet, en temps ordinaire, dans la baie des anges et pour
comprendre comment ils se déplacent. Pour ce faire, certains galets
ont donc été identifiés et les pucés.
Et saviez-vous que si la mer à tous les droits, vous, vous ne pouvez
pas emporter les galets chez vous en souvenir ?


Quels hôpitaux de Nice vont disparaître pour
laisser place au méga hôpital dans la plaine du Var
C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Le maire de
Nice, Christian Estrosi, a évoqué mardi 31 octobre la construction
d'un méga hôpital à Nice.
Un projet à 500 millions d'euros, qui doit voir le jour en 2032.
Cependant, cette construction ne sera pas sans conséquences pour les
autres hôpitaux. En effet, l'objectif est de tout centraliser dans
ce seul et unique endroit.
Ainsi, plusieurs hôpitaux de la métropole vont être détruits. Parmi
eux, l’hôpital L’Archet, le Centre Antoine-Lacassagne et l’hôpital
de Cimiez.
La raison? Les établissements actuels ne seraient "plus adaptés,
plus dimensionnés pour prendre en charge les patients lorsque l’on
connaît l’évolution démographique, le vieillissement de la
population, et donc les besoins grandissants", a confié le maire
de Nice.
Ce projet pharaonique fait déjà réagir
Le projet fait par ailleurs fait tousser la CGT CHU de Nice. "Certes,
on avait déjà entendu une possibilité de projet sur la 202. Mais
rien d’aussi affirmatif que ce qui est paru dans les colonnes de
Nice-Matin. Apprendre par voie de presse une décision aussi
importante, c’est un manque de respect ", a indiqué le
secrétaire général Stéphane Gauberti, après avoir lu les
déclarations du maire de Nice, également président du conseil de
surveillance du CHU.
"Pourquoi aller sur la 202 ? ", s’interroge le représentant
syndical, qui reconnaît :
" il peut y avoir un besoin de soins dans
ce secteur, nous ne nous opposons pas à cette idée. Mais il n’est
pas envisageable que les seuls pôles de santé publics soient situés
aux extrémités de Nice: à l’est et à l’ouest ! Au milieu, il n’y
aura plus rien! Nous avons déjà perdu St-Roch comme hôpital de ville
qui aurait été bien utile lors de la Covid…"


Qu'est-ce que Oweynagat surnommé la "Porte de
l'enfer", cette grotte dont il ne faut pas approcher à Halloween ?
Midi Libre - Laure Ducos

L'entrée d'Oweynagat, la porte de l'enfer. COMMONS WIKIMEDIA -
GILLAWEEN
Située dans le comté irlandais de Roscommon, cette cavité s'étend
sur plus de 37 mètres sous terre et serait le passage avec le monde
de créatures démoniaques.
Il y a de quoi en avoir des frissons. À l’origine de la fête
d'Halloween, il y a la célébration celte Samain.
Les Celtes vivaient il y a quelques milliers d'années en Irlande et
en Ecosse. Mais ça serait en Irlande, dans le comté de Roscommon que
se situerait le passage entre le monde des vivants et celui des
enfers. Passage ouvert seulement chaque année dans la nuit du 31
octobre, lors de la fête de Samain.
Un souterrain néolithique assez vaste
La grotte qui est un souterrain du site néolithique de Rathcroghan
est surnommée Oweynagat, la grotte des chats et serait la porte
menant aux enfers, ou plutôt la porte empruntée par les démons pour
venir de l'enfer.
Située au cœur d'un site archéologique composé de plus de 240 sites
datant de plus de 5 500 ans, la grotte s'étend à 37 m sous terre,
comme le rapporte la BBC.
Lieux de la reine Medb mais aussi de la déesse Morrighan
Ce serait le lieu de naissance de la
reine Medb qui veut dire ivresse du pouvoir. Dans la
mythologie irlandaise, une reine guerrière et ambitieuse, sa seule
vue affaiblit les hommes qui la regardent, et on dit qu’elle court
plus vite que les chevaux.
Il s'agirait également de la demeure de
la déesse de la guerre Morrighan, une sorcière qui
ferait remonter les monstres et les démons.
Un secteur à éviter le 31 octobre
Pour éviter de croiser les créatures démoniaques, il était donc
conseillé de rester chez soi ou de sortir grimer de manière à leur
ressembler pour ne pas être repéré.
Et surtout il était déconseillé de s'approcher de la grotte.
Peut-être une précaution à prendre encore de nos jours, sait-on
jamais..


Liste des communes des Alpes-Maritimes dans
lesquelles les équipements d'hiver pour les véhicules sont
obligatoires
Écrit par Elise Regaud et Sébastien Lemaire

La détention de chaînes, pneus neige ou chaussettes est
obligatoire dans 82 communes des Alpes-Maritimes. • © Simon Daval -
Periples & Cie / MaxPpp
À partir du 1ᵉʳ novembre 2023, les véhicules de certaines
communes des Alpes-Maritimes sont concernés par la Loi Montagne II.
Celle-ci les contraint à détenir des dispositifs antidérapants
amovibles pour les pneus afin d'éviter tout accident sur les routes
de montagne.
À partir du 1ᵉʳ novembre 2023, comme dans les 47 autres départements
français depuis 2 ans, les habitants ou visiteurs de certaines
communes des Alpes-Maritimes devront équiper leur véhicule de pneus
neige, de chaînes ou de chaussettes jusqu'au 31 mars 2024.
Cette année encore, pour laisser le temps de s'adapter à cette
obligation, le gouvernement prolonge l'approche pédagogique. Aucune
sanction ne sera donc appliquée pendant cette saison hivernale
2023/2024.
Les 82 communes concernées sont : Amirat, Andon, Ascros, Auvare,
Bairols, Belvédère, Beuil, Bezaudun-les-Alpes, Bonson,
Breil-sur-Roya, Briançonnet, Caille, Caussols,
Chateauneuf-d'Entraunes, Clans, Coaraze, Coursegoules,
Daluis, Duranus, Entraunes, Escragnolles, Fontan, Gars, Gilette,
Gourdon, Gréolières, Guillaumes, Ilonse, Isola, La
Bollène-Vésubie, La Brigue, La Croix-sur-Roudoule, La Penne, La
Tour, Lantosque, Le Mas, Les Mujouls, Levens, Lieuche, Lucéram,
Malaussène, Marie, Massoin, Moulinet, Peille, Péone, Pierlas,
Pierrefeu, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Revest-les-Roches, Rigaud,
Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Antonin, Saint-Auban,
Saint-Dalmas-le-Selvage, Sainte-Agnès, Saint-Etienne-de-Tinée,
Saint-Léger, Saint-Martin-d'Entraunes, Saint-Martin-Vésubie,
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Vallier-de-Thiey, Saorge, Sauze,
Seranon, Sospel, Tende, Thiery, Toudon, Touët-sur-Var,
Tourette-du-Chateau, Tournefort, Utelle, Valdeblore, Valderoure,
Venanson, Villars-sur-Var et Villeneuve-d'Entraunes
Certains véhicules concernés
La loi s'applique aux véhicules utilitaires légers, voitures,
autobus, autocars, poids lourds et véhicules lourds avec ou sans
remorque ou semi-remorque. Tous devront avoir des dispositifs
antidérapants amovibles "permettant d'équiper au moins deux roues
motrices" ou porter "sur au moins deux roues de chaque
essieu, de pneumatiques "hiver " ", détaille le site de la
Préfecture des Alpes-Maritimes.
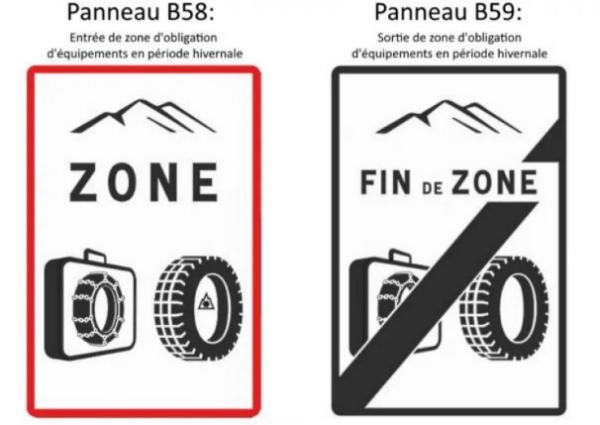
Ces panneaux d'entrée et de fin de zone d'obligation
d'équipements en période hivernale sont présents aux abords des
communes concernées. • © Syndicat des professionnels du pneu
Une signalisation est présente à l'entrée et à la sortie des zones
concernées.


Comment sont nés les grands magasins sur la Côte
d'Azur ?
L’ère des grands magasins a débuté à Paris en 1852. L’enseigne "A
la ville de Nancy", créée à Nice huit ans plus tard, fut le premier
grand magasin de la Côte d’Azur.
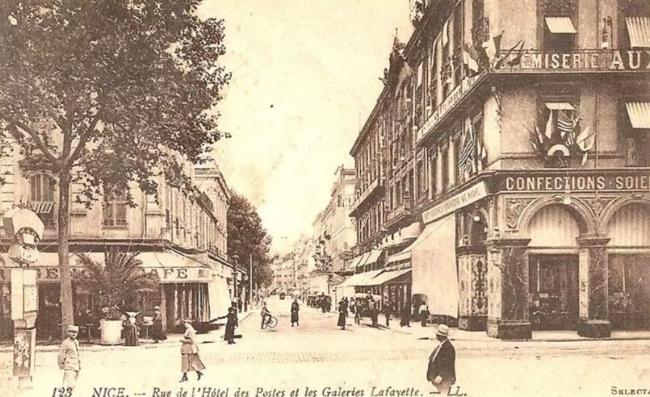
À Nice, les Galeries Lafayette ont succédé Aux dames de France en
1912. (Service communication des Galeries Lafayette Paris)
En 1852, Aristide Boucicaut, entrepreneur et homme d’affaires, crée
à Paris le "Bon Marché", premier grand magasin au monde.
Simultanément, un autre visionnaire pense que la Côte d’Azur est un
lieu propice pour en faire de même. Ainsi, le 28 octobre 1860s’ouvre
à Nice le premier grand magasin pour dames
"A la ville de Nancy".
Cependant, le magasin n’a pas longtemps perduré longtemps et il n’en
reste qu’un entrefilet dans la chronologie de la ville. Mais l’idée
va faire son chemin...
Premier grand magasin à Cannes
En 1898, les frères Jules et Nathan Gompel, propriétaires depuis
1880 d’une boutique à Cannes, fondent la société Paris-France avec
l’idée de monter une chaîne de grands magasins. Déjà leur enseigne
cannoise propose plusieurs étages des rayons de vêtements et
d’ameublement, ce qui est très rare à l’époque. Conscients du
potentiel, ils créent, dès 1900, dans un immeuble situé à l’angle
des rues de la Gare (actuelle du Maréchal-Foch et Hoche), un magasin
plus grand qui propose un vaste choix d’articles. C’est le premier
maillon de l’enseigne Aux dames de France. Puis, la chaîne
s’implante dans d’autres villes azuréennes: Nice et Menton en 1902,
Toulon, en 1904 et Hyères en 1907. Pour encourager les clients à la
flânerie, Aux dames de France ne choisissent que les beaux
bâtiments.
À Nice, c’est dans un immeuble de l’avenue de la Gare (actuelle
avenue Jean-Médecin) que le magasin entièrement électrifié s’étage
sur deux niveaux organisés autour d’un vide central coiffé d’une
verrière. À Menton, le bâtiment grandiose à l’architecture chargée
et à la décoration rococo se situe avenue de la République.
À Toulon, le magasin Aux dames de France marque l’ascension
triomphale des grands magasins en ouvrant à proximité de la place de
la Liberté. Faute de place, en 1912, il déménage à l’angle du
boulevard de Strasbourg et de la rue Henri-Pastoureau. Entièrement
ravagé par un incendie vers 1918, il faut attendre 1921 pour qu’il
s’installe dans un bâtiment plus haut de deux étages que le
précédent. Et comble du modernisme, il possède alors des ascenseurs
avec liftiers.
L’installation des Galeries Lafayette
À Nice, la première succursale des Galeries Lafayette s’installe au
bas de l’avenue de la Gare, en lieu et place des Dames de France en
1912. En 1916, grâce au rachat des petites boutiques qui longent la
place Masséna, Théophile Bader, l’un des créateurs de l’enseigne, en
augmente la surface jusqu’à 4.000m². Il fonde la Société parisienne
d’achat et de manutention et des Galeries Lafayette de Paris. C’est
ainsi que l’enseigne niçoise Galeries Lafayette devient le tout
premier magasin en région parmi les nombreuses succursales qui vont
s’implanter en France. L’extension de ce grand magasin est en grande
partie due à l’arrivée du train sur la Côte. Car, si la réception
des marchandises passe par des circuits divers elle est surtout
expédiée par différentes maisons de groupage et elle arrive par
rail.
En 1950, pas moins de 1.200 personnes travaillaient au magasin.
À la fin des années cinquante, il va occuper une surface de
19.600m². En 1966, le magasin s’offre une seconde jeunesse. La
totalité du magasin est remodelée avec installation d’escalators et
pose de faux plafonds, cachant le dôme. Le magasin a pu ainsi
atteindre une superficie de 23.000m² avec 14.000m² de surface de
vente. Bien que modernisé au fil des années, les Galeries Lafayette
de Nice sont toujours dans cette figuration.
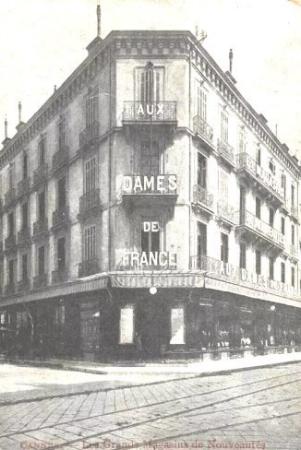
Premier magasin Aux dames de France installé à Cannes vers 1900.
(Carte postale ancienne)

Les arcades des Galeries Lafayette de Nice en 1916. (Service
communication des Galeries Lafayette Paris)
Le Var ouvre l’ère de la consommation en 1904

Dessin montrant le premier magasin toulonnais Aux dames de France
dans son ensemble, sur la gauche c’est la rue Victor-Clappier et à
droite, la place de la Liberté. (Carte postale Ed. des Dames de
France)
Le premier grand magasin Aux dames de France de Toulon fut bâti en
1904. Situé d’abord rue Victor-Clappier puis boulevard de Strasbourg
après 1912, il avait très fière allure. Détruit par les bombes à la
fin mars 1944, il fut réduit à l’état de bloc incandescent
impossible à approcher jusqu’au lendemain.
En attendant sa reconstruction, l’enseigne a occupé un bâtiment
situé quartier du Champ-de-Mars. Le 9 octobre 1951, le nouveau
magasin ouvre au premier étage d’un bâtiment propriété de la société
Palais Paris-France. Le magasin devient les Galeries Lafayette en
1985. Quant à Hyères, le magasin Aux dames de France ouvre ses
portes à la Toussaint 1907. Il s’installe dans un immeuble de style
haussmannien qui, situé avenue du Maréchal-Lyautey, fut construit
par l’architecte parisien Georges Debrie et les entrepreneurs
toulonnais Noble et fils. Sur toute la façade du bâtiment qui
symbolise l’architecture Art nouveau, sont encore sculptés les mots:
Papeterie, Chaussures, Faïence, Ménage etc.
Au début du XXe siècle, le magasin hyérois est, non seulement le
premier de la Côte d’Azur à ouvrir un rayon ameublement avec
présentation d’installations complètes, mais il va aussi introduire
le paiement en plusieurs fois, soit le crédit. S’ouvre alors un
nouveau mode de consommation. Si le magasin a fermé ses portes à la
fin des années 1980, l’immeuble qui l’abritait fut inscrit à
l’inventaire des Monuments historiques en 1999.
.


A Nice, la promenade du Paillon fête (déjà) ses
10 ans : son passé, son futur, sa vie cachée...
Nice Matin - Écrit par Manon Hamiot

Les travaux sur l'ancien parvis du TNN se poursuivent. • © Manon
Hamiot/ FTV
Le 26 octobre, la promenade du Paillon fêtera ses 10 ans. Un
anniversaire marqué par les travaux de prolongation de la promenade.
A cette occasion souvenez-vous à quoi le lieu ressemblait avant,
découvrez à quoi il ressemblera d'ici 2025 et vivez les coulisses de
la coulée verte.
C'était il y a 10 ans déjà... La coulée verte était inaugurée,
renommée depuis, promenade du Paillon. Pour célébrer son
anniversaire, des festivités étaient prévues le 19 octobre, elles
sont finalement reportées. Le concert à la lumière des bougies sur
le miroir d'eau aura lieu le vendredi 17 novembre.
La verrue de Nice
Avant d'arborer fièrement ses 12 hectares de parc, son miroir d'eau
et ses milliers d'espèces différentes... La promenade était une gare
routière, un ancien parc auto, le forum Jacques Médecin, le tout
surplombé par des jardins suspendus qui n'avaient pas grand succès.
Projet phare de Christian Estrosi, la coulée verte a été inaugurée
le 26 octobre 2013.

Revenons quelques siècles en arrière, c'est dans le lit du Paillon
que les lavandières de Nice lavaient leur linge.
C'était un lieu de
vie iconique du Nice populaire.
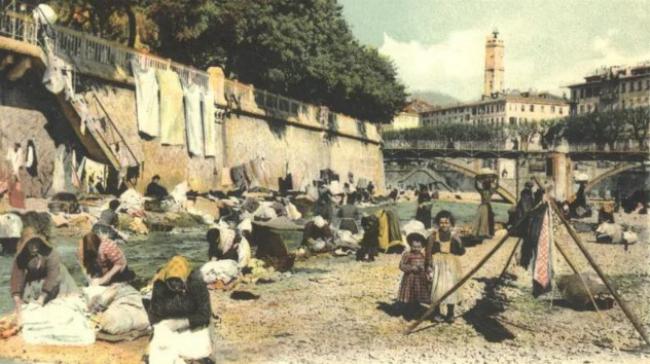
Des lavandières lavent le linge dans le Paillon. • © Archives
municipales de Nice
Son couvrement a débuté en 1867, pour la municipalité niçoise, il
permettait de répondre aux vœux des propriétaires et pensionnaires
des hôtels donnant sur ses berges. Petit à petit, la création de
place Massena en 1881, le secteur Garibaldi-Barla en 1965... Le
fleuve fut complètement recouvert du palais des expositions actuel,
jusqu'à la mer. C'est d'ailleurs avec ces mêmes extrémités que le
parc acte II sera terminé en 2025.

Le Pont Barla en1957, avant le recouvrement de cette partie du
Paillon. • © Service municipal d'archives
La saison deux
Nommée par la ville de Nice : "la forêt urbaine",
la prolongation de promenade du Paillon fera gagner 8 hectares aux
12 déjà présents. Trois secteurs sont en chantier. Le premier de la
traverse de la Bourgada au Mamac, à cet endroit, le TNN a été
démoli, des jardins montants iront jusqu'au musée. Ce secteur
devrait être terminé en juin 2024.

Le Mamac sera au centre de la promenade du Paillon. • © Manon
Hamiot/ FTV
Le musée, lui sera complètement rénové promet la mairie. La terrasse
deviendra notamment un lieu de vie. Les accès seront revus, tout
comme pour la bibliothèque Louis Nucéra, l'accès se fera par une rue
adjacente.

La promenade du Paillon saison 2, vue accropolis. • © © Alexandre
Chemetoff et associés
Pour le secteur "Acropolis", l'ancien centre des congrès et ses 70
000 tonnes de béton ont entamé leur démolition. Un jardin de lecture
attenant à la bibliothèque Louis Nucéra prendra place. Ainsi que des
bassins d'eau naturelle. Le jardin Sosno sera complètement
requalifié.

Promenade du Paillon saison 2 : les travaux se poursuivent. • ©
Manon Hamiot/ FTV
Les rues attenantes font également partie du projet, elles sont
actuellement en travaux, sur le boulevard Risso, comme sur le
boulevard Gallieni, puisque des pistes cyclables bidirectionnelles
sont en construction, ainsi que la création de lignes de bus à haut
niveau de service. Des arbres et des plantes aborderont les
trottoirs qui seront agrandis. Pour ce secteur, il faudra attendre
2025.

Les bassins d'eau naturelle prévus pour la prolongation de la
promenade du Paillon. • © © Alexandre Chemetoff et associés
Troisième secteur, celui du maréchal de Lattre de Tassigny, ici les
jardins se prolongeront et sous terre, des citernes d'une capacité
de deux piscines olympiques stockeront l'eau de pluie. Elles doivent
à terme permettre l'autonomie en eau de la Promenade du Pallion. Ici
aussi, les travaux sont en cours, date de livraison, fin 2024.
La ville de Nice a pour projet de planter plus 1500 arbres et ainsi
supprimer 1700 tonnes de CO2 par an. Ce qui réduirait de 20% les
maladies cardiovasculaires. Une réduction qui a un prix: la
promenade du paillon saison 2 coûte 75 millions d’euros.
La vie cachée de la promenade du Paillon
La promenade du paillon s’est aussi un voyage botanique. 7000
espèces différentes s’y épanouissent. Des espèces méditerranéennes
d’abord comme des oliviers, des vignes et des figuiers. Mais aussi
d’Océanie avec des eucalyptus, d’Amérique du Sud avec les fleurs
jaunes du Tipuana tipu ou celles, roses, du Chorisia speciosa.
Romain Betti Directeur des espaces verts ville de Nice:
"Nice a cette particularité, par la douceur de son climat de pouvoir
accueillir plusieurs espèces, de plusieurs continents."

132 jets d'eau composent le miroir d'eau. • © FTV
Des plantes par milliers à observer mais, l'un des lieux les plus
visités de la promenade du Paillon reste le miroir d'eau : 106
mètres de long, 30 mètres de large, 2,5 centimètres de profondeur et
pour faire tourner toute cette eau, il y a une sacrée machinerie.
Sous le miroir d’eau, enfin plus précisément sous l'avenue Félix
Faure, un centre de contrôle avec une dizaine de pompes est caché
pour actionner 132 jets d’eau.
"Toutes les 20 minutes la totalité de l’eau est filtrée, 20 à 30 m³
passent par jour".
Éric Grenier, Technicien hydraulique Responsable de la promenade du
Paillon

Dans son projet de saison 2 de la promenade du Paillon, la ville
de Nice prévoit l'installation de brumisateur. • © © Alexandre
Chemetoff et associés
Pour la saison deux, le côté aquatique sera présent avec les bassins
d'eau naturelle, mais aussi des brumisateurs. Ce sera donc bientôt
sur 20 hectares que niçois et touristes de passage pour flâner,
jouer, déambuler, se rafraîchir. Rendez-vous en 2025.


Tandis que la mer monte, l'aéroport Nice Côte
d'Azur s'enfonce
L’aéroport Nice-Côte d’Azur est victime d’un affaissement qui,
par endroits, dépasse 1 cm par an. Un phénomène d’autant plus
menaçant qu’il s’ajoute à la montée du niveau de la mer.

L’aéroport de Nice vu du ciel, en 2014. Photo Cyril Dodergny
On savait l’aéroport de Nice menacé par la montée du niveau de la
mer, provoquée par le réchauffement climatique. On apprend qu’il
l’est aussi… par l’abaissement du niveau du sol. C’est ce
qu’indiquent les données issues du programme européen Copernicus,
qui surveille l’état de la Terre.
La cartographie établie par le Service européen des mouvements de
sol (EGMS, pour European ground motion service) est édifiante:
l’aéroport s’affiche en rouge vif, avec un affaissement dépassant
par endroits un centimètre par an.
"Je suis surpris des valeurs. Sur les bords, l’affaissement
atteint 8 cm en cinq ans [les données concernent la période
2016-2021]. Et même ailleurs, là où c’est 1 cm en cinq ans, ce
n’est pas anodin", réagit Jonathan Chenal, géodésien et chargé
de mission changement climatique à l’IGN (Institut national de
l’information géographique et forestière).
"Le phénomène est flagrant"
Le géologue Thomas Lebourg, professeur à l’université Côte d’Azur et
membre du laboratoire Géoazur, connaît bien la carte de l’EGMS: il a
"participé à son développement " et "l’utilise tous les
jours". Les données? Obtenues "par interférométrie radar ",
elles sont fiables, assure-t-il, en dépit d’une petite marge
d’erreur dans "le mode de calcul de l’algorithme."
L’affaissement de la plateforme? "Il est flagrant. L’aéroport, en
partie construit sur la mer par apport de matériaux*, se tasse. Le
poids de la terre déposée sur des sédiments marins fait que le sol
se compacte avec le temps. Un processus qu’on observe sur de
nombreux ouvrages construits sur la mer."
L’activité des avions n’est pas en cause, tranche ce spécialiste des
grands mouvements de terrain et des masses géologiques instables: "Ça
revient à demander si on peut faire bouger une table en jetant une
allumette dessus."
Hausse du niveau de la mer
Inquiétant ? "Ce qui l’est, selon Jonathan Chenal, c’est
l’ordre de grandeur " et la conjugaison du phénomène avec la
montée des eaux. "Je n’ai pas les valeurs exactes pour Nice, mais
sur la même période, le niveau de la mer à Marseille est monté d’un
peu plus de 3 mm par an", expose ce fin connaisseur du
marégraphe de la cité phocéenne, qui calcule avec précision le
niveau de la Méditerranée depuis plus d’un siècle. "La
conjonction des deux phénomènes expose l’aéroport à des
problématiques de submersion chronique à marée haute ou en cas de
surcote atmosphérique [quand une pression atmosphérique plus
basse que la moyenne fait monter le niveau de la mer] ou encore
au phénomène de vagues associées au vent…"
"À moyen terme, une partie de l’aéroport de Nice peut se
retrouver sous l’eau, corrobore le géologue niçois Thomas
Lebourg. Je ne suis pas alarmiste, mais c’est à surveiller. Je
pense que l’aéroport le fait."
"Rien d’inquiétant", jure l’aéroport
"L’effet de tassement nous est parfaitement connu, confirme
un porte-parole des Aéroports de la Côte d’Azur. Nous travaillons
depuis plusieurs années avec des bureaux d’étude géotechnique qui
nous fournissent et analysent des données encore plus précises**.
L’ensemble de ces données, qui n’ont rien d’inquiétant, nous
permettent de préserver la conformité de nos installations,
notamment les pistes et voies de circulation, afin qu’elles ne
présentent aucun risque pour les avions et les passagers."
Docteur en génie civil, Jean-Laurent Burlet est moins formel : "La
principale menace est effectivement la montée des eaux. Ce tassement
du sol est seulement le facteur aggravant d’un phénomène qui, lui,
est réellement inquiétant."
*Entre 1975 et 1978, 20 millions de mètres cubes de remblais,
prélevés sur le site de l’actuel PAL, sont déversés dans la mer pour
porter la superficie de l’aéroport de 200 à 380 hectares. La surface
prise sur la mer a permis la construction de la piste sud.
**"Conformément à notre devoir en matière de suivi de nos
installations et de la préservation de la concession, précise
l’aéroport, nous effectuons des relevés topographiques de mesures
annuelles sur certains points fixes, nous avons instrumenté la
plateforme à l’aide d’inclinomètres et d’extensomètres, en
complément de relevés bathymétriques qui complètent nos données
topographiques par un suivi des fonds marins. Nous réalisons
également un suivi des données satellitaires."

Le secteur de l’aéroport de Nice sur la carte établie par l’EGMS.
Capture d’écran Nice-Matin.
Quels risques, quelles solutions ?
Faut-il vraiment s’inquiéter de ce phénomène de tassement ? Pour le
porte-parole d’Aéroports de la Côte d’Azur (ACA), c’est non. "Le
tassement est la conséquence logique » de la construction d’une
partie de l’aéroport sur la mer et "les données n’ont rien
d’inquiétant ".
D’autant que l’effet de tassement a tendance à… se tasser: "La
courbe atteint son asymptote, ce qui signifie que le phénomène tend
à ralentir et est de moins en moins prononcé."
Docteur en génie civil, Jean-Laurent Burlet observe également "un
infléchissement à partir de 2019." Il distingue trois cas de
figure.
D’abord, les bâtiments: "Dans cette zone, le tassement est faible
et surtout uniforme, donc pas inquiétant du tout."
Ensuite, la piste sud, construite sur la mer: "On peut
relativiser le risque: la géométrie d’une piste de 3 km de long
n’est pas impactée par 5 cm de différentiel."
Enfin, le reste de la plateforme: "Plus on va vers la mer, plus
on observe un tassement important. C’est au sud-est de l’aéroport,
au niveau des enrochements, que c’est le plus inquiétant. Il existe
un risque de submersion."
Celui qui est également professeur au département bâtiment de
Polytech, l’école d’ingénieurs de Nice-Sophia Antipolis, avance une
solution: "Remblayer [pour surélever le niveau du sol] puis
relever le niveau des enrochements", mais reste perplexe: "On
peut faire plus haut, mais combien de temps ça va tenir ? "
ACA n’a pas les mêmes interrogations: "La plateforme se situe
autour de 300 cm au-dessus du niveau de la mer, 350 cm pour la piste
sud. Ce qui, en complément de l’effet protecteur des digues, nous
préserve sur le long terme."
La Lauvette, le tunnel du tram… Les autres secteurs sensibles
D’autres secteurs de Nice montrent des signes d’affaissement des
sols. À commencer par la zone du tunnel de la ligne 2 du tramway. Au
droit de la station Durandy, les données de l’EGMS indiquent un
abaissement de 3 cm entre 2016 et 2021.
Idem boulevard Dubouchage, où des riverains avaient mis en évidence
des désordres dans le bâti au moment du creusement du souterrain.
Près de la station souterraine Jean-Médecin, le constat est encore
plus frappant. À l’angle de l’avenue éponyme et du boulevard
Victor-Hugo, où un immeuble avait été évacué en urgence début 2022,
on constate un affaissement de plus d’un centimètre… en moins d’un
mois.
À Grand-Arenas, sur l’emprise de la nouvelle gare Saint-Augustin, le
sol s’est affaissé de 2 à 3 cm en cinq ans. Mais les observations
les plus spectaculaires visent le complexe sportif de la Lauvette. À
l’emplacement des terrains refaits en 2017, l’affaissement oscille
entre 6 et 12 cm en cinq ans !


Tram, palais des congrès, gare, voie rapide… On
fait le point sur les grands travaux à Nice

Le prolongement de la voie Mathis vers la route de Grenoble et
l’entrée de l’A8 en 2025. (Image de synthèse Métropole)
Ce sont, avec l’extension de la coulée verte attendue fin 2025,
les grands chantiers qui font parler à Nice.
Où en est-on? Invité dans les locaux de "Nice-Matin", le maire
dresse l’état des lieux.
Quels équipements à quelle échéance? Les calendriers seront-ils
tenus? Invité ce week-end de L’interview à la Une, le grand
entretien hebdomadaire de Nice-Matin en partenariat avec Radio
Émotion, le maire de Nice Christian Estrosi a été interrogé sur les
grands projets de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte
d’Azur.
Nouvelles lignes de tramway, palais des congrès et des expositions,
prolongement de la voie rapide… On fait le point.
Les lignes 4 et 5 de tramway
La ligne 4 du tramway doit relier Nice à Cagnes-sur-Mer via
Saint-Laurent-du-Var, la ligne 5 remonter la vallée Paillon jusqu’à
Drap. "On reste sur 2028" pour la livraison de ces deux
liaisons, assure Christian Estrosi.
La première doit traverser le Var et arriver à la station Tzanck "tout
début 2026" puis desservir Cagnes "fin 2028", avait précisé
Louis Nègre, le maire cagnois, au dernier conseil métropolitain. La
seconde doit atteindre en 2026l’entrée de L’Ariane (pont Garigliano)
avant de franchir le fleuve pour desservir La Trinité et Drap deux
ans plus tard.
La sortie de la voie Mathis
Le prolongement de la voie Mathis? Le chantier qui permettra
d’acheminer "30.000 véhicules par jour sur la route de Grenoble
ou à l’entrée de l’autoroute" accuse quelques mois de retard. La
raison? "Les erreurs commises sur les fondations par le promoteur
du grand immeuble de Quartus [L’Avant-Scène]. "
"J’aurais préféré livrer la sortie de l’autoroute urbaine sud en
souterrain dès fin 2023; c’est reporté à la fin du premier semestre
ou au début du 2e semestre 2024."
La nouvelle gare de l’ouest bientôt dévoilée
L’arrêt a été déplacé de 500mètres il y a un an, quittant l’avenue
Grinda pour permettre le prolongement de la voie Mathis. Il se
trouve désormais dans une station provisoire, en attendant la future
gare. "Je présenterai dans quelque temps l’architecture de la
nouvelle gare, qui sera la gare centrale et aura un peu la
configuration de la gare de Satolas [à Lyon] qui est absolument
magnifique. Elle sera prête en 2028 avec une sorte de canopée qui
apportera de la verdure sous une toiture."
Les nouveaux palais des congrès et des expositions
Christian Estrosi avait pris tout le monde de court en annonçant, au
printemps, un nouveau centre des congrès sur le parking Infernet, au
port, pour accueillir la conférence des Nations Unies sur les océans
en 2025. Des délais vraiment tenables? "Ça ira beaucoup plus vite
que vous l’imaginez", soutient le maire. Et il est formel: il ne
s’agira pas d’un simple chapiteau provisoire mais "de la salle
des congrès définitive". Un équipement "financé
essentiellement par l’État " et qu’il promet comme "le plus
moderne entre Gênes et Marseille".
Quant au parc des expositions "en lieu et place du MIN fleurs
courant 2028, les études sont en cours". Il en est certain: "La
halle du MIN fleurs, qui fait près de 40.000m2, avec des plafonds
hauts et aucun pilier central, peut être habillée par des
architectes de très haut niveau et équipée pour en faire un grand
centre d’expositions."


L'étrange scénario autour de la mort d'Edith
Piaf le 10 octobre 1963
Écrit par Hélène France

Le convoi funèbre part très officiellement du
domicile d’Edith Piaf jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Un
demi-million de personnes est dans la rue.
C'est une histoire de dingue que fort peu connaissent. Une histoire
où l'aura de Paris, la capitale de la France, est censée avoir plus
de prestige qu’un petit village de Provence. Une histoire que
n’aurait pas renié Marcel Pagnol mais qu’aurait certainement détesté
celle à qui la vie avait appris l’importance de l’authenticité :
Edith Piaf.
Il y a 60 ans, Edith Piaf tirait son ultime révérence. Pas à Paris
comme certains ont voulu le faire croire à l’époque mais, dans le
sud, entre Grasse et Valbonne, dans le village de Plascassier dont
le nom signifie chemin boueux, en provençal.
Perché sur une colline à 300 m d’altitude, c'est là que la Môme a
choisi de poser ses valises. Dans une grande bastide qui est la
sienne : Les Parettes.
Une maison qui était en vente il y a quelques années
Usée par les excès
Elle est fatiguée, accablée par les hospitalisations à répétition,
usée par les excès de trop de misère, trop de luxe, l’alcool, la
morphine, les souffrances en tous genres dont son cœur est perclus
comme cette polyarthrite rhumatoïde qui ravage son corps.
On est le 10 octobre 1963. Aux côtés d’Édith, son infirmière, Simone
Margantin. Et puis, surtout, celle dont la présence à ses côtés se
compte en décennies, Danielle Bonel, sa dame de compagnie, sa
secrétaire, sa confidente, sa dernière amie.
Il est 13h 10. La bonne à tout faire, l’apprentie-crémière, la
chanteuse de cabarets et de bars a prostituées, la vedette de
music-hall, la veuve de Marcel Cerdan, la dénicheuse de talents,
l'actrice, la parolière, l’amoureuse inconditionnelle rend son
dernier soupir.
Rupture d'anévrisme due à une insuffisance hépatique.

Edith Piaf • © De Baecque et associés
Durant la nuit, en catimini, clandestinement...
À partir de là, un étrange scenario se met en place. Durant la nuit,
en catimini, clandestinement son corps va être transporté en toute
illégalité.
Objectif : faire croire qu'elle a fini sa vie dans sa ville natale,
Paris, pardon : Panam comme elle le chantait.
C’est la Mère Supérieure de la clinique de Cannes la Bocca qui prête
son ambulance et fourni le chauffeur. L’improbable attelage rejoint
dans le plus grand secret l’appartement parisien d’Édith, boulevard
Lannes.
Le lendemain, son médecin produit un faux certificat de décès
postdaté.
Claude Bernay de Laval indique que la chanteuse est décédée le 11
octobre à 7 heures du matin, le lendemain de la date réelle de la
mort de l'artiste de 47 ans, à Paris. Non à Plascassier.
À peine 6 heures après que son décès soit annoncé, c'est Jean
Cocteau avec qui la chanteuse entretenait une grande amitié et une
correspondance suivie, qui meurt à son tour.
Apprenant le départ d'Edith Piaf, Jean Cocteau avait déclaré :
"C'est le bateau qui achève de couler. C'est ma dernière journée
sur cette Terre. Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son
âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait, elle en jetait
l'or par les fenêtres."
Jean Costeau.
La presse s'emballe et publie la fausse nouvelle "Edith Piaf est
morte dans son lit, boulevard Lannes" . La chanteuse est
embaumée. Une photographie illustre l'article montrant le visage de
Piaf entouré d'un horrible foulard qui retient à peine son menton.
L'infirmière Simone Margantin entre dans le scénario mensonger en
racontant aux journalistes qu'avant de mourir, "Piaf était
lucide, gaie et pleine de projets de chansons".
Théo Sarapo autorise la foule, qui a pris d'assaut les grilles de
l'immeuble du boulevard Lannes, sitôt la nouvelle diffusée à la
radio, à entrer dans leur domicile. Des petits groupes de proches et
d’anonymes s’entassent auprès du cercueil de l’artiste posé sur un
catafalque dans le salon-bibliothèque. Incessamment pendant deux
jours, les femmes très majoritaires défilent tandis qu'au-dehors
s'entassent bouquets et gerbes de fleurs sur le trottoir.
L'organisation des obsèques quasi nationales a lieu le 14 octobre

L'organisation des obsèques d'Edith Piaf, quasi nationales a lieu
le 14 octobre.
Le convoi funèbre part très officiellement du domicile d’Edith Piaf
jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Un demi-million de personnes
est dans la rue.
L'inhumation a lieu sans cérémonie religieuse. La Môme Piaf,
divorcée a mené une vie sexuelle tumultueuse, et l’Église catholique
oppose son veto. Malgré tout et à titre strictement personnel
l’aumônier des artistes le père Thouvenin de Villaret, lui accorde
une dernière bénédiction au moment de l'enterrement.
Ce sont 40 000 personnes qui viennent lui rendre un dernier
hommage

Devant la fosse, Theo Sarapo, le mari et Louis Barrier
l'impresario d'Edith Piaf.
Rompant les barrages, la foule hystérique déborde le service
d'ordre, piétine les fleurs, se hisse sur les arbres et les
mausolées… Marlene Dietrich, présente, est effarée et Bruno
Coquatrix, le directeur général de l'Olympia, bousculé, tombe dans
la fosse.
Cette foule retiendra une dernière image : celle du fossoyeur qui a
déposé à côté du cercueil les objets fétiches de la chanteuse : un
lapin en peluche, un béret de marin, une cravate en soie verte, une
statuette de sainte Thérèse de Lisieux, une épaulette de
légionnaire, une carte postale de la chapelle de Milly-la-Forêt
portant une dédicace de l’ami Cocteau.
De Plascassier à côté de Grasse, nul mot ne sera soufflé. Ce n'est
que beaucoup plus tard que la vérité sera révélée. Trop tard sans
doute. Beaucoup sont ceux qui persistent à croire la légende qui
raconte que Cocteau le poète et Piaf, le moineau, sont morts le même
jour à Paris et dans la région parisienne.


On vous explique la différence entre la fourmi
de feu et la fourmi électrique
Écrit par Marie Joan
Il y a quelques jours, la fourmi de feu a été découverte
officiellement pour la première en Europe, en Italie. L'année
dernière, c'est la fourmi électrique qui avait été repérée à Toulon
dans le Var. On compare ces deux fourmis très différentes, mais qui
sont très souvent confondues.
Il y a de quoi s'emmêler les pinceaux entre ces deux espèces de
fourmis qui sont pourtant bien différentes. D'un côté la Solenopsis
invicta, fourmi de feu et de l'autre Wasmannia auropunctata,
l'électrique. Cette dernière est aussi renommée "petite fourmi de
feu" par les Anglosaxons, c'est ce qui peut prêter à
confusion...
Depuis quelques jours, la fourmi de feu fait beaucoup parler d'elle
et pour cause, elle a été officiellement aperçue pour la première
fois en Europe.
88 nids de cet insecte ont été découverts en Sicile.

Sa congénère électrique, a été repérée pour la première fois en
France, il y a un an, à Toulon (Var),
On vous explique leurs points communs et leurs différences pour
ne plus les confondre.
Des espèces exotiques envahissantes
Toutes deux font partie des espèces exotiques envahissantes. La
fourmi électrique a même été inscrite sur la liste des espèces
préoccupantes pour l'Union européenne. Leurs provenances
géographiques n'ont pas encore été arrêtées : États-Unis,
Amérique-Latine, Espagne, Chypre ou encore Israël... Des expertises
génétiques tentent toujours de déterminer leurs origines. Elles sont
probablement toutes deux arrivées par le biais de plantes mises en
pots.
Ces deux-là ont en commun de chambouler les endroits par lesquels
elles passent... "Elles impactent l'environnement, la
biodiversité, l'agriculture et elles engendrent des coûts
conséquents", explique Olivier Blight, enseignant chercheur à
l'université d'Avignon, et chercheur à l'Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale.

La grande fourmi de Feu, dite Solenopsis invicta. • © Enrico
Schifani
Ces deux fourmis ont une grande capacité "de colonisation de
l'espace, car elles ont plusieurs reines par nids et produisent
énormément d'ouvrières. Elles deviennent rapidement dominantes
et elles sont agressives. Elles monopolisent les ressources et
attaquent les fourmis locales", explique Olivier Blight.
Au-delà de s'en prendre à leurs cousines inoffensives et locales,
elles affectent toute la chaîne alimentaire en collectant de
nombreuses ressources, mais aussi en tuant. Toutes deux ont des
poisons puissants et elles n'hésitent pas à piquer leurs proies. "On
observe une baisse des arthropodes quand elles sont quelque part, ce
qui entraîne plus tard une baisse des vertébrés qui s'en
nourrissent, comme les lézards ou les oiseaux", ajoute
l'enseignant-chercheur. À terme, les plus gros animaux quittent
aussi ces zones infestées de fourmis, car constamment piqués par ces
dernières.
Les alliées des pucerons et des cochenilles
Ces deux espèces de fourmis sont aussi des grandes alliées des
pucerons et des cochenilles qui détruisent les cultures en se
nourrissant de la sève de ces dernières. Entre ses insectes une
relation de "donnant-donnant " se met en place. Les fourmis
se nourrissent d'une matière sucrée que rejettent cochenilles et
pucerons. "En contrepartie, les fourmis les protègent contre
leurs prédateurs, elles sont dans une optique : je m'occupe de toi
parce que tu contribues à me nourrir ", atteste Olivier Blight.
Les fourmis vont aussi directement compliquer le travail des
personnes qui travaillent dans les champs en les piquant, elles sont
l'équivalent du contact de la peau avec une ortie. Ces piqûres
laissent sur la peau d'importants petits boutons rouges et sont plus
conséquentes pour les fourmis de feu.
Elles peuvent être mortelles, à grande dose, pour les personnes qui
y sont allergiques.
Une étude sortie l'année dernière a estimé le coût des fourmis
envahissantes depuis 1930 et il s'élève à 51 milliards de dollars.
Un chiffre qui comprend à la fois les impacts directs et ceux liés à
l'éradication. L'enseignant-chercheur précise : " sur ses 51
milliards de dollars, 80% de la somme est imputée à ces deux fourmis".
Une taille et une dispersion différente
Ces deux fourmis, qui causent sensiblement les mêmes problématiques,
sont pourtant physiquement assez différentes. La fourmi de feu est
plus grande, elle peut faire de 2 à 5 mm et sa couleur tire sur le
rouge brun tandis que sa fausse jumelle est plutôt jaunâtre et
n'excède pas les 2 mm.
La fourmi de feu se disperse aussi beaucoup plus facilement et
efficacement et c'est bien là tout le problème... "Elle est
capable d'effectuer de longs vols nuptiaux de plusieurs kilomètres
pour se reproduire, sa progression est beaucoup plus rapide par
rapport à la fourmi électrique, beaucoup moins mobile, qui se
reproduit dans son nid ", complète l'enseignant-chercheur.
La différence se cache dans les détails... Les fourmilières ne sont
pas identiques non plus. La fourmi électrique niche dans des
endroits cachés, arbres, haies, sans véritablement construire de
nids.
Tandis que sa congénère niche sous terre en formant de grands
monticules.

En cas de doute, il est important de signaler ces deux fourmis pour
éviter qu'elles ne prolifèrent. Si certains pays savent comment les
éradiquer ce n'est pas encore tout à fait le cas de la France, une
expérimentation et une recherche de fonds sont toujours en cours
pour éliminer les fourmis électriques qui se trouvent dans le Var, à
Toulon.


Jean-Michel Ribes, Max Boublil, Tété... la
riche saison des Arts d’Azur au Broc

Après avoir rassemblé environ 5.000 spectateurs l’an dernier avec
une vingtaine de spectacles à l’affiche, la salle de ce village de
1.500 âmes propose une saison 2023-2024 attractive.
Jugez plutôt.
Bons mots, grand succès, mélange des genres…
Pour donner le coup d’envoi de leur nouvelle saison, Les Arts d’Azur
ont fait appel à l’auteur, metteur en scène et comédien Jean-Michel
Ribes (ci-dessus entouré de Manon Chirchen et Marie-Christine Orry)
qui débarquera ce 24 septembre avec "Carnet de la dernière pluie",
une plongée "mordante et drolatique" dans ses propres oeuvres.
Le 7 octobre, dans le cadre du Festival de créations organisé dans
la Métropole Nice Côte d’Azur, la Compagnie Alcantara et Isabelle
Bondiau-Moinet proposeront son adaptation de "Si tu mourais…", une
pièce écrite par Florian Zeller.
Le 14 octobre, Philippe Torreton, épaulé par le batteur Richard
Kolinka (ex-Téléphone) et le guitariste Aristide Rosier, joueront
"Nous y voilà". Sur fond d’electro-pop, l’homme de théâtre se
penchera sur notre rapport à la nature, avec des textes d’écrivains
français et amérindiens.
Le 12 avril, le multicarte Eric-Emmanuel Schmitt viendra au Broc
avec "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran".

Max Boublil
Vanneurs de tous horizons
Que ce soit sur Radio Nova ou France Inter, Djamil le Shlag s’est
imposé comme un vrai punchliner des ondes. Le voilà prêt à boxer
avec les mots sur les planches. Avec son premier one-man-show,
"Premier Round", il passera par Le Broc le 25 novembre.
Max Boublil, lui, a prévu d’emprunter des chemins plus intimes avec
"Maximilien", le 8 décembre. Il promet "une sincérité totale" et "un
lâcher prise qu’(il) n’a encore jamais exploré dans (sa) carrière".
Le 23 février, on changera encore de registre avec la performance de
Christelle Chollet. Pour "Reconditionnée", un show où la musique a
toujours sa place, elle deviendra Nabilou l’influenceuse, Ferdinand
le taureau ou encore une love coach.
Le 20 avril, Stan, de son côté, se posera une question: "Et si
les oeuvres d’art pouvaient parler ? ".
Une bonne occasion pour les sculptures et les tableaux d’observer
finement ceux et celles qui les scrutent sous tous les angles depuis
des siècles.

Faada Freddy. Photo Omar Victor Diop.
Reggae, soul et jazz de concert(s)
Aux Arts d’Azur, antre de 400 places (200 en version assis), la
musique occupera encore une place de choix. On commencera avec une
journée pédagogique, à la découverte du jazz. Le 10 novembre, Vibe
Quartet, mettra en lumière le vibraphone.
Le 18 novembre, on retrouvera Mike et Riké, les voix de Sinsemilia,
trois décennies de scène au compteur. Le duo promet un spectacle
"atypique et inclassable".
Le 2 décembre, les élèves de l’école de musique du Broc seront
réunis pour leur concert de Noël. Le 16 mars, place à leurs
professeurs.
De retour avec l’EP "Tables Will Turn", Faady Freddy fera entendre
sa voix digne des plus grands soulmen le 23 mars. Le Sénégalais
insiste sur sa patte "100% organique, 0% technologique".
Le 29 mars, une autre opportunité de basculer dans un versant
folk-soul, avec Tété. Un artiste discret, mais suivi par un public
fidèle depuis plus de 20 ans.
Le 25 mai, il flottera un petit air de Bueno Aires au-dessus du
village durant "Monumental Tango". Sur scène, la pianiste Lucia
Abonizio, le joueur de bandonéon Gilberto Pereyra et le chanteur
Gilles San Juan seront accompagnés de trois danseurs (Karine
Soucheire, Sophie Raynaud et Jean-Franois Dubourg). Le 1er juin,
nouvelle journée dédiée au jazz, avant une date consacrée aux
percussions, le 8 juin.
Les Arts d’Azur, 12 rue des Jardins, Le Broc.
Rens. 04.92.08.27.30. Programme et tarifs détaillés sur
lesartsdazur.net

Carte jeunes entre contes, magie et humour
Le 27 octobre, Emilie Pirdas et Stéphane Eichenholc donneront vie à
"La Sorcière du placard à balais", histoire issue des "Contes
de la rue Broca" de Pierre Gripari, à savourer dès 4 ans.
Le 28 février, trois conteuses de la Compagnie Alcantara
embarqueront les enfants (dès 3 ans) avec des histoires "venues
d’ailleurs, parfois sans âge".
Le 25 avril, la Compagnie Sens en éveil mêlera magie, humour et
aventure dans un show intitulé "La Cité perdue", pour enfants
de 5 ans et plus.


La liste des 51 sites d'exception classés au
patrimoine mondial de l'Unesco en région Occitanie et en France

Le centre historique d’Avignon fait aussi partie des monuments
classés en région
Au lendemain de l'annonce historique de l'entrée de la Maison
Carrée de Nîmes au patrimoine mondial de l'Unesco, retour sur les
trésors culturels et naturels en région Occitanie et en France.
Avec l'ajout de la Maison Carée de Nîmes à la liste des sites et
monuments d'exception classés au patrimoine mondial de l'Unesco, la
région Occitanie compte désormais fièrement 13 biens inscrits à la
prestigieuse liste des merveilles mondiales :
Le centre historique d’Avignon, comprenant le Palais des papes,
l'ensemble épiscopal et le Pont d’Avignon
Arles, ses monuments romains et romans
Le Pont du Gard
Le canal du Midi
Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen
La ville fortifiée historique de Carcassonne
La cité épiscopale d'Albi
Les fortifications de Vauban
La grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc,
Ardèche
Le théâtre antique et ses abords et "Arc de Triomphe" d'Orange
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
Pyrénées - Mont Perdu
La Maison Carrée de Nîmes
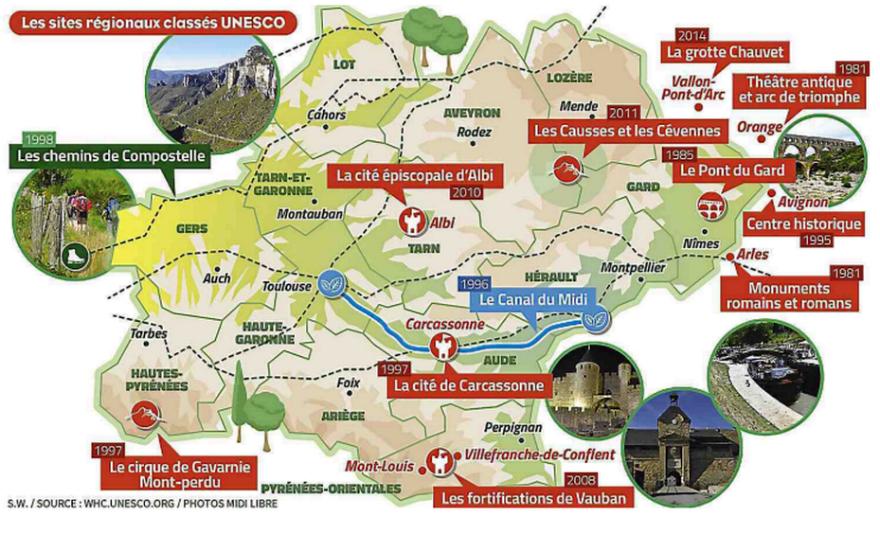
Les sites régionaux classés Unesco
51 sites en France
Avec ses 51 merveilles, la France n’a pas à rougir de son patrimoine
culturel qui fait de l’hexagone le troisième territoire européen et
quatrième pays au monde à abriter le plus de sites classés. Elle
talonne ainsi l'Allemagne (52), derrière la Chine (57) et
l'indétrônable championne l'Italie (58).
Basilique et colline de Vézelay
Cathédrale de Chartres
Mont-Saint-Michel et sa baie
Palais et parc de Versailles
Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère
Abbaye cistercienne de Fontenay
Cathédrale d'Amiens
Palais et parc de Fontainebleau
De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale
d’Arc-et-Senans, la production du sel ignigène
Abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe
Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de
Scandola
Places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à Nancy
Strasbourg, Grande-Île et Neustadt
Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau,
Reims
Paris, rives de la Seine
Cathédrale de Bourges
Site historique de Lyon
Beffrois de Belgique et de France
Juridiction de Saint-Émilion
Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes
Provins, ville de foire médiévale
Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret
Bordeaux, Port de la Lune
Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres
régions d’Europe
Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes
associés
Pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion
Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes
Bassin minier du Nord-Pas de Calais
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Les Climats du vignoble de Bourgogne
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution
exceptionnelle au Mouvement Moderne
Taputapuātea
Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de Limagne
Terres et mers australes françaises
Le phare de Cordouan
Les grandes villes d’eaux d’Europe
Nice, la ville de la villégiature d’hiver de riviera
Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la
Martinique
Au total à l'échelle mondiale ce sont 1185 sites - 924 sites et
monuments culturels et 222 sites naturels, 39 sites dits mixtes -
qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.
Ils en rêvent aussi en région…
Plusieurs sites en région Occitanie ambitionnent aussi une
inscription à l’Unesco. Le prochain dossier susceptible d’être
examiné est celui des châteaux sentinelles cathares de l’Aude. Cette
série de sept fortifications, jusqu’à la cité de Carcassonne,
témoigne de la conquête du Languedoc au XIIIe siècle. En 2017, le
ministère de la Culture a validé leur inscription sur la liste
indicative des biens français candidats à l’Unesco.
Le pic du Midi, en Hautes-Pyrénées, a aussi franchi cette étape
importante en 2022. Cet observatoire scientifique pionnier est parmi
les plus anciens et l’un des plus remarquables par sa position au
sommet d’un pic rocheux escarpé et sa fonction scientifique n’a
jamais cessé d’être et de se renouveler jusqu’à aujourd’hui.
La Camargue fait partie de cette liste indicative depuis 2002 mais
le dossier n’a jamais évolué. Il vient tout juste d’être relancé par
un riziculteur gardois, Bernard Poujol, qui met en avant cette vaste
zone humide aux écosystèmes variés façonnée par l’Homme depuis
toujours. Seulement deux deltas sont aujourd’hui inscrits à l’Unesco
: le Danube en Roumanie et l’Okavango au Botswana. Le processus
débute tout juste, le chemin sera donc très long.
Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, avait aussi évoqué
l’idée lors de sa campagne de 2020, avec un dossier centré sur les
huit siècles d’histoire de la botanique et de la médecine de la
ville.
Aujourd’hui, un travail est finalement engagé pour porter une
candidature pour l’inscription des collections documentaires liées
aux sciences médicales au registre international de la “Mémoire du
monde” de l’Unesco.


Arthrose : "Demain, avec un film hydrogel enrichi en cellules
souches, on régénérera le cartilage"
Dix millions de Français souffrent d'arthrose, une maladie
articulaire qui conduit à la destruction du cartilage et qui touche
un patient sur trois avant l'âge de 40 ans. Avec la création, en mai
dernier, d'un institut hospitalo-universitaire (IHU) dédié aux
maladies auto-immunes et aux immunothérapies innovantes, Montpellier
est un pôle de pointe de recherche sur cette affection qui fait
l'objet de sensibilisation pour la journée mondiale du 17 septembre.
Le professeur Christian Jorgensen, rhumatologue, dirige l'IHU de
Montpellier qui héberge un institut de l'arthrose unique en France.

Le professeur Christian Jorgensen évoque les pistes futures de
prise en charge. MIDI LIBRE - KATYA SHABUT
Pour commencer, il faut rappeler que l'arthrose ne touche pas que
des personnes âgées...
Tout à fait. Je vois des familles et des patients qui développent de
façon précoce ce type de pathologie.
C'est lié à quoi, c'est génétique, c'est une question de mode de
vie, d'activité sportive ?
C'est très souvent multifactoriel. Il y a clairement des éléments
génétiques, il y a des gens qui ont une susceptibilité accrue à
cette pathologie, et ensuite le surpoids, une activité physique
inadaptée ou trop intensive qui s'avère délétère...
Quels sont les traitements qui marchent aujourd'hui ?
Il y a des évolutions sensibles dans la prise en charge. Et la
recherche avance à son rythme...
Quelles sont les possibilités ?
On peut faire ce qu'on appelle de l'orthobiologie, des traitements
biologiques en orthopédie qui consistent à faire des injections de
PRP (plasma riche en plaquettes), ou des injections de cellules
souches mésenchymateuses (NDLR : ce sont des cellules régénératrices
qui stimulent la réparation du cartilage et diminuent
l'inflammation), ou d'acide hyaluronique, et des combinaisons de
tout ça qui permettent de stabiliser des sujets.
Ce sont des approches qui sont intéressantes et qui sont encore en
recherche clinique pour les thérapies cellulaires, mais qui sont
pertinentes, avec de plus en plus de progrès. Les produits
biologiques s'améliorent par étapes. On arrivera à des choses
intéressantes.
La mobilisation de l'industrie pharmaceutique
Et il y a des innovations.
Oui, par exemple les facteurs de croissance avec la sprifermine.
C'est le facteur de croissance FGF-18, en recherche clinique, mais
quand même en phase 3, et porté par l'industrie pharmaceutique, ça
va aboutir.
Le traitement sera basé sur des injections ?
Exactement. Des injections locales. Mais l'avantage de
l'articulation, c'est que c'est accessible. On peut faire des
injections répétées de facteurs de croissance qui stimulent
l'expansion des cellules du cartilage.
Dans un premier temps, cela se fera dans des centres spécialisés
parce que ce sont quand même des traitements qui vont avoir un coût
important et il faudra cibler les patients au mieux sur un plateau
technique qui permet d'avoir une analyse quantitative de la marche,
une imagerie performante de type IRM mais en charge pour le genou et
la hanche, et d'avoir un tapis de marche pour avoir des mesures
précises.
Cette analyse technique du mouvement ne peut pas se faire partout
sur le territoire.
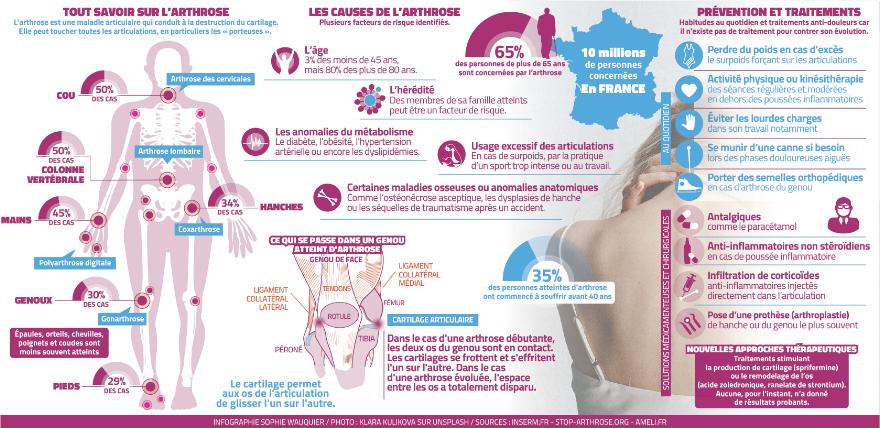
Tout comprendre sur l'arthrose.
On y est, c'est pour demain, ou à horizon beaucoup plus lointain
?
Non, ça, c'est pour demain. L'industrie pharmaceutique finalise les
phases 3 avec des milliers de patients. Après, ça va vite, avec les
autorisations de mise sur le marché et reste à caler le prix.
Vous le faites à Montpellier ?
On participe à des essais cliniques.
Et vous constatez des résultats probants ?
C'est assez difficile à dire car quand il y a un essai clinique
comme ça, il y a 100 centres dans le monde et on ne peut pas donner
de conclusions hâtives car les essais se font en aveugle sous
placebo, une partie des patients ne reçoit pas le traitement.
Anticorps monoclonaux : "Des patients se sont aggravés sous
traitement"
La recherche sur l'arthrose semble compliquée par le fait qu'il
n'y a pas une mais plusieurs maladies sous cette même appellation...
Tout à fait. Il y a les arthroses précoces, et ce qu'on appelle les
condrolyses (NDLR : dégradation du cartilage, souvent après un choc
traumatique), les chondrocalcinoses (NDLR : dépôts de pyrophosphate
de calcim au niveau des cartilages)...
L'utilisation de facteurs de croissance est le traitement le plus
prometteur ? On trouve aussi, dans les publications scientifiques,
des pistes d'avenir diverses, qu'il s'agisse de la stimulation du
nerf vague, de l'utilisation de piment ou des anticorps monoclonaux.
Il y a des stratégies antidouleur dans lesquelles entrent les
dérivés du piment, qu'on applique sur la peau, ou la stimulation du
nerf vague, une stratégie de neurostimulation qui peut être
intéressante pour son effet antalgique. Mais ça ne change pas le
pronostic et il n'y a pas de régénération du tissu.
Sur les anticorps monoclonaux (NDLR : anticorps thérapeutiques
produits en laboratoire sur le modèle des anticorps naturellement
produits par l'organisme pour traiter des maladies), il faut parler
de cet anticorps monoclonal anti-récepteur NGF qui avait un effet un
effet très significatif sur la douleur. Mais on s'est aperçu qu'il y
avait des patients qui s'aggravaient sous traitement parce qu'ils
n'avaient plus mal, ils forçaient plus.
Un effet analgésique trop puissant peut être un piège et
contre-productif.
L'intérêt principal reste la régénération du cartilage, c'est ça
qu'il faut arriver à faire...
C'est ça. Et la voie actuelle est biologique, en ciblant des
cellules du cartilage, ça peut être des facteurs de croissance, des
ARN, des anticorps monoclonaux de stimulation ou de la thérapie
cellulaire, c'est plus dans ce sens-là qu'on travaille.
"Une amélioration sensible"
Vos équipes travaillent depuis des années sur la thérapie
cellulaire.
On conduit plusieurs études. Il a d'abord fallu montrer la sécurité
d'emploi, c’est-à-dire l'absence de réaction négative. Ensuite, on
s'est aperçu dans les études que la stratégie de faire de
l'autologue, c’est-à-dire d'utiliser les propres cellules du
patient, ou de faire de l'allogénique (NDLR : avec un donneur),
c'est la même chose. Et on a constaté que ça marchait bien chez des
patients à un stade très précoce mais que ça ne marchait pas très
bien sur des patients avec une arthrose à un stade tardif.
Il y a aussi une difficulté dans toutes ces études, l'effet placebo
: même les groupes de patients recevant des injections avec du sérum
salé ressentaient une amélioration sensible.
Ce traitement sera, quoi qu'il en soit, réservé aux formes
précoces de la maladie...
Oui.
Quel est le traitement qui vous paraît le plus prometteur ?
Un produit en développement : il s'agit d'un film hydrogel
transparent dans lequel il y a des produits biologiques, des
cellules IPS (NDLR : cellules souches pluripotentes induites,
capables de s'auto-renouveler et de se différencier en n'importe
quelle cellule spécialisée de l'organisme) qui ont la capacité
complète de régénération des tissus.
Sous arthroscopie, on déposera un film qui va recouvrir la surface
du cartilage à régénérer, et il régénérera les tissus. C'est ce
qu'on attend. Pas que nous, beaucoup d'équipes dans le monde sont
mobilisées sur cette recherche. Il y a beaucoup d'études sur le
sujet, qu'il s'agisse de toxicologie, ou de stabilité cellulaire.


Coupe du monde de rugby 2023. Pourquoi les
rugbymen, dont les Bleus, portent-ils ces drôles de casquettes ?

Dans le jargon du rugby, on dit qu'un joueur sélectionné pour une
compétition internationale est "capé. Comme ici, les joueurs de
l'Equipe de France. • © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Dans le jargon du rugby, on dit qu'un joueur sélectionné pour une
compétition internationale est "capé". Mais d'où vient cette
expression ?
On a trouvé l'explication dans les allées du Musée national du
sport, à Nice.
La ville de Nice s'apprête à vivre au rythme de la Coupe du monde de
rugby, qui se tient en France de ce 8 septembre au 28 octobre. La
capitale azuréenne hébergera quatre matchs de la compétition au
stade Allianz Riviera, les 16, 17, 20 et 24 septembre.
Ce mercredi 6 septembre, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de
France, a dévoilé la composition de l'équipe qui affrontera les All
Blacks en match d'ouverture. En tout, 33 joueurs ont été appelés
dans l'équipe de France pour la compétition internationale.
Dans le jargon du ballon ovale, on dit qu'un joueur ainsi
sélectionné en équipe nationale est "capé". Ainsi, le Gallois
Alun Wyn Jones est le rugbyman le plus "capé" du monde. Il
totalise 158 sélections en équipe internationale, un record absolu.
Mais pourquoi cette expression, exactement ?
On a trouvé l'explication dans les allées du
Musée
national du sport, à Nice.

Une casquette pour les joueurs
"Un joueur capé, c'est un joueur qui commence sa carrière
internationale", résume Thomas Fanari, chef du développement du
musée. L'expression vient d'un vêtement porté historiquement par les
rugbymen.
Aux débuts de l'histoire du rugby, dans l'Angleterre des années
1880, les joueurs anglais devaient se présenter aux matchs en
arborant une casquette – "cap", en anglais – aux couleurs de
leur équipe. La tradition s'est étendue à d'autres équipes dans le
monde, à l'instar des équipes françaises et néo-zélandaises. Un
joueur qui rejoignait une équipe était donc "capé", en
référence au couvre-chef qu'il
La pratique ne se limitait pas au rugby, "mais le rugby est le
seul sport où la tradition s'est perpétuée", raconte Thomas
Fanari. Aujourd'hui, seuls les joueurs au ballon ovale se voient
encore offrir une casquette lors de leur sélection dans une équipe,
qu'ils portent lors des cérémonies.
Le Musée national du sport, voisin du stade Allianz Riviera, à Nice,
en expose plusieurs, datées du début du siècle dernier.

Des casquettes de rugbymen et un maillot historique du XV de
France, exposés au Musée national du sport, à Nice, le 6 septembre
2023. • © Baptiste Renaut / France Télévisions
Aujourd'hui, l'expression s'applique surtout aux sélections de
joueurs en compétition internationale, comme la Coupe du monde de
rugby. Le joueur français le plus "capé" est Fabien Pelous,
avec 118 sélections en compétitions internationales.
Depuis le 8 septembre et pendant toute la compétition mondiale, le
Musée national du sport accueille dans son hall d'entrée une
exposition gratuite sur l'histoire de la Coupe du monde de rugby.
Les "caps", elles, peuvent être découvertes dans la
collection permanente du musée.


Gérald Darmanin annonce une nouvelle brigade
antidrogue : Nice première ville à la tester en France
Le ministre de l'Intérieur était en visite à Nice ce mardi 12
septembre, quatre jours après une fusillade dans le quartier des
Moulins. Il a annoncé l'arrivée en novembre à Nice d'une nouvelle
brigade chargée de "faire de l’investigation" sur les trafics
de drogue.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en visite dans
les Alpes-Maritimes, notamment ce ce mardi après-midi à Nice après
un passage à Marseille dans la matinée.
Le ministre a annoncé la création d’une nouvelle brigade de police
chargée de "faire de l’investigation" sur les trafics de
drogue. Basée à Paris, cette unité sera déployée à Nice dès novembre
pour y effectuer sa première mission, a affirmé Gérald Darmanin.
La brigade sera composée "d'officiers de police judiciaire
spécialisés, à compétence nationale", indique le ministre. Ces
policiers "pourront être envoyés pendant plusieurs semaines sur
un territoire pour aider des territoires locaux, pour lutter
profondément contre la drogue", a-t-il informé, précisant que
les effectifs de cette unité doivent encore être recrutés.
Nice sera la première ville à bénéficier de cette
expérimentation.
Le ministre de l'Intérieur est arrivé peu après midi devant le
chantier du futur Hôtel des polices Saint-Roch, dans le
centre-ville, où il a été accueilli par le maire (Horizons) de Nice,
Christian Estrosi et le député (Horizons) des Alpes-Maritimes
Philippe Pradal.
Cette visite intervient au lendemain du déploiement à Nice de la CRS
8, une unité de police spécialisée dans les violences urbaines et la
lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin avait annoncé ce
déploiement samedi 9 septembre, au lendemain d'une fusillade ayant
fait deux blessés dans le quartier niçois des Moulins, réputé
sensible.
Plus d'effectifs à la frontière italienne
Ce mardi, le ministre s'est également déplacé dans la commune de
Vallauris et à la frontière franco-italienne à Menton. Il avait
annoncé le matin même dans une interview à Nice-Matin le doublement
des effectifs des forces mobiles à la frontière italienne, en plus
du doublement du nombre de militaires de l'opération Sentinelle sur
place. Des drones ont aussi été déployés à la frontière, a-t-il
indiqué.
Le ministre de l'Intérieur a aussi fait l'annonce de l'affectation,
à partir de l'automne, de 400 jeunes policiers tout juste sortis
d'école aux Compagnies républicaines de sécurité (CRS). Une partie
de ces effectifs sera en activité en région PACA. "C'est un
effort inédit ", confie-t-on dans l'entourage du ministre.
Les compagnies de CRS sont des unités de police chargées du maintien
de l'ordre et de la sécurité.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reçu à son arrivée par
le maire de Nice, Christian Estrosi.
"Il n’y a aucune ville où la collaboration entre l’état et la
municipalité en matière de police est aussi efficace", s'est
réjoui Gérald Darmanin. "Si Nice ne s’est pas embrasée comme
d’autres villes, c’est aussi grâce à notre action commune", a
affirmé le maire de Nice, faisant référence aux émeutes ayant pris
place en juillet dans plusieurs grandes villes en France, mais qui
ont été relativement moins violentes dans la capitale azuréenne que
dans d'autres métropoles.
Gérald Darmanin s'est rendu dans l'après-midi à la Villa Massena,
sur la promenade des Anglais, à Nice, où a eu lieu une cérémonie en
l’honneur des forces armées, de sécurité et de secours ainsi qu'une
remise de décorations de plusieurs membres de ces mêmes forces.
Plus tôt, à Marseille, le ministre a annoncé l'arrivée de renforts
de police dans la cité phocéenne, notamment d'une nouvelle unité de
CRS en novembre.


Coupe du monde de rugby 2023 : "caramel", "cuillère", "chistera"...
le glossaire des gestes pour comprendre un match

"Offloads" et "chistera", l'ouvreur français Romain Ntamack
maîtrise les deux à la perfection, ici contre le Pays de Galles lors
du Tournoi des VI Nations 2023
Éviter les "pizzas " mais enchaîner les "caramels",
réussir une "cuillère" mais ne pas faire de "cathédrale
" : tantôt bâtisseurs, parfois cuisiniers, les joueurs devront
maîtriser les gammes du jargon truculent du rugby s'ils veulent
soulever le titre lors du Mondial.
Pour les "déménageurs de pianos" ou les "gros", à
savoir les huit joueurs de devant, qui portent de moins en moins
bien ce dernier surnom à mesure que le professionnalisme gagne ce
sport, tout commence aux fourneaux.
"Cartouche" et "tampon"
Pas question pour le talonneur de "lancer une pizza" en
touche, au risque de perdre la balle qui atterrirait dans les mains
d'un adversaire après un lancer hasardeux. Mieux vaut la conserver
au chaud dans une "cocotte", où François Cros, Paul Willemse
et les autres avants bleus pousseront en entourant le porteur du
ballon.
Si le temps des "fourchettes", geste vicieux consistant à
mettre ses doigts dans les yeux de l'adversaire, ou celui des "salades
de phalanges" à savoir des coups de poing, est bien révolu, on
attend des avants qu'ils mettent un "arrêt-buffet " en
distribuant des "caramels", des plaquages dévastateurs aussi
appelés "tampons" ou "cartouches".
Parfois maladroit, l'avant peut se retrouver à envoyer un "parpaing",
une passe "dans les chaussettes" mal ajustée que son
coéquipier plus agile tentera de rattraper.
Mais jamais un joueur ne peut réaliser un plaquage "cathédrale", en
retournant son adversaire de manière à ce qu'il retombe la tête vers
le sol, au risque de l'expulsion définitive. Lorsqu'il est privé du
ballon, charge à lui d'être présent au "grattage" au sol pour le
récupérer à la force des biceps, domaine où la France brille avec
son talonneur Julien Marchand ou le N.8 Gregory Alldritt.
"Chistera" et "pas de l'oie"
Une fois les jambes alourdies par ce combat, les espaces s'ouvrent
et avec eux débarquent la panoplie des beaux gestes techniques.
D'une seule main, l'ouvreur Matthieu Jalibert et les autres arrières
envoient acrobatiquement une "chistera" dans leur dos,
tentent de passer leurs adversaires sur un "cad deb", ou "cadrage
débordement ", changement brusque d'appui que réussit
régulièrement avec brio l'ailier Damian Penaud.
Plus rare, il peut tenter un "pas de l'oie", une feinte dont
le faux pas d'arrêt trompe l'adversaire, geste immortalisé par
l'ancien ailier australien David Campese.
Faire des "offloads" mais pas des "cravates"
Sport né en Angleterre, le rugby regorge de termes directement tirés
de la langue anglaise, comme "l'offload " ou passe après
contact, où le joueur parvient à donner la balle alors même qu'il
est plaqué.
Aidé d'une "croisée", où la course sans ballon d'un
coéquipier trompe le défenseur, ou d'un bon "raffut " pour
écarter de la main son vis-à-vis, un joueur perce enfin : mais gare
à la "cuillère" d'un adversaire qui, d'un plongeon, rattrape
le pied de son adversaire pour le déséquilibrer et le faire chuter.
À moins qu'un dernier défenseur, dans un geste désespéré et illégal,
ne gratifie le porteur de balle d'une "cravate" en envoyant
son avant-bras en pleine figure plutôt que de le voir arriver en "terre
promise", à savoir l'en-but.
Des "chandelles" à la "troisième mi-temps"
Si le jeu reste fermé et que les occasions se font rares, les demis
de mêlée usent et abusent des "coups de pied dans la boîte",
qu'ils tapent eux-mêmes depuis l'arrière d'un regroupement. Ils
peuvent aussi laisser le soin à leur ouvreur de monter des "chandelles"
les plus hautes possibles pour éclairer la voie... et espérer que
l'adversaire rate la réception de ce ballon haut.
Quand le tableau d'affichage affiche 80 minutes, si tout s'est bien
passé, et que l'arrière Thomas Ramos et les autres buteurs ont "enquillé"
les pénalités en les passant entre les perches, place à la "troisième
mi-temps". Où ce sont des verres que les joueurs enquilleront
cette fois, lors des mémorables libations qui accompagnent les
titres comme les défaites au rugby.


Coupe du monde de rugby 2023 : durée, barème de
point, tirs au but... tout ce qu'il faut savoir pour comprendre un
match

Le Français Damien Penaud en train d'inscrire
un essai contre les All Blacks en 2021
Du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre 2023 se déroule la
Coupe du monde de rugby en France.
Barème de point, déroulement d'un match, essais
et tirs au but... toutes les informations à savoir.
La Coupe du monde de rugby commence ce vendredi 8 septembre. Après
quatre ans d'attente les Bleus seront-ils prêts pour se hisser
jusqu'en finale et remporter pour la première fois la plus
prestigieuse des compétitions internationales ? Réponse le 28
octobre prochain. En attendant, voici toutes les informations
pratiques à connaître pour passer un bon moment devant sa
télévision.
Le fonctionnement d'un match
Au rugby, deux équipes de quinze joueurs s'affrontent sur un terrain
d'environ 100 mètres de long pour 70 mètres de large. Chaque équipe
est constituée de huit avants et de sept arrières. Il faut y ajouter
les huit remplaçants, le plus généralement cinq avants et trois
arrières ou six avants et deux arrières.
Un match dure 80 minutes avec deux mi-temps de 40 minutes. La
mi-temps dure, elle, jusqu'à quinze minutes.
Essai, drop, pénalité... le barème de points
Au rugby, il y a quatre manières de marquer des points : les essais,
les transformations, les pénalités et les drops.
Lorsqu'un joueur aplati le ballon dans l'en-but adversaire, il y a
essai. Cela vaut 5 points.
Après l'essai, une transformation peut permettre d'ajouter 2 points
supplémentaires dans la musette. Le buteur de l'équipe qui a marqué
l'essai doit passer un coup de pied entre les perches. Ce coup de
pied doit être tiré dans l'alignement dans lequel a été aplati le
ballon lors de l'essai.
Petite subtilité, il existe l'essai de pénalité. Il est accordé
lorsque, selon l'arbitre, "un essai aurait probablement été
marqué (ou marqué dans une position plus avantageuse) sans un acte
de jeu déloyal commis par un adversaire", écrit World Rugby,
l'organisme international qui gère le rugby à XV.
Lorsque l'arbitre siffle une faute contre une équipe. L'autre équipe
subissant la faute a plusieurs opportunités de jeu, parmi elles "prendre
la pénalité". Le buteur pose alors le ballon sur un tee,
lui-même posé sur le sol, à l'endroit où a eu lieu la faute. Il doit
alors taper dans le ballon et le faire passer entre les perches.
Cette action rapporte 3 points.
Enfin, il existe le drop qui rapporte également 3 points. C'est
quand "le ballon, après avoir été délibérément lâché de la ou des
mains d'un joueur, touche le sol et est botté lors son ascension
après le premier rebond ", indique World Rugby.
Barème de points pour un match de poule
Pour une victoire, une équipe marque 4 points, 0 en cas de défaite.
Un point est attribué à une équipe si elle marque quatre essais ou
plus durant un match, c'est le bonus offensif. À l'inverse, il
existe aussi le bonus défensif. L'équipe perdante marque ce point
supplémentaire si elle s'incline avec sept points d'écart ou moins.
Un match nul vaut deux points.
Le fonctionnement de la compétition
Vingt équipes participent à la dixième Coupe du monde de l'histoire.
Elles sont réparties dans quatre poules de cinq. À l’issue des
quatre journées de la phase de poule, les deux équipes de chaque
poule avec le plus de points sont qualifiées pour les quarts de
finale. S'ensuit les demi-finales puis la finale, sans oublier la
petite finale pour la troisième place.
Prolongation, tirs au but... les issues d'un match à élimination
directe
Lors de la phase finale, si un match se termine sur une égalité
après les 80 minutes de temps réglementaires, il y a alors une
prolongation de 20 minutes (deux fois dix minutes). Si au terme de
la prolongation, il y a toujours égalité, c'est l'équipe avec le
plus d'essais qui remporte la partie. Si le nombre d'essais est le
même pour les deux équipes, une séance de tirs au but est alors
organisée.
"Cinq tirs au but sont frappés par cinq joueurs différents depuis
la ligne des 22 mètres. Facile. Sauf que la 1ère et 4e tentative
s'effectuent dans l'axe des poteaux ; la 2e et la 5e à gauche ; la
3e à droite", précise le journaliste spécialisé David Reyrat
dans les colonnes du Figaro.


"Une bonne partie des glaciers sont déjà
condamnés" : comment le réchauffement climatique accélère leur fonte

La fonte des glaciers - ici l'Upsala, en
Patagonie - contribue pour un quart à l'élévation du niveau des mers
Ils ont perdu un tiers de leur volume dans les Alpes depuis 2000,
ils auront disparu des Pyrénées d'ici 2050. Les glaciers sont les
victimes évidentes de la hausse des températures, qui va emporter
irrémédiablement les plus petits d'entre eux, avec des impacts forts
sur le niveau des mers.
Sous les arêtes de Vignemale, à cheval sur la frontière avec
l’Espagne, Ossoue est le plus grand glacier des Pyrénées françaises,
mais il est en sursis. "Il ne se régénère pas depuis des années,
glisse Pierre René, il se démantèle, se perce, la roche apparaît,
son allure n’est plus celle d’un glacier comme on peut en voir dans
les livres." Longueur, surface, épaisseur, le glaciologue
installé à Bagnères-de-Luchon mesure et suit les variations du
volume de glace depuis plus de deux décennies ; il y était le 6 août
et encore ce mardi : "Le glacier d’une vingtaine d’hectares a
perdu plus de deux mètres d’épaisseur de glace en un mois, sept
centimètres par jour. Les gens que j’accompagnais étaient
stupéfaits."

Le glacier pyrénéen Ossoue a perdu deux mètres
d'épaisseur durant le seul mois d'août 2023. PIERRE RENÉ/ASSOCIATION
MORAINE
Ossoue est condamné. Comme le glacier d’Aneto ont conclu les
scientifiques espagnols auteurs d’un article publié le 8 août, qui
rapportent à son propos qu’au cours des quarante et une dernières
années "la surface totale glaciaire a diminué de 64,7 % et
l’épaisseur de glace de 30,5 m en moyenne". Il en reste moins de
douze. En 2021, cette même équipe, à laquelle Pierre René était
associé, avait écrit qu’il ne subsisterait des cinquante-deux
glaciers listés en 1850 – une quarantaine au tournant du millénaire
–, dans le massif pyrénéen, que des tâches résiduelles "d’ici
vingt ans".
Oraison funèbre
"Chaque année est pire que la précédente, soupire le
Haut-Garonnais. La tendance se poursuit, voire s’amplifie et l’on
s’approche de la disparition totale et complète" et ce n’est pas
exclusif aux Pyrénées, bien sûr. Dimanche, à L’Alpe-d’Huez, on a
prononcé l’oraison funèbre du glacier de Sarennes, dont les
caractéristiques ne sont pas si différentes de ses cousins du Midi.
Avec eux, il partage une dimension similaire, une altitude
inférieure à 3 000 m, c’est un glacier de petite taille et "en
nombre, c’est l’essentiel des glaciers" de la planète, observe
Étienne Berthier, glaciologue, spécialiste des effets du changement
climatique sur les glaces continentales, c’est-à-dire calottes
polaires et glaciers.
Son diagnostic est sans appel : "Une bonne partie des glaciers
sont déjà condamnés. Le réchauffement a été tellement rapide que
même si demain la température n’augmente plus, scénario parfaitement
irréaliste, ils vont continuer de perdre de la masse, parce qu’ils
sont en déséquilibre fort avec un climat qui a changé trop vite."
267 gigatonnes d’eau
Directeur de recherches CNRS rattaché à un laboratoire partagé avec
l’Université de Toulouse, Étienne Berthier analyse via l’imagerie
satellitaire l’évolution de la masse des glaciers depuis 2000, dont
la perte "va s’accélérant, dit-il. Le virage un peu fort s’amorce
au début des années quatre-vingt-dix."
Durant ce quart de siècle, les glaciers ont perdu "environ 4 % de
leur masse". Une moyenne, la situation étant très variable d’une
région glaciaire à l’autre, plus marquée sous nos latitudes moyennes
qu’en Arctique, par exemple, où le réchauffement est pourtant quatre
fois plus rapide que la moyenne de la Terre. Ainsi, dans les Alpes,
"ils ont perdu un tiers de leur volume, c’est énorme. 6 % en
2022, avec les séries de canicules. C’est hors-norme, les
glaciologues étaient médusés, on ne pensait pas voir cela durant
notre carrière."
Cet effacement des glaciers, dont la période de fonte se rallonge, a
des impacts sur "la biodiversité, parce qu’ils abritent des
espèces spécifiques, explique Pierre René. Sur les paysages
de haute montagne dont ils sont le symbole et l’accès à la montagne,
rendu plus difficile là où ils ont disparu. Ils sont une sorte de
marchepied."

Ces "lanceurs d’alerte des problématiques du changement climatique"
sont aussi dans certaines régions du monde des châteaux d’eau "importants
pour la ressource en eau ", souligne Étienne Berthier. Qui
insiste sur la part de responsabilité, 25 %, de leur fonte dans
l’élévation du niveau de la mer. "Ce sont 267 gigatonnes d’eau
par an, l’équivalent de la France métropolitaine recouverte chaque
année par 50 cm de glace qui fondent et partent à la mer. Il y a
urgence à agir pour limiter la hausse de température" et que les
plus gros ne partent à leur tour à vau-l'eau.


Tramways, bus... On fait le point sur les
nouveautés du réseau Lignes d'Azur en vigueur dès lundi
Comme chaque année, des nouveautés sont attendues dans les
transports en commun métropolitains. Des nouvelles lignes de bus
sont notamment lancées.
Nice-Matin fait le point.
À partir de lundi, de nombreux changements seront opérés sur le
réseau Lignes d’Azur.
A Nice
- La ligne 2 du tramway, qui relie Port Lympia au Cadam et à
l’aéroport, sera renforcée avec deux rames supplémentaires.
- Une nouvelle ligne 98 desservira les quartiers du Port, du Vieux
Nice, de la place Masséna et de Garibaldi.
- La ligne 30 bénéficiera de trois nouveaux arrêts de bus aménagés
courant septembre, rue Auguste Gal: "Place Arson", "Barbéris",
"Pierre Sola".
- La ligne 34 desservira le bas de l’avenue de Fabron, le Parc Carol
de Roumanie ainsi que le musée d’art naïf grâce à la création de
deux nouveaux arrêts: "Parc d’Indochine" et "Carol de Roumanie /
Musée d’art naïf".
- Un nouvel arrêt de bus "Raccourci de Saint-Pancrace", situé 24
chemin du Col de Bast, sera créé sur la ligne C12.
- La ligne express 2, qui relie Pont Michel à la rue 17ter, sera
renforcée avec trois passages par jour supplémentaire. Des
doublements de bus seront également mis en place sur les horaires
les plus fréquentés.
Dans la Métropole
- Une ligne express 4 sera mise en route pour se rendre dans la zone
industrielle de Carros – Le Broc. En conséquence, les lignes 22, 68
et 73 seront modifiées.
- Quatre allers-retours supplémentaires seront effectués entre Nice
et Colomars-La Manda toutes les heures.
- Du côté des Chemins de fer de Provence, depuis le 1er juillet, les
voyageurs peuvent utiliser un unique titre de transport Lignes
d’Azur entre Nice (Libération) et Le Chaudan (Utelle). La Régie
régionale des transports de la Région Sud renforcera la fréquence
aux heures de pointe au départ de Nice. Un départ sera réalisé
toutes les 20 minutes le matin entre 7h00 et 9h00.
- Un nouvel arrêt de bus, "Maison Médicale / La Manda", a été
installé devant la maison médicale de Colomars. Cette dernière sera
desservie par la ligne 52 et la ligne à la carte C5.
- Afin de desservir avec plus de proximité Saint-Jeannet, la ligne à
la Carte C13 et ses 25 arrêts seront mis en service.
- À titre expérimental, en période scolaire uniquement, la ligne à
la Carte C7, à Saint-Blaise, proposera quatre courses fixes entre
"La Bouissa" et "Saint-Blaise Village".
- Afin de garantir une place assise aux usagers se rendant dans la
Vésubie, la ligne 90 sera modifiée. La descente du bus ne sera
possible qu’à partir de l’arrêt "Cros d’Utelle".
Plus de détails sur le
site Lignes
d’Azur


En quête de "l'ADN environnemental", ce premier
inventaire du vivant en Méditerranée pour préserver la biodiversité
Photos MIDI LIBRE - SYLVIE CAMBON

David Mouillot (à gauche), professeur à Montpellier, à
l'initiative de la mission
Ce mercredi 19 juillet, Midi Libre embarqué à bord du catamaran LOVE
THE OCEAN, participant à l'Expédition OceanoScientific ADNe
Méditerranée 2023 au service de la science et de la mission
BioDivMed. Elle a pour ambition de réaliser la première grande
cartographie des espèces marines présentes en Méditerranée.
Reportage.
Il est 9h40 et le catamaran de 17 mètres de long dans lequel Midi
Libre a embarqué pour la matinée, largue les amarres. Son intérieur
en bois tranche avec la blancheur de la coque et les chaussures sont
abandonnées sous la table du cockpit à peine monté sur le bateau.

L'équipe du catamaran Love the ocean
Dans un vrombissement de moteur, il quitte le port et s'élance au
large de la Grande Motte. La chaleur en cette journée caniculaire
commence déjà à se faire ressentir mais la douce brise marine qui se
lève nous préserve de sa chaleur accablante. Une cigale a même
embarqué à bord du bateau et chante de sa plus belle voix du haut de
son mât.
Expédition scientifique
Malgré cette météo clémente aux airs de vacances, l'équipage du
catamaran OceanoScientific Explorer LOVE THE OCEAN ne chôme pas.
Arrivés à la pointe de l'Espiguette quatre des matelots enfilent des
combinaisons protectrices et préparent le matériel scientifique
avant d'embarquer dans l'annexe.
En réalité, le catamaran, dont Yvan Griboval est le capitaine, sert
de base logistique pour l'Expédition OceanoScientific ADNe
Méditerranée 2023. Elle s'inscrit dans le cadre d'une mission
scientifique : la mission BioDivMed 2023 lancée conjointement par
l'ANR (Agence nationale de la recherche) et l'Université de
Montpellier.

Le catamaran fait 17 mètres de long
Ainsi, parmi l'équipage qui est composé de cinq personnes, tous ne
sont pas marins mais ont à cœur la cause scientifique et la défense
des océans. Il accueille ainsi Pierre Friant, second du capitaine,
Léni Guillotin, biologiste marin, Justine Camus, coordinatrice de
l'Expédition Océanoscientific et Léa Griboval, assistante aux
expéditions de collecte. Également invité à bord, David Mouillot est
professeur à l'université de Montpellier et à l'initiative de la
mission.
Premier inventaire du vivant
Parti le lundi 3 juillet 2023 du port de Monaco, l'expédition doit
durer 25 jours non-stop et est chargée de la collecte d'ADN
environnemental sur 54 stations le long de la côte française
méditerranéenne entre les villes de Menton et Canet-en-Roussillon.

L'équipe scientifique qui procède aux relevés d'ADN
La mission BioDivMed a pour but de réaliser une grande cartographie
de la biodiversité marine méditerranéenne avec un maillage complet
et des échantillons récoltés tous les 10 km. Le résultat des
analyses est à prévoir pour le 8 juin 2024 et sera le tout premier
inventaire du vivant en Méditerranée, possible grâce à la très
récente technologie de l'ADN environnemental.
Qu'est-ce que l'ADN environnemental ?
Cette technique développée dans les années 2010 permet de prélever
des fragments d'ADN laissés par les poissons, les crustacés ou
encore les mammifères dans leur environnement, c'est ce qu'on
appelle "l'ADN environnemental ". "Elle permet d'analyser
et de détecter des espèces qui sont passées sous nos radars"
explique David Mouillot.
Qu'elle est la finalité de la mission BioDivMed ?
La finalité de la mission BioDivMed est à terme de "faire bouger
les lignes politiques pour une meilleure préservation de la
biodiversité en Méditerranée", explique David Mouillot. Ainsi,
le but est, par l'identification de la ressource côtière, la
création de zones de préservation réglementées pour une "pêche et
une alimentation durable".
Cette technique aide également à identifier et repérer les espèces
en voie de disparition, des espèces encore inconnues ou bien des
espèces invasives dont il faut limiter leur impact.
Par exemple, David Mouillot raconte que le requin ange était une
espèce qu'on pensait éteinte à cause de la pêche. Ce poisson plat
inoffensif et vivant sous le sable des fonds marins a finalement été
détecté grâce à l'ADN environnemental au large des côtes corses où
il a été également aperçu. Cette espèce en danger critique
d'extinction semble avoir trouvé son dernier refuge dans les eaux
corses et pourrait donc faire l'objet d'une zone de protection
marine.
Auparavant, la seule façon de répertorier et suivre les espèces
marines se faisait au travers de la pratique de la pêche, de la
plongée, via les caméras sous-marines ou encore les sonars, des
techniques plus ou moins invasives et non exhaustives. L'analyse de
l'ADN environnemental "n'est en aucun cas invasive et ne détruit
pas l'environnement ", rappelle David Mouillot.
Celle-ci est prélevée grâce à une crépine qui filtre l'eau de mer.
Fixée au bout d'une tige en aluminium elle-même rattachée à
l'annexe, la collecte s'effectue sur un mile marin, soit environ 1,6
km, aller-retour à une vitesse comprise entre 2 à 3 nœuds.
Travail d'équipe
À bord de l'annexe, c'est Léa qui se charge de vérifier la
profondeur et la vitesse tandis que Justine contrôle le cap. Pierre
est aux commandes du semi-rigide et Léni s'occupe de la collecte.
C'est donc un vrai travail d'équipe et de rigueur qui s'opère car
avant chaque expédition, tout est passé au désinfectant pour
éliminer toutes traces d'ADN étranger dans l'annexe, 20 min de
préparation et double pair de gants sont nécessaires.
Une heure vingt plus tard, l'annexe revient vers le catamaran avec
un précieux échantillon d'eau de mer de l'Espiguette. Léni
sauvegarde ensuite les échantillons dans une solution liquide
fournie par un de leur partenaire, l'entreprise Spygen, spécialisée
dans l'analyse de l'ADN environnemental. Celle-ci permet la
conservation des prélèvements avant qu'ils soient analysés.
Après avoir fait remonter à bord les quatre aventuriers
scientifiques, Yvan change de cap et rentre au port sous un soleil
de plomb vers 13 heures. Les échantillons prélevés auparavant sont
remis à David Mouillot qui les transférera à l'entreprise Spygen
chargée de les analyser. L'expédition qui était aux deux tiers de
son trajet quand nous les avons rencontrés, continue avec comme
prochaines étapes Sète, Agde jusqu'à la frontière espagnole.
"Mieux connaître les océans pour mieux les protéger"

Yvan Criboval
Yvan Griboval, capitaine du catamaran Love The Ocean pour
l'expédition Oceanoscientific ADN environnemental Méditerranée 2023
a accordé un peu de son temps pour répondre aux questions du Midi
Libre et explique les enjeux de cette mission.
En quoi consiste l'expédition dans laquelle vous vous êtes engagé
en tant que capitaine
L'expédition Océanoscentific ADN environnemental Méditerranée 2023
consiste en la collecte d'ADN environnemental dans 54 stations,
c'est-à-dire des zones qui ont été déterminées au préalable par les
scientifiques et qui se situent entre la frontière italienne et la
frontière espagnole.
D'une durée de 25 jours sur le bateau, nous longeons la côte
méditerranéenne et nous arrêtons très peu dans les ports seulement
en fonction de nos besoins en pétrole et vidange et autres. Cette
expédition scientifique est une première en Méditérannée et
s'inscrit dans le cadre plus large de la mission BioDivMed qui ne
concerne pas que son littoral mais également la Corse et le
sanctuaire Pelagos.
Qu'est-ce que l'ADN environnemental et comment s'organise sa
collecte ?
Le principe est simple, on va filtrer de l'eau de mer car celle-ci
contient des fragments d'ADN des espèces qui sont passés dans cette
zone. Le filtre permet de conserver l'ADN qui par la suite sera
analysé dans des laboratoires.
Les zones étudiées n'excèdent pas 50 mètres de fond ce qui va
permettre l'analyse et la cartographie de la biodiversité marine le
long de la côte méditerranéenne française.
Pourquoi vous être engagé dans cette aventure à titre personnel ?
Avec l'association, nous sommes engagés auprès de Oceanoscientific
depuis 2011 mais à titre personnel, je suis engagé depuis 2006-2007.
Après une carrière de coureur au large à haut niveau, puis d'une
bifurcation vers celle du journaliste dans la presse écrite et la
télévision tout en passant par la communication et l'organisation
d'événements, je me suis retrouvé papa de triplets et c'est là que
tout a changé.
J'ai pris conscience que mes enfants ne vivraient jamais les mêmes
choses que j'ai pu connaître à leur âge. Par exemple, durant mon
enfance au bord des côtes normandes, les eaux étaient très
poissonneuses et nous pêchions des maquereaux, des morues, des
crevettes, des crabes, des homards à la pelle, mais tout cela à
disparu de nos jours.
Alors je me suis dit : "pourquoi mettre à profit mes compétences en
navigation pour contribuer à faire avancer la science et la
connaissance des océans pour mieux le protéger ?". Je peux ainsi
aider les scientifiques à collecter des données grâce à mon
expérience en tant que marin.
Quelle est la finalité de la mission BioDivMed ?
L'océan représente plus de 70 % de notre planète, ce qui
gigantesque, mais nous connaissons très peu de choses sur ces
derniers. Il représente néanmoins un espoir pour notre avenir sur la
Terre. Toutes les ressources terrestres sont en train d'être pillées
et avec une population à l'échelle mondiale qui ne cesse
d'augmenter, si on veut continuer à vivre, et à bien vivre sur cette
planète, il faut donc se tourner vers les ressources océaniques.
Mais il est nécessaire que nous ne répétions pas les mêmes erreurs
comme nous avons pu le faire avec nos activités terrestres. Il faut
donc changer radicalement nos comportements, c'est-à-dire qu'il faut
que nos nouvelles activités dans les milieux marins soient beaucoup
plus respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes.
L'expédition en cours va ainsi permettre aux scientifiques de
collecter ces données et encourager la recherche océanographique
avec l'utilisation de ce bateau à voile qui n'émet aucun rejet de
C02 et qui possède un matériel adapté car toutes les missions ne
peuvent pas être effectuées par les gros navires de la flotte
océanographique française
.


La Méditerranée, une mer sous pression: "Non,
ce n’est pas foutu, c’est à nous de bosser"
Attention aux messages trop désespérants, car ils dénaturent la
réalité. Face aux menaces qui pèsent sur la Méditerranée agir permet
de changer la donne. Parfois de façon spectaculaire. Expliquer ce
qu’il se passe rationnellement. Redire combien la vie marine est
exceptionnelle en Méditerranée. Se mettre en ordre de marche pour
agir. C’est la boussole de Pierre Boissery, expert mer à l’Agence de
l’eau.

Fonds marins en Méditerranée Photo DR Andromède océanologie -
Laurent Ballesta
On a pu dire maintes fois qu’elle est menacée, voire qu’elle risque
de mourir. Polluée, réchauffée, exploitée, la mer Méditerranée n’en
reste pas moins résiliente et riche d’une vie sous-marine
"remarquable et toujours présente".
Le message que porte Pierre Boissery est un plaidoyer pour agir. "J’ai
un scoop, lance-t-il, avec ironie. En 2023, la Méditerranée
n’est pas morte. De désespérée dans les années soixante-dix, la
situation s’est améliorée."
Pierre Boissery est expert mer au sein de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse. L’agence vient de se voir confier un nouveau
périmètre de compétence, au-delà des zones côtières, jusqu’à 400km
au large. Il est l’auteur du livre, Méditerranée, la mer qui ne
voulait pas mourir, aux Éditions Maïa.

Pierre Boissery, expert mer à l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse Photo DR.
#1 Bactérie et boulette de pétrole
Quel chemin parcouru en quelques décennies, alors que nos eaux usées
se déversaient sans filtre dans le bleu de la mer. "Il y a 40
ans, quand on se baignait, on avait 1 chance sur 3 d’attraper une
bactérie liée au manque de propreté, ou de ramener une boulette de
pétrole sur son maillot. Aujourd’hui, les gens râlent quand la plage
est fermée après un orage."
On avait moins d'argent, moins de volonté… et on l'a fait!
Selon Pierre Boissery, il n’y a aucun doute: "Chaque fois qu’on
s’est mobilisé, qu’on a bossé, on a eu des résultats. Dans les
années quatre-vingt, on avait moins de connaissances, moins
d’argent, moins de volonté. Et on l’a fait ! "
#2 À condition de changer ses usages
Si la création de stations d’épuration a prouvé qu’on pouvait être
efficace, une décision récente a déjà montré toute sa pertinence… À
condition d’accepter de changer ses usages.
Cas d’école: "La protection de la posidonie est officialisée dans
une loi de 1988. Or la réglementation instaurée par le préfet
maritime remonte à 2021. Entre-temps? On n’a fait que constater les
pertes."
On avait juste 40ans de retard.
Au moment où il est devenu interdit de jeter l’ancre dans les
posidonies, pour les bateaux de plus de 24m, beaucoup ont eu peur: "Vous
allez tuer l’emploi, les plaisanciers vont partir. Voilà ce qu’on
entendait, poursuit Pierre Boissery. Mais d’autres comme les
Baléares, la Croatie, l’Italie le font aussi. On avait juste 40ans
de retard dans l’application de notre propre loi."
#3 Résultat bluffant sur 80% de posidonie
Les moyens de l’État (préfecture maritime, douanes, Agence de
l’eau), mais aussi les scientifiques d’Andromède océanologie se sont
impliqués, chacun dans son rôle.
Malgré l’opposition des capitaines de yachts, l’interdiction est
devenue la norme. Et les autorités l’ont fait respecter. Les
résultats sont bluffants. "La pression des ancres des bateaux a
diminué de 80% sur les herbiers de posidonie."
Cette proportion n’est pas calculée au doigt mouillé. Elle est issue
du croisement des données de localisation des bateaux, avec les
emplacements des herbiers. Réaction: "Jamais j’aurais cru pouvoir
atteindre un tel résultat."
#4 Aller au-delà du terrain de foot
Comment construire la protection d’un territoire marin qui va
jusqu’à 400 km du littoral ? C’est la question actuelle que se
posent les experts de l’Agence de l’eau.
"Le premier axe de travail qui a été identifié est l’amélioration
des connaissances, situe Pierre Boissery. En mer, nous
connaissons à peu près de 0 à 100m de profondeur. Cela représente la
valeur d’un terrain de foot."
S’il y a quelques certitudes sur les zones côtières, le large est
méconnu. Et on veut y aller. En ligne de mire, l’objectif politique
de classer 10% de la Méditerranée en "zone de protection
renforcée", où toute activité humaine est interdite.
Protéger 10% de la Méditerranée, c’est une grande superficie.
Actuellement, ce type de protection forte est rarissime. Les aires
marines existantes peuvent connaître la pêche, voire le chalutage.
"Protéger 10% de la Méditerranée, c’est une grande superficie. Il
y a un vrai enjeu d’application, pour un objectif qui peut
apparaître comme un casse-tête."
Grâce aux connaissances à venir, "nous pourrons identifier les
sites où il est pertinent de créer une protection forte". Et
continuer d’agir.

Fonds marins en Méditerranée Photo DR Andromède océanologie -
Laurent Ballesta.
.


"On n'a jamais vécu ça, c'est incroyable" : les
pontes des tortues caouannes ont explosé et c'est une bonne nouvelle

En moyenne, sur 1 000 naissances, une seule tortue atteindrait
l'âge adulte
Dix pontes de caretta caretta, une espèce fragile et menacée, ont
été observées sur le littoral méditerranéen français. C'est un
record. Explications alors que les premières éclosions pourraient
débuter à Marseillan (Hérault).
La date du 18 août a été cochée par les suiveurs des tortues
caouannes, cette espèce de Méditerranée vulnérable, menacée,
protégée et inscrite sur la liste rouge de l'UICN (Union
internationale pour la conservation de la nature). Car depuis deux
étés, la caretta caretta a décidé de pondre sur les côtes françaises
et le top départ pour l'éclosion possible d'une partie de ces
tortillons - les bébés - est donné.
Imaginez : jusque-là, seulement trois observations de ponte avaient
été recensées, une à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) en 2018 puis
deux en 2020 sur la Côte d’Azur. Et puis la fameuse tortue de Valras
(Hérault) et ses 110 œufs éclos en septembre 2022 a tenu en haleine
les spécialistes comme le grand public. Mais que dire de ces
dernières semaines !
"C'est une année record, on n'a jamais vécu ça, c'est incroyable,
nous en sommes à dix pontes sur le littoral français" se réjouit
Céline Ferlat, chargée de mission tortues marines au centre national
de soins CestMed, réparti entre le Grau-du-Roi et La Grande-Motte
(lire par ailleurs).
Soit depuis fin juin, deux pontes en Corse, six sur la Côte d’Azur
et deux en Occitanie, dans l'Hérault, à Marseillan le 9 juillet puis
à Sète le 18 juillet.

Cette tortue de 92 cm a pondu à Marseillan le 9 juillet dernier.
RENAUD DUPUY DE LA GRANDRIVE
Le même scénario s'est donc reproduit avec ces femelles qui sortent
de l'eau et creusent le sable sur plusieurs dizaines de centimètres,
alors que leurs nageoires poussent, formant ainsi des arcs de cercle
de chaque côté.
Un record en Italie et des milliers de pontes en Grèce
"La tortue monte, pond et redescend, les œufs sont enfouis et
elle ne revient pas couver " rappelle Renaud
Dupuy-de-la-Grandrive, directeur du milieu marin d'Agde qui a pu
mesurer celle de Marseillan : "Elle fait 92 cm, c'est une adulte,
une belle maman".
Cette série inédite en France doit se mesurer également à l'échelle
européenne. La Grèce reste l'épicentre des naissances avec, pour la
seule partie du Péloponnèse, plus de 5000 pontes. L'espèce est
représentée en Turquie ou au Liban mais aussi en Italie avec 360
nids cet été, un record, et 25 pour l'Espagne.
"L'Italie et l'Espagne ont vu une augmentation des pontes, c'est
une bonne nouvelle ! L'espèce se reproduit, il faut désormais en
trouver les raisons" poursuit Céline Ferlat, coordinatrice pour
la France du programme européen Life Turtle Nest, lancé en janvier
2023 pour améliorer les connaissances scientifiques de l'animal.
Bien sûr, le dérèglement climatique et le réchauffement de l'eau
apprécié par la caretta pèsent. Mais pas que.
"Des tortues en Méditerranée ? Les gens nous rigolaient au nez"
"Les courants ont pu changer, des zones de reproduction peuvent
disparaître à cause de l'urbanisation et nos plages peuvent être des
lieux plus propices, il faut vérifier toutes ces hypothèses"
indique la spécialiste. Un autre facteur joue désormais : les
actions de sensibilisation aux traces permettent de moins rater des
nids.

Les oeufs du nid de la caretta caretta découverts. RENAUD DUPUY
DE LA GRANDRIVE
"Pour le nid de Sète, c'est un Monsieur qui nous a appelé, sans
voir la tortue, il a reconnu les traces alors que l'on a
l'impression qu'elles proviennent d'un engin mécanique. Même pour
nous ce n'est pas simple et si le vent passe en plus" indique
Céline Ferlat. "A contrario, sur la Côte d’Azur, une tortue est
montée, des gens pensant qu'elle était désorientée l'ont remise à
l'eau... Elle est sortie 300 m plus loin pour pondre. Il y a encore
un grand besoin de sensibilisation, mais en 2017, quand nous avons
commencé les actions, les gens nous rigolaient au nez : "Des tortues
en Méditerranée ? C'est pas possible ! "Aujourd'hui, nous n'avons
plus ces réflexions-là".

Voilà des traces de la montée de la tortue de Sète qui n'a pas
été vue, son nid si. AMP/CÔTE AGATHOISE
Le feuilleton des tortues nicheuses entre en tout cas dans sa phase
la plus délicate : celle de l'éclosion. Elles pondent une centaine
d'œufs en moyenne avec des pertes et une fragilité quand sortent les
tortillons entre 40 et 60 jours après. À Marseillan, ce 18 août
marque donc, le début possible de l'arrivée des bébés.
"Nous passons en surveillance accrue du nid pour accompagner les
naissances" confirme Renaud Dupuy de la Grandrive.
Sur 1 000 naissances, une seule tortue atteindrait l'âge adulte
"Nous entrons dans la phase délicate, le suspens est de savoir
quand les tortillons vont émerger pour les protéger contre les
nuisances de l'Homme et les amener à la mer " complète Céline
Ferlat, par ailleurs référente RTTM (Réseau Tortues Marines de
Méditerranée Française) en Occitanie. Il s'agit de lutter contre la
pollution lumineuse - réverbères et autres enseignes de commerce
pourraient les désorienter - en disposant un paravent au niveau du
nid mais aussi de dresser un corridor jusqu'au rivage, un circuit
sécurisé jusqu'à la mer où la nature décidera de leur avenir.

En septembre 2022, les oeufs non viables retrouvés de la tortue
de Valras. ML - YP
Le tout dans la plus grande discrétion car l'enjeu est de taille :
en moyenne, sur 1 000 naissances, une seule tortue atteindrait l'âge
adulte... "Et elles ne pondent qu'à partir de 20 ans et tous les
deux, trois ou quatre ans" souligne la spécialiste.
Des balises posées sur les tortues pour connaître leurs secrets
C’est un paradoxe : la caouanne est une espèce menacée de
Méditerranée, qui bénéfice d’un capital sympathie hors norme, chez
les enfants mais pas que et pourtant, elle est mal connue.
Quel est son cycle migratoire ? Où se nourrit-elle ? Où
reproduit-elle ? Pourquoi des pontes surviennent sur nos côtes ?
En Paca comme en Occitanie, via le Cest-Med, et sous l’égide du
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHM), des programmes de pose
de balise sont en cours pour suivre les tortues dans leurs périples
pour mieux comprendre l’état de santé des populations afin de mieux
les protéger dans le futur.


Congelé pendant 46 000 ans dans le permafrost,
un ver a été ressuscité : quels enjeux, quelles inquiétudes ?

Des petits vers qui sont nés il y a plus de 46 000 ans et qui continuent de
vivre
Depuis leur découverte en Sibérie, ces petits vers ont fait l’objet de
nombreuses publications et de recherches scientifiques. Le point.
C’est une découverte qui fait parler depuis de nombreuses années. Et pour
cause, ces petits vers retrouvés congelés dans le permafrost en Sibérie ont
de quoi surprendre. On vous explique pourquoi et surtout quels enjeux
entourent leur “retour à la vie”.
Découverte en 2002 et ressuscité en 2018
Un étrange petit ver rond microscopique a été découvert par des
scientifiques lors d’une expédition pour des travaux d’études sur le
permafrost en Sibérie près de la rivière Kolyma en Arctique en 2002. Les
spécimens emprisonnés dans la glace d’un terrier d’écureuil fossilisé
étaient congelés. Ils ont été rapatriés à Moscou afin d’être étudiés.
Ces nématodes ont été appelés Panagrolaimus kolymaensis en référence au nom
de la rivière.
Les chercheurs ont réussi à les “ressusciter ” ce qui a valu une
publication en 2018 dans la revue scientifique Doklady Biological Sciences.

Ils ont ainsi pu sortir de leur sommeil en étant décongelés dans des boîtes
de Pétri avec de l’agar-agar et des bactéries E. coli pour les nourrir. Les
vers se sont reproduits depuis sur une centaine de générations en quelques
années.
Datation
Au départ, les chercheurs pensaient que les vers étaient restés en état de
congélation durant 30 000 à 40 000 ans. Mais après avoir étudié ces
spécimens pendant des années, les scientifiques de l’Institut de Zoologie de
l’Université de Cologne et de l’Institut Max Planck de biologie cellulaire
moléculaire et de génétique à Dresde en Allemagne ont découvert grâce à leur
bol alimentaire que la datation était bien plus ancienne : entre 45 839 à 47
769 ans.
Nouvelle espèce ADN
D’ailleurs dans la conclusion de leurs travaux publiée dans la revue Plos
Genetics il y a quelques jours, les chercheurs estiment avec l’étude de son
ADN que ce ver appartient bien à une nouvelle espèce qui jusque-là n'avait
jamais été identifiée.
Comment ont-ils pu survivre ? Qu’est-ce que la cryptobiose ?
La cryptobiose est l’état de vie au ralenti grâce auquel certaines espèces
vivantes peuvent résister à des conditions de vie inhabituelles, pendant
parfois de très longue durée.
Pour faire simple, le métabolisme est mis en pause afin d’affronter des
conditions extrêmes et les organismes se mettent en sommeil - un peu comme
une hibernation. Grâce à ce mécanisme, les vers peuvent survivre sans eau,
ni oxygène, sous des températures extrêmes, très élevées ou très basses. Et
ils y arrivent grâce à un sucre, le tréhalose, qui les protège.
L’espèce la plus résistante connue
Quelques exemples de cryptobiose avaient déjà été recensés par le passé. Une
spore de la bactérie Bacillus retrouvée dans l'abdomen d'abeilles enfermées
dans de l'ambre pendant 25 à 40 millions d'années ou encore une graine de
lotus de plus de 1 000 ans à 1 500 ans trouvé dans un lac qui avait pu
germer.
Les exemples de métazoaires tels que les tardigrades, les rotifères et les
nématodes en cryptobiose sont légion, mais jusqu’ici il n’avait pas dépassé
les 40 ans : le lectus murrayi avec 25,5 ans dans de la mousse congelée à
-20°C et Tylenchus polyhypnus avec 39 ans desséché dans un spécimen
d'herbier.
L’étude de la capacité à se mettre en cryptobiose pourrait être intéressante
pour la recherche.
Bactéries et virus enfermés dans la glace pourraient ainsi se “réveiller
” et se propager
La question se pose dans le fait qu’avec le réchauffement climatique, des
bactéries et des virus enfermés et congelés dans la glace pourraient
ressusciter.
Avec 968 espèces de micro-organismes qui ont été découvertes piégées dans la
glace au Tibet, ou encore un "virus zombie" réactivé après avoir
passé 48 500 ans dans la glace sibérienne, le risque n'est pas anodin.
S’ils étaient réactivés naturellement, ils pourraient en effet être une
menace pour la santé publique.
Piqûres de tiques, de frelons, morsures de
vipère...
Comment éviter ces dangers lors de vos
activités en plein air

Un frelon asiatique lors de la destruction de
son nid à Draguignan, le 9 novembre 2022
Les vacances d'été offrent la possibilité de réaliser de nombreuses
balades et randonnées en Provence. Mais il faut faire attention à la
faune locale qui peut entraîner de sérieux désagréments.
Des conseils à garder en tête avant de partir en balade. La région
Provence-Alpes-Côte d'Azur regorge de sites à visiter durant ces
vacances d'été à l'image de la calanque de Sugiton à Marseille, ou
les Gorges du Toulourenc dans le Vaucluse. Ces lieux, réglementés
pour faire face à l'afflux de touristes, peuvent aussi entraîner
certains désagréments en raison de la présence de frelons, de tiques
ou de vipères. France 3 Provence-Alpes vous livre un petit guide
pratique en cas de morsures ou de piqûres.
Les tiques
La tique, qui mesure en moyenne entre 1 et 8 mm, est susceptible de
transmettre différentes maladies, dont la plus connue est la maladie
de Lyme.

Les tiques sont nombreux dans les milieux
naturels et sont susceptibles de transmettre des maladies dont la
maladie de Lyme. • © Vanessa MEYER/MaxPPP
Les précautions à prendre. En randonnée, il faut porter des
chaussures et vêtements couvrant bras et jambes, en rentrant le bas
de pantalon dans ses chaussettes. Restez sur les chemins en évitant
de marcher au milieu des broussailles et des hautes herbes. Pensez à
inspecter tout votre corps, une fois rentré à la maison.
Que faire en cas de morsure ? Pour retirer une tique, il ne faut
surtout pas se servir d’un coton imbibé d’éther. Il faut
impérativement utiliser un tire-tique pour dégager la tête de
l’insecte, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
Désinfectez la zone avec un antiseptique. Surveillez cette zone, car
si un mois après, apparaît une plaque rouge et ronde s’étendant en
cercle ou des signes tels que fièvre ou paralysie, il faut consulter
un médecin sans attendre.
Les vipères
Reconnaissable à sa pupille verticale et sa tête en V, la vipère
peut injecter un venin causant des douleurs et un gonflement au
niveau de la morsure, tout comme des troubles digestifs,
cardiovasculaires et respiratoires. Dans certains cas, rares, la
morsure peut être mortelle.

Largement présente en Provence-Alpes, la vipère
aspic tue ses proies grâce à son venin. Pour l'homme, sa morsure
peut être mortelle si un antidote n'est pas administré dans les 15h.
Soyez donc prudent à l'abord des chemins cet été.
Les précautions à prendre. En promenade, évitez de
soulever les pierres et les tas de bois.
Que faire en cas de morsure ? Appelez immédiatement les secours (15
ou 112). Otez tout ce qui peut gêner au niveau de la zone qui va
gonfler : bijoux, montre, chaussure… désinfectez avec un
antiseptique et immobilisez le membre mordu pour ralentir la
propagation du venin.
Frelons, bourdons, guêpes et abeilles
La piqûre d’une guêpe, d’un frelon ou d’un bourdon, pour douloureuse
qu’elle soit ne présente pas de risque majeur, sauf chez certaines
personnes allergiques. Elle peut alors provoquer des réactions
violentes, de type œdème de Quincke, qui peut conduire à une
hospitalisation. Les cas mortels sont exceptionnels. Une personne
qui se sait allergique doit toujours avoir sur elle d’une seringue
d’adrénaline auto-injectable.

Les précautions à prendre. Lors de vos balades, évitez de vous
approcher trop près des nids que vous apercevez. Et si vous
consommez des boissons sucrées, vérifiez votre verre ou votre
bouteille avant de boire, car des abeilles ou guêpes peuvent s'y
trouver.
En cas de piqûre. Après une telle piqûre, retirez le dard, ôtez les
bijoux qui pourraient gêner quand la plaie sera enflée. Désinfectez
à l’eau et au savon, puis à l’antiseptique.
En cas de piqûre dans la bouche ou dans la gorge, sucez un glaçon et
consultez immédiatement un médecin.
Profiter de la nuit des étoiles en pratique
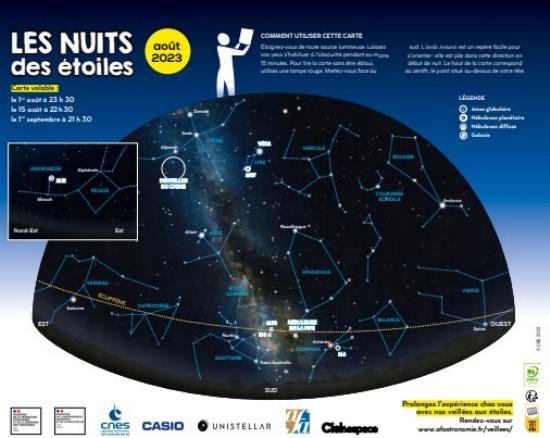
Du 11 au 13 août
2023 a lieu la nuit des étoiles.
Événement incontournable des amateurs
d'astronomie ou même des curieux de la beauté du ciel.
Cet événement est soumis à modification en fonction des conditions
météorologiques. L'association française d'Astronomie a même mis au
point un programme de veillée nocturne pour guider votre regard.
Quant aux stars de ces soirées, les étoiles filantes, l'Afa rappelle
que "pour les observer, aucun instrument n’est requis :
simplement vos yeux et un transat confortable vous permettront de
profiter du spectacle".
Il est recommandé de vous éloigner de toute source de pollution
lumineuse. Une carte du ciel est également
disponible en ligne et des applications permettent de se repérer
dans le ciel et vous indique notamment en direction de quelle
constellation vous regardez.


Nuit des étoiles : on vous explique ce qui se
passe vraiment dans le ciel ce week-end et comment en profiter au
mieux

La nuit des étoiles, l'occasion de s'immerger dans l'immensité du
ciel et d'observer les étoiles filantes
La 33e nuit des étoiles, c'est ce vendredi 11 et ce samedi 12 août.
L'occasion d'admirer les nombreuses étoiles filantes qui percent le
ciel nocturne. Pour aller plus loin, nous avons demandé à
Jean-Michel Faidit, mathématicien et maître de conférences en
astronomie et astrophysique à Montpellier, de nous expliquer ce
qu'il se passe vraiment au-dessus de nos têtes à cette période de
l'année.
Quel phénomène se déroule dans le ciel au moment de la nuit des
étoiles ?
Simplement, la terre croise l’orbite de la comète appelée
Swift-Tuttle. Derrière sa trajectoire se trouvent de nombreuses "poussières"
qui vont rencontrer l’atmosphère de la terre et y entrer à une
vitesse importante. Ces poussières se consument par frottement avec
les couches supérieures de l’atmosphère d’où le phénomène lumineux
qu’on appelle étoile filante.
Cela a été identifié par l’astronome italien Schiaparelli vers 1865
qui a repéré la trajectoire de cette comète dont les débris
constituent l’essaim des Perséides. Le radiant de cet essaim, qu’on
pourrait comparer à des voies de chemin de fer qui convergent à
l’horizon semble partir de cette région de la constellation de
Persée, à côté de Cassiopée. Le pic maximum a lieu la nuit du 12 au
13 août.
Et tous les ans on retrouve la même intensité ou selon la
trajectoire de la comète, l’intensité est variable ?
En 1992 quand la comète Swift Tuttle est repassée (dans notre
système solaire, NDLR), pendant quelques années on a eu jusqu’à 300
à 400 météores par heure, c’était très important, puis ça a
descendu. Actuellement, on est environ à une centaine par heure.
La thématique de l’année, ce sont les poussières célestes. Mais
de quoi s’agit-il exactement ?
Les poussières célestes sont de deux types : des poussières de
météores ou de comètes dont les trajectoires croisent la terre, mais
il peut s'agir aussi d'astéroïdes de différentes tailles. Les
poussières célestes sont des poussières cométaires ou des débris
d’astéroïdes, des fragments, et qui se consument.
Ces poussières célestes se retrouvent donc en grande quantité sur
Terre ?
C’est difficilement quantifiable, des mesures sont faites à partir
des chutes de météorites et autres mais il y en a une quantité
impressionnante, oui. Et c’est ce qui donne sur la lune ce qu’on
appelle la régolithe, soit la poussière sur laquelle marchent les
astronautes. Sur terre, elle ne reste pas en état comme sur la Lune.
Que nous apprend sur le plan scientifique l’étude des comètes,
des météores ?
Depuis quelques années peut envoyer des sondes directement à la
source, se poser sur des comètes ou des astéroïdes, donc
l’astronomie spatiale apporte aujourd’hui des informations directes,
notamment sur l’histoire du système solaire.
Grâce à l'étude des météorites, on sait par exemple que celle tombée
à Alès en 1806 est du même type que la célèbre météorite tombée à
Orgueil (Tarn-et-Garonne) en 1864. Ce sont des chondrites carbonées,
soit les plus primitives des météorites, qui se sont formées au tout
début du système solaire.
La nuit des étoiles est-elle aussi un moment particulièrement
propice à d’autres observations ?
C’est aussi l’occasion d’observer les constellations, à commencer
par la principale, la Grande Ourse. Quand on regarde le ciel,
généralement il y a la lune, les planètes, les étoiles, et les
étoiles filantes. C’est en gros ce qu’on voit le mieux, mais il y a
d’autres objets, qui sont les nébuleuses, les galaxies. Avec une
bonne paire de jumelles, on peut voir la galaxie d’Andromède ou la
nébuleuse d’Orion, mais c’est déjà plus pointu, il faut savoir où
regarder. Alors que le ciel à l’œil nu, le firmament, c’est une
émotion accessible à tous.
Quels sont vos conseils pour profiter au mieux de la nuit des
étoiles ?
Profitez-en pour vous rendre dans des réserves de ciel étoilé ou des
zones en altitude, dépourvues de pollution lumineuse. On peut se
prévoir une petite collation et pourquoi pas un transat, pour
s’allonger et voir l’ensemble de la voûte céleste, car on ne sait
pas où vont avoir lieu les étoiles filantes.
Au fur et à mesure que la nuit avance, la Terre avance dans sa
rotation sur elle-même et dans sa révolution autour du soleil, c’est
donc vers le matin qu’on est à l’avant de la trajectoire. Donc plus
on va vers le matin, plus on capte d’étoiles filantes. D’autant que
c’est une bonne année, la Lune ne sera pas gênante et du côté de la
météo, on a un ciel magnifique. Et pour les retardataires, on peut
toujours observer de très nombreuses étoiles filantes les nuits qui
suivent comme les nuits qui précèdent.
.


Nuit des étoiles 2023 : étoile filante,
météorite, astéroïde... ne les confondez plus grâce à notre lexique

L'été, en particulier durant les Perséides, est la période idéale
pour observer le ciel nocturne et les étoiles filantes
La nuit des étoiles, c'est l'occasion d'admirer les étoiles
filantes, mais aussi de parfaire sa culture spatiale. À commencer
par les mots que l'on emploie.
Ce que vous voyez passer dans le ciel, est-ce une comète, un
astéroïde, une étoile filante, une météorite... Pas toujours facile
de s'y retrouver. Pour ne plus faire d'erreur, nous avons demandé à
Jean-Michel Faidit, mathématicien et maître de conférences en
astronomie et astrophysique, de nous dresser la définition des mots
que l'on confond le plus souvent, ou que l'on utilise à mauvais
escient.
Étoile filante : Une étoile filante est une poussière qui rentre
dans l'atmosphère et se consume par frottement avec les couches
supérieures de l'atmosphère. Le phénomène lumineux se situe
généralement entre 110 et 90 km d'altitude.
Météore : Pour les étoiles filantes, on parle aussi de météores,
et dans le cas de ces étoiles filantes du mois d'août, d'essaim de
météores.
Météorite : Dans le cas d'un objet plus massif donnant une
traînée beaucoup plus lumineuse dans le ciel, on parle d'un bolide.
Un fragment peut même atteindre le sol, c'est alors une météorite.
Astéroïde : Un astéroïde est un petit corps du système
solaire. La plupart gravitent entre Mars et Jupiter et certains
peuvent croiser l'orbite de la Terre. On parle d'astéroïdes
géocroiseurs.
Comète : Une comète est un objet contenant du gaz, de la
glace est des poussières. En se rapprochant du Soleil, elles peuvent
développer deux queues, une de gaz à l'opposé du Soleil, et une
autre de poussières dans le sillage de leur orbite. Ce sont ces
poussières qui entrent dans l'atmosphère de la Terre en ces nuits
d'août, facilement observables dans la douceur estivale.
Étoile ou planète : Une étoile est un astre comparable au
Soleil, qui émet sa propre lumière. L'étoile la plus proche, Proxima
du Centaure, est déjà située à quatre années-lumière. Le système
solaire comprend huit planètes, de Mercure à Neptune, qui gravitent
autour du Soleil et réfléchissent sa lumière. De nombreuses étoiles
ont aussi un système de planètes. On parle d'exoplanètes.
Nébuleuse : Une nébuleuse est un nuage de gaz d'hydrogène où
se forment de nouvelles étoiles.
Constellation : Une constellation est une figure apparente
dans le ciel, constituée de plusieurs étoiles brillantes. Le premier
atlas de constellations a été décrit par Ptomémée, astronome du
deuxième siècle à Alexandrie.


Nuit des étoiles 2023 : cinq applications pour
vous aider à lire et comprendre le ciel

En pointant le téléphone vers le ciel, l'application vous aide à
décrypter ce qui se passe au-dessus de votre tête
Pour y voir plus clair dans le ciel nocturne, plus besoin d'éplucher
des manuels d'astronomie. De nombreuses applications permettent,
grâce à la géolocalisation, d'afficher les étoiles, les planètes,
les constellations, qui vous entourent. Voici une petite sélection.
Des cartes du ciel interactives sur votre téléphone peuvent vous
aider, en les pointant vers là où vous regardez, à situer
nébuleuses, constellations et planètes. Voici cinq exemples à
télécharger à l'occasion de la nuit des étoiles.
Stellarium
Une carte du ciel, comme un planétarium, pour identifier étoiles,
constellations, planètes, comètes, et même les satellites, avec des
fiches explicatives pour affiner votre culture générale spatiale.
SkyView
Une application qui a l’avantage de fonctionner même hors connexion,
ce qui peut s’avérer pratique. La réalité augmentée permet une
observation immersive.
StarWalk2
Sur le même mode de fonctionnement que les deux précédentes,
l’application StarWalk 2 permet de jour comme de nuit de repérer
tout ce qu’il y a à l’instant T dans le ciel visible. Le + : il est
possible de se projeter dans le futur pour visualiser le ciel à une
date donnée. Idéal pour préparer de futures observations.
SkySafari
Celle-ci est payante, mais les retours sur cette application sont
particulièrement encourageants. Elle conviendra aux curieux
passionnés, pour sa grande précision et les fiches explicatives
détaillées. Petit bémol, l'application est en anglais, même s'il
semble que la version 7 pro propose l'essentiel traduit en français.
ISS Live Now
Avec cette dernière application, on change de point de vue, pour
désormais observer la Terre depuis l'espace. Cette application vous
permet d'accéder en temps réel au streaming vidéo de la station
spatiale internationale et de voir sur la carte où elle se trouve en
temps réel.


Les abeilles aussi souffrent de la canicule et
de la sécheresse l'été

Les butineuses ont d’ailleurs tendance à réduire leurs sorties
perturbant radicalement la production de miel
Les abeilles aussi souffrent de la chaleur. Canicule et sécheresse
font des dégâts chez nos amis apidés. Le défi est de taille pour les
apiculteurs qui s’adaptent et prennent des mesures afin de préserver
au maximum leurs butineuses.
Dure vie que celle de Maya l’abeille ! Alors que la floraison est
déjà déréglée, c’est le changement climatique qui heurte lui aussi
de plein fouet le petit monde des ruches. Des pluies torrentielles
dans le haut pays, de grosses chaleurs et la sécheresse extrême sur
le reste du territoire azuréen…
Sale temps pour les apidés ! Les abeilles éprouvées sont
déroutées.
La sècheresse et les abeilles

Quand il fait trop chaud, les abeilles font ce que l'on nomme "la
barbe", c'est-a-dire, une sorte de protection pour tenter de réduire
la chaleur à l'intérieur de la ruche. • © Aline Métais FTV
La 1 ère conséquence d’une très forte chaleur est le manque d’eau.
Outre l’assèchement des points d’eau, des mesures de restrictions
sont mises en place. Or, le manque cruel d’eau affecte faune et
flore. Les insectes ne passent pas à travers.
Problème numéro 1
Cette période est cruciale pour les abeilles qui doivent faire leurs
provisions pour l’hiver. En campagne, si elles n’ont pas un
abreuvoir à proximité des ruches, elles sont obligées de parcourir
de longues et épuisantes distances pour trouver des points d’eau.
Certaines même se perdent. Dans les villes où les ruches fleurissent
sur les toits, béton et plein soleil génèrent des coups de chaud
encore plus stressant pour les pollinisateurs qui ont besoin de
s’hydrater.
Problème numéro 2
La température de la ruche doit avoisiner 34°- 35°. Son taux
d'humidité doit se situer entre 50 et 70 %. Cette température de
confort est une modalité essentielle au bon développement de la
colonie. Cette dernière a besoin de travailler dans un environnement
permettant la bonne évolution du couvain (l’ensemble des nymphes,
des larves et des œufs) et l’éclosion des larves. Quand le
thermomètre flirte avec les 40°, les ouvrières s’occupent à
refroidir l’intérieur de la ruche. Elles battent des ailes pour
ventiler leur ruche.
Un air conditionné à leur façon mais extrêmement fatigant et leur
demandant de consommer leurs propres provisions. Quand, de surcroit,
ces battements d'ailes se révèlent insuffisants, la cire de la ruche
fond et les larves en maturation meurent.
Parfois, les abeilles restent simplement collées aux parois de la
ruche pour tenter de faire barrage à la chaleur.
Des chercheurs canadiens ont démontré que quand les températures
sont trop élevées, les abeilles se suicident en expulsant leur
abdomen.
6 heures d'exposition à une température de 42° font mourir de choc
thermique la moitié d'une colonie !
Problème numéro 3
Au-dessus de 35°, le processus de photosynthèse ne s'opère pas. En
période de sécheresse, les fleurs ne peuvent plus produire de
nectar, cette sève qui est donnée aux plantes pour attirer les
abeilles. Les végétaux conservent tout pour résister. Les abeilles
qui ont besoin, pour fabriquer du miel, de ce mélange précieux d’eau
et de sucres, diminuent alors leur temps de butinage. Ne parlons pas
de la déforestation, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive
qui raréfient la production de fleurs, créant d’énormes difficultés
d’approvisionnement chez nos amis les hyménoptères.
Isabelle Panchieri, apicultrice amateur au service espace-verts de
Saint Laurent du Var : " Quand il y a la sécheresse, le
nectar ne monte plus, les abeilles n'ont plus rien à manger. Comme
il faut qu'elles nourrissent la reine et les cadres du bas, elles
mangent la production."
La chaleur affecte également la quantité de pollen ainsi que sa
qualité. Les grains remplis de nutriments essentiels à la bonne
santé des abeilles perdent, avec l’asséchement, leurs propriétés.
Les apidés se retrouvent carencés, plus fragiles et donc moins
résistants au passage de l’hiver.
Les abeilles sortent moins et se nourrissent des réserves. La
population de la colonie diminue puisque la réduction d’eau et de
nourriture amène la reine à, elle-même, diminuer sa ponte.
L’ennemi venu de Chine
Sècheresse et canicule ne sont pas les seuls ennemis de l’abeille.
Le frelon asiatique importé en 2004, en France, à bord d’un bateau
transportant une cargaison de poteries venues de Chine, a
progressivement envahi presque toute l’Europe. Ce prédateur est
redoutable. C’est lui qui (avec les pesticides et la monoculture)
contribue au déclin dramatique des colonies de butineuses. Posté en
vol stationnaire près des ruches, ou directement posé sur leurs
planches d’envol, le frelon asiatique se jette sur les abeilles qui
rentrent chargés de pollen.
Les butineuses ont d’ailleurs tendance à réduire leurs sorties
perturbant radicalement la production de miel.
Quand le frelon attaque une abeille, il la dépèce n’emportant que
son thorax gorgé de protéines. Parfois même, lorsque à l’automne les
colonies d’abeilles sont affaiblies d’avoir tant travaillé, les
frelons arrivent à pénétrer l’intérieur des ruches.
Apiculteur : un métier toujours plus technique
70 847 apiculteurs sont officiellement déclarés, en 2021, dans
l’hexagone. Ils ont dû apprendre à être réactifs aux aléas
climatiques. Et donc, à s’adapter. Déjà, le bouleversement des
périodes de floraisons les ont contraints à organiser différemment
leur collecte de miel.
Les périodes de sécheresse les ont, elles, amenés à mettre en place
des ruches plus spacieuses afin que plus d’air circule à
l’intérieur. Ils ont aussi aménagé des sources d’eau remplies à
proximité de ces demeures d’abeilles. Certains donnent même de la
nourriture.
Si autrefois, il suffisait de poser des ruches au fond du jardin et
de laisser les abeilles se débrouiller, climat et frelon asiatique
rendent cela inenvisageable désormais.
Alors que les abeilles jouent un rôle essentiel dans la préservation
de la biodiversité, le stress hydrique est un nouveau challenge
qu'elles doivent aborder en espérant que tout se passera mieux que
dans d'autres pays d'Europe.
En Hongrie, où une sécheresse inédite affame les pollinisateurs, des
apiculteurs font un constat inquiétant depuis plusieurs semaines :
les ruches sont désertées par les colonies d’abeilles et les cadres
sont dépourvus de miel.
Cinq millions d’abeilles vivent autour de Budapest demandant 30 à 40
litres d’eau par jour.
Les apiculteurs hongrois ont constaté que l’absence de nectar et de
pollen les rend agressives, et les empêche de se reproduire.


Île Sainte-Marguerite: retour sur les mystères autour du Masque de
fer
Savez-vous que le Masque de Fer a été détenu ici, dans les
Alpes-Maritimes ? Oui et plus exactement sur l’Île
Sainte-Marguerite. Depuis le XVIIème siècle, c'est un personnage qui
génère bien des fantasmes (malgré lui). Nous sommes allés sur ses
traces au large de Cannes pour parler des zones d'ombre qui existent
encore autour de ... son identité !
Le Masque de fer. Quand on entend son nom, on peut penser au film
des années 90 avec Leonardo Di Caprio dans le rôle d'un bien cruel
Louis XIV... Mais c'est surtout le nom d'un des plus grand mystère
de l'histoire de France.
Et un bout de cette histoire s'est déroulé justement dans les
Alpes-Maritimes, et plus exactement sur l'île Sainte-Marguerite au
large de Cannes. Le Masque de fer se retrouve ici en 1687, après des
années de détention puisqu’il a été arrêté en 1669. Il y restera 11
ans, avant d'être transféré à la Bastille, à Paris. Et ce jusqu'à la
fin de ses jours.
Mais ce qui est très intéressant à Sainte-Marguerite, c'est que
c'est la seule prison du Masque de fer qui n'a pas été détruite, et
c'est aussi une prison spécialement construite pour lui. Ce qui nous
permet de découvrir la spécificité de son statut, et d'ajouter
encore un peu plus de mystère !
Visite guidée avec Christophe Roustan Delatour, historien de l'art
et directeur adjoint des musées de Cannes. Il est également l'auteur
du livre "Le masque de fer - Un secret d'Etat révélé".
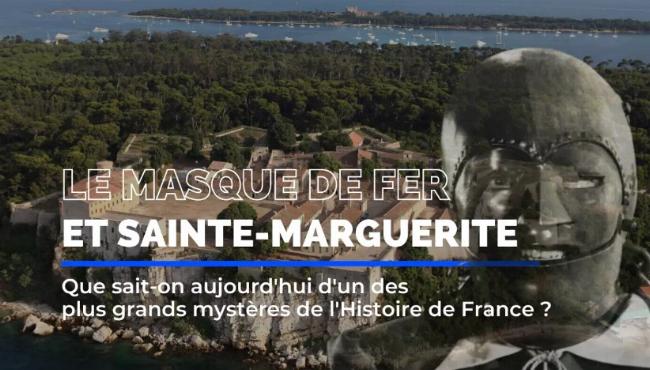


À Villefranche-sur-Mer il existe une chapelle
entièrement décorée par Cocteau
Elle fait partie du paysage de Villefranche-sur-Mer mais reste
méconnue des visiteurs.
La chapelle Saint-Pierre a été entièrement décorée par l'artiste
Jean Cocteau.
Voici son histoire en vidéo dans le nouvel épisode de Sun-Fact !
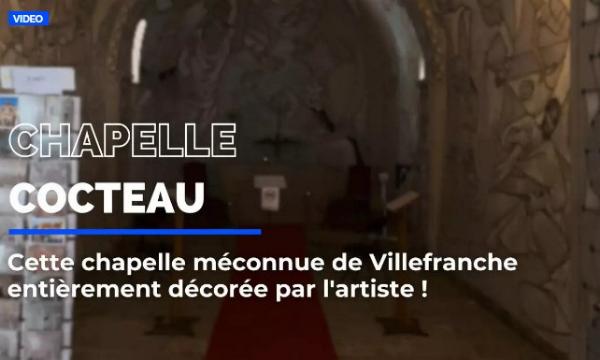
Chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer a été décorée en
1956 par Jean Cocteau
Miniature de Quentin Lazeyras
Dans les années 20, le jeune Jean Cocteau vient régulièrement à
Villefranche et sur la côte d’azur. Il a développé des liens pour le
territoire.
Ce lieu de culte appartient à la Prud’homie des pêcheurs de
Villefranche, il est devenu le tribunal de pêche, puis un hangar à
filets.
Cocteau la décrivait ainsi : "Je l’ai toujours connue comme une
vieille clocharde endormie sous la poussière. Et j’ai eu la surprise
après nettoyage et déblayage de découvrir une admirable petite nef
romane au bord de la mer."
Il dit ne pas l’avoir fait avec un objectif commercial, mais
simplement pour rendre hommage aux pêcheurs et rendre la chapelle
culte pour les fêtes de la Saint-Pierre.
L’idée est donc de lui rendre son aspect religieux et d'apporter un
aspect artistique au lieu.
En 1956, le peintre s'attaque à la décoration de la chapelle
Saint-Pierre. Les travaux dureront un an.
Voici le résultat et son histoire en vidéo :



New York, Philadelphie, Paris... Des tableaux
de Matisse "jamais venus à Nice" visibles lors de l’exposition
exceptionnelle au musée cet été
Cette exposition célébrant les 60 ans du musée Matisse, vaut le
détour, notamment pour découvrir des œuvres prêtées par des musées
étrangers. Une première pour la villa niçoise.

Certains tableaux sont à découvrir pour la première fois à Nice.
Photo Cyril Dodergny
Le Grand Nu couché (Nu rose), pièce maîtresse du musée de Baltimore.
Femme à la voilette en provenance du MoMa de New York. La Grande
Robe bleue et Mimosas du musée de Philadelphie. Nature morte à la
dormeuse arrivée de la Washington National Gallery of Art...
Cette exposition, coproduite par le musée Matisse de Nice, le musée
de l’Orangerie à Paris et le Philadelphie Museum of Art, c’est du
lourd. "Il y a là des tableaux qui ne sont jamais venus à Nice."
On comprend et on partage l’extase du président du musée par intérim
Aymeric Jeudy et de son équipe concernant la réunion de nombreux
prêts nationaux et internationaux: 50 sur les 150 œuvres présentées.
Plongée dans les années 30
L’époque est ciblée: les années 30. "Une décennie fondamentale
pour Matisse, qui à cette époque, loue des appartements-ateliers
cours Saleya, puis en achète un au Régina de Cimiez." La revue
Cahiers d’art sert de fil rouge à cette grande frise chronologique
révélant la vie d’atelier de Matisse. Un acharné de travail qui
adorait la photo, le canoë, les objets rares, toutes les régions du
monde, les oiseaux, les fleurs, qui dessinait d’un seul trait,
peignait, gravait, sculptait, illustrait, qui a introduit les
gouaches découpées.
C’est varié, riche, coloré, dense, intense, vibrant. La production
niçoise brille également à travers les odalisques.
"Une période critiquée où on reproche à Matisse une facilité
alors qu’il s’agit d’une période d’expérimentation. Matisse écoute,
arrête la peinture au début des années 30..." Premier voyage aux
États-Unis de New York à San Francisco, puis à Tahiti. Un tournant
décisif dans l’œuvre de l’artiste.
Au gré des salles, on comprend, on apprend plein de choses sur
l’homme. Son rapport au mouvement de la main, son amour pour un vase
étrusque omniprésent, 22 états photographiques que Matisse prend
d’un tableau en cours, la monumentalité, etc.
Quelle atmosphère!


Abonnements, cartes, tickets... On fait le
point un mois après les changements survenus au sein du réseau
Lignes d'Azur
Les grands changements intervenus sur le réseau de transport
Lignes d’Azur au 1er juillet ont modifié les habitudes des
voyageurs. Prix, cartes, portiques...
Quel bilan au bout d’un mois ?

30.000 cartes d’abonnement ont été demandées ces dernières
semaines. Photo Dylan Meiffret
Au 1er juillet dernier, Lignes d’azur mettait en service de nombreux
changements en particulier concernant la grille tarifaire et les
types de titres de transport.
Le mois dernier, la file d’attente était bien longue devant l'espace
mobilités du boulevard Dubouchage. Qu’en est-il aujourd’hui?
Force est de constater que ça cafouille encore sur certains points.
Chose positive, il y a beaucoup moins d’attente en agence, où une
dizaine de guichets reçoivent les clients. Certaines personnes s’y
trouvent par dépit faute d’avoir pu acheter leur abonnement avec
leur smartphone. En effet, s’il est possible d’opter pour un ou
plusieurs tickets solo, un pass ou un abonnement mensuel;
l’abonnement annuel est quant à lui impossible à acquérir. Il faut
donc aller en agence ou sur une borne. Pas toujours pratique.
Mais Gaël Nofri, président de la régie Ligne d’azur, assure: "Nous
travaillons à développer cette option, pour l’instant nous sommes
confrontés à des problèmes techniques. Par ailleurs, nous allons
aussi modifier le système afin de pouvoir proposer la reconduction
tacite de l’abonnement, qui sera plus pratique pour les voyageurs."
Portiques à l’étude

Du côté de l’aéroport, c’est encore un peu compliqué aux heures
d’affluence.
Les touristes sont parfois perdus. Certains ont du mal à savoir
quelles sont les modalités pour voyager sur le réseau. D’ailleurs,
beaucoup d’Azuréens ignorent également qu’aux deux terminaux, la
seule option d’achat est le ticket Aéro qui permet d’effectuer un
aller-retour au tarif de 10 euros. Tout en sachant qu’on peut tout
de même utiliser tous les autres titres de transport achetés, soit
ailleurs, soit en ligne.
Dernier détail: le trajet jusqu’à Grand Arénas (la première station
après l’aéroport) est gratuit.
L’astuce consiste donc à s’y rendre, descendre de la rame,
acheter un billet (2 euros de caution pour la carte + trajet
solo à 1,70 euro par exemple).
Encore faut-il le savoir car cela n’est pas affiché (maintenant,
vous êtes au courant!).
Dans les stations souterraines, les voyageurs doivent valider leur
ticket aux portiques à l’entrée et à la sortie (ailleurs c’est
directement dans les rames ou sur les quais lorsqu’il y a des
valideurs).
Les portes décalées à Jean-Médecin

Les usagers prennent de nouvelles habitudes. Au total 30000
cartes nominatives ("ma carte") ont été expédiées ces dernières
semaines.
Là encore, quelques difficultés. D’abord, ceux de la station
Jean-Médecin ne sont pas encore en service car il y avait des
ajustements à faire, cela avait été annoncé il y a deux mois.
Les portes sont ouvertes, pas de problème. Gaël Nofri précise: "Les
portiques vont être décalés afin d’éviter le risque d’engorgement à
la sortie. Car lors de la conception de la station, le bureau
d’études n’avait pas prévu autant d’affluence que celle que nous
connaissons."
En revanche ailleurs, certains passagers n’arrivent pas à actionner
le mécanisme car tous les portiques ne prennent pas toutes les
cartes. Il faut être observateur: sur certains, des pictogrammes
indiquent qu’on ne peut pas passer avec "la carte" ni avec le
ticket Aéro. Il suffit d’emprunter ceux d’à côté.
De temps en temps, des personnes se retrouvent bloquées parce que
leur billet papier (encore valable jusqu’à la fin de l’année) n’est
pas reconnu. La plupart du temps, des agents sont présents et
peuvent aider. Là encore "nous travaillons pour supprimer ces
dysfonctionnements", assure Gaël Nofri.

Les lignes de centre-ville renforcées durant l’été
Le réseau Lignes d’Azur s’adapte durant l’été.
"Nous avons augmenté l’amplitude horaire dans trams et bus à
haute fréquentation à l’instar des lignes 15 et 82 ", assure
Gaël Nofri. Pour mémoire, la régie s’appuie notamment sur les
chiffres de fréquentation, récoltés via la validation des titres de
transport.
C’est la raison pour laquelle toute carte doit être validée, au
risque de s’exposer à une amende (10 euros s’agissant d’une carte
d’abonnement par exemple).

30.000 cartes expédiées
Le nombre d’abonnements Lignes d’azur a bondi. "Nous sommes en
train de faire les comptes mais la progression atteint entre + 22 et
+ 25 % d’abonnements, se réjouit Gaël Nofri. Ce sont les chiffres
que nous espérions car cela signifie qu’il y a de plus en plus
d’abonnés parmi les Azuréens et que l’on gagne des parts de
mobilité. Nous avons dépassé les 100 millions de voyages en 2022,
cela sera bien plus cette année."
Ces dernières semaines, ce sont plus de 30 000 cartes qui ont été
expédiées.
Attention cependant, si vous achetez des tickets de voyage via votre
smartphone, il faut prévoir un délai: l’application indique que
l’opération peut prendre 48 à 72 heures. Aucun problème sur les
bornes, où la carte est créditée immédiatement.
Quant aux titres de transport non nominatifs ("la carte"), "pour
le moment, relativement peu de personnes demandent le remboursement
de la caution, indique le président de Ligne d’azur. Il est possible
de la faire en agence ou chez les revendeurs. Par ailleurs, nous
sommes en train d’organiser des points de collecte de ces cartes à
la gare et à l’aéroport. Cela permettra aux touristes qui partent de
les laisser, ainsi les deux euros de caution seront récupérés et
reversés à des associations caritatives".



Voici comment la Métropole de Nice va financer
le projet titanesque de la nouvelle station d’épuration (et on sait
si le prix de l’eau va augmenter)
Le chantier de la nouvelle station d’épuration à laquelle seront
raccordées 26 communes de la Métropole débutera l’an prochain. Un
énorme investissement qu’il va bien falloir payer.
Explications.

Le prix de l’eau de la Métropole va être réévalué afin de
financer ce projet. Photo Sébastien Botella
Le chantier de la station d’épuration Haliotis 2 débutera au second
semestre 2024. L’enveloppe de ce marché titanesque s’élève à plus de
six fois le budget annuel d’investissement de la Régie Eau d’Azur
(REA) qui va porter cet engagement pour la Métropole Nice Côte
d’Azur.
Comment arriver à financer un tel équipement ultramoderne alors que
le chiffre d’affaires prévisionnel de REA pour 2023 n’excède pas 182
millions et sans pour autant faire exploser le prix de l’eau? On
vous détaille tout.
Quel montant ?
"C’est le groupement Degrémont, filiale de Suez, qui a remporté
le marché en février dernier pour un montant de 700 millions d’euros",
rappelle Christian Estrosi, le président de la Métropole. C’est le
prix à payer pour un équipement de dernière génération, cinq fois
moins énergivore que la station actuelle, capable d’éliminer
l’ensemble des polluants présents dans les eaux d’assainissement
jusqu’aux microplastiques, de retraiter les boues et de les
transformer en combustible par méthanisation, ainsi que recycler 7%
des eaux traitées pour permettre de couvrir l’intégralité des
besoins d’arrosage et de nettoiement de Nice, soit 5 millions de m3.
Le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC), Alexis Rouque, confie même que l’enveloppe de financement
négociée par la Métropole "peut même aller jusqu’à 800 millions
d’euros pour couvrir d’éventuels aléas de chantier ". Même si,
précise-t-il, "s’agissant d’un marché global de performance, il
ne devrait guère y en avoir ".
Quel financement ?
C’est en effet la Banque des territoires, une marque de la Caisse
des dépôts créée en 2018 qui va apporter l’essentiellement du
financement. Soit 600 millions d’euros.
Le reste devrait être couvert par des subventions: "L’agence de
l’Eau apporte 20 millions d’euros, détaille Christian Estrosi. La
Région amène 1 million pour le moment mais on attend encore une
réponse sur un dossier européen qui pourrait nous rapporter entre 10
et 15 millions d’euros. En revanche, déplore le maire de Nice, nous
n’avons pas reçu pour l’heure de réponse à la demande de subvention
que nous avons également faite auprès du conseil départemental."
D’où vient l’argent ?
La Caisse des dépôts et consignations ne manque pas de liquidités.
Comme son nom l’indique, cet organisme public – créé à la sortie des
guerres napoléoniennes en 1816, mais indépendant du gouvernement
puisqu’il est placé sous le contrôle du Parlement –, gère les dépôts
d’épargne. Notamment le produit financier préféré des Français le
Livret A.
Ce qui a permis à la CDC de "collecter près de 30 milliards
d’euros rien que depuis le début de l’année", confie le
directeur général de la Banque des territoires, Olivier Sichel. La
banque avait prévu d’en consacrer 2 milliards au Plan eau annoncé il
y a quelques mois par Christophe Béchu. "Le projet de Métropole
de Nice a quelque peu explosé l’enveloppe", reconnaît-il sans
pour autant s’en inquiéter. Bien au contraire: "C’est un projet
exemplaire qui entre parfaitement dans nos deux lettres de missions
qui sont le financement de la transition écologique ainsi que la
cohésion sociale et territoriale".
À quel taux ?
Le prêt consenti à la Régie Eau d’Azur sera donc indexé sur le taux
de rémunération du Livret A. Il est actuellement de 2%. Le
gouvernement envisage de le porter à 3% d’ici la fin de l’année. "Mais
une fois le pic d’inflation passé, il devrait rapidement
redescendre, assure Olivier Sichel. C’est l’avantage d’un taux
encadré. Il est fixé par le gouvernement. C’est une garantie pour
les collectivités que nous finançons." D’autant plus que la
marge prise par la Banque des territoires est minime: 0,4% pas plus.
"Nous sommes une banque publique. Nous sommes hors du marché et
nous n’avons pas les mêmes obligations de rentabilité qu’une banque
privée", justifie le directeur général.
Sur combien d'années ?
La Banque des territoires n’a pas non plus le même horizon de retour
sur investissement.
Le prêt de 600 millions accordé pour financer Haliotis 2 sera
remboursable sur 40 ans!
"Aucune banque privée ne peut se protéger aussi loin. Nous
parlons d’un horizon à 2063. La plupart d’entre nous ne seront plus
là, souligne Olivier Sichel. Je ne serai plus directeur de la Banque
des territoires et Christian Estrosi ne sera plus maire. Beaucoup
d’élus se refusent à engager les travaux nécessaires à la transition
écologique parce qu’ils ne veulent pas endetter les générations
futures. En réalité c’est une dette écologique qu’ils leur lèguent.
Il n’y a rien d’illogique de financer sur plusieurs générations un
équipement qui va durer 40 ou 50 ans."
C’est aussi l’avis de Christian Estrosi qui va même jusqu’à "plaindre
les communes du littoral qui n’ont pas pris cette orientation car
elles vont se retrouver plus tard avec l’exigence de le faire mais
dans des conditions financières beaucoup moins favorables. Nous
investissons pour l’avenir, martèle l’élu niçois. Ne pas le
faire aujourd’hui c’est prendre un gros risque pour demain."
Quelle conséquence sur le prix de l’eau ?
Aussi favorables en soient les conditions, un crédit ça se
rembourse.
Même étalé sur 40 ans, lorsque l’investissement est de 600 millions
d’euros, un tel emprunt supporter par la REA va-t-il faire grimper
le prix de l’eau pour les abonnés de la Métropole?
La réponse est "oui ". Christian Estrosi ne s’en cache pas: "Le
prix de l’eau va être réévalué à partir de 2023." Même s’il
promet une hausse assez contenue puisqu’elle sera "de 5,43€ pour
120mètres cubes consommés".
Ce qui correspond selon l’Insee aux besoins annuels moyens des
ménages français. Mais "en contrepartie, grâce à cet équipement
ultramoderne, les métropolitains n’auront à faire face à aucune
surprise sur les 40 ou 50 ans à venir. Et malgré tout nous gardons
un des tarifs les plus bas de France", souligne l’élu.


Fourmis : espèces, organisation, agressivité...
10 questions pour tout savoir de cet insecte fascinant
Photos Midi Libre/SYLVIE CAMBON - Midi Libre/FRANCOIS CELIE -
OKTAVIANUS MULYADI/UNSPLASH

Il existe des milliers d'espèce de fourmis, avec chacune ses
spécificités.
Elles sont des millions de milliards sur Terre et constituent des
colonies toutes plus surprenantes les unes que les autres. Alors
qu'en été elles envahissent parfois nos cuisines, tour d'horizon
d'une espèce d'insecte unique avec un spécialiste montpelliérain des
fourmis.
Combien sont-elles, comment vivent-elles, comment évoluent-elles, se
reproduisent-elles, quelles sont les espèces que l’on croise sur nos
plages, à la ville, à la campagne ?
Luc Gomel, myrmécologue (spécialiste des fourmis) passionné et
passionnant, et Zaynab Abdelli, étudiante, ont répondu du tac au tac
aux 10 questions de Midi Libre, sur les grandes et petites histoires
de fourmis.

Luc Gomel et Zaynab Abdelli
Fourmis des bois, fourmis pénibles, esclavagistes, électriques,
tisserandes...c’est tout un monde minuscule qui se révèle sous nos yeux.
1. Fourmis des villes ou fourmis des bois et même des plages
"Les fourmis vivent partout, sauf dans les zones très froides",
précise Luc Gomel, chargé de mission à la transition écologique à
l'Université Paul-Valéry, à Montpellier.
Fourmi des villes, fourmis des champs, des sous-bois, des campagnes, aucun
espace de vie n'est épargné par la présence d'une de fourmis, et les espèces
"débordent " de plus en plus d'un territoire dédié au gré des
transports de marchandises, particulièrement "dans les pots de fleurs".

Trois exemples : les Tapinomas, du complexe nigerrimum, sont
implantées sur quelques kilomètres carrés sur la plage de Carnon (Hérault),
un "spot " situé au début du lieu-dit du Petit Travers, sont aussi
très présentes dans le quartier de Port Marianne, à Montpellier, dans le
parc Charpak et autour du bassin d'eau Jacques Coeur.
Luc Gomel et Zaynab Abdelli font la visite. On partira aussi à la recherche
de Formica rufa, dans les sous-bois des forêts d'Occitanie.
Les fourmis Pharaons (Monomorium pharaonis) "vivent dans les immeubles,
notamment en Europe du Nord ", souligne Luc Gomel : "Elles posent des
problèmes dans les hôpitaux, elles sont susceptibles de transporter des
bactéries".
2. Pacifistes et toujours gentilles ?
"Elles mordent toutes, elles ont toutes des mandibules, mais elles n'ont
pas toutes un aiguillon pour piquer. Elles sont parfois capables de
badigeonner ou de projeter de l'acide formique", précise Luc Gomel,
chargé de mission à la transition écologique à l'Université Paul-Valéry de
Montpellier, et myrmécologue.
Une fourmi d'une autre famille que la sienne est considérée comme hostile :
"Elles sont presque toujours agressives avec les individus d'autres
familles, que ce soit leur propre espèce ou pas, mais elles sont toujours
solidaires des individus de leur propre famille".
Les Tapinomas, qui se sont adaptées pour ne plus se faire la guerre au sein
de leur propre genre, "mordent ". Il suffit de rester quelques
minutes dans les dunes du Petit-Travers, à Carnon, pour en faire
l'expérience, y compris habillé d'un pantalon et de chaussures fermées.
La fourmi "qui pique le plus fort en France" est Myrmica scabrinodis,
"elle n'est pas présente sur le pourtour méditerranéen, elle a besoin
d'humidité". Luc Gomel n'oublie pas Manica rubida, présent en altitude,
dans les Alpes, le Jura, le Massif central.
Quant aux fourmis des bois, les Formica rufa, "elles sont capables
d'envoyer un jet d'acide formique à un mètre", c'est un caustique
puissant.

Violentes, les fourmis ? "Chez les fourmis d'Argentine, indique
Luc Gomel, les reines sont exécutées chaque printemps".
Il précise également que Pheidole pallidula, une espèce agressive présente
sur le pourtour méditerranéen, a des soldates : c'est unique pour une espèce
en France.
Une autre anecdote : "Les fourmis esclavagistes (NDLR : présentes aux
Etats-Unis et en France, notamment en Ardèche et en Aveyron) ont perdu la
capacité à s'occuper de l'autre et à travailler. Elles savent que se battre
et organisent des raids de pillage, guidées par des éclaireuses, pour voler
des cocons d'autres espèces".
A savoir : Paraponera clavata, la fourmi “balle de fusil ”, qui vit
en Amérique du Sud, est ainsi appelée car sa piqûre extrêmement douloureuse
est comparée à l’impact d’un tir.
3. Muettes ou bavardes ? Comment les fourmis communiquent
On a fait le test. À chaque fois, une odeur d'acétone se dégage. "Ce sont
les phéromones qui sont un de leurs principaux outils de communication, et
qui permettent de donner l'alarme", précise le scientifique.
"Phéromones de piste, de recrutement, de déménagement "... ces
substances chimiques, émises par la majorité des animaux et quelques
végétaux, jouent un rôle essentiel dans la communication des fourmis entre
elles. Les combinaisons d'odeurs forment des "mots".
"La communication et l'orientation sont sonores, ou tactiles via les
antennes, et phéromonales", listent Luc Gomel et Zaynab Abdelli, qui
expliquent que des fourmis sont aussi capables de se "repérer au paysage
et aux astres, quand elles voient, pour retrouver leur route".

Mais "certaines espèces sont quasiment aveugles".
En termes de communication, ces insectes n'ont ainsi rien à envier aux
abeilles, qui "dansent" pour donner toutes les informations nécessaires à
l'orientation de leurs congénères.
Les fourmis ne sont pas muettes : "Elles émettent des sons, parfois des
stridulations, ou de petits crissements qu'on peut entendre à l'oreille",
précise Luc Gomel. Elles sont même "capables de faire du tam-tam avec
leur abdomen".
4. Solitaires mais solidaires ?
"Elles sont toujours solidaires des individus de leur propre famille mais
presque toujours agressives avec les individus d'autres familles, que ce
soit de leur propre espèce ou pas", dit Luc Gomel.
"Contrairement aux abeilles et aux guêpes dont de nombreuses espèces sont
solitaires, la caractéristique des fourmis est que toutes les espèces sont
sociales, aucune n'est solitaire, mais certaines espèces sont parasites",
ajoute le scientifique : "Les fourmis esclavagistes utilisent des fourmis
esclaves volées sous forme de cocons chez d'autres espèces".
Les fourmis sont aussi capables de piller une espèce voisine, voire
d'assassiner une congénère : "Chez les fourmis d'Argentine, la Reine est
exécutée à chaque printemps".

Dans une même espèce, les fourmis, soumises aux lois de l'évolution,
peuvent aussi avoir changé de comportement pour devenir plus "sociables".
Un exemple avec les Tapinomas : "Il y en a un à 35 ans, quand j'étais
étudiant, les Tapinomas, qui se divisent en quatre espèces impossibles à
distinguer à l'œil nu, se battaient entre elles. Ce n'est plus le cas, elles
se reconnaissent désormais comme appartenant à une même espèce".
Que s'est-il passé ? "C'est comme si le passeport chimique des Tapinomas,
jusqu'ici spécifique à chaque famille, était devenu universel à toutes les
Tapinomas".
5. Tapinoma, Formica, Crematogaster, Messor... mais toutes identiques ?
"Il y a 13 000 espèces de fourmis dans le monde, chaque jour, leur nombre
augmente, beaucoup sont encore à découvrir. On en recense 200 en France",
indique Luc Gomel, chargé de mission à la transition écologique à
l'Université Paul-Valéry et passionné de fourmis. Myrmécologue (spécialiste
de l'espèce), il est capable d'en reconnaître une trentaine. Tapinomas,
australiennes, Crematogaster... la liste est longue et . "Il en reste
plein à découvrir et à décrire".
"La plupart des gens pensent qu'il y a des noires et des rouges, des
petites et des grandes, des volantes"... et c'est tout, indique Luc
Gomel.
À Carnon, sur le parking de la plage du Petit Travers, c'est une colonie
très active de Tapinomas qui se dessine, jusque dans les dunes.
À Saumur, en Maine-et-Loire, l'espèce est devenue envahissante au point que
des habitants ne peuvent plus manger dans leur jardin, comme en témoignent
des reportages consacrés aux nuisances, France 3 notamment.

Ces fourmis sont considérées comme "invasives". L'œil averti
de Zaynab Abdelli montre ici un cimetière où les insectes déposent déchets,
cadavres, voire fourmis malades qui choisissent de se mettre en retrait pour
éviter de contaminer la colonie.
Là, des larves qui se repèrent par un amas blanchâtre.
Quelques espèces à connaître, répertoriées par le duo : la fourmi
électrique, une "miniature d'1,5 mm", repérée à Toulon où cette
fourmi exotique de couleur orangée, de son vrai nom Wasmannia auropunctata,
inquiète les scientifiques pour sa capacité à proliférer, son impact sur la
biodiversité et ses nuisances pour l'homme, qui peut devenir allergique.
Elle n'a pas de prédateur.
"La fourmi du Sud la plus courante"
Quelles sont les espèces implantées en Occitanie ? La Tapinoma nigerrimum,
bien sûr, et la fourmi d'Argentine, "qui entre dans les maisons pour
chercher de la nourriture", la Crematogaster, fourmi présente dans le
bois (plaintes, poutres...) reconnaissable à sa tête rouge, est "la
fourmi du Sud la plus courante". Il y a aussi la Cataglyphis cursor, la
Formica rufa, dont les fourmilières forment des pyramides dans les
sous-bois, la Messor barbarus, choisie pour le film Microcosmos "parce
qu'elle est grosse, très graphique et transporte des graines", rappelle
Luc Gomel.
Le documentaire sur les insectes tourné en Occitanie est sorti sur les
écrans en 1996.
Toute petite en revanche, et également très présente sur le pourtour
méditerranéen : la Pheidole pallidula. Les ouvrières mesurent entre 1,5 et 5
mm (8 mm pour les reines).
6. Microcosmos, Werber... les fourmis sont aussi des stars de cinéma et
de romans
Lui-même a été associé à la réalisation du documentaire Microcosmos, sorti
en 1996 : "Il nous fallait filmer un vol nuptial, c'est un phénomène qui
a lieu deux jours par an, on a mis trois ans", se souvient Luc Gomel,
conseiller scientifique du film tourné en grande partie en Aveyron, qui se
décrit comme un "montreur de fourmis". "Pour trouver la reine,
j'ai creusé un trou de 2 m3 dans une fourmilière à Vauguières, sur la
commune de Mauguio", se souvient le scientifique.
Il s'agissait de grandes fourmis, les Messor barbarus. Mais "toutes les
fourmis sont des stars", surtout depuis qu'elles ont été popularisées
par Bernard Werber, auteur des "Fourmis", premier d'une série de
romans animaliers, à partir de 1991.
Pour les passionnés, Luc Gomel rappelle d'autres incontournables : "Quand
la Marabunta gronde", film américain de Byron Haskin, en 1954 ; "Phase
IV", film d'horreur de Saul Bass, en 1974 ; "L'empire des fourmis
géantes", film américain de science-fiction de Bert I. Gordon en 1977 ;
"1001 pattes", pour les enfants, en 1998, et la même année le film
d'animation "Fourmiz".
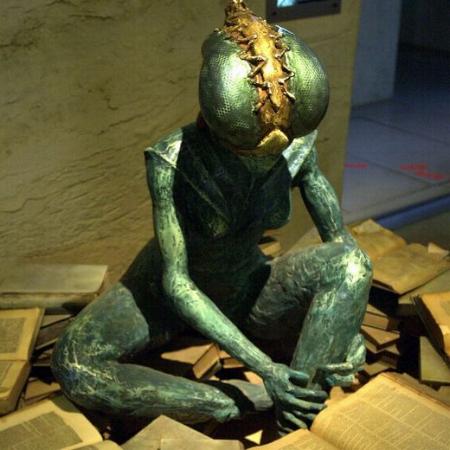
Pour les documentaires, outre Microcosmos, "La Citadelle assiégée",
en 2006, a un scénario bâti sur l'opposition de sympathiques termites à de
méchantes fourmis carnivores.
Pour lire : "Formidables fourmis", de Luc Passera (ed. Quae), est "un
des meilleurs livres illustré pour adultes", conseille Luc Gomel,
lui-même auteur du livre pour enfants "La fourmi " (ed. Milan).
À visiter enfin : la cité des insectes
Micropolis,
à Saint-Léons, en Aveyron.
Pour ceux qui souhaitent avoir un élevage de fourmi : "Il est dangereux
de commander des fourmis exotiques sur internet ", avertit Luc Gomel.
7. Champignonnistes, tisserandes, ces fourmis capables d'exploits
Au sein d'une espèce très performante, certaines sont ultra-performantes.
Luc Gomel donne l'exemple des champignonnistes et des tisserandes, capables
d'incroyables exploits. Aucune ne vit en Occitanie.
Les premières sont présentes en Amérique du Sud. "Les fourmis
champignonnistes sont des agricultrices. Elles élèvent les champignons dont
elles vont se nourrir, et elles ont même évolué avec un fongicide qui
favorise leur culture". L'organisation est remarquable, et adaptée à la
morphologie de chacune : "Les fourmis les plus grandes découpent les
feuilles des végétaux, les moyennes les broient et cultivent les
champignons, les petites nourrissent les larves et les reines".

Les fourmis tisserandes sont essentiellement présentes en Asie, en
Afrique tropicale et en Australie. Pour installer leur nid dans des feuilles
qu'elles replient, "elles utilisent leurs larves comme un "tube de colle"
qui permet de fixer une feuille à l'autre".
8. Elles résistent à l'eau, aux insecticides, les secrets de la lutte
"Dans la plupart des cas, la cohabitation prévaut sur la destruction",
explique Luc Gomel, qui explique que l'utilisation d'insecticides est
parfois une "illusion", "en fonction des molécules utilisées"
: "Il n'y a aucun exemple de lutte réussie parce que les fourmis ont un
phénomène naturel de protection, une fourmi malade s'extrait du groupe",
rappelle Luc Gomel.
Les "noyer " est tout aussi illusoire : "Elles sont très
difficiles à noyer. Elles respirent par des orifices positionnés le long du
corps". En revanche, l'eau savonneuse peut être efficace.
Le secret : un appât toxique adapté et à effet retard.
9. Les femelles n'ont pas attendu MeToo pour prendre le pouvoir
"Le jour du vol nuptial, les fourmis ailées montent dans les airs, elles
s'accouplent, perdent leurs ailes quand elles retombent sur le sol. Le mâle,
lui, meurt tout de suite", indique Luc Gomel. "Mais onze mois de
l'année, il n'y a pas de mâle"...
La fourmilière est un matriarcat ? "Oui ! ", lâche spontanément Luc
Gomel.
Les mâles étant engendrés à des fins reproductives, ce sont essentiellement
des femelles qui naîtront, dans certaines conditions, qui englobent la
dimension temporelle ou encore la nourriture reçue : "On ne connaît pas
bien les mécanismes de la reproduction, on sait que chaque fois qu'il y a
besoin de mâles pour assurer la fécondation, ils seront engendrés",
précise le scientifique.

La majorité des femelles seront des ouvrières, elles sont stériles.
"Quand on a les moyens, on fait des soldates". Et "quand la
fourmilière est très établie, on fait des princes et des princesses pour
assurer la reproduction de l'espèce".
Il y a plusieurs sortes d'ouvrières : "Certaines assurent les récoltes,
d'autres les broient, il y a les nourrices, les gardiennes, celles qui
creusent les galeries..."
10. Carnivores ou omnivores ?
"La plupart des fourmis sont polyphages, elles mangent de tout,
rappelle Luc Gomel. Même les champignonnistes, qui, en Amérique
tropicale, cultivent des champignons à l'aide de broyat de feuilles" : "Elles
ne mangent pas que des champignons".
Plus compliqué de trouver la source de nourriture des Tapinomas repérées sur
le parking du Petit Travers à Carnon.
Elles se nourrissent de quoi ? "C'est un mystère, je n'ai jamais trouvé
la source de nourriture", précise Luc Gomel.
Il y a de grandes chances pour que les colonnes de fourmis conduisent à une
poubelle, à un végétal où elles récolteront le nectar des fleurs où
élèveront des pucerons pour récupérer le miellat, élaboré à partir de sève.
Si nécessaire, "elles sont capables de descendre le long des racines sur
une dizaine de centimètres".

Quelle distance sont-elles prêtes à parcourir pour s'alimenter ? "300
à 400 mètres", assure Luc Gomel. Certaines sont des sportives de haut
niveau : "Rapportées à leur taille, elles sont plus rapides qu'Usain Bolt
".
Pheidole pallidula elle, recherche constamment des sources de protéines pour
s'alimenter : "Si elle tombe sur un petit cadavre d'insecte, elle le
récupérera, comme Messor ".
Présentes dans les zones tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique
centrale, les fourmis Magnans, carnivores, "sont des fourmis nomades qui
dévorent tout sur leur passage : elles font des raids de chasse, et
découpent même de la viande".
Les reines ont une spermathèque, une grande banque de sperme : "Une fois
que la princesse s'est accouplée, elle est fécondée à vie". Et ce sera
une "usine à œufs" :
Les ouvrières vivent environ un an, les reines 40 ans au moins, précise Luc
Gomel. Il en a la preuve : "J'ai une reine Messa barbarus depuis 1994, je
l'avais récupérée dans un nid qui avait au moins dix ans".


Pourquoi la glace de l'Antarctique n'a jamais
autant fondu et ne parvient pas à se reconstituer ?

Jusqu'à récemment, la banquise de l'Antarctique semblait échapper
aux effets du réchauffement climatique
Après une fonte historique en février, la banquise antarctique peine
à se reconstituer malgré l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère sud,
un phénomène qui pourrait accélérer le réchauffement climatique et
menacer de nombreuses espèces de l'océan austral.
Quelque 2,5 millions de km², soit cinq fois la France
métropolitaine: c'est le déficit de banquise enregistré par
l'observatoire européen Copernicus à la fin du mois de juin, par
rapport à la moyenne 1991-2020.
Le 16 février dernier, la glace de mer antarctique, qui se forme par
congélation de l'eau salée de l'océan, avait déjà atteint son
étendue la plus faible depuis le début des mesures satellitaires, il
y a 45 ans, avec une superficie totale de 2,06 millions de km².
Depuis, elle se reforme à un rythme inhabituellement lent, malgré
l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère Sud. La superficie de la
banquise en juin s'est ainsi établie à 11,5 millions de km2 (17 % de
moins que la moyenne). Une étendue "extraordinairement faible",
selon Ed Blockley, qui dirige le Groupe Climat Polaire du Met
Office, le service météorologique britannique.
"Un événement inédit et inquiétant ", confirme Jean-Baptiste
Sallée, océanographe et climatologue au Centre national français de
la recherche scientifique (CNRS). "On est dans quelque chose de
jamais vu, avec une banquise qui ne croît pas au rythme naturel. La
question, est : est-on entré dans un nouveau régime? Mais il est
encore trop tôt pour y répondre".
"En 2015, tout s'est retourné"
Jusqu'à récemment, la banquise de l'Antarctique semblait échapper
aux effets du réchauffement climatique. Pendant 35 ans, elle était
ainsi restée stable, voire avait légèrement augmenté, battant même
en septembre 2014 un record d'étendue, à plus de 20 millions de km2,
pour la première fois depuis 1979.
"En 2015, tout s'est retourné : on a perdu en 2-3 ans ce qu'on
avait gagné en 35 ans", raconte François Massonnet, climatologue
à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. "Depuis 2016,
on bat des records quasiment chaque année et il semble que ces
records ne soient pas indépendants les uns des autres."
Une hypothèse serait, selon lui, qu'il s'agisse d'un phénomène
auto-entretenu : l'océan se réchauffe plus fortement l'été, faute de
banquise. Puis, "quand l'hiver revient, il faut d'abord libérer
toute la chaleur excédentaire avant de pouvoir former de la glace de
mer ", explique M. Massonnet. Cette glace, plus fine, fond aussi
plus rapidement une fois l'été revenu.
"Zone de refuge"
Ce recul de la banquise "est cohérent avec un changement
climatique qui commence à impacter la banquise antarctique",
note M. Sallée. Mais les chercheurs rechignent à établir un lien
formel avec le réchauffement planétaire, tant les modèles
climatiques ont peiné dans le passé à prévoir les évolutions de la
banquise antarctique.
Quoi qu'il en soit, une glace de mer réduite à la portion congrue
risque d'aggraver le réchauffement climatique. L'océan, plus sombre,
réfléchit en effet moins les rayons du Soleil que la banquise
blanche: il va donc emmagasiner plus de chaleur.
En fondant, la banquise va aussi perdre son rôle de tampon entre les
vagues et la calotte polaire sur le continent antarctique, risquant
d'accélérer l'écoulement des glaciers d'eau douce vers l'océan.
Enfin, le retrait de la glace de mer menace le riche écosystème
qu'elle abrite. Car, loin d'être un désert gelé, "la banquise
forme des terrasses, des tunnels, des labyrinthes, qui servent de
refuges où les animaux peuvent se cacher des prédateurs",
explique Sara Labrousse, chercheuse en écologie polaire au CNRS.
Elle abrite notamment le krill, un crustacé semblable à une
crevette, qui broute des algues de glace, avant d'être lui-même
mangé par de nombreux prédateurs comme les baleines, les phoques ou
les manchots.
"La banquise, c'est aussi une zone de repos, de mue et de
reproduction pour beaucoup de mammifères et d'oiseaux marins",
ajoute Sara Labrousse.
Lorsque la banquise se casse trop tôt dans la saison, les jeunes
phoques qui ont peu de graisse et une fourrure pas assez étanche
peuvent mourir d'hypothermie en tombant à l'eau, selon la
chercheuse.
Le recul de la banquise "peut mettre en danger des populations",
prévient-elle.


Nombreuses méduses sur la Côte d'Azur :
découvrez sur une carte où elles se trouvent

La méduse "pelagia noctiluca", une habituée des côtes des
Alpes-Maritimes et du Var
Cette fin du mois de juillet, les plages des Alpes-Maritimes sont la
cible d'une invasion de méduses ! Une application permet de savoir
en temps réel où se trouvent ces bestioles ! Et toujours utile,
quelques bonnes pratiques en cas de piqûre.
La méduse pelagia noctiluca passe une nouvelle fois ses vacances
d'été sur les plages de la Côte d'Azur. Plusieurs dizaines de ces
spécimens ont été repérées sur le rivage d'Antibes, Nice, Cannes,
Saint-Raphaël... Bref, partout !
Température de l'eau élevée, du vent qui les pousse vers les plages,
présence de zooplancton propice à la reproduction... La conjonction
de ces facteurs expliquerait cette arrivée massive.
Depuis plusieurs années, le laboratoire ACRI de Sophia-Antipolis
dresse une carte en temps réel de la présence des méduses sur nos
côtes.
Un travail précis et possible grâce aux informations transmises par
les "baigneurs citoyens". Aujourd'hui, c'est une application
pour Smartphones qui permet de traquer les méduses et de surtout les
éviter en connaissant exactement la zone de leur invasion.
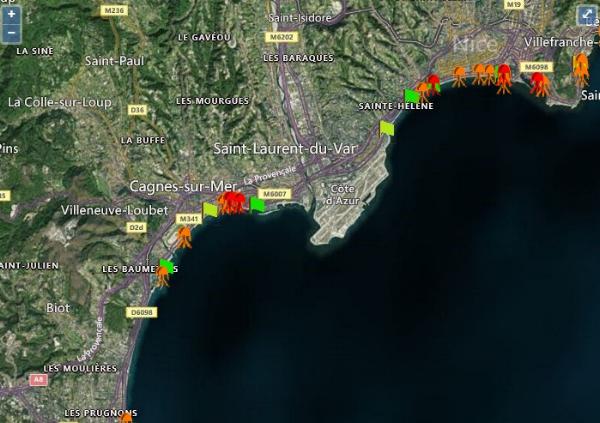
Sur le site d'ACRI, vous pouvez consulter la présence des méduses
en temps réel et participer à leur référencement.
Leur nombre et leur direction restent imprévisibles. Les méduses se
déplacent au gré des courants, suivant la température de l'eau et de
facteurs biologiques.
Il est difficile du coup de prévoir où elles seront d'un jour à
l'autre.
Drapeau violet
Sachez que leur présence peut aussi être signalée par un drapeau
violet sur les plages surveillées. C'est en effet, cette couleur qui
signale la présence d'un danger lié à une pollution oou à la
présence d'espèces protégées (comme les tortues) ou dangereuses.
À faire et à ne pas faire en cas de piqûre de méduse
Surtout ne pas frotter la zone piquée.
Ne pas mettre d'alcool.
Ne pas rincer à l'eau douce.
Rincer à l'eau de mer.
Ôter à l'aide d'une pince les fragments restés sur la peau.
En cas de piqûre sévère, le venin peut être neutralisé avec du
vinaigre ou de l'eau de mer chaude.
Contre la douleur : un antalgique type paracétamol.
Bonne baignade quand même !


La fin des travaux au nouveau tunnel de Tende
prévue pour juin 2024, mais...
La Préfecture des Alpes-Maritimes confirme que le chantier de
percement du nouveau tube devrait s’achever au printemps prochain.
Mais la délégation française milite toujours pour une réouverture à
la circulation - en mode chantier - dès l’automne 2023.

Les habitants de la Roya sont nombreux à attendre avec impatience
la remise en circulation pour être définitivement désenclavés par la
route
Bientôt le bout du tunnel (de Tende) ?
Sur ce plan, Français et Italiens ne savent plus vraiment sur quel
pied danser, tant plusieurs dates ont été avancées ces derniers
mois.
Lors d’une réunion de la commission intergouvernementale pour
l’amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud
(CIG) organisée le 20 juillet "en format restreint", les autorités
sont revenues sur l’avancement des travaux de réalisation du nouveau
tunnel. La réhabilitation du tube historique devant faire l’objet
d’une deuxième étape dans le chantier XXL.
Lors de ce rendez-vous officiel, la Société nationale pour les
routes italiennes (Anas), maître d’ouvrage, a présenté un calendrier
des travaux restant à effectuer, en particulier pour l’entrée du
nouveau tunnel côté français, particulièrement impactée par la
tempête Alex. "Ce calendrier qui concerne le rétablissement de la
plate-forme, le nouveau pont, l’aménagement des cours d’eau conduit
à un achèvement complet en juin 2024 ", confirme ce mardi la
préfecture des Alpes-Maritimes. Précisant que le percement du tunnel
étant désormais réalisé, "la délégation française a demandé à
l’Anas d’étudier toutes les possibilités pour rétablir la liaison
dès l’automne 2023 et permettre des circulations en mode chantier,
sous forme contingentée (convois) en respectant les conditions de
sécurité de la circulation et des ouvriers".
La commission intergouvernementale se réunira de nouveau en
septembre à Rome - à l’initiative de la délégation italienne - pour
"approfondir ces différents sujets".


Le baliste, ce poisson parfois mordeur venu des
mers chaudes, bien présent en Méditerranée

Ce baliste a été photographié par Eric Desmet le samedi 10 juin
2022. • © Eric Desmet
Eric Desmet est moniteur d'apnée et vidéaste amateur.
En ce mois de juin, en baie de Cannes, il a croisé à plusieurs
reprises un baliste gris, un gros poisson qui peut mordre le
baigneur s'il sent son territoire menacé.
Cannes, un samedi ensoleillé, un température qui avoisine les 30
degrés, il n'en faut pas plus pour qu'Eric Desmet parte avec son
épouse pour quelques plongées en apnée.

Eric Desmet et son épouse, qui est aussi son binôme quand il
plonge en apnée. • © Eric Desmet
Et pour ce gérant de société de 59 ans qui vit à la fois à Dunkerque
et sur la Côte d'Azur, le rituel est le même : à 9 heures du matin,
il entre dans l'eau à Bocca Cabana avec deux caméras, un trépied et
un appareil photo, nage dans la zone des 300 mètres et plonge en
apnée par 8 ou 10 mètres.
Objectif : faire de belles rencontres, et les immortaliser !
Un baliste gris le renverse et le mord !
Ce samedi 11 juin, il pose donc l'une des deux caméras au fond de
l'eau quand un baliste gris s'approche de l'appareil, le renverse et
le mord.
Eric Desmet, prof d'apnée et vidéaste amateur : "C'est un poisson
de belle taille, 40 centimètres au moins. Il a une forme ovale et
une mâchoire puissante munie de petites dents Les balistes, on en
voit normalement dans des mers chaudes, et il y en a depuis deux
trois ans en Méditerranée ! "
Eric connaît donc bien ce poisson qu'il a vu lors de ses plongées
dans toutes les mers du monde.
Baliste titan, ondulé, royal, clown, vermiculé, Picasso, à marges
jaunes, il y en a de différentes variétés. Il est généralement très
coloré et on le voit bien dans les récifs coraliens.
En Méditerranée, il est gris. Un animal curieux, solitaire, qui
protège son territoire et qui avait déjà été remarqué par les
nageurs en 2020.

Dans les mers chaudes, le baliste mange du corail qu'il écrase avec
ses dents (14 en haut, 8 en bas).
En Méditerranée, ce grand curieux dévore des petits crustacés, et
parfois, les mollets des baigneurs s'il estime qu'on envahit son
territoire notamment en période de reproduction. Ce fut le cas voilà
deux ans dans les Alpes-Maritimes et dans l'Aude.
Eric est resté en retrait de ce caïd des mers !
Eric Desmet : "Il m'a bien surpris, il est venu droit sur moi.
Faut juste cacher ses doigts mais pour moi il n'y a pas de risques,
le baliste sent qu'on est juste des visiteurs. Il nous montre qu'on
est chez lui ! "
Et depuis, lors d'une autre plongée à 200 mètres de là, il a revu un
baliste, le même lui semble t-il. Il s'apprête à faire un montage de
sa vidéo pour le Musée Océanographique de Monaco.
Pour le plaisir, voici une autre vidéo d'Eric Desmet.
Le 27 août 2017, c'est un poulpe qu'il avait filmé !

Eric continue ses plongées en apnée caméra au poing. Sur les réseaux
sociaux, il continuera à nous faire partager ses moments uniques de
rencontre avec des animaux marins.
A noter que selon Pascal Romans, de l'Observatoire océanologique de
Banyuls (Pyrénées Orientales) d'autres poissons comme le Sar ou
l'Oblade aiment aussi taquiner le baigneur en le mordillant !


Requins près des plages : un biologiste dénonce
la "psychose bleue" et la désinformation

Le requin bleu est l'espèce la plus régulièrement aperçue sur nos
côtes (métropolitaines) • © Christophe Bernard / Le Télégramme /
MAXPPP
Comme un syndrome "les dents de la mer ", les vidéos buzz sur
internet, de requins, alimentent les fantasmes et autres
squalophobie. Nicolas Ziani, biologiste au sein du groupe phocéen
d'études des requins, casse les idées reçues et nous éclaire sur le
sujet
"On ne s'improvise pas scientifique" C'est ainsi que commence
notre entretien avec Nicolas Ziani spécialiste des requins en
Méditerranée. Il faut dire qu'il est agacé par tous ceux qui
véhiculent des approximations à propos des squales, il explique :
"Quand les gens voient un aileron, une nageoire dorsale, pour eux
c'est forcément un requin. Alors que ça peut être un dauphin, un
marlin ou même un poisson-lune. Cet été, les médias relayaient
l'information comme quoi, il allait faire chaud et que nous verrions
plus de requins. C'est prophétique, mais pas scientifique."
Selon lui, les deux "requins" observés en Espagne, en
Catalogne, ne sont en fait que des marlins.
Les "sosies" des requins
Le marlin possède un aileron et ondule dans l'eau, de loin, les
amateurs peuvent croire à un requin, mais les spécialistes ne se
trompent pas.
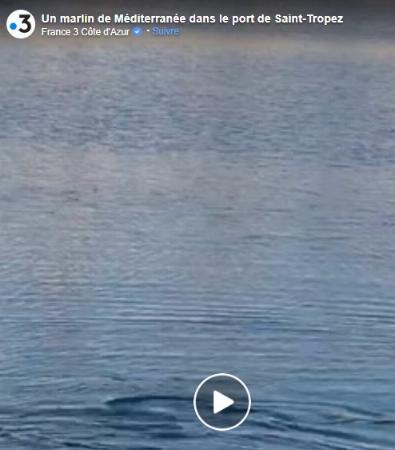
Un marlin avait été filmé dans le golfe de Saint-Tropez en 2020
(vidéo : Frédéric Saveuse).
Plus récemment, c'est à Antibes qu'un marlin-lancier a été vu sans que la
folie "requin" ne s'empare (trop) de la toile. Le marlin est un
poisson qui ressemble à un thon ou à un espadon. Son rostre (l'épée au bout
de son museau) peut causer des blessures en cas de geste non contrôlé et sa
vitesse peut atteindre 100km/h.
L'aileron peut appartenir à un poisson-lune, cette espèce, étrange, est très
grande (jusqu'à 4m de large). Cette espèce est en voie de disparition à
cause de la pêche accidentelle.

C'est un poisson inoffensif qui possède une nageoire dorsale
imposante.
Non, il n'y a pas plus de requin qu'avant
C'est vrai qu'aux États-Unis il y a énormément de requins, sur les 57
attaques non provoquées, de requin dans le monde en 2022, 41 se sont
déroulées aux USA. Une attaque non provoquée est un accident, dans lequel
aucune intervention humaine n'a favorisé la tenue, comme l'intervention d'un
pêcheur ou d'un plongeur sous-marin.
En France, les requins sont présents, mais peu nombreux sur les côtes.
Nicolas Ziani (Biologiste et fondateur du Groupe Phocéen d'Etude des
Requins) : "Il y a moins de requins cette année. Pour l'instant une
dizaine de spécimens ont été aperçus, habituellement c'est beaucoup plus."
L'espèce la plus visible est celle du requin bleu Nicolas Ziani explique : "c'est
un requin, un peu pataud, curieux, un peu comme les loups se rapprochent des
villes, il se rapproche des côtes. Il n'est ni gentil, ni méchant, il n'est
jamais conseillé d'approcher un requin. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres, se
déplace tranquillement et ne va pas à plus de 20 km/h."

Un requin bleu repéré à Hyères, sur la plage de l'Almanarre • ©
FTV JF Fuster
5 attaques de requin en France métropolitaine
Les attaques de requins sont recensées depuis le Moyen Âge (à l'époque
c'étaient des témoignages, des traces, écrits...) et représenté sur une
carte interactive du musée de Floride en charge des données.
Ainsi, en France, 5 attaques ont été recensées dont une à Antibes en 1972.
Un nageur a été blessé par un requin blanc :
"On comprend avec ces données que ça ne sert à rien de paniquer. Il y a
très peu d'attaque en France métropolitaine. En revanche, il y a des
attaques là où les populations de requins sont importantes comme à la
Réunion ou en Polynésie Française." Analyse Nicolas Ziani "En
Méditerranée, la population de requin blanc a considérablement baissé, selon
les estimations, l'extinction de l'espèce approcherait 96 %, il y avait plus
de 700 spécimens au Moyen-âge".
C'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 70 ans, sa croissance est lente et
la fécondation se fait par contact avec le partenaire (en opposition aux
espèces qui disséminent leurs œufs un peu partout) les naissances sont donc
rares.
Au regard de ces éléments, pas de panique, le remake des "dents de la mer
" n'est pas près d'arriver.

Un requin blanc an Afrique du Sud chasse l'otarie. Les jeunes
spécimens préfèrent le poisson, mais les requins adultes s'intéresse à des
proies plus grosses et plus énergétiques. • © Ewan Wilson/ Media drum worl/
MAXPPP
La psychose bleue
Nicolas Ziani parle "d'apocalypse cognitive". Selon lui, avec les
réseaux sociaux : "les gens sont conditionnés dans un univers parallèle.
Entre fascination pour les uns, psychose pour les autres. Ils regardent des
vidéos et se font des films. Le problème, c'est que l'on se fait une fausse
image de la situation, des espèces, de leur intérêt pour l'écosystème. Il
est important d'apprendre à aimer la science et d'arrêter
l'anthropomorphisme. Les requins ne sont ni gentils, ni méchants."
Cette hypervisibilité des requins sur internet accentue la squalophobie
(peur irraisonnée des requins). De l'autre côté du spectre, chez ceux qui
sont fascinés, on peut observer des comportements irresponsables comme le
fait de tenter de sauver un requin qui se serait échoué ou fait prisonnier.
Nicolas Ziani rappelle que "la plupart des espèces de requin sont en
danger d'extinction et protégées. De manière générale, il ne faut pas
intervenir lorsqu'un cétacé est en danger. Préférez prévenir le réseau
national d'échouage qui pourra vous guider."
Selon l'expert, en Méditerranée, "on peut se faire attaquer par des
murènes, des balistes (un poisson avec des dents) ou par un espadon, mais
rarement par un requin."
À l’instar de "Sauver Willie", "flippeur le dauphin" ou encore
le "Petit chaperon rouge" certains animaux ont une bonne ou une
mauvaise réputation parfois éloignée de la vérité.
Une vulgarisation scientifique et une communication accrue peuvent
permettre, à terme, de rendre plus accessible les faits scientifiques.


Risque d’inondations à Nice: le Paillon est-il le "grand oublié" des
Alpes-Maritimes ?

Le Paillon, en avril. Souvent à sec, il fait figure de fleuve
endormi; mais que se passerait-il s’il venait à déborder ? (Photo
Frantz Bouton)
Les militants de gauche de Viva ! interpellent mairie et
préfecture sur le risque que représente le Paillon, fleuve qui
traverse la ville et dont les scénarios de crue n’ont pas été
actualisés depuis 25 ans.
"Il y aura, hélas, de nouvelles catastrophes avec leur flot de
drames, de tragédies. Nos infrastructures sont menacées…" Ce
n’est pas Zarathoustra qui parle, mais le maire de Nice. En
préambule du conseil municipal du 13 octobre, Christian Estrosi
s’adressait aux élus avec solennité: "Je vous le dis avec une
certaine gravité, nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre."
Parce qu’un scénario catastrophe menace la ville: "Ce qui a
touché la Tinée et la Vésubie peut toucher le Paillon et le Magnan
demain", prévient l’édile niçois, qui va jusqu’à décrire ce qui
se passerait alors. "Un paquebot de béton dressé sur le lit d’un
fleuve torrentiel dont nos ancêtres connaissaient les caprices et
les tumultes. Une dalle imperméable aux précipitations qui
s’engouffrent dans les rues adjacentes et inondent les sous-sols des
immeubles, les parkings…"
Un plan de prévention des risques vieux de 25 ans
Ce paquebot de béton, c’est Acropolis que la municipalité veut
raser. Mais ce jour-là, le maire de Nice envisage d’aller plus loin.
Et pourquoi pas déplacer le lycée de l’est construit, lui aussi, sur
le lit du Paillon.
Pour une fois ce ne sont pas ses opposants à l’extrême gauche de
l’échiquier politique qui vont le contredire. Le rassemblement
citoyen Viva ! plaide même pour une découverture totale du fleuve.
L’ancien chef de file du parti communiste n’est d’ailleurs pas plus
rassurant. Pour lui, l’enjeu n’est autre que de "sauver le cœur
de Nice".
Car le Paillon, ce fleuve qui coule au beau milieu de la ville,
représenterait aujourd’hui une menace largement sous-estimée. "On
connaît les risques mais tout le monde fait l’autruche", assure
Robert Injey. Selon lui, "le Paillon est le grand oublié du
département ". Il n’apparaît même pas dans le rapport du Grec
Sud (1) de 2021 sur "la Métropole Nice Côte d’Azur face aux
risques climatiques". Quant au plan de prévention du risque
inondation (PPRI) le concernant, il date de presque un quart de
siècle ! Et n’a toujours pas été actualisé. En dépit des
enseignements de la tempête Alex. Le préfet a bien prescrit la
révision de ce document essentiel, mais "c’était il y a trois ans
déjà, en mars 2020". "Qu’est-ce qu’on attend ? ",
s’emporte-t-il.
Les effets d’une crue centennale bientôt modélisés
Du côté de la préfecture, on assure que la procédure suit son cours.
Elle a réellement débuté à l’automne 2020. Par une réunion des
différentes collectivités associées que le maire de La Trinité et
vice-président de la Métropole en charge justement des risques
naturels, n’est pas près d’oublier. "Elle s’est déroulée la
veille de la tempête Alex. En sortant de la réunion, nous avions
d’ailleurs reçu le message d’alerte du préfet ", se souvient
Ladislas Polski, qui rappelle que ce type de documents ne s’établit
pas d’un claquement de doigts: "Il faut arriver à caractériser
l’aléa et, pour cela, établir des modèles mathématiques complexes."
Ce sont eux qui vont dessiner la carte des zones potentiellement
inondables en fonction du niveau de cru, modéré, fort ou très fort.
Le représentant de la Métropole annonce que ces cartes d’aléas
devraient tomber sous peu. La préfecture assure, quant à elle,
qu’elles ont été transmises en mai "aux communes, aux EPCI (2) et
au Smiage (3) ". Même si elles doivent faire l’objet d’une
présentation au second semestre 2023 avant une diffusion publique
début 2024. On sera alors fixé sur le risque que représente
réellement le Paillon. Sa dernière évaluation, dans le PPRI de 1999,
tablait sur un débit de crue centennale n’excédant pas 750m3/s au
niveau du palais des expositions… Moitié moins que le débit constaté
dans la Vésubie lors de la tempête Alex.

1. Groupement régional d’experts sur le climat
2. Établissements publics de coopération intercommunale, comme l’est
la Métropole Nice Côte d’Azur, par exemple.
3. Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion
de l’eau maralpin.


Cinq forts à visiter dans les Alpes-Maritimes
pour se mettre au frais cet été
Photos
• MAXPPP
© FRANZ CHAVAROCHE - © SEBASTIEN BOTELLA - © DRONE IN NICE - ©
STEPHANE DOUSSOT
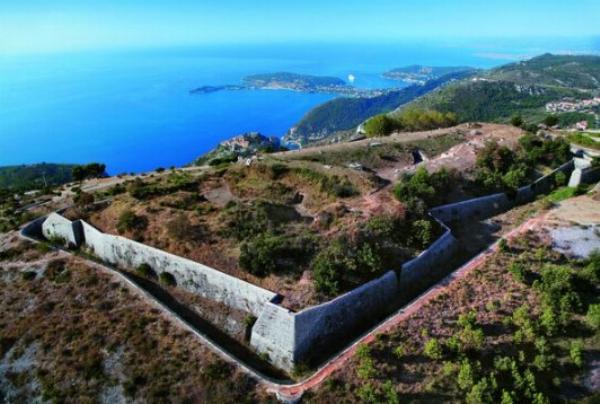
Le fort de la Revère, à Èze (Alpes-Maritimes)
Le département des Alpes-Maritimes comprend un riche patrimoine
de fortifications. Ces forts, édifiés entre le XVIe et le XXe
siècle, sont ouverts au public pour des visites culturelles à
travers leurs histoires. Nous vous en présentons quelques-uns des
plus illustres.
Au fil des siècles, le territoire des Alpes-Maritimes a vu s'ériger
de nombreux sites de fortifications. Ces constructions s'expliquent
par l'exposition particulière, entre terre et mer, de ces lieux
stratégiques qu'il a fallu protéger des ennemis tout au long de
l'histoire.
En voici quelques-uns qu'il est possible de visiter cet été.
Le fort Maginot de Sainte-Agnès
Situé sur un piton rocheux offrant un magnifique panorama, le fort
Maginot de Sainte-Agnès couvre le pays mentonnais jusqu'à la mer et
la frontière franco-italienne. Dernier rempart de la ligne Maginot,
il en constituait l'ultime bastion sud. Le fort de Sainte-Agnès a
été achevé en 1934.
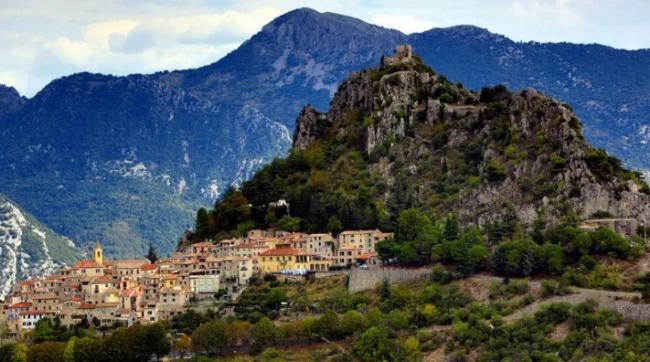
Le Fort Maginot de Sainte-Agnès surplombe la vallée.
Le fort carré d'Antibes
La tour Saint-Laurent, utilisée comme noyau central du fort carré,
fut construite au sommet de l'isthme Saint-Roch vers 1550, face à la
tour Saint-Jacques située à l'entrée du port. La construction du
fort, avec ses quatre bastions triangulaires, débuta vers 1565 pour
se terminer vers 1585.

La construction du fort carré d'Antibes s'est terminée en 1585.
Le fort royal de l'île Sainte-Marguerite, à Cannes
L'importance des îles de Lérins, au large de Cannes, qui permettent
d'interrompre la navigation côtière, n'a pas échappé aux ingénieurs
des fortifications. Les Espagnols s'emparent de l'île en septembre
1635 et construisent le fort existant en deux ans. L'île est reprise
en mai 1637 et les leçons de la bataille se traduisent par le
renforcement du fort, notamment par Vauban. À la fin du XVIIe
siècle, le fort devient une prison d'état.

Le Fort royal de l'île Sainte-Marguerite se trouve sur les îles
de Lérins, au large de Cannes.
Le fort du Mont-Alban, à Nice
Le fort du Mont-Auban est construit dès 1557, sur la colline du même
nom, entre Nice et la rade de Villefranche, à partir d'un dessin de
l'architecte italien Domenico Ponsello. Ce dernier souhaite édifier
un fort bastionné selon un tracé dit en étoile, pour répondre aux
nouvelles techniques de l’artillerie en usage au XVIe siècle.

La construction du fort de Mont-Alban a commencé en 1557.
Le fort de la Madeleine, à Rimplas
Ce fort constitue, en 1928, le premier jalon de la ligne Maginot en
France. Son plan polygonal rappelant la lunette d'une fortification
bastionnée, son escarpe, digne d'un fort du XIXe siècle, sa
plateforme et ses cuirasses d'observations soudées en témoignent.
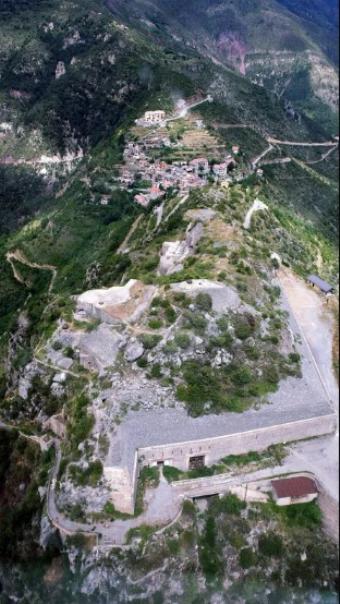
Le fort de la Madeleine est situé à 1.200 mètres d'altitude.
D'autres bâtiments fortifiés ouverts cet été
Et ces ouvrages fortifiés ne sont pas les seuls ouverts cet été dans
les Alpes-Maritimes. La batterie du Graillon (Antibes), la crypte
archéologique (Nice), le fort de la Frassinéa (Rimplas) et le fort
Maginot du Cap-Martin (Roquebrune-Cap-Martin) peuvent également être
visités.
Tout comme les fortifications de Saint-Paul de Vence, le fort Suchet
au Barbonnet (Sospel), le fort Maginot de Saint-Roch (Sospel) et le
fort Saint-Elme (Villefranche-sur-Mer). Les horaires et les tarifs
des visites sont à retrouver sur le
site du département.
3 lieux forts habituellement fermés à découvrir lors des journées
du patrimoine
En plus de tous ces bâtiments, trois forts, habituellement fermés au
public, accueilleront exceptionnellement les visiteurs lors de la
40ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17
septembre 2023.
Il s'agit du fort Maginot de l’Agaisen (à Sospel), du fort de la
Revère (à Èze) et du fort Maginot du Gordolon (à Roquebillière).


Vallée de la Roya : sur la haute route du sel,
des visiteurs de toute l'Europe viennent admirer les paysages
Photos
• ©Loïc BLACHE/FTV

La haute route du sel est un chemin militaire ouvert aux
touristes l'été. Elle se parcourt en 4x4, moto, vélo électrique ou à
pied
La haute route du sel relie le sommet du col de Tende à Briga
Alta (Italie).
Autrefois, les hommes y transportaient du sel à dos de mulets.
Aujourd'hui, ce sont des touristes et des randonneurs qui y
viennent, pour admirer les paysages et profiter d'un peu de
fraîcheur. Reportage.
Elle culmine entre 1.800 et 2.200 mètres d'altitude et zigzague
entre les territoires français (vallée de la Roya) et italiens
(Piémont et Ligurie). La piste militaire a rouvert au public le 19
juin dernier. Jusqu'au 15 octobre, la haute route du sel est
accessible aux 4x4 et motos (sauf les mardis et jeudis, réservés aux
randonneurs et aux vélos) et offre aux touristes un voyage à cheval
entre la France et l'Italie, ainsi qu'un retour dans le temps.
Côté Alpes-Maritimes, son accès se fait via La Brigue, la route des
46 lacets (attention aux restrictions de circulation) ou le hameau
de Casterino.
C'est là que nous attendait notre guide, Franck Panza.
Après environ 1h30 de trajet à basse vitesse (20 km/h) sur une route
caillouteuse, nous voilà au sommet du col de Tende, là où commence
la haute route du sel.
Du sel à dos de mulet
Ici, il y a plusieurs siècles, les hommes transitaient de la France
vers l'Italie avec des mulets chargés de sel. Un produit
particulièrement prisé à l'époque. "Les états de Savoie et le
Piémont n’avaient pas cette ressource en sel ", explique Franck
Panza, accompagnateur en montagne.
Franck Panza : "Entre
le XVe et le XVIe siècle, il pouvait y avoir jusqu'à 36.000 mulets
qui empruntaient le col de Tende et cette route du sel chaque année."

Le sel était "indispensable pour la conservation des aliments",
poursuit le guide. Son transport depuis Villefranche et Nice jusqu'à
Tende nécessitait trois jours de marche. Le franchissement du col
pour atteindre le Piémont, une journée supplémentaire.
Franck Panza : "Ce
commerce profitait à toute la vallée. À chaque village ou pont
traversé, on demandait un octroi de passage. Toute la vallée de
Tende vivait grâce à ce passage : le maréchal-ferrand, le
muletier..."
Aujourd'hui, les moyens de locomotion ont évolué. Les ânes bâtés ont
été remplacés par des véhicules ou des randonneurs. Et le commerce
du sel a laissé place au tourisme de plein air.
Des visiteurs de toute l'Europe
Depuis sa petite maison en bois, Mauro Padello compte les passages
de voitures, de quads et de motos. Depuis deux ans, il tient le
péage "ouest " de la haute route, non loin du fort central du
col de Tende. Sur la première quinzaine de juillet, il a
comptabilisé "plus de 1.000 voitures et motos".

Pour accéder à la haute route du sel, plus de gabelle, mais il
faut tout de même s'acquitter d'un péage. L'argent récolté permet
d'aménager le site.
Les visiteurs viennent "de toute l'Europe", notamment
d'Allemagne et de Suisse. Alors, il doit sans cesse jongler entre
les langues italienne, française et anglaise pour expliquer les
règles de base de la circulation dans cet espace préservé.
Mauro Padello, agent de péage : "La
vitesse maximale, c'est 20km/h. Surtout pour les motos. Les voitures
sont calmes, mais les motos et les quads, ils aiment bien faire
'vroum vroum' ! "

"Sur Internet, j'ai vu que c'était une route incroyable",
explique Achim, sur son deux-roues immatriculé en Allemagne. "Je
voulais venir ici parce que c'est l'un des meilleurs spots de moto",
poursuit Claudio, un Italien venu de Padoue (Vénétie), à 500
kilomètres de là.
Le paysage de la haute route du sel, à la frontière entre la Roya,
le Piémont et la Ligurie (Italie), entre 1.800 et 2.200m d'altitude
L'accès au site est limité à 90 motos et autant de voitures.
Alors il est conseillé de
réserver sa venue en ligne.
Faune et flore de montagne
Le chemin n'est pas très large, pas toujours évident de se croiser
en 4x4. Alors, pour les plus sportifs, le trajet peut aussi se faire
en vélo électrique ou à pied. "C’est un peu sportif pour moi qui
n’ai pas trop l’habitude", avoue Stefania, venue de Milan. "Mais
c’est magnifique ! "

La haute route du sel donne à voir des paysages à perte de vue, à cheval
entre la France et l'Italie
Un tourisme à basse vitesse, idéal pour profiter des paysages à perte de
vue. Et se faire peut-être un peu peur (attention si vous avez le vertige !)
sur le "tornante della boaria", un virage en épingle à flanc de
falaise.

Un peu plus loin, le sol se colore de plusieurs couleurs, notamment de
blanc. Ces petites fleurs sont des edelweiss.
"L'edelweiss se développe uniquement sur des roches calcaires", précise
Franck Panza. "C'est dans des endroits à plus de 2.000 mètres d'altitude
qu'on va la trouver."

Parmi la flore visible le long de la haute route du sel, des edelweiss
Puis, la nature multicolore laisse place à du gris. Un paysage de roche
sculpté par l'érosion glaciaire et la pluie.

Sur la haute route du sel, paysages minéral et végétalisé se côtoient.
En milieu d'après-midi, quand la circulation motorisée se fait moins dense,
des marmottes montrent leur tête. À peine le temps de les apercevoir
qu'elles ont déjà disparu. Dans le ciel, tournoient des "choucas", ou
chocards à bec jaune, des corbeaux de montagne.
"Le matin et le soir, c'est juste paisible"
Un paysage qui ravit Valerio, croisé en train de pédaler. "C'est une
première pour moi, je ne suis jamais venu ici ", dit le Milanais. "Pour
les Italiens, les montagnes, ce sont les dolomites. C'est dommage parce que,
ici, c'est très beau ! "

Le refuge Don Barbera, sur la haute route du sel, situé côté italien
Au refuge Don Barbiera, Florence et Michel, originaires de Grasse, profitent
d'un temps de repos. Ils parcourent la route à vélo électrique pour la
deuxième fois. "Dans la journée, ce n'est pas très tranquille, il y a
beaucoup de circulation motorisée", regrette Florence. "Mais, le
matin et le soir, c’est juste paisible. On a vu un chevreuil avec deux
petits et quelques marmottes ! "
"À vélo électrique, c'est vraiment accessible. Et par rapport à la côte,
la température est bien plus agréable ! ", rigole Michel.


Trois raisons de ne (surtout) pas manquer le Nice
Jazz Festival 2023

Mathieu Chedid alias -M- clôturera le Nice Jazz Festival vendredi
21 juillet 2023
C’est le plus vieux festival de jazz du monde !
75 ans après la première édition, le Nice Jazz Festival continue
chaque été d’animer les foules. Evénement estival incontournable
pour les habitants ou point d’orgue de vacances réussies pour les
touristes, rendez-vous du 18 au 21 juillet.
24 groupes au total, 6 plateaux par soir, 2 scènes en simultanée,
plus de 40 000 visiteurs… Des chiffres qui en disent long sur
l’importance de ce festival en terre azuréenne. Pourquoi choisir cet
événement plus qu’un autre ? On vous dit tout.

L’amour du jazz et de la musique partagés par des milliers de
spectateurs réunis chaque soir au théâtre de verdure à Nice. • ©
Julien VERAN
Une programmation exceptionnelle
Django Reinhardt, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis,
Chuck Berry, Keziah Jones, Ibrahim Maalouf… Des grands noms du jazz
qui ont foulé les scènes du Nice Jazz Festival, il y en a eu un
paquet ! Et, ce n’est pas près de s’arrêter. Entre artistes
internationaux et musiciens de la scène française, la programmation
2023 rime avec diversité et performance.
Mardi 18 juillet
Scène Masséna
23h00 : Juliette Armanet - 21H15 : Gabriels - 20H00 : Adi Oasis
Théâtre de Verdure
22h30 : Dave Holland New 4tet - 20h45 : Hiromi - 19h30 : Laurent
Coulondre
Mercredi 19 juillet
Scène Masséna
23h00 : Tom Jones - 21H15 : Hyphen Hyphen - 20H00 : Emile Londonien
Théâtre de Verdure
22h30 : Yuri Buenaventura & Roberto Fonseca - 20h45 : Ludovic Louis
- 19h30 : Immanuel Wilkin
Jeudi 20 juillet
Scène Masséna
23h00 : Herbie Hancock - 21H15 : Omah Lay - 20H00 : Jalen Ngonda
Théâtre de Verdure
22h30 : Gogo Penguin - 20h45 : Superblue: Kurt Elling & Charlie
Hunter - 19h30 : Generation Django feat. Edouard Pennes, Giacomo
Smith, Fanou Torracinta, Sebastien Giniaux & Romain Vuillemin
Vendredi 21 juillet
Scène Masséna
23h00 / -M- - 21H15 / Tower of Power - 20H00 / Olivia Deans
Théâtre de Verdure
22h30 / Dianne Reeves - 20h45 / Donald Harrison Jr - 19h30 / Julius
Rodriguez
Du jazz partout gratuitement
En juillet, Nice est ville de jazz ! Dans différents lieux de la
cité des anges, la musique résonne pour le plus grand plaisir des
promeneurs. Gratuit et ouvert à tous, c’est aussi ça la force du
Nice Jazz Festival, rassembler autour d’événements conviviaux et
familiaux.
Rendez-vous du 18 au 21 juillet au Radisson Blu Hotel pour les Jam
Sessions officielles du Nice Jazz Festival. Pour les non rassasiés
après les concerts officiels du festival, direction ce grand hôtel
de la promenade des Anglais. Ici, auront lieu les fameuses "séances
d’improvisation" de jazz, à l’image de celles que l’on croise
dans les bars américains. Des rendez-vous 100%, à la fois
décontractés et pleins de rythmes pour vous faire bouger jusqu’au
bout de la nuit.

Quatre soirs de concerts pour toute la famille, entre fête et
partage ! • © Julien VERAN
Le festival jazz OFF, pour tous les curieux ! Que ce soit sur la
colline du château à Nice ou dans les villes de la métropole comme
la Colmiane, Saint-Martin-Vésubie, Lantosque, Saint-Blaise,
Saint-Laurent-du-Var, Marie, Belvédère, Duranus, Auron ou encore la
Roquette-sur-Var, du jazz, il y aura. Les artistes se déplaceront
sur tout le territoire à la rencontre des habitants et des quelques
touristes de l’arrière-pays pour faire partager leur passion de la
musique.
Un lieu à redécouvrir
C’est au cœur du jardin Albert 1er, l’un des plus anciens jardins
publics de Nice, que se déroule le Nice Jazz Festival. Un véritable
écrin de verdure en plein cœur de la ville. Ce cadre bucolique est
particulièrement apprécié tout au long de l’année par les habitants
en quête de tranquillité. Cependant, il est aussi plébiscité par la
ville de Nice pour y accueillir de nombreux événements comme le
festival du livre au mois de juin.
Mais, c’est surtout son théâtre de verdure qui est sollicité chaque
année par les festivals musicaux. Construit en 1946, cet espace est
aussi appelé "le temple du rock ". Grâce à son architecture
d’inspiration grecque et son environnement fait de pins, palmiers,
cyprès et fontaines, c’est un cadre idyllique pour accueillir les
plus grandes stars musicales d’aujourd’hui. D’ailleurs, si le Nice
Jazz Festival s’est déroulé pendant une quarantaine d’années dans
les arènes de Cimiez, il a repris place en 2011 au Théâtre de
Verdure, son implantation d’origine. Le Nice Jazz Festival et le
Théâtre de Verdure, une grande histoire d’amour à redécouvrir cet
été.

Le Théâtre de Verdure accueillera tous l'été de nombreux
concerts. Une scène magique et mythique en plein air, face à la Mer.
• © Julien VERAN


Lutte contre les incendies : une nouvelle
caméra de détection des feux expérimentée à Nice

La caméra pivote à 360° et permet de surveiller
70 km2. Elle est équipée de deux capteurs : l'un thermique d'une
portée de 10 km, l'autre optique doté d'un zoom x100
Une super caméra de détection des feux sera installée fin juillet
sur les hauteurs du Mont Chauve à Nice. Elle permettra de repérer le
moindre départ d'incendie plus rapidement, et sur l'ensemble du
territoire de la Métropole.
La métropole de Nice expérimente cet été une nouvelle sentinelle
contre les feux de fotêts. 80 kilos, deux gros globes oculaires :
c'est un beau bébé, qui rappelle un personnage de dessin animé...
Pour un peu, on s'attendrait à l'entendre dire "Eve" ! Pour ceux qui
n'ont pas la "ref", vous devez absolument rattraper votre retard.
Sinon pas d'inquiétude : il s'agit d'un tout nouveau dispositif non
pas d'espionnage, mais de surveillance, destiné à repérer les
départs de feux le plus tôt possible.

80 kilos à la pesée, ce petit bijou coûte plus
de 100.000 euros et scrutera sans relâche le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur... à la recherche du moindre départ de
feu.
La métropole azuréenne est en effet particulièrement exposée aux
risques d'incendies, avec certaines zones végétalisées et proches
des habitations, mais parfois difficiles d'accès. L'incendie de
Castagniers en 2017, parti d'un barbecue mal éteint, avait ainsi
ravagé 120 hectares tout près des habitations.
Plus récemment, un incendie sur la commune de Colomars avait
contraint les pompiers à évacuer une vingtaine de maisons. Selon la
métropole, sur les 50 dernières années 600 hectares ont été détruits
par les flammes : aucun autre territoire des Alpes-Maritimes ne
serait autant exposé.
Une surveillance à 360°
L'une des réponses serait donc cette expérimentation : une super
caméra, fabriquée par la société Inéo, et qui sera installée le 22
juillet prochain au sommet du Mont Chauve. Elle permettra une
surveillance à 360° du territoire de la métropole.
Elle est équipée de deux capteurs distincts (d'où son look
futuriste) : un capteur thermique, capable de repérer un départ de
feu dans un rayon de 10 km. Il est relié à un algorithme pouvant
détecter des feux de 2 mètres par 2 mètres de large, en 3 minutes
maximum.
L'autre capteur est une caméra plus classique, mais doté d'une
optique puissante. Reliée au centre de supervision urbain, elle
permettra la vérification visuelle de l'alerte avant même l'arrivée
des pompiers.
Une expérimentation gratuite pour la métropole
Les premiers tests sont prometteurs. Le site du Mont Chauve est
idéal pour couvrir une grande partie du territoire métropolitain, du
Broc à La Trinité, en passant par Villefranche-sur-Mer et La
Trinité... Une expérimentation gratuite pour la collectivité,
puisque le fabricant cherche encore à roder son dispositif.

La caméra couvrira 70 kilomètres carrés, une
bonne partie des territoires des communes de la Métropole
De son côté, l'Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et de
Gestion des Risques accompagne cette expérimentation de son propre
plan de prévention et de sensibilisation. Le débroussaillement des
zones à risque a notamment été entrepris dès le mois d'avril et les
particuliers propriétaires de parcelles identifiées ont été mis en
demeure de faire de même.
Des moyens mobilisés sur le terrain
Trois équipes mobiles de l’Agence sillonnent également les secteurs
du Mont Boron et de l’aire Saint-Michel pour sensibiliser les
promeneurs, prévenir les comportements à risques, mais aussi pour
surveiller ces zones à forte végétalisation. Ces équipes sont
renforcées par des bénévoles (pour aider ça se passe ici par mail,
ou par téléphone au 04.97.13.46.34).
Enfin, une grande campagne de communication a été menée en juin,
pour rappeler toujours les mêmes messages, à savoir qu'une grande
majorité des départs de feux sont d'origine humaine : la viigilance
doit être extrême lors des barbecues ou d'activités de bricolage.
Par les temps qui courent, jeter un mégot de cigarette est criminel,
encore plus en pleine nature.
L'occasion de rappeler, encore une fois, que le brûlage de déchets
verts est interdit sur le territoire de la métropole, et ce pendant
toute l'année. L'été sera chaud, c'est une certitude. Autant ne pas
en rajouter !


Peuchère, Macarel, fada ou cacou... Connaissez-vous la véritable origine
de ces expressions du Sud ?

L'étymologie permet de mieux comprendre le sens des mots. Et le langage
régional n'échappe pas à la règle. Voici un petit quiz qpour tester vos
connaissances sur la véritable origine des mots que vous employez peut-être
si vous êtes local, ou que vous entendrez sans doute, si vous êtes touriste.
À chaque région son langage, ses mots et expressions bien d'ici, qui donnent
une couleur locale savoureuse à chaque coin de France. Le Sud au sens large
ne fait pas exception et si les expressions varient du Roussillon à la
Provence, de nombreuses sont communes à la partie la plus méridionale de la
France.
Brillez en société
De Marseille à Perpignan, voici une petite sélection d'expressions ou de
mots d'argot local que vous entendrez sans doute si vous visitez la région.
Pour briller en société, que vous soyez touriste ou local, nous vous avons
proposé à travers ce petit quiz, de plonger dans l'origine étymologique des
expressions, pour découvrir ce que signifient vraiment ces pépites verbales
si savoureuses.
Pour être sûr de maîtriser au mieux le verbiage du Sud, Midi Libre vous a
aussi compilé un glossaire, de la pègue
au pitchoun, en passant par les verbes espanter, rouméguer et les adjectifs
estoufadou ou goulamas. Le langage méridional n'a plus de secret pour vous.
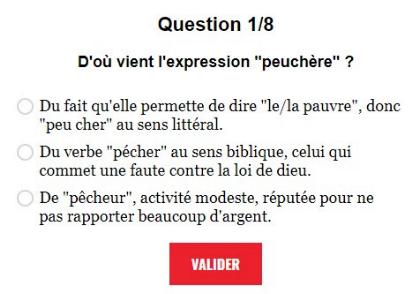
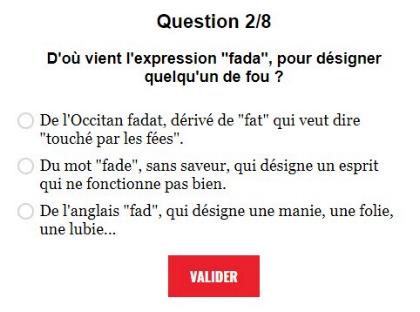
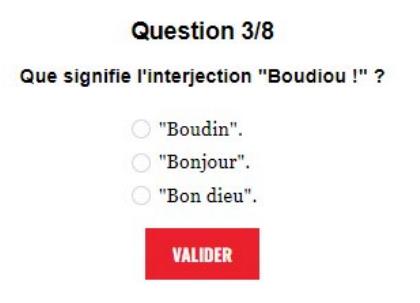
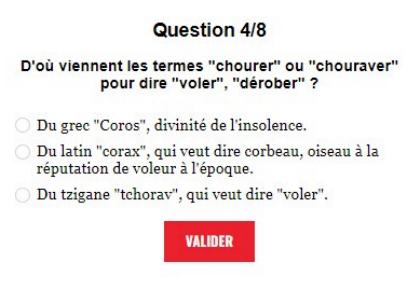
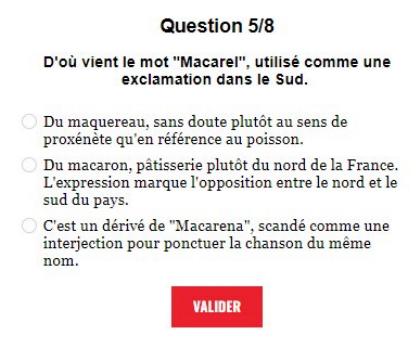
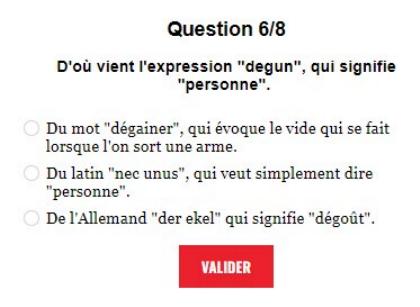
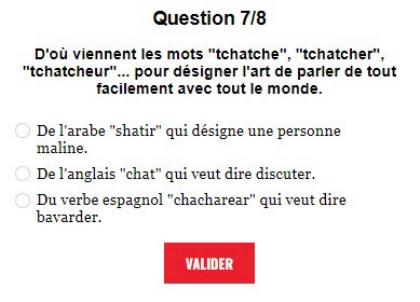
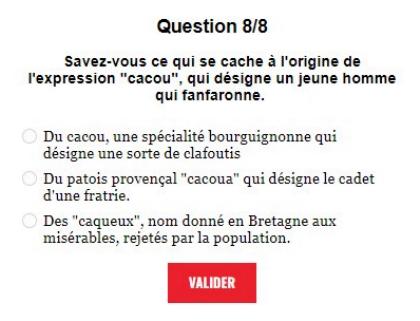


Festaïres, rouméguer, avoir la cagne... êtes-vous incollable sur les mots et
expressions du sud ?
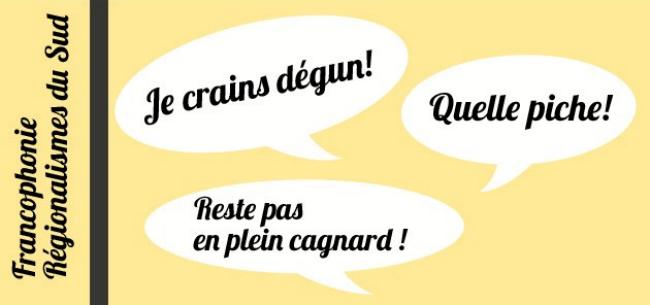
De Perpignan à Toulouse en passant par Sète et Montpellier pour finir à
Nîmes ou Marseille, florilège des expressions du sud
C'est pas nouveau, dans le sud on a la "tchatche" ! Entre les mots
qui n'existent que chez nous et les expressions de nos parents, guide
pratique pour comprendre le parler d'ici.
Le sud est riche, ses plages, ses montagnes, ses vignes, son soleil, ses
parties de pétanque... On aime le sud pour sa douceur de vivre, ses
habitants et, évidement, leurs franc-parler ! De Perpignan à Toulouse en
passant par Sète et Montpellier pour finir à Nîmes ou Marseille, florilège
des expressions qu'on a tous entendu au moins une fois.
Ça pègue
Un grand classique ! C'est quand quelque chose colle tout simplement, l'été
quand on se fait la bise et qu'il fait chaud ça pègue...
Rouméguer
Que l'on soit enfant ou adulte, dans le sud on ne râle pas on roumègue !
Une piche
Fille ou garçon être piche c'est quand vous n'avez pas été touché par la
grâce à votre naissance. La cagole de Montpellier c'est une piche ou une
pichette (c'est plus affectueux). On dit aussi d'un garçon que c'est un
pichou.
Mange que tu fréquentes
Plus rare mais pas des moindres. Comprenez ici le fait de bien se nourrir
pour être en bonne forme devant son ou sa dulcinée. Quand votre grand-mère
vous ressert pour la troisième fois du cassoulet c'est pour votre bien.
Espanter
C'est être surpris, sidéré, épaté parfois même pour dire qu'on est choqué.
Etre ensuqué
L'ensuqué c'est ce type un peu mou de nature, celui qui ne réagit pas très
vite, votre collègue de travail sur lequel vous ne pouvez pas compter. On en
connait tous un.
Jobastre / Fada
Le fada entretient un goût prononcé pour les situations dangereuses voire
complètement inconscientes, en bon français on dirait que c'est un fou.
Caguer
Ou plus communément "déféquer", on l'utilise aussi pour dire qu'on a peur,
qu'on s'est fait dessus, littéralement.
Boudiou
"Boudi", "boudu", "boudiou" au choix, une expression de surprise,
d'agacement ou d'exclamation qui peut remplacer "mon dieu".
Macarel
Dans le même genre que "boudiou" on peut utiliser "macarel" pour exprimer sa
surprise.
Peuchère
Fernandel connait bien ce mot ! On utilise "peuchère" pour dire "mon pauvre"
ou "ma pauvre".
Estoufadou
Quand un gâteau est très sec on dit que c'est une estoufadou, notre façon à
nous de dire que c'est un étouffe-chrétien.
Escagasser
Il y a plusieurs façon d'employer ce mot, la plus commune concerne le fait
d'abîmer quelque chose, la seconde souligne l'effort réalisé pour venir à
bout d'un projet. Enfin la dernière utilisation, pour quand on est très,
très fatigué...
Pitchoun
Le pitchoun c'est tout simplement un enfant ! Vous vous souvenez de ce
terrible souvenir avec les amies de votre grand-mère qui disaient en vous
pinçant la joue " qu'il est beau ce pitchoun !" ?
Dégun
Voilà un terme que nos amis marseillais ont l'habitude d'employer à tout va,
quand il y a "dégun" c'est qu'il n'y a personne dans les environs.
Quiller quelque chose
De l'occitan "quilhar", ce terme signifie que quelque chose est coincé,
souvent on "quille" un ballon dans un arbre.
Pécaïre
On l'utilise pour exprimer de la peine ou de la pitié. C'est comme peuchère
mais en plus difficile à dire.
Un gâté
Le gâté, c'est le câlin du sud !
Avoir la cagne
C'est faire preuve d'une grande paresse, pour être familier c'est avoir la
flemme de tout. Surtout à 14 h après le repas quand il fait 38°c à l'ombre.
Sûr que vous voyez bien de quoi il s'agit cet été.
Cagnard
Qui dit cagne dit cagnard. Le cagnard c'est ce soleil de feu qui tape dans
le sud pendant l'été. On dit d'un lieu qu'il est "en plein cagnard", l'ombre
est notre meilleur ami et surtout cet été 2022.
Festaïre
Celui qui fait la fête ou qui y participe.
Vé
Vé signifie regarde
Goulamas
Etre sale, pas doué
Boudiou
Mon dieu ! On dit également Mandeou, qui signifie exactement la même chose.


"Le plus grand état des lieux jamais réalisé dans le monde" : la
biodiversité de la Méditerranée va être cartographiée

Cartographier au mieux la Méditerranée française
L'Agence de l'Eau et l'université de Montpellier, notamment, ont lancé la
vaste étude de cartographie BioDivMed dont les résultats devraient être
connus en juin 2024. Avec ce but : identifier les richesses de la
Méditerranée pour mieux la protéger.
"C’est le plus grand état des lieux d'une mer jamais fait avec autant de
moyens, y compris au niveau mondial. La Norvège avait fait une grande étude
avec une centaine de points de relevés, là nous aurons plus de 700 ".
Pierre Boissery, expert pour l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée, est tout
sourire à l'évocation de l'ambitieuse mission BioDivMed lancée conjointement
avec l'université de Montpellier et l'ANR (agence nationale de la
recherche). L'idée : cartographier précisément la partie française de mare
nostrum et ce, pour la première fois.
"C’est le paradoxe, en 2023, nous sommes incapables de faire une
cartographie de la biodiversité. Là, avec nos outils de modélisation nous
pouvons viser une couverture quasi complète des espèces en Méditerranée"
se réjouit de son côté David Mouillot, Professeur à l'Université de
Montpellier.
En Occitanie, Paca, Corse
La campagne a été lancée au printemps et se concentre durant ces trois mois
de juin, juillet, août à prélever le maximum d'indices en Paca, Occitanie et
Corse, "dans les aires marines protégées, mais aussi en dehors, près ou
loin des émissaires en mer, proches ou non des aménagements, des embouchures
de fleuve, dans les lagunes et même le delta du Rhône où l'on va remonter un
peu" détaille Pierre Boissery.

Répertorier les espèces de Méditerranée, ici un poisson lune, mola mola
Pour cela, la mission s'appuie sur la mise en synergie de plusieurs
campagnes océanographiques. Celle d'Andromède, bureau d'études basé à Carnon
(Hérault) spécialisée dans les herbiers de posidonie et le coralligène ou
encore celles de l'association We are Méditerranée du photographe Greg
Lecoeur et l'expédition OceanoScientific.
Une pêche à l'ADN environnemental
Comment procéder ? Prélever de l'ADNe, environnementale, une technologie qui
permet d'inventorier la biodiversité aquatique via les traces laissées par
les espèces. Une véritable pêche à l'ADN.
"Il n’y a rien de magique : que ce soit du mucus, des déjections, de la
transpiration, nous larguons tous dans notre environnement des petits
morceaux d’ADN " décrypte David Mouillot. "Nous allons les filtrer,
les récolter, les examiner et ce n’est pas destructif ni invasif. On ne
prélève rien de vivant, on ne dérange pas les animaux. S’ils sont passés par
là dans la douzaine d’heures précédente, on a des chances de récupérer l’ADN
qu’ils ont laissé".

Récolter puis analyser l'ADN environnemental
Cette technique utilisée depuis cinq années environ, donne des
résultats plus spectaculaires que la recherche classique. "En
plongée, si on voit entre dix et 15 espèces, on est content. Là, ce
sont 30 à 40, beaucoup d’espèces passent sous les radars" complète
le spécialiste. Persuadé que de nombreuses découvertes seront au
rendez-vous, notamment chez les crustacés.
Améliorer les politiques de gestion
La filtration et l'analyse de l'ADNe vont donc permettre de
développer de nouveaux indicateurs de l'état de santé des eaux
marines. Les résultats sont attendus le 8 juin 2024 pour la journée
des océans. Mais en quoi est-ce si important ?
"Il y a deux sujets : d'abord, faire un état "0" de référence
cette année" répond le Professeur. "En second, à l'heure où
l'on parle de l’extension des zones marines protégées ou de
l’implantation de l’éolien, nous n’avons pas forcément d’outils
d’aide à la décision, là oui. Car même les fonds meubles peuvent
paraître très pauvres, mais on peut être surpris, avec des raies,
requins, des poissons enfouis que l’on ne voit pas. Avec la
cartographie on pourra mieux partitionner l’espace et avoir des
bonnes politiques de gestion".


Missions, matière noire... que va chercher le télescope européen Euclid,
parti explorer le côté sombre de l'Univers
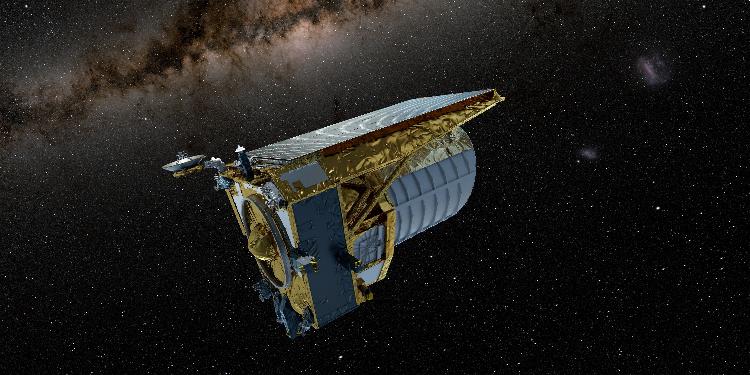
A 1,5 million de kilomètres de la Terre, Euclid effectuera une mission
d'au moins six années, soit 30 000 clichés de l'univers.
Ce samedi 1er juillet 2023, du pas de tir de Cap Canaveral, en Floride, une
fusée SpaceX a emporté à son bord l’un des outils les plus ambitieux de la
décennie. Un télescope spatial européen dont les images, depuis sa future
orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, vont sans doute bouleverser
"notre compréhension des lois fondamentales de la nature", jugent les
chercheurs. Débuté en 2013, le programme Euclid implique 1 600 scientifiques
de dix-sept pays pour cartographier et mieux comprendre l’Univers.
Astronomie et cosmologie font appel à des concepts qui défient nos yeux et
nos esprits béotiens mais qu’il faut bien accepter. La simple idée de vide,
le postulat d’infinité de l’Univers ou la théorie selon laquelle 95 % de ce
qui le constitue, matière et énergie, nous est à la fois invisible et "totalement
inconnu", dit l’astrophysicien Yannick Mellier.
Invisible mais pas insaisissable. Ce sera la mission du télescope européen
Euclid, depuis le port spatial de Cap Canaveral, d’où il a décollé ce samedi
à 17 h 11.

Vers les parages de James-Webb
Ce n’est pas une Ariane 5, la dernière devait avoir décollé – sans un souci
de dernière minute - le 16 juin, mais une Falcon 9 réservée par l’ESA, qui a
propulsé le joyau de l’Agence spatiale européenne vers sa destination, le
point de Lagrange 2. Un voyage d’un million et demi de kilomètres en quatre
semaines, vers ce "nouvel Eldorado de l’astronomie, vaste espace de près
d’un million de kilomètres de diamètre", décrit Bruno Altieri,
responsable scientifique du projet, pour l’ESA.
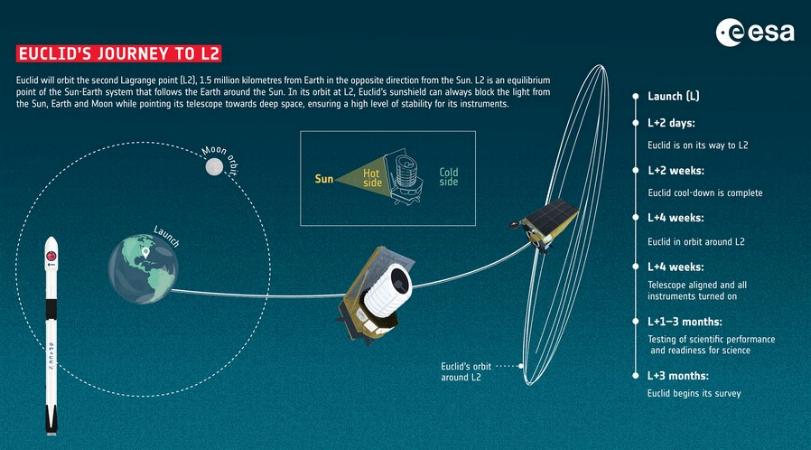
Il faudra quatre semaines au satellite pour se placer en orbite, trois
mois pour qu'il démarre ses observations
Euclid aura pour voisin – à distance respectable – le télescope James-Webb,
comme lui orienté dos au soleil vers la profondeur de l’univers mais avec
des fonctions bien différentes. "James Webb regarde des événements très
précis, des zones très précises de notre ciel, rappelle Julien Larena,
astrophysicien au laboratoire montpelliérain Univers et particules.
Euclid va regarder le ciel dans son ensemble, en faire une cartographie.
Comme si Euclid dessinait la côte atlantique française et Webb, très
précisément, le port de La Rochelle. Il est nécessairement moins précis que
Webb, mais il a une statistique d’objets beaucoup plus grande."
Dix milliards d’années et autant de galaxies
"Que verra Euclid ? Le temps découpé en tranches", dit Yannick
Mellier, chef de projet ESA. L’outil cartographiera l’Univers dans le temps
et l’espace, dix milliards de galaxies sur une période de dix milliards
d’années. Soit environ "73 % de l’histoire de l’univers, vieux de 13,8
Mds d’années", relève Bruno Altieri, et un tiers de la surface du ciel.
15 000 de ses 45 000 degrés carrés, unité de mesure de la voûte céleste.
Mathématicien, "Euclide était géomètre", s’amuse Marc Sauvage, du
CEA, le Commissariat à l’énergie atomique, partenaire du programme.
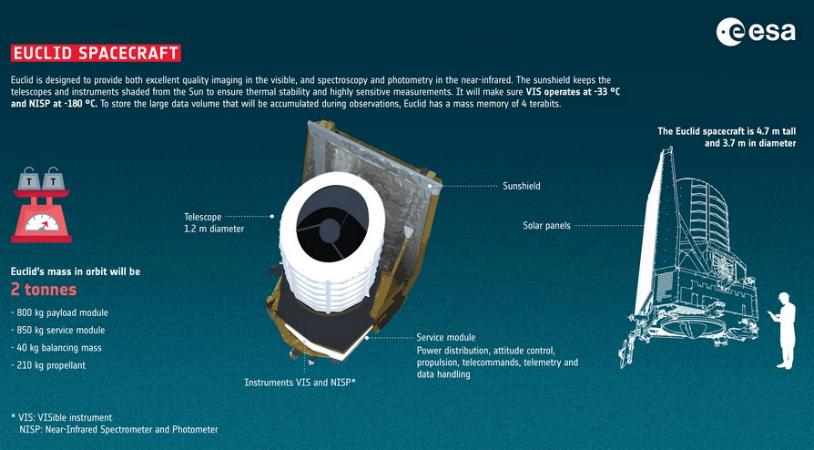
L'ensemble de la structure pèse deux tonnes, assemblé dans l'usine
turinoise de Thales Alenia Space
Rappelons ce principe de base : plus une galaxie est lointaine et plus sa
lumière qui nous arrive est ancienne ; la regarder, c’est donc regarder le
passé de l’Univers. Mais "plus on va loin plus c’est ténu, insiste
Yannick Mellier. D’autant que la structuration de l’Univers s’atténue
quand on remonte le temps."
Énergie sombre et matière noire
Euclid va le remonter très loin, en quête de solution à cinq mystères de la
cosmologie. "Nous voyons dans le ciel notre Voie lactée, reprend
l’astronome de l’ESA Bruno Altieri. Mais si l’on regarde bien au-delà, on
voit que les galaxies ne sont pas réparties de façon uniforme. Et
constituent une toile cosmique qui évolue dans le temps."
Au cœur de cette évolution, figurent la matière noire et l’énergie sombre, "95 %
du contenu matière-énergie de l’Univers", insiste l’astrophysicien
Yannick Mellier, contre seulement "5 % de matière connue".
Quelle est la nature de l’énergie sombre et celle de la matière noire, où se
trouve-t-elle ? Quelles sont les structure et l’histoire de cette toile
cosmique, comment l’expansion de l’Univers a-t-elle évolué ? Sait-on tout de
la gravité ? Euclid sera une "mine d’or pour l’astrophysique", prédit
Yannick Mellier, qui devrait conduire à "un bouleversement de la physique
et à une révision importante de notre compréhension des lois fondamentales
de la nature".
Deux tonnes de très haute technologie
Le miroir principal d'@ESA_Euclid (1,2 m de diamètre) va collecter la
lumière de milliards de galaxies. Celui-ci a été fabriqué au moyen de l'un
des matériaux les plus durs connus, pourtant bien plus léger que le verre.
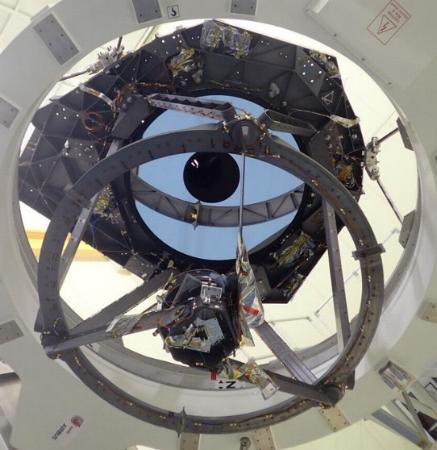
D’une fantastique acuité visuelle, voisine de celle de Hubble, le télescope
de 4,7 m et deux tonnes, assemblé à Turin par Thales-Alenia Space,
effectuera ses observations et ses clichés dans le visible et l’infrarouge.
Derrière son miroir d’1,2 m, "pratiquement équivalent à un 4 m terrestre",
indique Bruno Altieri, et d’une fabuleuse acuité visuelle, voisine de celle
d’Hubble, se trouve "la plus grande caméra jamais lancée dans l’espace.
VIS mesurera de façon très précise la forme des galaxies", le second
instrument, NISP, mesurant leur couleur et leur distance.
La mission est prévue pour six années, à raison de vingt observations par
jour, les premières données attendues "dès la fin de l’année, qui
donneront un avant-goût de ce qu’on pourra faire", juge l’astronome.
600 millions de pixels
350 scientifiques français sont impliqués dans le projet Euclid, outre les
entreprises qui ont participé à la phase de construction. La France est "le
premier contributeur " au consortium constitué autour du télescope, à
travers le Centre national d’études spatiales, le CNRS, nombre de
laboratoires, dont l’Irap, à Toulouse, ou le Commissariat à l’énergie
atomique. Le CEA a notamment conçu le plan focal de la caméra d’Euclid, dont
l’optique est constituée par le télescope.
Cet instrument exceptionnel comprend 36 capteurs CCD d’une définition totale
de 600 millions de pixels. "L’équivalent d’environ 300 téléviseurs HD",
indique André Debus, du Cnes, chef de projet pour les contributions
françaises.
Assemblé à Turin, testé à Cannes, l’ensemble – ni plus ni moins qu’un
satellite, en fait - comprend des modules de charge utile et de service, des
panneaux solaires qui servent aussi de pare-soleil (il doit fonctionner par
moins 170°) et une antenne. Le miroir et la structure sont construits en
céramique, du carbure de silicium.


30 ans d'histoire de la réintroduction du Gypaète barbu, ce fragile
oiseau qui ne fait qu'un œuf par an

On l’appelle le "casseur d’os", le Gypaète barbu est un rapace très
craint mais aussi très fragile.
C’est pourquoi sa réintroduction dans le Mercantour en 1993 était une
véritable réussite. Le week-end du 1er et 2 juillet, il sera mis à l’honneur
au sein de la Maison du Parc à Saint-Etienne-de-Tinée. En 30 ans, 25
Gypaètes barbus sont nés dans ce parc. Une véritable prouesse.
La réintroduction du Gypaète barbu est le fruit d’une réelle coopération
Franco-Italienne. Du côté de nos voisins transalpins, le Parco Naturale Alpi
Marittime et en France, le Parc National du Mercantour.
Seulement un œuf par an
Le Gypaète barbu est une espèce très rare et qui se reproduit très peu.
Victimes pendant des années d’une mauvaise image, nombreux sont ceux qui ont
tenté d'éradiquer le plus grand vautour de la faune européenne sans succès.

La reproduction se limite à un seul œuf par an qui ne survit pas toujours
aux aléas climatiques et géographiques.
Emmanuel Gastaud, chargé de communication du Parc national du Mercantour :
"Actuellement, cinq couples nichent dans le Parc du Mercantour. On est
très fier de nous, de nos investissements personnels et financiers à hauteur
de centaines milliers d’euros."

Gypaète Barbu
Un oiseau très rare et malaimé
Sur terre depuis des millions d’années, il est essentiellement présent en
Afrique et en Eurasie. C’est dans les Alpes, en Corse et en Isère que le
Gypaète semble avoir trouvé sa place.
Ces vautours qui peuvent vivre jusqu’à 45 ans atteignent leur âge de
maturité sexuelle à 7 ans.
Nathalie Siefert, chef de service connaissance et gestion du patrimoine Parc
national du Mercantour :
"C’est
assez tardif et généralement les premiers essais de procréation sont des
échecs. Un bébé par an, il ne faut vraiment pas se louper ! "
Depuis toujours, le Gypaète souffre d’une mauvaise réputation alors que
comme tout vautour, il ne se nourrit jamais d’animaux vivants, mais toujours
de cadavres.

ypaète Barbu
Le retour du gypaète dit le "casseur-d'os" n'est pas que symbolique, par son
rôle de recyclage des cadavres, cette espèce remplit un rôle primordial dans
le bon fonctionnement des écosystèmes.
Nathalie Siefert :
"Réussir à avoir des couples en captivité nous demande une énorme
technicité. C’est pourquoi nous en sommes si fiers."
Un pari difficile à relever, mais largement gagné.

Lors de la réintroduction d'un couple de Gypaète Barbu.
Le déroulé de ces deux jours de célébration
Les 1er et 2 juillet 2023, le Parc national du Mercantour fête les 30 ans
d'actions de réintroduction et de conservation du Gypaète barbu au sein du
massif franco-italien Marittime Mercantour.
Ce samedi 1er jullet sera une journée "grand public" à Saint-Etienne de
Tinée. De 15 heures à 18 heures, au cœur de la Maison du Parc, enfants et
adultes pourront profiter de plusieurs activités autour de ce rapace
reconnaissable notamment par sa barbe unique.

Plusieurs festivités sont prévues dans le Mercantour pour célébrer les 30
ans de la réintroduction du gypaète barbu. Certains visiteurs pourront même
l'observer dans son nid.
Au programme : des animations pédagogiques comme des jeux ou des ateliers et
une projection du film "Aigle et gypaète, les maîtres du ciel ",
tourné sur 7 années.

Le dimanche 2 juillet sera réservé aux institutionnels, aux partenaires et
aux membres du réseau "gypaète Mercantour". Ils pourront voir de plus près
un nid de gypaètes grâce à une lunette d’observation.
Deux jours pour savourer une réussite d’une telle ampleur que 25 Gypaètes
sont nés sur le territoire du Mercantour en 30 ans.


"Épidémies et mortalités massives" en mer Méditerranée : les conséquences
effrayantes du réchauffement de l'eau

Un pic de température de 27,4°C a été enregistré dans la région
Méditerranée, dans la région de Marseille
La Méditerranée est particulièrement touchée par des vagues de chaleur ces
dernières années, en raison du réchauffement climatique. Cela impacte
directement les espèces sous-marines, jusqu'à en faire disparaitre certaine.
C'est indéniable, les océans et mers se réchauffent. Et la mer Méditérranée
est particulièrement frappée par ses variations de températures et par
l'intensification d'épisode extrême. L'année 2022 a été celle de tristes
records, un pic a été enregistré à 27,4°C dans la Méditérranée, dans la
région de Marseille. Et ce n'est pas tout, pendant plus d'une semaine
entière le thermomètre n'est pas repassé en dessous de la barre des 26°C
sous l'eau.
Au total, sur les deux mois les plus chauds de l'été, la température moyenne
a été supérieure de 2°C par rapport aux années précédentes. Elle est
actuellement de nouveau frappée par des vagues de chaleur. Le mois de mai a
été le plus chaud jamais enregistré et celui de juin a été particulièrement
chaud.
Des impacts directs sur l'écosystème marin
La surface de la mer n'est pas la seule partie à subir ces températures, les
profondeurs sont aussi touchées. En 2022, une masse d'eau chaude a plongé
jusqu'à 20 mètres de profondeur à certains endroits du nord-ouest de la
Méditerranée.
Ces vagues de chaleur et ce réchauffement global de la Méditerrannée ont de
nombreuses conséquences sur les écosystèmes. Ces phénomènes peuvent
engendrer un changement géographique des espèces. "Il va y avoir un
mouvement progressif des espèces méridionales, la plupart du temps de
l'Ouest vers le nord. Ils vont migrer vers des côtes plus fraîches",
décrit Thierry Perez, chercheur CNRS, responsable de la station sous-marine
d'Endoume.
C'est ce qui explique que depuis plusieurs années, barracudas, sardinelles
et daurades coryphènes soient désormais visibles et pêchés dans la région de
Marseille, l'une des plus froides du Nord-Ouest.
D'autres espèces, envahissantes, exotiques, ont aussi gagné les côtes avec
la hausse des températures sous-marines et se sont propagées. "Elles
entrent alors en concurrence directe avec les espèces locales dans la
recherche de nourriture et dans le développement de leurs lieux de vie",
explique Thierry Perez.
Maladies et menaces et disparition
Et si d'un côté, des espèces migrent avec les vagues de chaleur, d'autres,
plus locales vont être très affectées massivement et certaines vont même
disparaître.
Le chercheur détaille : "lors de vagues de chaleur importantes des
bactéries se développent et engendrent des épidémies et des mortalités
massive. Coraux, éponge et autres invertébrés sont touchés".
Thierry Perez a même répertorié la disparition d'une espèce locale tout
dernièrement, après les événements de l'été dernier : l'éponge. Auparavant
très présente et largement pêchée, elle se fait aujourd'hui très rare.
Ces événements climatiques très extrêmes sont vécus par les espèces comme
des moments de stress car ils perturbent le fonctionnement normal de leur
système biologique. Chez les coraux cela se caractérise par exemple par un
blanchiment.
Thierry Perez :
"À chaque vague de chaleur c'est une trentaine, une quarantaine
d'espèces qui sont impactées à des degrés variables".
Comme l'année dernière à Marseille, les principales victimes seront
également les gorgones et plus particulièrement la pourpre. "Les espèces
qui étaient dans les 20 premiers mètres de profondeurs ont été très
sévèrement attaquées. Heureusement certaines sont protégées car elles
poussent plus en profondeur ", complète le chercheur.
Pour la suite, les scientifiques ne sont guère positifs, ces vagues de
chaleur devraient s'amplifier et durer encore plus longtemps dans le temps.
"Ces situations qui sont normalement "exceptionnelles"qui sortent des
normales, sont aujourd'hui fréquentes aussi bien en été qu'en hiver ",
termine le chercheur.


Lutte contre les incendies: les postes de secours sont de nouveau en
service aux Ferres
Les postes de secours du village sont à nouveau opérationnels. Répartis
sur cinq zones, ils sont équipés du matériel nécessaire pour agir en cas
d’incendie.

À l’intérieur de chaque coffre on trouve les clés de la bouche
d’arrosage attenante, des manches et des raccords pour ouvrir les vannes
Tout contre les flammes. L’incendie qui ravage les prairies et la vie. Au
village des Ferres, Philippe Tossan, le maire, a décidé de tout mettre en
œuvre pour éviter une telle catastrophe.
En pleine sécheresse, le premier magistrat du village vient de remettre en
service les postes de secours qui étaient tombés en désuétude "sous
l’ancienne municipalité".
De quoi parle-t-on ? Ces postes de secours sont équipés de matériel
permettant d’agir rapidement pour lutter contre un éventuel incendie. Du
matériel rangé dans un coffre à proximité du réseau de bouches d’arrosage
dont dispose la commune.

Les habitants ont suivi une journée de sensibilisation pour
apprendre, notamment, à utiliser un extincteur
"Être acteur dans son village"
"Nous avons fait le tour des postes de secours du village et dressé
l’inventaire des éléments manquants, résume le maire. À l’intérieur
de chaque coffre, on doit trouver les clés de la bouche d’arrosage
attenante, des manches et des raccords qui permettent aux habitants d’ouvrir
les vannes en cas de besoin."
Le village a été partagé en cinq zones bien délimitées. "Nous avons
dressé un plan pour déterminer le poste à utiliser dans chacun des secteurs
des Ferres."
L’idée, pour Philippe Tossan, est que "chaque habitant puisse être acteur
dans son village pour agir rapidement ". La caserne la plus proche étant
celle de Roquesteron, ces postes de secours sont vitaux pour éviter la
propagation en attendant les pompiers.
Pour se les approprier, les habitants ont participé à une journée de
sensibilisation, au début du mois. "L’an dernier, il y a eu un départ de
feu domestique au village et nous nous sommes rendu compte que les gens ne
savaient pas comment réagir, se rappelle l’édile. Grâce à cette
journée, encadrée par des pompiers, ils ont pu se familiariser avec les
gestes de premiers secours et l’utilisation d’un extincteur."


Pour désengorger des sites naturels, le Mercantour et la Métropole de
Nice proposent des navettes pour rejoindre les départs de rando
Le parc estime que la fréquentation minimale se situe entre 600.000 et
800.000 visiteurs par an, essentiellement l’été.

Le col de la Bonette fait partie des sites très fréquentés du Mercantour
Comme de nombreux espaces naturels protégés, le parc national du
Mercantour s’interroge depuis plusieurs années: comment mieux encadrer le
flux de touristes ?
"On attend à nouveau beaucoup de monde cet été: les réservations de
refuges sont de bon augure, souligne la directrice du parc, Aline
Comeau. C’est un espace soumis à des règles, il faut faire en sorte que
les visiteurs en profitent tout en préservant cette nature."
Combien de personnes viennent chaque été arpenter le haut-pays ?
Le parc estime que la fréquentation minimale se situe entre 600.000 et
800.000 visiteurs par an, essentiellement l’été. Mais ces chiffres sont à
relativiser et surtout peu représentatifs.
"Le Covid a créé un gros boom pour les espaces naturels, souligne la
cheffe de service sensibilisation et valorisation du territoire, Laure
Pumareda. Là, on note un retour à la situation de 2019. La fréquentation
baisse mais il y a des pics sur certains sites très fréquentés, à des
moments précis, comme le 14 juillet et le 15 août."
Ces "hot spots": le lac d’Allos, le col de la Bonette, le Boréon, la
Gordolasque, la Madone-de-Fenestre et la vallée des Merveilles.
Quelles mesures mises en places?
L’idée est de mieux réguler les flux et d’encourager le visiteur à plus
respecter les lieux ou à aller ailleurs, si le site est déjà saturé. Le lac
d’Allos connait des pics à 1.000 visiteurs par jour. Un dispositif a été mis
en place en 2021 avec la municipalité qui limite la capacité du parking,
avec un système de réservation à l’avance. Des dispositifs que le Mercantour
souhaite développer "au cas par cas", grâce à l’intelligence
artificielle, la data ou les GPS. C’est pour ça qu’il a commencé à faire des
comptages. Résultat, par exemple: 100.000 passages de véhicules au col de la
Bonette chaque saison, 80.000 au col de la Cayolle.
Comment venir sans voiture ?
Pour pousser à la mobilité douce et désengorger certains sites, le Parc et
la Métropole Nice Côte d’Azur testent un nouveau dispositif de navettes.
Elles sont mises en place pour relier la ligne régulière (ligne 90 Grand
Arénas - La Bolline Valdeblore) aux points de départ des randonnées, à des
horaires appropriés. C’est une correspondance, votre ticket est le même.
La navette du Boréon
Elle circulera du 10 juillet au 3 septembre, les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés. Départ de Saint-Martin-Vésubie à 9h35. Départ du
Boréon à 17h30.
La navette de la Gordolasque
Elle circulera pendant la même période, les vendredis, samedis, dimanches et
jours fériés. Départ de Roquebillière à 9h20. Départ de la Gordolasque à 18
heures.
Une navette doit également être mise en place pour relier la
Madone-de-Fenestre
Mais l’accès n’est toujours pas rétabli. Sous réserve de l’ouverture
de la route, cette navette circulera tous les jours. Départs de
Saint-Martin-Vésubie à 9h35 et 11 heures. Départ de la Madone à 15h15 et
17h45.
.


Avec la sécheresse comment préserver la biodiversité du Mercantour ?
Article Nice Matin d'août 2022

Le parc du Mercantour abrite plus de 8 000 espèces
La sécheresse sans précédent qui s’est abattue sur les Alpes-Maritimes
n’épargne pas nos montagnes. Alors, comment protéger la faune et la flore
alpines ? Voici quelques pistes.
La sécheresse historique de cette année touche aussi les versants du
Mercantour. Et tout indique que cela ne va pas s’améliorer à l’avenir. Une
situation préoccupante pour la biodiversité locale, extraordinairement riche
mais dépendante des ressources en eau pour sa survie.
Une biodiversité exceptionnelle à protéger
Le parc du Mercantour, c’est plus de 8.000 espèces différentes. On y
retrouve pas moins de 40% de toute la flore française, ainsi que la faune
emblématique de la montagne: chamois, marmottes, bouquetins, loups… Le parc
a aussi une grande variété d’insectes et de papillons. Autre exemple, le
saxifrage à fleurs nombreuses, la fleur emblématique du parc, qui ne pousse
que dans ces versants.
Au point que la région a été qualifiée de "hotspot ", ou point chaud,
de la biodiversité. Si les espèces y sont aussi nombreuses, elles sont
également particulièrement menacées par l’action de l’homme et vulnérables
face au changement climatique. D’où la création du parc national pour les
protéger.
Un impact inégal selon les zones
Les conditions climatiques de ces montagnes sont déjà naturellement
difficiles, souvent extrêmes, surtout l’hiver et l’été. Mais cette année, la
sécheresse a fait des ravages, fragilisant les espèces. "Le manque d’eau
l’été est une conséquence directe du manque de neige en hiver ",
explique Pierre Alengrin, qui s’occupe des pistes d’Isola 2000. Les cours
d’eau et le niveau des lacs sont extrêmement bas pour la saison. Un lac a
même disparu. "Ça fait 60 ans qu’on n’a pas vu ça, c’est exceptionnel
", témoigne Emmanuel Gastaud, chargé de mission au parc national du
Mercantour.
Le territoire du Mercantour reste inégalement impacté par la sécheresse, car
les averses sont très localisées. Dans la vallée des Merveilles, en
altitude, le constat est un peu moins alarmiste. Selon Yann Bonneville,
gardien du refuge des Merveilles, la situation s’est améliorée depuis le
début de l’été. "On était très inquiets début juin. Mais on a eu de beaux
orages cet été en altitude, ce qui nous a sauvé la saison". Les lacs et
cours d’eau de la vallée ont pu se remplir, même si les nappes phréatiques
restent tout de même basses.

Un beau couple de marmottes, un chamois et un spélerpès de Strinati
prenant la pose... Des trésors du Mercantour
Grenouilles et crapauds en danger de mort
Premiers touchés par cette sécheresse : les crapauds et les grenouilles. "La
vraie problématique se pose sur les animaux qui vivent dans les lacs, car
leurs espaces de vie sont de fait réduits", explique Emmanuel Gastaud.
Privés de nourriture et de lieux pour se reproduire, les batraciens accusent
une mortalité assez élevée cette année.
La "grande" faune, comme les chamois, s’adapte. Il reste encore de
l’eau pour que les animaux puissent s’abreuver, mais ils doivent parcourir
des distances plus grandes. Cela engendre une situation de stress, qui peut
être problématique si elle perdure dans le temps.
Côté flore, tout a poussé avec plusieurs semaines d’avance cette année. Les
fleurs ne vont pas au bout de leur cycle, car elles ne reçoivent pas
suffisamment d’eau, ce qui entrave la reproduction des espèces. Les insectes
pollinisateurs souffrent aussi beaucoup du manque d’eau, certains meurent.
Les oiseaux ont donc moins à manger. C’est toute la chaîne qui est
perturbée.
Eviter le cumul de stress pour les animaux
Que faire alors, pour soulager la biodiversité en cette période de
sécheresse exceptionnelle? Pour le parc du Mercantour, il faut à tout prix
éviter d’ajouter un stress supplémentaire aux animaux. Et donc inciter les
visiteurs à déranger le moins possible la faune.
En saison touristique, la fréquentation des lieux empire le stress. Le parc
note un nouveau type de visiteurs qui "n’ont pas forcément les bons codes
pour les espaces naturels". Les animaux approchés fuient, et dépensent
donc de l’énergie, alors que la sécheresse engendre déjà beaucoup de perte
d’énergie pour eux.
"Il faut bien comprendre que ces animaux évoluent dans des conditions
extrêmes, même s’ils sont habitués", insiste Emmanuel Gastaud. Alors, on
reste sur les sentiers et on ne court pas derrière les chamois pour prendre
le cliché parfait. Et on essaie de ne pas faire trop de bruit pour ne pas
déranger les animaux qui, ne l’oublions pas, sont chez eux.
Un travail sur le long terme
Pour l’association "Biodiversité sous nos pieds", qui œuvre pour la
protection des milieux naturels, la préservation doit se faire par un
changement profond de paradigme. "Il faut arrêter d’exploiter la montagne
de manière irraisonnée, explique Dorian Guinard, professeur de droit
public à Sciences Po Grenoble et membre de l’association. Si on continue,
on va droit à la catastrophe".
Face au changement climatique, il faut donc renforcer la résilience de la
faune et de la flore. Une préservation de la biodiversité alpine qui "ne
se joue pas sur un ou deux étés", explique le professeur. Car les
espèces s’adaptent sur le long terme.
Repenser la gestion de l’eau en montagne
Dorian Guinard insiste: pour protéger la faune et la flore, une bonne
gestion de l’eau est capitale. Alors, dans le Mercantour, le parc incite les
visiteurs aux gestes simples d’économie. Dans les refuges en particulier, la
ressource est précieuse.
Avec la sécheresse, l’approvisionnement en eau y est limité, alors que les
refuges en ont besoin pour les repas et les sanitaires. Ainsi, le refuge de
la Valmasque a décidé de couper ses douches. Ce n’est pas le seul. Le refuge
des Merveilles avait aussi décidé de les couper début juin, mais l’eau étant
approvisionnée par un lac, il a pu les remettre en service depuis.
Pour Emmanuel Gastaud, chargé de mission au parc, les visiteurs doivent
prendre conscience de cette problématique de l’eau. "L’eau est un bien
commun", insiste-il. Face à cette situation exceptionnelle, au lieu
d’aller prendre une douche, on opte donc pour une petite toilette ou on
saute dans un lac. À Isola 2000, beaucoup d’endroits ne sont plus irrigués
et les fontaines ont été coupées, de même, la micro-centrale, qui produit de
l’électricité, ne tourne pas à plein régime. Mais la question de la gestion
de l’eau est bien plus large que celle des petits gestes du quotidien.
"Ce n’est pas avec des points d’eau, des petites constructions, qu’on va
arriver à combler les carences hydriques", explique Dorian Guinard.
Selon lui, c’est tout le modèle économique de la montagne qu’il faut
repenser. La neige artificielle, qui nécessite une forte consommation d’eau
et engendre la création de retenues collinaires, est particulièrement visée
par les associations environnementales.
Or les canons à neige sont de plus en plus prisés par les stations, qui
cherchent à pallier le manque de neige en hiver. Une conséquence de la
hausse des températures et d’une faible pluviométrie, surtout en basse et
moyenne altitude. À Isola 2000, 60 à 70% du domaine skiable est ainsi équipé
de canons à neige.


Voilà que le maire de Nice annonce qu’un troisième "poumon vert" est
déjà en projet

On connaissait la promenade du Paillon, dont les travaux de prolongement
sont en cours. On savait qu’elle aurait à terme son pendant à l’ouest, avec
une seconde trame verte reliant l’Allianz Riviera au palais Nikaïa.
Retour à l’Est, sur l’immense emprise de la gare de marchandises à
Saint-Roch. Sauf que "du fret, il n’y en a plus" ou presque. "Les trois
quarts des voies ne servent plus à rien", souligne Christian Estrosi qui
lorgnait depuis un moment sur cette emprise foncière de plusieurs dizaines
d’hectares. Il fut même envisagé de façon éphémère d’y relocaliser la
prison... Il n’en sera rien.
Gommer l’un des principaux îlots de chaleur
"Le temps où dès qu’on avait du foncier libre on en profitait pour y
placer un équipement public est révolu. Aujourd’hui, l’enjeu c’est au
contraire la désimperméabilisation", insiste l’édile niçois qui en veut
pour preuve la carte thermique de la ville: "A Nice, il y a trois
principaux îlots de chaleur. Sur le Paillon, à l’Arénas au niveau du MIN et
à Saint-Roch. Il y fait 10°C de plus que sur la coulée verte. C’est
aujourd’hui une friche urbaine. Il faut en faire au contraire un lieu
qualitatif."

Autant de raisons qui ont décidé le maire de Nice à se lancer dans la "reconquête
de ce faisceau ferroviaire". Pas question pour autant d’abandonner le
rail. La SNCF vient au contraire de lancer un plan de modernisation du site
sur lequel elle va construire d’ici fin 2024 un centre de maintenance
technique. Christian Estrosi explique en avoir profité pour lui "imposer
un cahier des charges très strict sur le plan environnemental ".
Promenade arborée et pistes cyclables
Non seulement pour la construction de ses bâtiments administratif et
technique qui seront "en terre cuite". Mais la municipalité a aussi
demandé à la SNCF d’optimiser ses voies de chemin pour "en réduire
l’emprise". L’objectif est donc de végétaliser les espaces laissés
vacants. "Quelques dizaines d’hectares", assure le maire qui annonce
que la future trame verte traversera de part en part le faisceau
ferroviaire, quitte à envisager "des passages souterrains".
L’idée est justement de gommer cette "fracture dans la vallée du Paillon"
que constitue aujourd’hui la gare de marchandises. Et de reconnecter entre
eux les quartiers grâce à "une promenade arborée et des pistes cyclables"
qui "relieront le 109, Vauban, Pont Michel, Saint Charles et Bon Voyage".
Le tout "à l’horizon 2026 ou 2027 ", promet Christian Estrosi.
Et à moindre coût car cette végétalisation sera, assure-t-il, "financée
par la SNCF " qui reste propriétaire des lieux.


La disparition du lac de Broc serait-elle vraiment une catastrophe alors
qu'il est artificiel

Le lac du Broc, le 11 mai 2023
Vous vous questionnez sur l’impact qu’aurait la disparition du
lac du Broc – s’il venait à s’assécher – puisqu’il a été créé dans les
années 1950 pour l’exploitation d’une carrière.
Sollicité, le Département, en charge de cet espace protégé de 25 hectares,
décrit le "rôle essentiel pour la biodiversité des écosystèmes "
cette étendue d’eau.
"Il accueille la faune et la flore qui affectionnent les milieux humides
d’eau stagnante qui sont uniques et menacés au sein de la basse vallée du
Var par l’anthropisation [modification d’un milieu naturel par
l’activité humaine, N.D.L.R.]. L’assèchement complet du lac entraînerait
la disparition de l’ensemble des écosystèmes liés à la zone humide et à la
ripisylve [végétation installée sur la berge d’un cours d’eau,
N.D.L.R.]. Les poissons disparaîtraient, les essences forestières liées à
ces milieux humides également (peupliers, trembles, saules…), il n’y aurait
plus de halte migratoire pour les oiseaux d’eau migrateurs ainsi que pour
les sédentaires. Plus de développement d’insectes aquatiques et disparition
des zones de chasse des chiroptères (chauve-souris), ce qui impacterait
également les effectifs de chauve-souris. Cette disparition entraînerait une
perte importante de biodiversité et une banalisation et une homogénéisation
des milieux naturels restant au sein de la basse vallée du Var."


A quoi ressemblerait Nice avec le casino de la Jetée-Promenade ? La
réponse... en réalité virtuelle
L’inspiration byzantine, les arcades, les tourelles…
La projection 3D réalisée il y a bientôt dix ans recréait le
casino de Nice en virtuel

Si le casino municipal existait encore aujourd’hui, la vue depuis le
boulevard Jean-Jaurès ressemblerait probablement à cette projection 3D
réalisée, il y a dix ans, par Mario Basso. Image Mario Basso architecte
L'idée paraît folle mais elle a été approuvée par les riverains: la semaine
dernière, le président du comité de quartier a proposé... la reconstruction
du casino de la Jetée-Promenade.
Le "fantôme de la Prom", démantelé en 1944 par les nazis, n'en finit
donc pas d'alimenter les fantasmes. Et les envies: en quelques heures, plus
de 200 lecteurs ont répondu à notre consultation... et, en grande majorité,
penchent pour un "oui ".
On vous rappelle l'histoire
extraordinaire du casino de la Jetée-Promenade
Au-delà de la faisabilité du projet, qui paraît plus qu'incertaine
pour bien des raisons (loi Littoral, exigences environnementales, coût
faramineux, contraintes imposées par le classement de Nice au patrimoine
mondial de l’Unesco...), il n'est pas interdit de se demander à quoi
ressemblerait Nice si l'on y reconstruisait le bâtiment sur pilotis qui, de
1891 à 1944, abrita un espace de jeu et des restaurants d’inspirations
diverses dans lesquels se succédèrent de nombreuses fêtes, amusant la belle
société d’alors.
C'est d'ailleurs ce qu'avait fait, en 2014, l’architecte cagnois Mario
Basso, qui s'était lancé dans un projet unique: recréer la Jetée-Promenade
en images 3D.
Sans plan, l’Azuréen avait dessiné le casino grâce aux documents qu’il avait
trouvés dans les brocantes du département. "J’ai scanné les cartes
postales, décortiqué point par point la jetée pour en extraire les
proportions et les volumes", détaillait-il dans nos colonnes en janvier
2014.
Des heures de travail – 5.000 (!) pour être précis – plus tard et l’édifice
est reconstitué en 3D. En copie presque conforme.
"Je voulais refaire la jetée et le casino, dans l’esprit de 1891,
c’est-à-dire à l’achèvement des travaux." Les ajouts intervenus plus
tard, l’agrandissement du bâtiment et la réduction de la superficie des
terrasses, n’apparaissent pas sur cette projection.
70 ans après sa disparition, tout y est : l’inspiration byzantine, le dôme,
les arcades, les tourelles, les moulures.

Une vue depuis la plage. Image Mario Basso architecte
Malgré l’engouement numérique pour ce projet (8.000 internautes avaient
visité son blog en moins d’une semaine), Mario Basso n’imaginait pas qu’il
puisse aboutir.
"La jetée masquerait complètement la vue de Rauba-Capeù et du cap de
Nice, ce serait dommage. De plus, ça coûterait facilement le prix d’un stade
de bâtir 6.500 m3 sur pilotis ", estimait le professionnel à l’époque.


L’idée paraît folle... le comité de quartier propose de reconstruire
le casino de la Jetée-Promenade à Nice
Ce projet fou est proposé par l’Association de promotion et de sauvegarde du
front de mer à Nice-comité Promenade. Une résurrection, dont le financement
serait demandé à l’Allemagne…

Ressusciter le casino de la Jetée-Promenade, qui fut synonyme de
fêtes élégantes à Nice, entre 1891 et la Seconde Guerre mondiale. C’est
l’idée, inédite, de Kirkor Ajderhanyan. Photo DR
Reconstruire le mythique casino de la Jetée-Promenade sur la mer.
Redonner vie au spectaculaire bâtiment sur pilotis, inspiré du casino
britannique de Brighton, qui regroupa de 1891 à 1944 un espace pour le
jeu et des restaurants d’inspirations diverses, dans lesquels se
succédèrent de nombreuses fêtes amusant la belle société d’alors. Voilà
le projet, un peu fou, il faut bien l’admettre, de Kirkor Ajderhanyan.
Le président de l’Association de promotion et de sauvegarde du front de
mer à Nice-comité Promenade, l’a proposé lors de l’assemblée générale de
ce groupement qui travaille pour la qualité de vie le long du littoral.
Dans l’ensemble, l’assistance, bien que surprise par la suggestion
inattendue, a validé la proposition. Il faut dire que cette perspective
romantique et extravagante intervenait après une énumération d’accidents
souvent graves, de livraisons gênantes sur la chaussée, de nuisances
émaillant de négatif le quotidien de la promenade des Anglais et ses
environs immédiats.
Démantelé pour sa ferraille
Comment cette idée a-t-elle pu jaillir dans l’esprit du président? Ce
dernier raconte: "Lors de la présentation du magazine Lou Sourgentin, la
semaine dernière à la caserne des sapeurs-pompiers de Magnan, le
commandant a évoqué le casino, précisant que durant la guerre, les
Allemands avaient démonté l’acier de la structure."
C’est vrai. En 1944, les nazis, qui occupent la région, démantèlent
l’édifice pièce par pièce afin de réutiliser ses matériaux, notamment
métalliques, à des fins bellicistes.
Plus écologique
Ce qui rend Kirkor Ajderhanyan encore plus inventif dans sa démarche: "Pourquoi
ne pas lancer une réflexion concernant une reconstruction de la
Jetée-Promenade et, comme les Allemands l’ont détruite, on pourrait
demander à l’État allemand de prendre en charge, financièrement, cette
reconstruction prestigieuse et symbolique? Avec peut-être d’autres
matériaux écologiques et en étant conforme à la loi Littoral. Une partie
de Nice est inscrite au patrimoine de l’Unesco, qui pourrait d’ailleurs
s’intéresser à ce projet. Dans le cadre d’un réaménagement total du
front de mer, que nous préconisons, ça vaut la peine d’y songer."


On vous rappelle l'histoire extraordinaire du casino de la Jetée-Promenade
Près de 80 ans après son démantèlement par les nazis, le "fantôme la Prom"
continue de susciter des fantasmes à Nice. Au point que le président du
comité de quartier a récemment proposé sa reconstruction, financée par...
l'Allemagne. L'occasion de revenir sur l'histoire tourmentée de ce bâtiment
d'exception que fut le casino de la Jetée-Promenade.

C'était la Belle Epoque. Le bon temps où jeux, fêtes,
divertissements avaient pour théâtre cet extraordinaire casino en
suspension sur les flots de la Baie des Anges. Une phare dans une ville
en plein essor. Photo DR
Le Casino Jetée Promenade, joyau de la French Riviera, symbole du faste
de l'âge d'or de la Côte d'Azur, est né d'une tocade du marquis d'Espouy
de Saint-Paul.
Ce dernier s'est installé à Nice dans les années 1875. Lors d'un voyage
outre-Manche, il s'est entiché du Crystal Palace, le casino de Brighton,
édifice de fer et de verre sur la mer froide. Il rêve d'un édifice
identique sur la mer chaude qui borde le lieu de villégiature de la
jet-set mondiale.
Il convainc - non sans difficulté - la municipalité de l'époque et fait
appel à l'architecte anglais James Brunlers. Ainsi naît le premier
Casino Jetée-Promenade, que la presse de l'époque décrira comme un "immense
vaisseau aux coupoles hardies et lignes capricieuses ".
Incendié la veille de l'inauguration
Dôme culminant à 20 mètres, kiosque à musique, salle de concerts,
théâtre, sur une plate-forme de 6.500m2 sur la mer reliée au rivage par
une passerelle longue de 130 mètres: l'ouvrage est audacieux et doit
être inauguré le 4 avril 1883.
Tout est prêt pour le grand jour, on a verni de frais toutes les
boiseries, sorti la plus fine vaisselle de Limoges…
Hélas, la nuit précédant la fête, d'immenses flammes éclairent la Baie
des Anges. Un incendie a éclaté au cœur du Casino, qui flambe comme une
allumette. On raconte que le brasier est si violent qu'à cent mètres les
vitres des immeubles fondent…
Au petit matin, il ne reste du rêve du Marquis d'Espouy de Saint-Paul
que la passerelle et les terrasses calcinées. La rumeur court que
l'incendie est criminel, l'enquête piétine.
Remonté par une entreprise niçoise
Un groupe franco-belge reprend le projet. Une nouvelle autorisation est
donnée en 1889 par le préfet pour la reconstruction.
Le cabinet d'architecture parisien Denise est chargé des plans tandis
que la réalisation technique est confiée à l'ingénieur parisien Meyer.
L'entreprise niçoise, Dumontel et Tombarel, remonte le Casino. Qui est
inauguré le 10 janvier 1891.

Photo Jean Giletta.
Le lieu revit, fréquenté par la belle société.
Quand éclate la première guerre mondiale, il est transformé en
sanatorium.
Démantelé par les nazis
À la fin du conflit, le Casino rouvre. Mais les temps sont durs. Le
Casino vivote, loin de ses années fastes.
En 1944, il est démantelé par les Nazis. Les Allemands le démontent,
pièce par pièce, pour réutiliser ces matériaux dans des ouvrages de
défense.
A l'été 1944, quand les Américains arrivent à Nice, le Casino Jetée
Promenade n'est plus qu'un squelette dépecé...
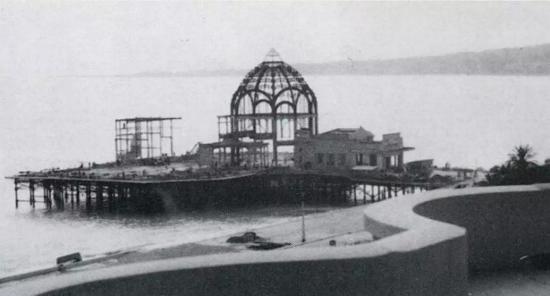
Dépecée par les Allemands en quête de métaux pour faire des
barrages anti-chars, la Jetée Promenade a connu une triste agonie et une
fin pitoyable… Photo Jean Giletta.


Déclin des papillons en Europe : pourquoi il est important de protéger
ces insectes pollinisateurs
 . .
Les papillons sont indispensables au maintien de la biodiversité et
précieux pour de nombreuses cultures agricoles puisqu'ils transportent plus
de 80% du pollen des fleurs
Les papillons d'Europe sont en danger. Généralement apprécié, cet insecte
aux mille teintes qui symbolise l'espoir et la liberté est surtout essentiel
au maintien des écosystèmes et précieux pour l'agriculture. Voici comment le
protéger.
Selon un rapport de l'Observatoire national de la biodiversité publié en
2022, parmi les 301 espèces de papillons de jour vivant en France
métropolitaine, 200 ont disparu d’au moins un département depuis le siècle
dernier.
Au total, cela représente 66% des espèces. Et d'après l’Agence européenne de
l’environnement, la moitié des papillons de prairie a disparu d’Europe en
l'espace de vingt ans. Mais le grand public ne réalise toujours pas
l'ampleur de cette menace qui pèse sur les papillons. "Trop souvent
perçus comme indésirables, les insectes sont rarement la cible d’actions de
préservation. Mis à part l’abeille domestique, prisée pour son miel, on
méconnaît le rôle essentiel des insectes qui sont pourtant des maillons clés
de la bonne santé des écosystèmes", déplore le Muséum national
d'Histoire naturelle sur son site internet.
Rôle essentiel
Mais que sait-on des papillons ? S'ils sont généralement très appréciés pour
leur beauté et suscitent la curiosité pour leur cycle de vie singulier, le
rôle essentiel joué par les lépidoptères dans le maintien des écosystèmes
est moins connu. Tout comme les autres membres de sa famille d'insectes
pollinisateurs, les papillons sont pourtant indispensables au maintien de la
biodiversité et précieux pour de nombreuses cultures agricoles puisqu'ils
transportent plus de 80% du pollen des fleurs. Ils représentent de surcroît
un maillon indispensable de la chaîne alimentaire, dans la mesure où ils
servent de nourriture à de nombreux prédateurs : les araignées, les lézards
ou encore les oiseaux.
Le déclin des papillons est en majeure partie dû à la perte de leur habitat,
elle-même provoquée par l'agriculture intensive et l'artificialisation des
sols. D'après les experts de l'Observatoire national de la biodiversité, les
papillons de prairie sont particulièrement concernés, ces espaces naturels
étant détruits par l’urbanisation, l’assèchement des zones humides, la
déforestation ou encore l’abandon des élevages extensifs. Mais d'autres
raisons expliquent le déclin des papillons, à commencer par le dérèglement
climatique et les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, la
pollution lumineuse, ainsi que les intrants chimiques injectés dans les sols
agricoles, et plus spécifiquement les pesticides.
Les solutions pour préserver au mieux les papillons consistent donc à
éliminer ces facteurs nocifs, par exemple en bannissant l'usage des
herbicides et des pesticides dans tous les espaces verts qui pourraient leur
servir d'habitats, ce qui implique également les jardins (ou même les
balcons) des particuliers. Une autre solution clé consiste à réduire
drastiquement l'intervention de la main humaine pour laisser la nature
s'exprimer. Par exemple en diminuant l'intensité et la fréquence des
fauchages dans les prairies, ou en tondant moins souvent la pelouse de son
jardin. Bon à savoir : certaines plantes et arbres servent aussi à la fois
de refuge et de garde-manger aux papillons, à l'instar du noisetier, du
framboisier et du tilleul.
On peut aussi participer à une opération de comptage : "Au-delà du
plaisir de les voir virevolter, reconnaître les lépidoptères, les observer
et les compter peut aussi grandement contribuer à leur sauvegarde",
plaide la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui incite tout citoyen
désireux de contribuer à la préservation des papillons de s'engager dans un
projet de sciences collaboratives. Ces projets qui favorisent l'engagement
écologique et collectif sont de plus en plus en vogue. Ils seraient même
bons pour le moral !


Création d'un pôle d’excellence nationale en santé respiratoire à Nice,
ça change quoi ?
L’annonce était attendue par la communauté scientifique. Elle est,
aujourd’hui, confirmée. Après des mois de présentation de dossiers, de jurys
et de préparation, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé,
la création d'un pôle d’excellence nationale en santé respiratoire à Nice
avec la réalisation d'un institut hospitalo-universitaire baptisé RespirERA.
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice, l'Université Côte d’Azur,
l'Inria et l’Inserm ont été choisis et primé à hauteur de 20 Millions
d’euros, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour la création d’un
Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) à Nice, dans le cadre du plan France
2030.
Il sera dédié à plusieurs pathologies respiratoires : les cancers
pulmonaires, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), les
fibroses interstitielles du poumon, la mucoviscidose et les allergies
respiratoires, comme l'asthme.
Cette décision fait suite à un appel à projets lancé par le gouvernement
français et s’inscrit dans le cadre du plan France 2030.
Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a alloué 1 milliard d’euros pour
renforcer la recherche médicale, avec un appel à projets doté de 300
millions d’euros pour la création de jusqu’à six nouveaux Instituts
Hospitalo-Universitaires (IHU) en France.
"Avec la création du nouvel IHU RespirERA, Nice est amenée à devenir un pôle
d'excellence en matière de recherche et d'innovation médicale sur les
pathologies respiratoires. C'est une excellente nouvelle et la démonstration
du dynamisme des projets menés par les chercheurs, cliniciens et
entrepreneurs, au bénéfice de l'amélioration de la santé des patients.
L'État se tiendra résolument aux côtés de Nice et de ses équipes pour
relever ce défi et inventer dès aujourd'hui la santé de demain" explique
François Braun, Ministre de la Santé.
Nom de code : RespirERA
Baptisé RespirERA, le nom de ce projet n'est forcément pas le fruit du
hasard. Avec une telle équipe de savants, nul doute, qu'ils y ont bien
réfléchi ! Ainsi, nous l'explique le professeur Charles-Hugo Marquette,
pneumologue et cancérologue au CHU de Nice qui est porteur du projet
RespirERA avec le professeur Paul Hofman, à l’origine de la découverte d’un
test de dépistage précoce du cancer du poumon et responsable du laboratoire
de pathologie clinique et expérimentale au CHU de Nice.
Le professeur Charles-Hugo Marquette, pneumologue et cancérologue au
CHU de Nice :
"RespirERA c'est "il respirera" mais l'on peut également dire que
c'est l'air de la respiration ou encore que c'est l'ère de la respiration,
une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour la respiration ! Voilà l'origine du
nom de ce projet ! Astucieux non ? "
 . .
Les trois mots clés de RespirERA
Intelligences artificielles : avec le développement de programmes
d'intelligences artificielles en partenariat avec l'Inria à Sophia Antipolis
;
Impact de l'environnement : avec l'impact mesuré et la prévention de la
pollution atmosphérique, quelle que soit la saison ;
Vieillissement de la population : avec des essais cliniques sur la personne
de plus de 65 ans.
Le trépied qui porte RespirERA
Optimisation du soin et du parcours du soin du patient ;
L'enseignement d'excellence, avec des masters internationaux qui
vont se mettre en place avec l'université Côte d'Azur ;
La recherche translationnelle et fondamentale. Ainsi, quinze équipes
de recherche travailleront ensemble sur la pathologie respiratoire. Ces
équipes ne seront pas forcément situées géographiquement à Nice. Une
synergie se créera entre le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice,
l'Université Côte d’Azur, l'Inria et l’Inserm et différents établissements
de santé comme l'hôpital Cochin de Paris, l'Institut Bergonié à Bordeaux et
le Centre de lutte contre le cancer de Dijon.
Un IHU dédié à la santé respiratoire, ça change tout !
Professeur Charles-Hugo Marquette :
"L'idée d'un IHU ce n'est pas, est-ce que je vais changer ma
façon de travailler demain matin ? Est-ce que je vais changer mes traitement
la semaine prochaine ? Un IHU ça a pour vocation, dans un domaine de la
médecine ou de la science médicale, d'imaginer la médecine de demain, voire
d'après-demain ! "
Selon le professeur Charles-Hugo Marquette, "c'est une démarche
intellectuelle qui est tout à fait particulière et c'est ça qui sous-tend la
construction des IHU. Quand vous activez ce type de projet, vous ne dites
pas, je ne suis pas trop mauvais, et je vais être encore un peu meilleur.
Ça, tout le monde essaie de le faire. L'équipe qui est derrière un IHU se
dit, compte tenu des connaissances de la médecine et compte tenu de ce qu'on
va acquérir comme connaissances dans les années qui viennent, dans dix ans,
voilà le pari qu'on fait. Alors, c'est vrai, on peut se fourvoyer
totalement. Mais, nous sommes suffisamment nombreux pour éviter que nos
cerveaux fassent de gros délires individuels."
Professeur Paul Hofman :
"Dans ce pôle d'excellence nationale va s'inventer la médecine de demain.
Grace à cette mutualisation des moyens et des compétences, tout devrait être
plus rapide et certainement mieux. Et surtout, on va développer, finalement,
la médecine de demain ! "
Et d'ajouter : "Ce sont des projets où il faut avoir une vision à dix
ans. En fait, il nous faut anticiper la médecine de demain et d'après-demain
même ! Par exemple, éviter des réhospitalisations abusives en gardant les
patients à domicile. Aujourd'hui et demain, plus encore, on sait que nous
pourrons aussi très bien soigner à domicile. L'Hôpital ne pourra pas
accueillir tout le monde dans les prochaines années et à domicile l'on
pourra aussi éviter des infections nosocomiales. C'est donc aussi tout un
projet économique et social qui se dresse en filigrane et qui finalement est
au cœur de ce projet."
Des exemples concrets
Afin d'appréhender les applications concrètes que peut apporter le projet
RespirERA, quelques exemples concrets s'imposent.
Il y a dix, quinze ans, la mucoviscidose était la maladie génétique le plus
fréquente qui détruisait les poumons des enfants et des adolescents dans le
monde. Aujourd'hui, on ne meurt plus de la mucoviscidose. Et selon certaines
projections médicales, dans cinq ans cette maladie n'existera plus. Une
raison à cela. Il y a dix ans, des scientifiques ont été suffisamment
novateurs pour imaginer un traitement complètement sensationnel. Un
traitement qui, aujourd'hui, est en train d'être affiné. "Ce genre de
miracle, parce que je considère qu'on est proche du miracle, existe"
selon le professeur Charles-Hugo Marquette. Et d'ajouter : " Nous, on se
dit que si ça a été fait dans la mucoviscidose, pourquoi pas, ne pas
l'imaginer dans un autre domaine, comme le cancer du poumon."
En effet, au cours des quarante dernières années, les progrès médicaux ont
été colossaux. C'est le cas de l'immunothérapie qui consiste à restaurer la
capacité des cellules immunitaires à détruire les cellules cancéreuses et
les traitements ciblés qui sont des petites molécules qui vont aller taper
sur le talon d'Achille de la tumeur du patient. Un vrai début de révolution
médicale, mais qui a ses failles. Certains patients ne répondent pas à
certains de ces traitements.
Professeur Charles-Hugo Marquette :
"Notre idée, c'est que dans dix ans, quand quelqu'un souffrira d'un
cancer du poumon, y compris avec métastases, on pourra dire : c'est tel
comprimé qu'il vous faut pour cibler le mal dont le malade est atteint, et
cela, sur la base de l'étude de ses cellules cancéreuses et sur la base de
ses marqueurs (que l'individu aura dans sa prise de sang). Le futur, celui
qu'on espère, ce sont des traitements extrêmement personnalisés du cancer du
poumon".
L'allié de la médecine prédictive
Autre domaine d'application dans lequel RespirERA pourrait peser dans
l'appréhension du cancer du poumon, la médecine prédictive. Si l'on en croit
les statistiques, 15 à 20 % des personnes atteintes d'un cancer du poumon ne
fument pas.
Selon le professeur Charles-Hugo Marquette, "la médecine de demain,
pourrait, dans ce cas, intégrer le concept que la maladie résulte, certes,
de notre patrimoine génétique, transmis par nos parents, mais aussi par la
vie que nous menons, où nous sommes exposés à toutes sortes de polluants, de
toxiques, de carcinogènes, par notre métier, notre lieu d'habitation, notre
activité et/ou notre nourriture. Donc, si on associe des compétences en
biologie, en épidémiologie et en intelligence artificielle, on pourrait
cerner la population qui serait le plus à risque de développer, par exemple
un cancer du poumon. Et cela, par le fait de joindre le patrimoine génétique
et ce à quoi les individus sont exposés et d'étudier les conséquences de ces
interactions. Ainsi, nous médecins, nous serons en capacité de dire à notre
patient, que comme ils ont été exposés à tel ou tel toxique au cours de la
dernière année, ils pourraient être susceptibles de développer un cancer du
poumon. En cernant, de la sorte, la population à risque, nous pourrons
proposer un dépistage précoce de la malade et donc mieux l'éradiquer
puisqu'un cancer de stade 1 est entièrement guérissable."
Professeur Charles-Hugo Marquette :
"En cernant, de la sorte, la population à risque nous pourrons proposer
un dépistage précoce de la malade et donc mieux l'éradiquer puisqu'un cancer
de stade 1 est entièrement guérissable."
 . .
Quelques chiffres du réseau des Instituts
Hospitalo-Universitaires. • © https://www.ihu-france.org/fr/
L'union unique d'une expertise nationale et internationale
Ce sera la 1ʳᵉ organisation française et européenne regroupant sur un même
site une expertise nationale et internationale unique en recherche
fondamentale, translationnelle et clinique, pour la formation, l’innovation
et le soin dans le domaine des maladies respiratoires liées au
vieillissement.
Ce pôle devrait réunir plus de 600 personnes, médecins, chercheurs,
industriels et rassemblera une dizaine de laboratoires de dimension
nationale et européenne.
Christian Estrosi, maire de Nice et président du Conseil de
surveillance du CHU de Nice :
"Je me réjouis que l’excellence hospitalo-universitaire Niçoise soit
aujourd’hui reconnue à un tel niveau "
Renaud Muselier président du Conseil Régional PACA :
"Annoncé à l’instant par le Président de la République, un IHU dédié aux
maladies respiratoires et au vieillissement va voir le jour à #Nice06 !
"
"Félicitations à l’Université de Nice et à @cestrosi pour ce pôle
d’excellence, que nous sommes allés chercher ensemble ! "
Autre bonne nouvelle pour la région PACA, la ville de Marseille
vient d'être sélectionnée pour la création d’un biocluster dédié au
développement des traitements de demain, contre les cancers, les maladies
auto-immunes, ou encore les maladies infectieuses.
Près de 100 millions d’euros d’investissements sont décrochés
par la région, en faveur de ce projet exceptionnel porté par l’Université
d’Aix-Marseille, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, l’Institut
Paoli-Calmettes, l’INSERM, le CNRS, Eurobiomed, et un grand nombre
d’industriels et de biotech de ce secteur.


Près d’une centaine de membres dans un village de 500 habitants...
Comment l’association culturelle de Coursegoules dynamise la commune
Avec près d’une centaine de membres dans un village de quelque 500 âmes,
l’association culturelle de Coursegoules dynamise la commune. Qui en sont
les acteurs ?
 . .
Une partie des animateurs en pleine séance de travail autour de
Frédérique la présidente au premier plan. (Photo C. D.)
Depuis quelque temps, fleurissent à Coursegoules, sur les panneaux
d’information, des affiches annonçant diverses activités, toutes
estampillées "association culturelle de Coursegoules". On y trouve
les heures d’ouverture de la médiathèque, mais aussi des cours de crochet,
une chorale, des ateliers de discussion, de philo, des propositions de
randonnée, des pièces de théâtre...
Mais qui se cache donc derrière cette dynamique association qui compte plus
d’une centaine de personnes pour une commune de 500 habitants ?
"J’ai débuté comme employée communale, à assurer les permanences du
samedi matin, puis en tant que bénévole de l’association de gestion de la
bibliothèque", détaille Frédérique, la présidente depuis le printemps.
De plus en plus de bénévoles et d’activités
Lors de la première réunion du bureau, les membres ont décidé d’élargir les
activités de l’association: "Je voulais une association de tous, pour
tous, confie Frédérique. Chaque personne qui a une idée, on prend. On
part de la médiathèque comme lieu physique et activité de base, mais ça
reste ouvert à condition que ce soit culturel au sens large et que ça reste
bien dans le cadre légal ". Ainsi, petit à petit, plusieurs personnes
ont rejoint l’association, adhérent mais aussi bénévole proposant une
activité.
Ce qui anime les membres
Aleksandra, membre du bureau, propose occasionnellement des cours de dessin.
Elle a rejoint l’association car "il faut faire partie d’une communauté
". "Je suis à Coursegoules depuis 2019 et je veux découvrir tout ce
qui est local, l’histoire, les lieux, les gens."
Pour Jean-Claude, qui anime les ateliers de discussion et de philosophie
après avoir fait partie de "multiples associations à Grenoble" c’est
"l’envie d’essayer de créer, de faire partager, d’animer " qui motive
celui qui se décrit comme un pur citadin.
Brigitte, elle, connaît Coursegoules depuis son enfance via ses parents qui
"étaient ici ". "Il y a des âmes derrière les grands murs et les
volets de ce village que je voulais découvrir ", livre-t-elle.
"Je suis venu à une activité, on a parlé randonnée et j’ai proposé des
sorties avec une partie culturelle, une initiation à la lecture de cartes,
ajoute Jean-Paul qui connaissait l’existence de la médiathèque par sa femme.
On va à la découverte de lieux mais aussi des personnes, on se retrouve
ensemble, ça crée un lien humain ".
De son côté, Florence dispense, des cours de crochet dans le local de
l’épicerie. Son petit groupe proposera bientôt ses créations à la vente pour
alimenter les caisses de l’association.
L’association culturelle de Coursegoules prévoit également des concerts, une
animation pour la Fête de la musique et sûrement d’autres activités au gré
de l’envie des membres actuels et futurs de l’association.
Savoir + : Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de
l’association et sur le site :
coursegoules.media


Moineaux, mésanges... pourquoi la population d'oiseaux s'est effondrée en
Europe depuis quarante ans
 . .
La population de moineaux est en grand danger
Une étude européenne pilotée par l'Institut des sciences de l'évolution de
Montpellier (CNRS/IRD/Université de Montpellier) et le centre d'écologie et
des sciences de la conservation (CNRS/Museum national d'histoire
naturelle/Sorbonne Université) pointe pour la première fois les effets de
l'agriculture intensive, de l'urbanisation, et du changement climatique sur
les populations d'oiseaux : elles ont disparu de 25 % ces quarante dernières
années sur le continent européen, et de 60 % pour les espèces des milieux
agricoles. L'étude est sortie dans la revue scientifique internationale PNAS
(Proceedings of the national academy of science).
Vincent Devictor, responsable de l'institut des sciences de l'évolution, a
coordonné l'étude inédite menée sur 20 000 sites dans 28 pays européens, sur
170 espèces d'oiseaux. Il alerte sur un "modèle agricole suicidaire".
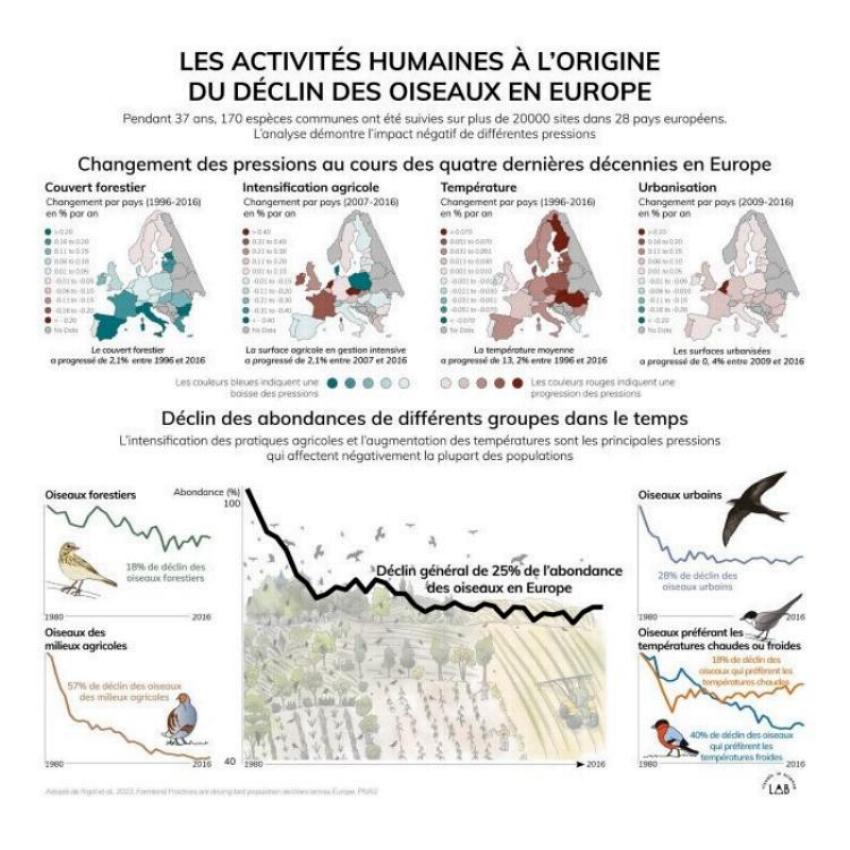
L'impact sur les populations d'oiseaux
Vingt millions d'oiseaux disparaissent chaque année en Europe, et ce
phénomène a commencé il y a quarante ans. Comment l'étude européenne que
vous avez coordonnée parvient-elle à ce chiffre effrayant ?
C'est la première fois que des équipes européennes ont travaillé avec une
même méthode, avec des observateurs qui vont physiquement compter les
oiseaux. On a pu comparer, de manière standardisée, les sites d'année en
année, et les sites entre eux. On est parti d'une masse de données très fine
d'observation des oiseaux. Et pour la première fois, on a mesuré l'impact
sur les populations d'oiseaux de chaque pays des fluctuations des pressions
liées à l'activité humaine, évolution des températures, de l'urbanisation,
des surfaces forestières et des pratiques agricoles. On a utilisé l'Europe
comme un laboratoire à ciel ouvert, de manière quasi expérimentale qui nous
a permis de faire ces analyses.
Dans ce paysage inquiétant, la France n'est pas plus vertueuse que les
autres pays : - 43 % pour la population d'oiseaux agricoles, - 19 % pour le
nombre d'oiseaux forestiers.
Hélas, on est plutôt mauvais élève en la matière. On continue à avoir des
surfaces agricoles qui augmentent, avec des méga fermes supérieures à 100
hectares qui augmentent de 12 % depuis 2005, et les petites fermes, de moins
de 4 hectares, chutent de 24 % dans le même temps.
La France est la plus grande importatrice de pesticides avec l'Allemagne. On
n'est pas du tout dans une bonne trajectoire en ce qui concerne le respect
de la biodiversité dans le monde agricole. La part du bio est relativement
faible et on a une aide directe de la production à l'hectare qui favorise le
productivisme et la rentabilité qui a des conséquences sur l'écologie des
espèces.
 . .
Stanislas Rigal, doctorant à l'Université de Montpellier, et Vincent
Devictor, directeur de l'institut des sciences de l'évolution de
Montpellier.
Avez-vous fait des focus plus précis sur les régions françaises,
l'Occitanie par exemple ?
C'est vraiment une étude européenne, avec quelques chiffres qui sont
synthétisés par pays. c'est pour ça qu'on est capable de dire que le
diagnostic porté sur la France n'est pas bon.
Il faudrait descendre à une échelle plus fine, plus régionale, pour en tirer
des conclusions. Ce que l'on sait, c'est qu'on a eu des changements du
paysage en Occitanie qui ont pu montrer, notamment sur le secteur de la
vigne, la rapidité d'une transition vers le bio et la biodynamie.
Économiquement, ça fonctionne. On voit des possibilités d'évolution de tout
un secteur qui respecte de plus en plus l’écologie des sols, les levures
indigènes, et bannit l'emploi de pesticides. C'est possible d'évoluer.
Mais sous la pression démographique, notre territoire est de plus en plus
urbanisé...
On a une urbanisation galopante. Il faut mener une réflexion là-dessus. Et
on a une situation qui se tend sur la sécheresse, et la question climatique
est un des éléments qui affecte de plein fouet les cultures et les paysages.
Loin de moi l'idée de dire que l'Occitanie s'en sort bien. La modification
des territoires au sens large avec plus d'artificialisation et des logiques
qui n'intègrent pas vraiment l'environnement dans le développement a des
effets néfastes.
"Le moineau friquet, le tarier des prés, le pipit farlouse ont chuté de
75 %"
Quelles sont les espèces d'oiseaux qui suscitent le plus d'inquiétude ?
On a tout un cortège d'espèces spécifiques des milieux agricoles qui
déclinent de manière spectaculaire. Par exemple en France le moineau
friquet, le tarier des prés, le pipit farlouse qui ont décliné de 75 %.
On a une autre espèce aussi emblématique de ces milieux agricoles, le bruant
ortolan, qui a chuté de 93 %Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos.
Ces espèces assez communes régressent de façon très spectaculaire.
Pour le moineau domestique, que tout le monde connaît, c'est moins 64 %.
C'est ce qui nous a donné le vertige en analysant ces données : des espèces
communes de nos campagnes souffrent de l'impact des changements globaux.
La mésange boréale, c'est moins 79 %, probablement en raison du changement
climatique. Elle aime les températures froides et souffre de l'augmentation
des températures. Mais on a aussi des bonnes nouvelles.
C'est-à-dire ?
Nous, sur le littoral, on a des protections de zones humides, des réseaux
Natura 2000, des législations sur certaines espèces comme le héron qui avant
était plutôt rare, dont la population augmente. Les mentalités changent mais
la situation reste très préoccupante pour la situation des oiseaux communs.
Vous évoquez le littoral, prenons une de nos espèces emblématiques, le
flamant rose : il pourrait être impacté par ces changements ?
Il est très vulnérable à la fluctuation de la hauteur d'eau qui est aussi
gérée en fonction des besoins des riziculteurs notamment. Il y a un
programme spécifique sur cette espèce qui connaît des fluctuations
importantes d'une année sur l'autre. Mais c'est sûr que les sécheresses vont
tendre la situation de pas mal d'espèces.
"Je vois un oiseau qui décline, ça me fait peur "
En quoi les oiseaux sont indispensables à la biodiversité et à la vie sur
terre ?
Les oiseaux sont des vertébrés, on est très proches... s'ils ne sont pas
capables de vivre dans des conditions de vie dégradée parce qu'ils ne
survivent pas parce que la présence de produits chimiques, l'augmentation
des températures, l'artificialisation des sols sont défavorables à leur
maintien dans l'environnement, ça nous concerne directement, c'est une
espèce dont on est très proche physiologiquement, en termes d'exigences.
Quand je vois un oiseau qui décline dans la campagne, ça me fait peur.
Vous vous dites que ce sera bientôt notre tour ?
Il y a une proximité de fait entre certaines espèces, et c'est le cas entre
les oiseaux et les humains, on n'est pas très différents. Au-delà, les
oiseaux sont impliqués dans de nombreuses interactions, ils dispersent des
graines, régulent certaines populations d'insectes, sont eux-mêmes mangés
par des prédateurs. C'est un maillon vital dans la chaîne trophique.
La chute de la population d'oiseaux est à l'image de ce qui se passe sur
d'autres espèces, pour peu qu'on s'y intéresse ?
On est à peu près sûr qu'une des raisons pour lesquelles on observe ce
déclin est la disparition des populations d'insectes. Tous les oiseaux ont
besoin d'insectes pour se nourrir. Si on parle de disparition des
invertébrés, c'est tout un ensemble d'espèces qui sont impactées. On a là
une manifestation très concrète de ce qu'on appelle l'érosion de la
biodiversité que nous qualifions de sixième crise d'extinction. Nous vivons
de manière rapide l'effondrement de tout un groupe d'espèces autrefois
communes, qui deviennent de plus en plus rares.
De ce point de vue là, oui, il y a quelque chose de très inquiétant qui est
en train de se passer.
"L'Allemagne et la France continuent à augmenter leur consommation de
pesticides "
Une fois qu'on a fait ce constat, on fait quoi ? Demain, on passera à
autre chose...
L'alerte a été donnée il y a à peu près 70 ans, on cite souvent Rachel
Carson comme étant une des pionnières de l'alerte sur le lien possible entre
l'utilisation de pesticides et la vie dans les champs avec "Printemps
silencieux ". Nous, on continue à faire ce constat. ce qu'il y a de très
nouveau ici, c'est qu'alors qu'on avait repoussé la question de la
responsabilité et des causes à quelque chose de difficile à comprendre, de
complexe, certains évoquaient la présence de chats... on a pour la première
fois dans cette étude menée une analyse de front qui prend en compte ces
différents facteurs. Et il se trouve que le modèle agricole apparaît comme
un élément déterminant.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut plus se cacher derrière
l'inaction alors qu'il y a des alternatives qui fonctionnent, et qu'il y a
des agriculteurs qui jouent ce jeu de la conversion depuis des années. Ils
manquent tout simplement d'aides. Il faut absolument revoir l'idéologie qui
est derrière le modèle agricole, productiviste, intensif, avec des prix les
plus bas possibles et un rendement à l'hectare le plus haut possible. C'est
faisable. Ces résultats devraient combattre cette idéologie d'utiliser des
surfaces toujours plus grandes en utilisant la chimie. On sait que le modèle
industriel de l'agriculture est complètement néfaste.
C'est un peu comme le changement climatique : reste la question des
lobbys, de l''inaction...
Tout à fait. On a des forces adverses qui cherchent à maintenir une
agrochimie extrêmement forte avec des enjeux économiques. Ceux qui veulent
s'installer et produire en bio ont beaucoup plus de mal que les grands
céréaliers devenus des grands industriels.
On est sur des décisions politiques très concrètes. Notre étude, on
l'espère, pourra servir d'argument pour dire qu'un modèle est suicidaire.
C'est le cas...
Complètement. D'autant que l'agence européenne de l'environnement a constaté
la présence inhabituelle de pesticides dans les rivières, dans les sols,
dans les lacs... 22 % des sites sont au-dessus des seuils, on a constaté la
présence d'herbicides interdits depuis 2007. En Angleterre, une étude de la
présence de pesticides dans les stocks agricoles montre qu’il y a un volume
suffisant pour traiter dix fois la superficie du pays. Il y a un problème de
quantité et de régulation de l'utilisation de ces produits. Aujourd’hui,
rien ne nous empêche de faire autrement, et les agriculteurs eux-mêmes
militent pour qu'on trouve des alternatives. On est arrivé au bout d'un
système.
Vous citez l'Angleterre, y a-t-il des pays plus vertueux que d'autres ?
Il y a, et on le trouve dans nos chiffres, des pays qui ont baissé la vente
de pesticides depuis 2011 : la République tchèque, le Portugal et le
Danemark. À l’inverse, la Lettonie, l'AUtriche, mais aussi l'Allemagne et la
France continuent d'augmenter leur consommation et l'importation de
pesticides. En Europe, on a seulement 8 % de bio, ce qui est très faible. Et
en France, 21 % de notre agriculture est représentée par des fermes à haut
niveau d'intrants. C'est énorme. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus
d'insectes, plus de vers de terre, plus d'oiseaux. On a du mal à qualifier
ces endroits de naturels.


Les Bains de la Police rouvrent à Nice :
l'histoire de ce site historique de la Promenade des Anglais
La plage anciennement dévolue aux forces de l'ordre après la Seconde
guerre mondiale s'apprête à rouvrir à Nice. Après l'attribution de
la concession à Castel Plage - l'établissement voisin - et de longs
travaux, ce site historique du littoral va pouvoir accueillir à
nouveau du public.
Douze mètres sous Rauba Capeu et sa sculpture "I Love Nice",
un site historique du littoral niçois est en pleine renaissance. La
réouverture de ce site, auparavant tant aimé par les amateurs de
plongeons, est prévue en ce mois de mai 2023.
C'est d'ailleurs ce qu'il l'avait fait fermer, en raison des risques
encourus par les nageurs. Trop de PV dressés ou de blessés avaient
été enregistrés et son accès, interdit par arrêté préfectoral.
Les Bains de la Police avaient ensuite été grillagés à partir du 4
août 2019.
Un site en partie détruit en 2017
En 2017, cette partie de la promenade des Anglais - qui comporte une
plage surplombée d'une dalle de béton et de deux niveaux accrochés à
la roche - ne répond pas aux exigences du décret plage de 2006
stipulant qu'aucune structure en dur ne peut perdurer sur le
littoral.
Des engins de démolition rentrent en action le 27 novembre de cette
année-là pour ôter la dalle sur les galets et une plateforme
utilisée par les plongeurs. La plage a été délaissée en 2015 lorsque
la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas renouvelé la concession
faite aux agents des forces de l'ordre.
Le renouveau après des mois de travaux

Pour rendre savoureuse la nouvelle recette de ces lieux, une
nouvelle concession pour cet endroit emblématique du littoral niçois
a été établie. C'est l'établissement voisin du Castel Plage qui a
pris les commandes des lieux. Des mois de travaux et des centaines
de milliers d'euros ont été investis pour métamorphoser ces Bains de
la Police anciennement réservés aux forces de l'ordre.
L'établissement ne dispose désormais plus de plongeoir, mais d'une
plonge. Un bar et une cuisine ont été taillés dans la roche, du
sur-mesure. Deux niveaux dédiés aux clients qui pourront - presque -
déjeuner ou dîner les pieds dans l'eau.
Ali Abdelhafidh, gérant des Bains de la Police et du Castel Plage :
"On
est dans un lieu historique de Nice, qui a connu toutes les
générations de Niçois. Ici, c'était plutôt les locaux, les
pêcheurs... De ce fait, on est plutôt dans un lieu historique et
endémique de Nice."
Ali Abdelhafidh, le gérant des deux établissements qui ponctuent la
Promenade des Anglais, souligne le défi technique de cette mise en
service.
"On a été obligé de faire un conduit de ventilation qui a été
assez complexe, étant donné que l'on a dû percer la roche sur 12
mètres de hauteur. Cela a été une véritable performance."

Ce site historique du littoral va pouvoir accueillir à nouveau du
public... Avec vue sur la baie de Nice !
La passerelle historique, abimée par plusieurs coups de mer, a été
recréée pour résister aux intempéries. Concernant le béton coulé
dans les années 1960, tout a disparu : "C'était une recommandation
de l'architecte des Bâtiments de France, que tout le béton devait
disparaitre dans le cadre de l'exploitation."
Les décors de fausse roche viennent ainsi s'ajouter au décor minéral
naturel, une touche artificielle bien connue des décorateurs de
cinéma.
Côté carte
Un accent méditerranéen sera décliné en ces terres nissardes. Au
menu, des fruits de mer essentiellement.
Ali Abdelhafidh, gérant des Bains de la Police et du Castel Plage :
"Cela va être beaucoup autour des poissons de la Méditerranée. On
va être sur une carte avec des huîtres, des sashimis, des poissons
entiers. Évidemment, on fera une petite restauration pour tous les
gens qui n'aiment pas les fruits de mer, mais cela va être à
dominante méditerranéenne" explique le patron de ces deux
établissements niçois.
Il y aura des poissons à 32 euros, des entrées à 22 euros. On est
à Nice, on n'est pas à Cannes, à Monaco, ou à Saint-Tropez. On a été
obligé de s'adapter au portefeuille moyen des actifs ici. On ne vise
pas tellement une clientèle internationale.
Des tarifs justifiés pour le gérant par des frais de fonctionnement
supérieurs au Castel Plage dus à la configuration des lieux, et les
travaux qui ont été effectués. C'est bien connu, quand on aime, on
ne compte pas.


Notre-Dame de Paris : "Nous la reconstruisons pour 850 ans
au moins", dit le directeur de l'établissement publique

Philippe Jost est le bras droit du général Jean-Louis
Georgelin, au sein de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de
Paris
Directeur général délégué de l'établissement public Rebâtir
Notre-Dame de Paris, le polytechnicien Philippe Jost est au plus
près de ce chantier depuis que le président de l'établissement, le
général d'armée Jean-Louis Georgelin, représentant spécial du
président de la République, l'a appelé à ses côtés. Quatre ans après
le dramatique incendie du monument, il revient longuement sur
quelques moments clé et se projette vers la réouverture de la
cathédrale, en décembre 2024.
Quatre ans après l'incendie, ce mois d'avril a marqué le début de
la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Est-ce un moment fort
?
Oui, c'est une étape vraiment importante à tout point de vue. Par
rapport à l'avancement du chantier, mais aussi symboliquement.
Chacun a en tête les images de l'effondrement de la flèche, qui a
illustré la violence de l'incendie. Sa reconstruction est un signe
tangible que l’on se rapproche à grands pas de la réouverture de
Notre-Dame.

Est-ce une affaire techniquement délicate ?
C'est évidemment un beau morceau technique de la restauration, un
chef-d’œuvre de charpente de 70 m de haut, qui prend appui à 30 m du
sol, au-dessus des voûtes de la cathédrale, sur les quatre piliers
de la croisée du transept. Cela fait plusieurs mois que les
charpentiers y travaillent, dans leur atelier. Il y a eu des
simulations, beaucoup de travaux préparatoires, dont une phase
d'épure, de taille et une autre de montage à blanc, avant enfin le
désassemblage des éléments pour leur acheminement à Paris, au cœur
de l’île de la Cité. Ainsi, quand les éléments de la flèche arrivent
désassemblés sur le chantier pour être grutés, puis installés à leur
emplacement définitif, on a de ce fait déminé les principales
difficultés.
Quels moments de doute auront marqué les quatre années passées ?
Doutes, ce n'est peut-être pas le terme, des difficultés assurément
et j'en citerai deux. À l'été 2019, quand pour mettre en place les
moyens d’une maîtrise d'ouvrage adaptée à une opération d'une telle
envergure, la création d'un établissement public été confirmée. Il
fallait qu'il fonctionne avant la fin 2019 et nous n'avions pas la
certitude de trouver les ressources humaines adéquates. Finalement,
l'attractivité de Notre-Dame jouant à plein, dès le début de
l'automne, nous avons pu sélectionner les personnes clé pour réussir
dans les temps la mise en route de l’établissement.
Je citerai un autre moment, entre l'automne 2021 et l'été 2022,
celui où l'on a lancé les grands appels d'offres de travaux et où
l'on s'interrogeait : allait-on trouver les savoir-faire, est-ce que
le plan de charge des entreprises leur permettrait de répondre
présent et dans les temps ? Et on a effectivement trouvé les
entreprises et les ateliers d'art dont nous avions besoin, à la fois
en adéquation avec notre calendrier et en termes de compétences.
Tout est-il calé, choix, matériaux, marchés pour la livraison fin
2024 ?
Oui, tout à fait. On est dans le faire et plus dans ce que l'on
pourrait faire. Ce que vous évoquez, nous y avons réfléchi durant la
phase d'étude de projet en 2020-2021, où ont été prises les
décisions essentielles. La restitution à l'identique de
l'architecture de la cathédrale que tout le monde aimait, mais aussi
l'authenticité des matériaux et des modes constructifs.

Les voûtes sont reconstruites avec des pierres et à l'aide de
cintres en bois, les charpentes médiévales de la nef et du choeur
avec du bois de chêne vert taillé à la main, la flèche comme
Viollet-le-Duc l'avait conçue au XIXe siècle, en bois de chêne. Ce
n'est pas du folklore, ce sont ces matériaux, pierre, bois, plomb,
qui offrent la meilleure garantie de pérennité à cette restauration
: nous la reconstruisons pour 850 ans au moins, un anniversaire
qu'elle avait fêté en 2013.
Quand verra-t-on apparaître sa couverture dans le ciel de Paris ?
Flèche et charpente en chêne apparaîtront en milieu d'année 2023,
bientôt, et s'élèveront tout au long de l'année. La couverture de
plomb sera l'affaire du premier semestre 2024.
Quelles seront les autres grandes phases ?
Celle-ci sera certainement la plus marquante pour les Parisiens et
les touristes, notamment parce qu'elle sera bien visible de
l'extérieur du chantier. Après, il y a des travaux moins visibles
mais très importants, en particulier les installations techniques et
électriques durant les deuxième semestre 23 et premier semestre 24.
Les restaurations intérieures continueront-elles en parallèle
jusqu'au bout ?
Elles seront terminées pour l'essentiel en 12023. Le nettoyage
intérieur est aujourd'hui très largement avancé, ce qui nous permet
de dire qu'on retrouvera la cathédrale plus belle qu'avant, dans le
respect de la blondeur de sa pierre et magnifiée par la splendeur
retrouvée de ses décors peints. C'est très frappant. Il y aura
encore des travaux tardifs, notamment l'installation du mobilier
liturgique que l'archevêque de Paris aura commandé, pour remplacer
celui des années quatre-vingt dix détruit par l'effondrement de la
voûte.
La cathédrale sortira-t-elle de ce noir épisode mieux protégée
qu'auparavant ?
L'incendie nous a permis de reprendre complètement à zéro les
installations techniques de la cathédrale et sa protection incendie,
de les reconstruire à l'aide des techniques les plus récentes afin
qu'elle soit protégée et que ce drame de 2019 ne survienne plus.
L'un des éléments les plus emblématiques est un dispositif de
brumisation dans les charpentes, qui diffuse automatiquement un
brouillard d'eau, sur détection d'un départ de feu, et étoufferait
celui-ci. Si un tel système avait été en place, l'incendie ne se
serait pas propagé.
Est-elle devenue plus que jamais un monument "national", au-delà
de tout sens religieux ?
Ce que représente Notre-Dame de Paris dans le cœur des Français nous
aide car chacun, compagnon, achitecte, ingénieur, est tendu vers
l'objectif. Mais au-delà des acteurs du chantier, en France et dans
le monde entier, nos réseaux sociaux (NDLR, @rebatirnotredamedeparis
sur Facebook Instagram et YouTube), nos publications (1), les
expositions (2), les témoignages que nous recevons montrent un
intérêt qui ne se dément pas pour Notre-Dame. Cette cathédrale, à la
fois dans sa composante religieuse et de monument qui incarne la
France, constitue un ensemble unique, porteur de sens, que l’on soit
croyant ou non.
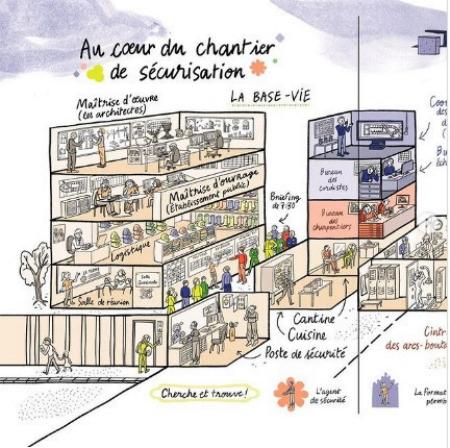
Au final, quel sera le budget de cette reconstruction ?
La phase de mise en sécurité a représenté 150 millions d'€, la phase
de restauration 550 millions. Donc au total 700 millions d'€ pour
une réouverture complète et définitive au culte de la cathédrale en
décembre 2024.
Il y aura encore des campagnes de restauration extérieures, pour
certaines de ses parties de longue date en mauvais état, mais pour
la réouverture l'ensemble des travaux programmés seront réalisés
comme prévu.
(1) "La Fabrique de Notre-Dame", le journal de la restauration.
Disponible en français ou en anglais, 116 pages, 12 € (l’intégralité
des bénéfices est reversée au projet de restauration). Numéro 4 en
vente en librairie et en ligne :
https://boutique.connaissancedesarts.com/produit/la-fabrique-de-notre-dame-n-4
(2) "Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier", la Maison du
chantier et des métiers Espace Notre-Dame, parvis de la cathédrale
(plus d’informations sur :
rebatirnotredamedeparis.fr)
et "Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs", Cité de
l’architecture et du patrimoine – Paris 16e (plus d’informations sur
:
citedelarchitecture.fr)


Visite médicale réussie pour 15 bouquetins du Parc national
du Mercantour

Pour vérifier l'état de santé des bouquetins, une équipe du
Parc national du Mercantour a capturé plusieurs spécimens dans la
Vésubie et effectué prélèvements sanguins et marquages sur ces
animaux sauvages protégés.
Le bouquetin n'est pas farouche : protégé, chassé nulle part, il se
laisse facilement approcher par l'homme. Suffisamment pour l'admirer
à quelques dizaines de mètres... mais de là à lui faire une prise de
sang, il y a un peu plus d'un pas.
Alors, les agents du parc national du Mercantour ont dû recourir au
fusil chargé de flèches hypodermiques pour endormir quinze
spécimens. Les opérations ont eu lieu de lundi à jeudi dans la
Vésubie, plus précisément dans les secteurs du Boréon et de la
Gordolasque, aux confins des Alpes-Maritimes.
"Ne surtout pas le perdre de vue"
"L’animal est fléché et, selon sa sensibilité et l'endroit où il
est touché, il va plus ou moins courir, explique Nathalie
Siefert, chef du service connaissance et gestion du patrimoine du
Parc national du Mercantour qui a participé à l'opération. Les
gardes doivent le suivre, aux jumelles et à pied, et ne surtout pas
le perdre de vue pour sa sécurité ".
Une fois endormi, les agents lui placent un bandeau sur les yeux et
le maintiennent pour éviter tout mouvement dangereux pendant que le
vétérinaire réalise un prélèvement sanguin, une rapide inspection de
l'animal. L'examen se termine avec la pose deux marques de type "boucles
bovines " aux oreilles.

Les bouquetins sont marqués avec des boucles de différentes
couleurs selon leur âge et leur sexe.
L'opération ne prend qu'une dizaine de minutes. Le vétérinaire
injecte alors un antidote et le bouquetin est de nouveau sur pattes
"en moins d'une minute". 15 animaux ont subi ce traitement
ces derniers jours, dans le cadre d'une campagne de "veille
sanitaire".
Vérifier leur état de santé
"Les échantillons de sang vont être analysés pour vérifier si ces
bouquetins sont porteurs de maladies problématiques pour la
conservation de l’espèce" indique Nathalie Siefert. Il y a
quelques années, les bouquetins du parc national de la Vanoise en
Savoie avaient été décimés par une épidémie de pneumonie.
Chaque printemps, quand les animaux profitent de l'herbe fraiche des
prés déneigés, le parc national du Mercantour organise une campagne
de ce type. Cette année elle avait lieu dans le secteur où 19
bouquetins originaires de la Vanoise avaient été introduits il y a
deux ans.
"On les a trouvés en bon état "
Nathalie Siefert, chef du service connaissance et gestion du
patrimoine du parc national du Mercantour
Les résultats des prélèvements sanguins devraient être connus
dans quelques semaines, mais les premières observations sur les
animaux sont encourageantes :
Ils ont bien passé l’hiver, on les a trouvés en bon état, avec
une bonne couche de graisse, sans infestation de tiques.
Si vous observez, lors d'une randonnée, un bouquetin portant des
marques colorées aux oreilles, vous pouvez participer au programme
d'observation du parc en communiquant le lieu d'observation et la
couleur des boucles.
"Chaque bouquetin marqué a sa petite histoire et porte un prénom,
nous vous enverrons régulièrement des nouvelles de ces ibex
(bouquetin NDLR) aux parures colorées."
A vos jumelles !


Sécheresse dans les Alpes-Maritimes : alerte renforcée pour
certains secteurs
Le préfet des Alpes-maritimes vient de prendre
un arrêté relatif à la situation de sécheresse dans le
département. Le détail des mesures et des communes concernées.
Un passage au stade d’alerte renforcée pour les bassins versants de
la Cagne, de l’Estéron et du Paillon est instauré.
Sont maintenus au stade d’alerte : les bassins versants de l’Artuby,
du Loup, de la Brague, du Var amont, du Var central, du Var aval, de
la Roya et de la Siagne.
Tout le département est déjà au stade d’alerte sécheresse depuis
le 10 mars 2023.
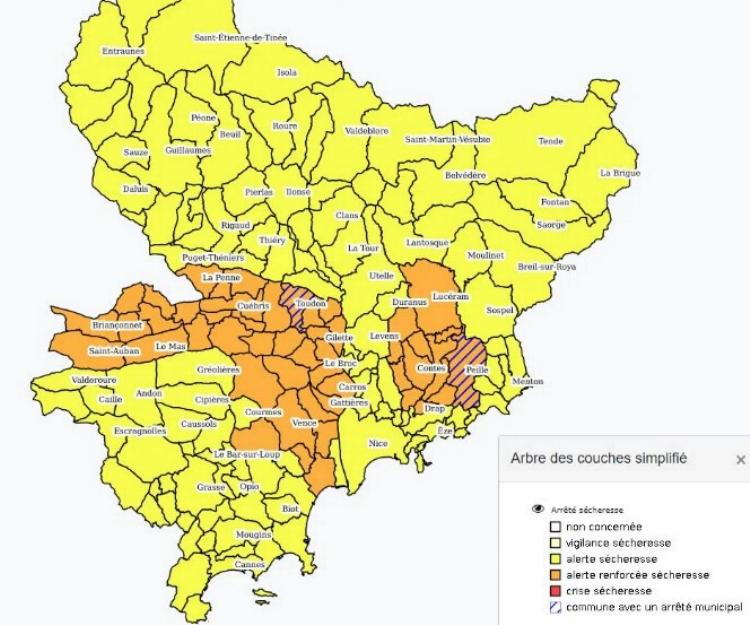
Passage au stade d’alerte renforcée pour les bassins versants de
la Cagne, de l’Estéron et du Paillon dans les Alpes-Maritimes ce 28
avril.
Depuis, la situation s’est encore aggravée : le mois de mars
présente un déficit pluviométrique de - 76 %.
Selon le constat préfectoral, "le débit des cours d’eau et des
nappes sont anormalement bas pour la saison, faisant apparaître des
assecs avec une précocité d’environ 3 mois par rapport à la normale.
Le manteau neigeux est pour sa part déficitaire d’environ 60 % par
rapport à la moyenne sur le département."
Mesures de restriction
Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes, a décidé de renforcer
les mesures de restriction d’usage de l’eau applicables.
Les bassins versants de la Cagne, de l’Estéron et du Paillon passent
ainsi au stade d’alerte renforcée. Les communes concernées sont les
suivantes :
• Bassin versant de la Cagne : Cagnes-sur-Mer, la Gaude,
Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence, Vence.
• Bassin versant de l’Estéron : Aiglun, Amirat, Ascros,
Bézaudun-les-Alpes, Bonson, Bouyon, Brianconnet,
Collongues, Conségudes, Coursegoules, Cuébris, Gars,
Gilette, la Penne, le Mas, le Broc, les Ferres, les Mujouls,
Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquesteron, la Roqueen-Provence,
Saint-Antonin, Saint-Auban, Sallagriffon, Sigale, Toudon,
Tourette-duChâteau.
Sont également concernées, au titre du dispositif du double zonage,
les communes de Carros, Gattières, Tourettes-sur-Loup.
• Bassin versant du Paillon : Bendejun, Berre-les-Alpes, Blausasc,
Cantaron, ChâteauneufVillevieille, Coaraze, Contes, Drap,
l’Escarène, Lucéram, Peille, Peillon, Touët-de l’Escarène.
Dans toutes ces communes, il est désormais interdit :
D’arroser de jour comme de nuit, sauf pour la plantation (arbres et
arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an et en dehors
des périodes de restrictions sécheresse) où l’interdiction
l’interdiction d’arroser s’applique de 8 h à 20 h.
De laver sa voiture ou son bateau (les stations professionnelles
équipées de matériel haute pression et de système de recyclage d’eau
restent autorisées), ou de laver les voiries, terrasses et façades à
grande eau.
Le remplissage des piscines privées est également interdit (à
l’exception du premier remplissage à condition que le chantier ait
démarré avant le déclenchement des premiers stades de restriction
d’eau), en revanche leur mise à niveau reste autorisée.
Les usagers industriels doivent réduire leur consommation de 40 %.
Le reste du département est maintenu au stade d’alerte.
Concertation en juillet
De son côté, Charles Ange Ginésy, président du Département des
Alpes-Maritimes, a dressé un premier bilan de l’Observatoire
départemental de l’eau ce vendredi.
Ce plan se décline en 4 piliers poursuivant des objectifs quantifiés
en matière de sobriété, d’innovation et d’exemplarité.
Lutter contre les pertes d’eau, 10 M€
Fonds de 10 M€ destiné au repérage et à la réparation des réseaux de
distribution d’eau, pour passer d’un rendement de 70 à 90 % à
l’horizon 2030.
Favoriser des dispositifs innovants, 10 M€
Appel à Projets GREEN Deal "Eau et innovation", à hauteur de 5 M€.
Lancement du futur Appel à Projets "REUT", à hauteur de 5 M€ (à
partir du 2 juin 2023).
Accompagnement et exemplarité du Conseil départemental, 5 M€
Incarner une collectivité exemplaire par l’installation de
dispositifs d'économie d’eau et de suivi de consommation dans chaque
bâtiment de la collectivité et de ses satellites.
Améliorer ensemble la connaissance pour agir, 2 M€
Installation d’un Observatoire départemental de l’eau qui recense la
donnée, actualise la connaissance sur l’eau, cartographie la
ressource exploitable et constitue un réservoir d’idées.
Les chauves-souris ne sauveront finalement pas
le palais des congrès Acropolis de la démolition à Nice
Le référé liberté déposé par l’association Capre 06 afin de tenter
d’empêcher la démolition du palais des congrès Acropolis de Nice,
examiné mercredi, a été rejeté par le tribunal administratif.
Le référé liberté, déposé par l’association Capre 06, le Collectif
associatif pour des réalisations écologiques des Alpes-Maritimes, au
tribunal administratif de Nice, a été rejeté.
L’association exigeait de la Ville qu’elle arrête immédiatement les
travaux de démolition du bâtiment Acropolis et sollicitait "sans
délai une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des
espèces protégées ".
Selon les militants écologistes, l’étude réalisée par les écologues
sur la présence d’espèces protégées sur le site "n’est pas
exhaustive, hésitante, au conditionnel ". Ils évoquent notamment
la présence de chauves-souris, de reptiles, d’oiseaux ou encore de
lézards.
La Ville a contre-attaqué: "La qualité du diagnostic écologique,
vérifié par la Dreal [Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement] n’a pas à être mise en doute et il a
retenu, pour toutes les espèces protégées, un enjeu de conservation
faible à très faible". Des arguments suivis par la justice
administrative.
Les pelleteuses peuvent donc continuer leur œuvre. La démolition
totale du palais des congrès devrait être effective au dernier
trimestre 2024 ou au début de 2025. Place ensuite aux travaux de
réalisation de l’extension de la coulée verte.
La sécheresse dans les Alpes-Maritimes en avril
2023 est digne d'un mois de juin selon Météo France
La situation devient critique dans les Alpes-Maritimes où la
ressource en eau s'amenuise. Recharge des nappes phréatiques
déficitaire, faible pluviométrie et indice d'humidité des sols
alarmant permettent d'aboutir à ce constat. On fait le point.
Les statistiques de Météo France ne sont pas bonnes pour le
département, qui fait face, déjà, à un nouvel épisode de sécheresse.
Les indicateurs, dans le rouge, font que nous nous trouvons déjà
avec deux mois d'avance sur les niveaux habituellement constatées.
On vous explique tout ça.
Une recharge des nappes phréatiques largement déficitaire depuis
2021
La recharge des nappes phréatiques, c'est l'un des premiers critères
qui est scruté au moment de s'attarder sur la sécheresse.
"Cette période s'étend de septembre à mars ", explique Sylvain
Galliau, météorologue conseil chez Météo France. Et cette année,
déficit pluviométrique oblige, la recharge n'a pas pu se faire comme
espéré. "C'est la 4eme période la plus sèche jamais observée
depuis 1958 et le début des relevés ".
"Le déficit cette année est de 47%. Il était de 52% un an plus
tôt ", poursuit-il. Une répétition du phénomène qui préoccupe du
côté de Météo France. "Cela fait même trois ans que l'on assiste
à cette tendance. En 2021 déjà, le déficit était de 20% ",
explique le spécialiste basé à Aix-en-Provence.
Un déficit pluviométrique qui se poursuit en avril
Avec le retour du printemps, la période de recharge des nappes est
terminée. Résultat, à chaque épisode pluvieux, c'est la végétation
qui en profite. L'eau n'est donc pas absorbée.
Sauf que cette année, c'est à peine si la végétation peut en
profiter, tant la pluie se fait rare. Très rare. Au 27 avril, il
n'est tombé que 29 mm de pluie en moyenne sur le département, soit
un déficit de 67% par rapport à la normale. L'an dernier, les
Alpes-Maritimes avaient enregistré un total de 68,3mm.
Si un épisode pluvieux est attendu dans la nuit de dimanche à lundi,
le mois d'avril s'annonce sec et déficitaire. "D'autant qu'il ne
s'agit que d'une moyenne", rappelle Sylvain Galliau. La pluie
s'est faite encore plus rare près des zones côtières et dans le
moyen pays, souligne le spécialiste.
Un indice d'humidité des sols digne d'un mois de juin
Autant de critères qui permettent d'aboutir à un constat préoccupant
: l'indicateur d'humidité des sols a deux mois d'avance sur un
niveau de sécheresse normal dans le département.
"Ce 25 avril 2023 a été le 25 avril le plus sec jamais observé
", affirme le météorologue. Les valeurs actuelles sont celles de
mi-juin. "On a deux mois d'avance, comme en 2022 ",
rappelle-t-il, préoccupé par la récurrence de ce phénomène.
Le palais des congrès Acropolis de Nice sauvé
de la démolition par des chauves-souris?

La justice doit trancher
Un référé liberté déposé par l’association de défense de
l’environnement Capre 06 a été examiné ce mercredi après-midi par le
tribunal administratif de Nice qui devrait rendre sa décision
rapidement.
Les défenseurs du palais des congrès tentent de sauver le bâtiment,
cette fois en évoquant la possible présence de chauves-souris. Photo
Sébastien Botella
Des bébêtes permettront-elles de sauver le palais des congrès
Acropolis, voué à la démolition ?
L’association Capre 06 (Collectif associatif pour des
réalisations écologiques des Alpes-Maritimes), a déposé un référé
liberté au tribunal administratif de Nice.
L’audience s’est tenue ce mercredi 26 avril et la décision de la
justice administrative devrait être rendue très rapidement.
L’association, désormais présidée par la Gaudoise Geneviève Andréa,
qui a succédé à la conseillère municipale écolo Sylvie Bonaldi, a
fait valoir, par la voix de son conseil parisien, Me François Braud,
que les études réalisées par des écologues au sujet de la présence
d’espèces protégées sur le site n’étaient pas exhaustives.
Et notamment de chauves-souris dans les anfractuosités du bâtiment.
Les experts n’auraient pas pu accéder entièrement à l’intérieur du
site pour le vérifier.
Les défenseurs du palais Acropolis, dont la destruction a débuté en
mars, estiment qu’il faut arrêter immédiatement la mise à terre du
paquebot de béton en attendant des études plus poussées.
Si la justice n’en décide pas autrement, l’iconique bâtiment devrait
n’être plus que poussière en 2025, afin de permettre à Christian
Estrosi de livrer l’extension de la coulée verte en 2026. Si tout va
bien, avant les municipales.
Les hirondelles du stade du Ray
En mai 2017, ce sont des hirondelles qui avaient perturbé le
chantier de démolition du stade de Ray, à Nice-Nord. Classées
espèces protégées, elles avaient fait leur nid dans l’emblématique
tribune ouest. La Ville avait dû prévoir des habitats de
substitution pour ces oiseaux avant de pouvoir laisser de nouveau
les pelleteuses faire leur œuvre.


De couvent à hôtel 5-étoiles: on vous fait
visiter le gigantesque chantier de la Visitation, dans le Vieux-Nice
Perseus espère pouvoir ouvrir son hôtel "Le Couvent" à la fin du
printemps 2024.
Les travaux battent leur plein au sein de la Visitation, cet endroit
hors du temps dans la vieille-ville.

D'ici un an, le couvent de la Visitation, dans le Vieux-Nice,
sera devenu un hôtel 5-étoiles
En 2016, Christian Estrosi annonçait la transformation du couvent de
la Visitation en hôtel 5-étoiles et dévoilait que la Ville avait
accordé un bail à construction de 93 ans au groupe Perseus, présenté
comme le spécialiste de réhabilitation de bâtiments à valeur
patrimoniale.
Sept ans – et leur lot de déboires avec des riverains – plus tard,
les travaux avancent.
Valéry Grégo, le maître d’ouvrage, espère ouvrir Le Couvent à la fin
du printemps 2024. Un immense challenge: il fallait respecter
l'authenticité, l’âme et l’esprit du lieu, inscrit à l’inventaire
des monuments historiques en 1989.
Les architectes, dont Louis-Antoine Grégo, se sont plongés dans
l’histoire du couvent pour mieux s’en imprégner et essayer de ne pas
trahir l’histoire.
Un travail de documentaliste et d’archiviste fait également de
rencontres: Louis-Antoine Grégo a même pris attache avec Sœur
Marie-Chantal, la dernière religieuse vivante qui a pris ses habits
à la Visitation de Nice et qui vit aujourd’hui à la Visitation de
Voiron.
Sur un peu plus de 7.500m2, Le Couvent offrira 88 chambres, trois
restaurants, deux bassins de nage extérieurs et des thermes romains.
Les frères Grégo veulent en faire un havre de paix, un lieu de
sérénité en pleine ville.
Nice-Matin a visité les lieux pour vous.
Un hôtel, quatre entités

L’hôtel 5-étoiles Le Couvent est formé de quatre entités. L’entrée
se fera par la rue Honoré-Hugo, dans le Vieux-Nice, une
perpendiculaire à la rue des Serruriers. Le seuil franchi, les hôtes
découvriront le cloître, ici en travaux, avec la Grande cour des
orangers, entourée par l’ancien couvent de la Visitation qui
abritera une quarantaine de chambres sur les 88.
Le second est le bâtiment de la rue des Serruriers, sur la gauche,
avec une vingtaine de chambres. Le troisième est une extension qui
contiendra une vingtaine de chambres. À l’entrée, deux chambres à
l’étage et l’accueil des hôtes.
La cour des orangers

Dans la cour ci-dessus, des orangers seront plantés, il y aura de
nombreux endroits pour s’asseoir et profiter de la quiétude du lieu
ainsi qu’une grande calade, c’est-à-dire un sol pavé de galets.
Sur la gauche, le premier restaurant du Couvent, ainsi que le bar,
avec salle intérieure et terrasse. L’hôtel disposera aussi de
thermes romains et d’un "mouvement studio", une salle de
sport sans "machines", pour les hôtes du lieu mais pas
seulement.
L’hôtel envisage d’accueillir des personnes extérieures avec un "pass
journalier".
L'entrée de l'hôtel

L’entrée du Couvent. Avec l’accueil au rez-de-chaussée et deux
chambres à l’étage. Un parking déporté sera mis à la disposition des
clients qui seront acheminés à l’hôtel avec des voiturettes de golf.
Elles seront aussi mises à disposition des clients qui voudront
profiter des trois restaurants du lieu.
4. Le vieux four conservé, l'hôtel aura sa... boulangerie

L’hôtel va disposer d’une… boulangerie. Le vieux four à pain a été
conservé. Les nonnes qui occupaient le lieu l’ont utilisé pendant
des siècles. À côté, la cellule abritera une herboristerie. Et celle
d’après sera la cave à vin.
En face, le restaurant donc, construit dans l’ancien réfectoire des
Visitandines, qui avaient succédé aux Clarisses, demeurées dans ce
couvent jusqu’en 1793. Dans ce même bâtiment, une bibliothèque. Elle
proposera des livres sur le projet, sur la région et sur l’École de
Nice.
L’hôtel a vocation à être un centre culturel, avec des expos hors
les murs, des signatures de livres, dans une grande salle qui pourra
également accueillir des mariages.
Couloirs et chambres avec vue

Les magnifiques couloirs qui mènent aux chambres… Certaines auront
vue sur le jardin en restanque. Les arbres ont été conservés, une
cinquante a été plantée. 150 autres vont suivre. Le jardin,
véritable havre de paix, aura de nombreux transats, des chiliennes.
Un bassin existant sera transformé en petit bassin de nage. Un autre
va être créé sur une planche plus haut. Le jardin aura son potager,
comme les nonnes en leur temps.

On y trouvera également le deuxième restaurant, une "guinguette"
sous les arbres. Le troisième, un "bistro", sera abrité dans
le bâtiment des Serruriers.
La future suite présidentielle

Une partie de la grande suite "présidentielle". Elle pourra
communiquer avec d’autres chambres. Certaines chambres vont disposer
de leur propre cuisine, pour des familles par exemple. Une chambre
sera abritée dans une maison avec jardin privatif. Enfin, d’autres
chambres ont été créées dans les cellules des Sœurs, comme on peut
le voir sur la photo ci-dessous.

Un bâtiment "ocre clair" ou "ocre sable"

Sur le bâtiment, on aperçoit la future couleur de l’hôtel. Un "ocre
clair" ou "ocre sable", précise Louis-Antoine Grégo,
l’architecte qui travaille pour Studio Méditerranée. Les façades ont
été travaillées à la chaux. "Cela permet au bâtiment de respirer,
il y a du confort au ressenti et un très bel effet de lumière. Ce
matériau est aussi choisi pour sa durabilité, il évolue et vit dans
le temps", décrypte l’architecte, frère du maître d’ouvrage et
président du groupe Perseus, Valéry Grégo.
Devant des troncs d’arbre qui ont déjà eu plusieurs vies. "Ils
ont été des mâts de navire pendant deux siècles. Ils ont fait le
tour du monde avant de venir ici, pour leur deuxième vie au couvent,
pendant quatre siècles. Et maintenant, on leur donne leur troisième
vie…", sourit Louis-Antoine Grégo.
Ces troncs seront transformés en meubles pour l’hôtel. Perseus a
souhaité un chantier vertueux. "Tout ce que nous excavons, nous
le trions et nous recyclons tout ce qui est possible pour les
travaux."
Le chantier vu d'en haut

En prenant de la hauteur, on comprend mieux l’ampleur du chantier.
26 corps de métier, une centaine d’ouvriers. Coût total des travaux:
65 millions d’euros.
Le couvent de la Visitation, plus de 4 siècle d'un histoire
parfois mouvementée
Le couvent remonte à 420 ans en arrière, en 1604, alors que la
première pierre du couvent des Clarisses était posée. D’abord conçu
comme un petit couvent, il a connu trois développements: en 1630,
1670 et 1750.
En 1792, en pleine Révolution française, les révolutionnaires
mettent les Clarisses dehors pour loger les troupes miliciennes.
Arrive alors la restauration sarde.
En 1819, le bâtiment est attribué aux sœurs de la Visitation.
En 1960, elles quittent les lieux, rachetés par la mairie.
En 1989, à la suite de travaux de restauration, l’ancien couvent et
la chapelle de la Visitation sont inscrits à la liste des monuments
historiques.
Paul Touvier y a été arrêté
Le couvent n’a pas toujours connu une existence tranquille. Dans la
nuit du 23 au 24 mai 1989, les gendarmes de la brigade des
recherches bouclent la place Sainte-Claire, dans le Vieux-Nice, et,
à l’aube, se font ouvrir les portes du prieuré Saint-Joseph où ils
savaient Paul Touvier réfugié depuis peu.
L’ancien chef de la milice lyonnaise s’est laissé arrêter sans
résistance dans l’une des cellules de ce cloître, dépendance de
l’église de la Visitation qui était le fief local des catholiques
traditionalistes de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X se
réclamant de l’enseignement de Mgr Lefèbvre.
Selon les éléments de l’enquête révélés par la suite, il semble que
Touvier s’y trouvait – sous le nom de Paul Lacroix – depuis moins de
deux mois, avec son épouse et ses deux enfants.

Bonus : visite de l'ancien Couvent de la Visitation


Du nouveau sur le réseau de tramway: la future
ligne 4 change de tracé, les lignes 2 et 3 aussi
Le tramway qui ira jusqu’à Cagnes s’arrêtera finalement au Cadam. Ce
prolongement permettra à la ligne 2 de n’avoir plus qu’une gare
d’arrivée, l’aéroport, et à la 3 de pousser jusqu’au port.
S’il y a une chose qui n’avait pas changé depuis l’annonce de la
création de la ligne 4 du tramway métropolitain, c’est bien le
terminus. Manqué.
La ligne reliant Cagnes-sur-Mer à Nice ne s’arrêtera finalement pas
à Grand-Arénas.
Elle poursuivra son chemin jusqu’au Centre administratif des
Alpes-Maritimes (Cadam) sur les rails déjà existants de la ligne 2.
C’est en tout cas ce qu’indique désormais le site de la Métropole,
qui semble avoir réactualisé (en catimini ?) le tracé prévisionnel.

Voici le nouveau tracé prévisionnel de la future ligne 4 qui
reliera Nice à Cagnes-sur-Mer en passant par Saint-Laurent-du-Var.
(Capture d’écran/site Métropole Nice Côte d’Azur).
C’est le compte Twitter @Nice2030_actu, très au fait de l’actualité
urbaine et architecturale de la capitale azuréenne, qui a repéré, en
fin de semaine dernière, cette modification.
Le prolongement de la ligne 4 n’est pas anodin puisqu’il entraîne du
changement sur la 2 et la 3.
La ligne 4
Pour Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice délégué aux Transports, "ce
n’est pas forcément qu’il a changé, c’est qu’il n’a jamais été
explicité. Grand-Arénas n’est pas un endroit efficace pour un
terminus, qui doit être un lieu de régulation " ou des rames
peuvent stationner quelques minutes avant de repartir dans l’autre
sens.
Pourtant, jusqu’à il y a peu, le schéma présenté indiquait la fin de
la ligne à cet endroit… Quand a eu lieu ce changement ? Gaël Nofri
n’a pas été en mesure de répondre sur ce point précis.
"Les choses n’ont pas changé. Le projet de la ligne 4, c’est un
projet de travaux entre Grand-Arenas et Cagnes. Qu’après,
l’exploitation soit différente… Ça ne change ni le coût, ni les
travaux, ni la ligne", martèle l’élu niçois.
Les lignes 2 et 3
L’adjoint l’assure: "Il a toujours été annoncé que le plan
d’exploitation actuel [des lignes 2 et 3, N.D.L.R.] était
temporaire." Ce dont nous n’avons trouvé nulle trace dans nos
archives.
Le passage de la ligne 4 sur le tronçon Grand-Arénas – Cadam
permettra aux deux autres lignes d’accéder à leur tracé définitif,
donc. La ligne 2 ne desservira plus le Cadam et n’aura plus qu’un
seul terminus: l’aéroport. Et la ligne 3 reliera Saint-Isidore
directement au port de Nice. Tout cela à partir de la mise en
service, "même partielle", de la 4, a précisé l’élu.
Autrement dit, pendant la période où elle ne s’arrêtera qu’à
Saint-Laurent-du-Var. Soit à partir de 2026.
"Christian Estrosi s’est engagé à ce que le cœur de l’Ecovallée
soit desservi par une ligne directe jusqu’au centre-ville. Or, si on
veut cette ligne directe, et une autre (la 2) vers l’aéroport avec
une fréquence de moins de dix minutes, le tronçon Grand-Arenas –
Cadam reste à couvrir. Il sera couvert par la 4 qui fera Cadam –
Cagnes-sur-Mer ", détaille Gaël Nofri.
Ces trois lignes auront une régularité de desserte de huit minutes,
comme c’est déjà le cas.


Dijon et Poitiers forment plus d’internes que
Nice, Christian Estrosi écrit au ministre de la Santé
Le maire de Nice estime que Nice est trop mal servie par rapport à
Marseille ou même à des villes de moindre importance. Après une
première demande en juillet, restée lettre morte, il remonte au
créneau.

L'hôpital Pasteur de Nice, en avril 2021
"Protéger la santé des citoyens, c’est avant tout former les
futurs professionnels en nombre suffisant." Christian Estrosi
interpelle les ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur,
François Braun et Sylvie Retailleau, afin que la faculté de médecine
de Nice puisse accueillir davantage d’internes en 2024.
"Sur les 686 internes que s’apprête à demander l’Agence régionale
de santé, nous apprenons que 487 seraient déployés à Marseille.
Nice, 5e ville de France, aurait droit à former 199 internes, alors
que Dijon (158.000 habitants) forme 261 internes, Poitiers (89.000
habitants) en forme 261 ", écrit le maire dans un communiqué
publié le 19 avril.
Très insuffisant par rapport aux demandes formulées par l’Université
Nice Côte d’Azur, juge l’élu qui est également président du conseil
d’administration du CHU.
Il demande "de manière urgente à ce que le nombre d’internes soit
porté à 245 et que la pondération soit revue entre nos deux grandes
métropoles, Nice et Marseille, pour les années à venir ".
Et de plaider: "Ce n’est pas un luxe, il s’agit de répondre aux
besoins de formation, mais aussi d’anticiper les futurs départs à la
retraite: plus de la moitié des médecins installés sur notre
territoire ont entre 60 et 74 ans. Le besoin de soin dans notre
région est de plus en plus important face à une population âgée
consommatrice de soins en forte augmentation."
Une première demande restée sans réponse
Christian Estrosi tire la sonnette d’alarme: "Notre territoire
subit déjà les conséquences de ces choix: le nombre de médecins en
formation à Nice est insuffisant pour assurer la médicalisation du
CHU de Nice et des Centres hospitaliers de la subdivision (Cannes,
Antibes, Grasse, Menton, Draguignan, Fréjus ainsi que la Corse). De
nombreuses filières sont en difficulté, avec des délais de prise de
rendez-vous supérieurs à six mois dans le public comme dans le
privé, l’impossibilité de prendre en charge de nouveaux patients
dans certaines spécialités des hôpitaux généraux, la saturation des
urgences et très peu de médecins qui participent à la permanence des
soins."
Il espère être entendu par le gouvernement. En juillet dernier, il
était déjà monté au créneau et avait fait la même demande: il
n’avait reçu "aucune réponse, ni argumentaire".


Victoire du maire de Conségudes : l'unique
liaison de bus de son village est rétablie par la région PACA
Après l'appel, désespéré, du maire de Conségudes, dans les
Alpes-Maritimes, du mardi 18 avril 2023 - sur les antennes de France
3 Côte d'Azur et de France Bleu Azur -pour que soit rétablie
l'unique ligne hebdomadaire de bus qui desservait son village, l'élu
a obtenu satisfaction.
Ce matin, jeudi 20 avril, à 10h04, la région lui a indiqué le
rétablissement de la liaison directe entre Conségudes et la zone
commerciale de Lingostière.
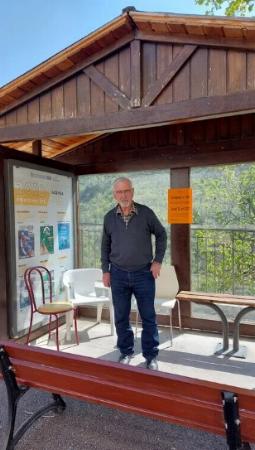
Une fabuleuse nouvelle pour René Trastour et son village !
Il était un peu plus de 9h, ce matin, quand le téléphone du maire de
Conségudes a retenti. Au bout du fil, Gilles Moroni, de la direction
des transports scolaires et interurbains et du service réseau
transport des Alpes-Maritimes de la région PACA. L'élu n'en croit
pas ses oreilles, son interlocuteur lui propose de rétablir la
liaison directe de bus entre Conségudes et la zone commerciale de
Lingostière. René Trastour exulte de joie et de satisfaction.
Appel de la Région à la mairie de Conségudes
"Alors ça, c'est efficace ! Franchement, je n'y croyais plus. Je
ne vous cache pas ma joie de cette nouvelle qui est arrivée par
téléphone en début de matinée. C'est merveilleux pour les tous
habitants de Conségudes. Nous ne sommes plus coupés du monde. Nous
ne sommes plus abandonnés par la Région. La ligne de bus va être
rétablie dès le vendredi 28 avril ".
Voilà les premiers mots, ce matin, d'un maire, heureux. Comme quoi,
un simple coup de téléphone peut métamorphoser la vie de tout un
village !
La ligne de bus est rétablie
Moins d'une heure plus tard, la mairie reçoit, par mail, la
confirmation de la bonne nouvelle. On peut y lire les mots suivants
de Gilles Moroni: " Après analyse des options envisageables, la
seule retenue est de prolonger la ligne 671 qui ferait un départ de
Conségudes à 9h05 le vendredi et un retour de Carrefour Lingostière
à 12h20 le vendredi ". Et d'ajouter " Merci de bien vouloir
me confirmer votre accord sur cette proposition afin que je puisse
l’organiser rapidement. On maintiendrait une demande de
"réservation" ou nous prévenir afin de nous assurer de l’utilité du
trajet supplémentaire le jour indiqué".
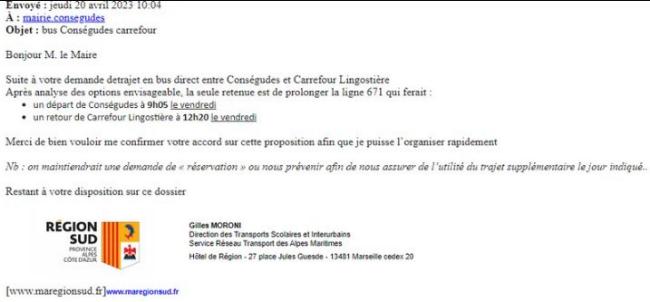
La ligne Conségudes-Carrefour de Lingostières est rétablie
L'élu n'est pas peu fier du contenu de ce courriel. C'est une
victoire qu'il vient de remporter au bout de 8 mois de
sollicitations restées sans réponse de la Région.
Désormais, les résidents de Conségudes pourront, chaque vendredi,
comme avant le 2 septembre 2022, réemprunter la ligne de bus 671 qui
les mènera jusqu'au centre commercial de Lingostière. Une ligne
directe qui les relie au reste du monde, comme le soulignait le
premier magistrat : "C'est une ligne de bus vitale. Il n'y a plus
de commerce dans le village, plus de boulangerie. Cette ligne de bus
est essentielle pour nous".
Dans un communiqué de presse, Renaud Muselier, Président de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de
France, déclare : "Nous sommes très attachés à l’équité entre les
territoires et particulièrement pour les transports régionaux. Nous
nous efforçons de proposer le meilleur service aux usagers en lien
avec les communes et les réseaux de transports locaux ".
Prochain départ de Conségudes, vendredi 28 avril à 9h05.
La vie reprend dans le Haut-Pays.


Nice bientôt à la pointe sur la réutilisation
des eaux usées avec un projet à 540 millions d’euros

A l’ouest de Nice, tout près de son aéroport, la station d’épuration
Haliotis va bénéficier d’un chantier de réhabilitation et de mise à
niveau à 540 millions d’euros pour offrir un nouveau système de
traitement des eaux usées permettant notamment leur réutilisation
partielle.
"Elle possédera une unité industrielle de Réutilisation des Eaux
Usées Traitées (Réut') capable de recycler 5 millions de mètres
cubes d’eau par an, c’est-à-dire la totalité des besoins en arrosage
des espaces verts et de nettoyage des voiries de la ville de Nice",
précise la métropole.
Les travaux doivent démarrer l’an prochain pour une mise en service
progressive entre 2025 et 2030.
C’est un chantier à 540 millions d’euros qui s’annonce. A l’ouest de
Nice, la station d’épuration Haliotis va bénéficier d’un projet de
réhabilitation et de mise à niveau pour offrir un nouveau système de
traitement des eaux usées permettant notamment leur réutilisation
partielle, ont annoncé jeudi la collectivité et le groupe Suez, qui
a remporté le marché. Les travaux doivent démarrer l’an prochain
pour une mise en service progressive entre 2025 et 2030.
La future installation de la métropole Nice Côte d’Azur, plus grand
projet de France et un des plus grands en Europe selon ses
initiateurs, traitera les eaux usées de 26 communes, soit six de
plus qu’actuellement, et 680.000 habitants.

Selon la métropole Nice Côte d'Azur, le projet comprendra
également "4,5 hectares de biodiversité composés de 600 arbres,
haies vives et garrigue"
"Elle possédera une unité industrielle de Réutilisation des Eaux
Usées Traitées [Réut'] capable de recycler 5 millions de mètres
cubes d’eau par an, c’est-à-dire la totalité des besoins en arrosage
des espaces verts et de nettoyage des voiries de la ville de Nice",
précise la métropole. Dans son plan Eau annoncé fin mars, Emmanuel
Macron a fixé l’objectif de 10 % d’eaux usées réutilisées d’ici
2030. Encore marginal en France, le procédé est courant dans
d’autres pays, notamment pour l’irrigation agricole.
En pointe, "Haliotis 2 " offrira des performances de
traitement des eaux "supérieures aux normes sanitaires avec près
de 90 % des microplastiques qui seront éliminés par la station",
assure également la collectivité. Elle produira également de
l’énergie liée notamment aux boues issues de l’épuration, de quoi
alimenter en biométhane l’équivalent de 11 000 logements ou de 300
bus. Le potentiel calorifique de l’eau usée traitée sera en outre
utilisé par le réseau de chaleur irriguant l’aéroport et le quartier
du Grand Arénas.
Le projet "participera largement à atteindre l’objectif de notre
Plan Climat qui vise à réduire de 55 % de nos émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050
", se réjouit Christian Estrosi.


Sécheresse: l'inquiétude monte face à l'arrivée
de l'été dans les Alpes-Maritimes
Le Paillon, L’Estéron, la Cagne, peut-être aussi la Siagne...
plusieurs bassins-versants des Alpes-Maritimes devraient passer en
alerte renforcée la semaine prochaine. À l’approche de la saison
estivale l’inquiétude monte. Pour de nombreux experts une crise
majeure semble d’ores et déjà inévitable.
Le comité sécheresse s’est une nouvelle fois réuni ce jeudi en
préfecture. Ce groupe d’experts qui rassemble tous les acteurs de
l’eau, des producteurs aux consommateurs, scrute presque chaque mois
depuis un an l’état d’une ressource qui n’en finit plus de
s’amenuiser.
Début mars le comité sonnait déjà l’alerte pour l’ensemble du
département. Elle devrait être renforcée, dès la semaine prochaine,
sur au moins trois bassins-versants: l’Estéron, la Cagne et le
Paillon. La situation de la Siagne inquiète également.
"Une situation de crise majeure"
Ces territoires azuréens se verront automatiquement assignés des
objectifs de réduction de consommation d’au moins 40%. Une
injonction préfectorale qui, faute de contrôles suffisants (voir
ci-dessous), semble bien difficile à faire respecter. L’été dernier,
au plus fort de la crise, la consommation d’eau du département
n’avait baissé au final que de 10% en août dernier. 2022 aura
pourtant été la deuxième année la plus sèche depuis 1959. Le
problème c’est que 2023s’apprête à grimper elle aussi sur ce triste
podium des plus forts écarts à la normale.
"Même si on ne parle pour l’heure que d’alerte renforcée,
note le maire d’Aiglun, Anthony Salomone, il ne faut pas se
leurrer, nous sommes déjà dans une situation de crise majeure."
Vers des coupures d’eau au robinet
"L’été sera dur, prévient lui aussi, Jean-Luc Belliard,
responsable du pôle eau de la chambre d’agriculture. Sans doute
marqué par des coupures d’eau au robinet. Et peut-être pas que dans
les villages de l’arrière-pays..."
Certaines communes, dans l’Estéron ou bien Caussols, seraient déjà
au bord de la rupture. Ce ne serait "qu’une question de jours".
Tous les feux sont en effet au rouge. La période de recharge qui, de
septembre à mars, est censée remplir les nappes, vient de s’achever
avec un déficit pluviométrique de 47%. Celui-ci a même atteint 76%
le mois dernier. Et alors qu’avril a débuté sous les mêmes auspices,
Météo-France n’annonce que de rares pluies éparses pour les 15
prochains jours.
Des mètres en moins dans les nappes
Au-delà, personne n’a de boule de cristal. Mais tout le monde
s’accorde à dire que même si la pluie venait à s’abattre sur les
Alpes-Maritimes cela ne suffirait pas à reconstituer des stocks
largement entamés. "Tous les capteurs du département affichent
des mesures inférieures de 40 à 60% à la normale. La sécheresse de
cette année est déjà au niveau de ce qu’elle était l’an passée, mais
trois mois plus tôt ", constate avec inquiétude Antoine Véran,
maire de Levens et vice-président de la Métropole.
"Le niveau de l’Estéron est 50cm en dessous de ce qu’il devrait
être", pointe le maire d’Aiglun, Anthony Salomone. "Et ceux
de la plupart de nos nappes phréatiques ont reculé de plusieurs
mètres", ajoute Jean-Luc Belliard, responsable du pôle eau de la
chambre d’agriculture.
Le château d’eau de Saint-Cassien au plus bas
Pour lui le point le plus noir de ce tableau déjà bien sombre est le
lac de Saint-Cassien. Ce château d’eau qui alimente l’est-Var et
plusieurs communes de l’ouest des Alpes-Maritimes, comme Cannes ou
Mandelieu, a déjà perdu "entre 2,5 et 3mètres".
"Parce que la Siagne qui l’alimente subit elle aussi la sécheresse
et que le Var, lui-même en crise, a dû beaucoup puiser dedans",
explique Jean-Luc Belliard qui rappelle qu’on ne pourra continuer
indéfiniment de ponctionner Saint-Cassien. Réglementairement le lac
doit entamer la saison avec une réserve de 20 millions de mètres
cubes au 1er juillet. C’est l’approvisionnement de centaines de
milliers de Varois et de Maralpins qui en dépend.
Plus que jamais le risque de pénurie menace les Alpes-Maritimes. "Tous
les experts le disent, souffle Antoine Véran, certaines
communes ne devraient pas échapper à des coupures d’eau."
Lesquelles ? Personne ne veut vraiment le dire "pour ne pas
affoler les populations". Même si les secteurs les plus
vulnérables sont connus: les hameaux de la Roya, certains villages
de l’Estéron... Et, au-delà du moyen et haut pays, toute la rive
droite du Var.


Bientôt des méga-bassines dans le parc du
Mercantour pour faire face à la sécheresse ?
Ces retenues d’eau dans le sol sont à l’étude en raison de la
sécheresse qui pourrait être pire que l’an dernier. En mars, une
manif contre un projet similaire avait dégénéré à Sainte-Soline.

Une retenue collinaire à Valberg. Une bassine qui retient l’eau de
la fonte des neiges et qui sert pour la neige artificielle des
stations de ski.
"Les bassines sont l’une des solutions au manque d’eau " dans
les vallées. Antoine Véran, le maire de Levens, vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur délégué à l’Agriculture, ne le cache pas:
"Il y a urgence, il faut stocker de l’eau."
La situation est "inquiétante", dit-il, chiffres à l’appui. "Nous
sommes entre 40 et 60% en dessous des chiffres de l’année dernière,
44% en moyenne et avec deux mois d’avance sur l’ensemble des
réserves d’eau", explique l’élu métropolitain.
"Ça s’est mal passé l’an dernier. Les éleveurs, par exemple, ont
beaucoup souffert. On a dû amener de l’eau pour les bêtes. Et 2023
sera pire que 2022 ", assène-t-il. Antoine Véran pense à
l’agriculture "nourricière", aux éleveurs, aux fromagers.
Mais pas seulement: "Il ne s’agit pas affoler les gens, mais
peut-être que plusieurs villages n’auront pas d’eau potable cet été.
L’Estéron est au plus bas, par exemple". Déjà, assure le maire
de Levens, "je reçois des alertes de transhumants qui me disent
que leurs points d’eau sont à sec".
Des cuves et des camions
La Métropole est en train de faire l’acquisition de cuves pour
transporter l’eau potable. "On a déjà les camions, on les a
utilisés pour emmener du foin dans les vallées après la tempête Alex,
précise-t-il. Il leur faut trouver une solution pour stocker
l’eau de manière conséquente. On pourrait s’appuyer sur les réserves
existantes des stations de ski ", confie-t-il. Problème: elles
veulent garder leur eau. La solution: "On peut imaginer
d’agrandir ces retenues". Ce ne sera certainement pas suffisant.
"On va étudier aussi comment et où créer des bassines",
poursuit le maire de Levens.
Pas simple non plus. "Il va falloir
parler avec le parc du Mercantour ".
Pas de pompage dans les nappes phréatiques ?
"Ces bassines seront sans pompage dans les nappes phréatiques,"
jure-t-il. "On récupérera l’eau du ciel ou on détournera les
torrents lorsqu’ils sont chargés." Antoine Véran, anticipant les
critiques des écolos, souffle:
"L’eau n’est pas un modèle
politique mais un modèle économique et un modèle de vie."
Les Verts vent debout
"Les méga-bassines ne sont pas simplement alimentées par les eaux
de pluie. Elles nécessitent des opérations de pompage, des nappes
phréatiques et des cours d’eau ", assure de son côté Fabrice
Decoupigny, élu EE-LV de Nice.
Il grogne: "Ces méga-bassines auront des impacts dramatiques sur
nos nappes phréatiques. Elles ne servent que pour des cultures très
gourmandes en eau."
Le conseiller municipal Vert analyse: "Il ne neige plus assez
dans les stations de ski du haut-pays. Pour compenser cela, ils font
appel à de la neige artificielle. Les canons à neige ont besoin de
plus de
4 000m3 d’eau pour un hectare de pistes contre 1 700m3 pour la même
surface de maïs (cultures réputées très consommatrices en eau).
C’est l’accaparement de la ressource “eau" au seul profit des
stations de sport d’hiver. Les pompages pour les alimenter auront
des conséquences écologiques funestes".


Alpes-Maritimes : le combat du maire de Conségudes
pour rétablir l'unique liaison de bus de son village

René Trastour, le maire de Conségudes, une petite commune de cent
habitants près de Bouyon, dans les Alpes-Maritimes, se mobilise et
lance un appel pour que soit rétablie l'unique ligne hebdomadaire de
bus qui desservait son village. Une liaison vitale selon lui.
Entre désespoir, épuisement et colère, René Trastour, le maire de
Conségudes, hésite face au non remplacement de l'unique navette de
bus qui desservait son village depuis le 2 septembre 2022.
René Trastour, le maire de Conségudes est épuisé. Il est épuisé de
ne pas être entendu par la Région qui fait la sourde oreille, depuis
le 2 septembre 2022. Depuis ce jour, l'unique ligne de bus, de la
petite commune de 96 habitants à l'année, a été supprimée.
Il s'agissait d'une ligne de bus "Zou" de la Région PACA qui
permettait de se rendre de Conségudes au centre commercial
Lingostière et à la gare routière de Nice. Selon l'élu, "une
ligne de bus vitale. Il n'y a plus de commerce dans le village, plus
de boulangerie. Cette ligne de bus est essentielle pour nous".
Une offre de transport qui va de Charybde en Scylla
Il faut dire, aussi, que les Conségudois et Conségudoises ont été
autrement habitués. Il y a plus de cinquante ans, chaque jour, un
bus desservait le village matin et soir. Selon les souvenirs du
maire, "le chauffeur habitait même le village, c'était vraiment
très très pratique".
Puis, dans les années 2000, la liaison quotidienne est devenue
hebdomadaire. Le vendredi matin. "Ça fonctionnait avec le
transport à la demande", se remémore René Trastour. "Il
fallait téléphoner à la "centrale du transport à la demande" de la
Région. C'est Marseille qui gérait ".
Puis vint le 2 septembre 2022 et depuis plus rien. Enfin, pas tout à
fait...
Un système D plutôt chaotique
Élu depuis 2012, ce Niçois adopté par les villageois, a toujours
connu au moins un moyen de transport pour se rendre ou sortir de
Conségudes qu'il fréquente depuis de nombreuses années, puisqu'il y
a une résidence secondaire.
Face à ce "rien ", la CASA a donc mis en place un "système
D ", comme l'appelle monsieur le maire. Une sorte de transport
pour pallier l'absence du bus du vendredi. "Il y a bien un
système D de bus qui a été mis en place par la CASA pour descendre
de Conségudes à Lingostières pour y faire ses courses. Mais alors
là, c'est l'aventure ! Il faut prendre la petite navette Envibus de
Conségudes à Bouyon."
René Trastour, maire de Conségudes :
"Il
y a bien un système D de bus, mais alors là, c'est l'aventure ! "
"Une fois à Bouyon, il faut prendre un autre bus qui va sur Nice
et qui s'arrête à l'hypermarché. Le problème, c'est que ce bus
s'arrête à tous les arrêts sur la route. Il passe même par
l'intérieur de Carros. Le voyage est interminable. Au final, on
arrive vers 11h pour faire les courses… et à 12h30, le bus repart !
En fait, je devrais offrir des patins à roulettes aux mamies. Elles
iraient plus vite pour faire leurs courses ! ", s'amuse René
Trastour.
Monsieur le maire a le sens de la dérision ! Et d'ajouter : "Et
vous savez quoi ! Le bus, au retour, à 12h30, il est plein ! Il y a
vraiment peu de place pour loger les courses d'une semaine. Et une
fois à Bouyon... il faut ressortir les courses et les remettre dans
la navette pour Conségudes !!!
Non vraiment, ce n'est pas pratique du tout ! Mes administrés ne
sont plus tous jeunes. C'est difficile quand on est âgé ou fatigué
ou handicapé et encore pire quand on cumule les trois ! Une dame de
la commune a une prothèse à chaque genou. Vous imaginez que pour
elle, c'est très compliqué".
Un maire... chauffeur !
Alors, c'est tout logiquement pour lui que René Trastour se
transforme les vendredis matin en chauffeur ! "Cela fait des mois
que tous les vendredis matin j'accompagne à Lingostières ceux qui
n'ont pas ou plus de voiture, ou qui ne peuvent plus conduire, ou
qui ne se sentent plus de conduire, car la route est très sinueuse".
René Trastour : "Cela
fait des mois que tous les vendredis matin j'accompagne à
Lingostières, ceux qui n'ont pas ou plus de voiture."
"Ce sont souvent les mêmes personnes : des personnes âgées de 70
à 80 ans. Au dernier recensement, la commune compte 96 personnes à
l'année et l'été un peu plus de 150. Ce n'est pas rien tout de même
! Oui il y a de l'entraide au village. Oui, il y a possibilité de
covoiturage, mais ce n'est pas simple. Les actifs partent vers 6h30
et ne rentrent pas avant 19h. Un peu long pour faire des courses
pour les retraités ! Certains remontent des courses, aussi, pour
d'autres. Mais c'est difficile de toujours dépendre de quelqu'un.
Là, ça commence à bien faire ! " , s'insurge l'édile.
De la colère... au dépit
Interrogé sur son sentiment vis-à-vis de cette situation, le maire
avoue tout d'abord "être en colère". Puis il se reprend :
"non, je suis dépité, car je sens que notre village est abandonné.
Les gens du village ne cessent de m'interroger sur la question du
bus. Ce que je comprends tout à fait. Comme eux comprennent bien
aussi que je ne peux rien faire et que les instances supérieures ne
veulent pas se mobiliser. Si c'était moi, il y a longtemps que ce
serait fait ".
Déjà sollicité pour un éventuel troisième mandat, René Trastour
avoue qu'il n'a plus trop la foi. "Ça devient trop compliqué
quand on est un petit village perdu dans la montagne. Pour tout ce
qui est routes et transports, nous sommes les oubliés de la
République".
René Trastour, maire de Conségudes : "De
but en blanc, on enlève la ligne de bus. Ils vont faire mourir le
village. C'était la seule commodité qu'on avait."
René Trastour, le maire de Conségudes se mobilise pour rétablir
l'unique liaison hebdomadaire de bus.
Conségudes ou la mort annoncée d'un village ?

Il en a gros sur le cœur le maire de ce petit village du haut
des Alpes-Maritimes. Et il n'a de cesse d'énumérer toutes les
démarches qu'il fait pour sauver son village et qui n'aboutissent
jamais : "j'ai parlé de ce dossier à Charles Ange Ginésy, le
président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et président
de la communauté de communes Alpes d'Azur, mais il m'a dit que ce
n'était pas de son ressort, que c'était la Région. Je comprends
bien, le Conseil départemental ne peut pas se substituer à la
Région. Alors, j'ai contacté des conseillers régionaux, que je
connaissais, mais rien. Aucune réaction. J'ai essayé de contacter
Renaud Muselier, le président du Conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais je n'ai jamais réussi à lui parler
au téléphone. Sachant les dépenses royales qui se font parfois et
qui sont bien moins importantes que la mort annoncée d'un village,
comment vous dire… "
Et de conclure, d'un ton grave : "2026, c'est dans pas très
longtemps. Si je m'arrête, qui va emmener les gens du village faire
leurs courses ? "
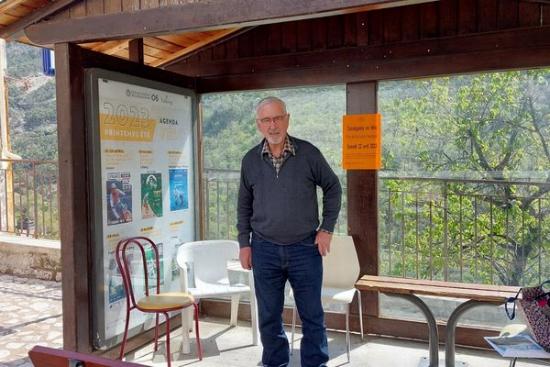
L'Abribus de la colère : depuis le 2 septembre 2022, aucun bus ne
dessert l' Abribus de Conségudes !
Une bouteille à la mer
Le maire demande donc - par voie de presse, car il ne sait plus
comment faire - à la Région PACA le rétablissement de cette ligne.
Il demande également, à la communauté d'agglomération de
Sophia-Antipolis, cette fois-ci, la création d'une nouvelle ligne
entre Conségudes et Carros.
Démunis, dépité, se sentant abandonné de tous, René Trastour garde
néanmoins toujours un certain sens de l'humour :"si la Région nous
remet le bus" conclut-il, "je vais jusqu'à Marseille, avec mon
auto, pour faire la bise à Monsieur Muselier ". Parole de
montagnard !


Pont pédestre, amphithéâtre, navettes... Voici
à quoi pourrait ressembler le port de Nice pendant (et après) le
Sommet des océans
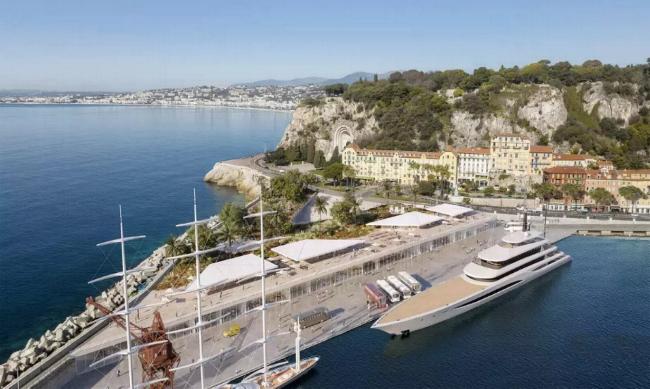
Grâce à un premier appel d’offres, on en sait plus sur le
réaménagement du port pour, en juin 2025, la Conférence des Nations
Unies sur les océans et, à terme, le nouveau palais des congrès.
On savait le calendrier contraint. Pour accueillir, en juin 2025, la
Conférence des Nations Unies sur les océans, la Ville de Nice veut
réaménager le port en un temps record. Et en profiter, au passage,
pour se doter d’un nouveau pôle dédié aux congrès.
Pas question de se contenter de structures éphémères: la salle
plénière du One Ocean Summit a vocation à devenir un "palais
Acropolis bis".
Christian Estrosi l’a annoncé, à la surprise générale, il y a tout
juste trois semaines. Et, déjà, un premier marché public vient
d’être lancé par la municipalité, comme l’a repéré L’Echo du
Mercantour.
Il s’agit, pour l’heure, de désigner l’assistant à maîtrise
d’ouvrage (AMO) privé qui va aider la collectivité publique à mener
à bien le projet.
L’appel à candidature a été publié ce samedi sur les plateformes
spécialisées. Les entreprises intéressées n’ont qu’un mois pour se
positionner. Sur la base d’un cahier des charges qui, du coup,
dévoile la transformation qui va s’opérer sur le bassin Lympia.
35 millions d’euros
La première information – de taille – que contient cet appel
d’offres, c’est le coût de l’opération. Le cahier des charges de
l’AMO précise que "le budget global affecté à l’accueil de cette
manifestation s’établit, de façon prévisionnelle, à environ 35
millions d’euros..."
Le maire de Nice avait toutefois promis que les contribuables locaux
n’auraient à en supporter qu’une part marginale, la facture devant
être réglée par un groupement d’intérêt public (GIP) réunissant
l’ONU, la France et le Costa Rica, au-delà de la Ville de Nice et de
la Métropole.
Ce que confirme l’AMO: ces 35 millions seront "répartis en
cofinancement entre les acteurs du projet ". Même si le document
ne précise pas la part qui incombe à chacun.
Un pont au milieu du port ?
En revanche, il détaille les équipements nécessaires à la tenue de
cette conférence internationale. On apprend ainsi qu’il est envisagé
de bâtir un pont pédestre pour relier les deux rives du bassin
Lympia.
À défaut, des navettes devront être mises en place. Car la
conférence, qui doit accueillir plus de 20 000 participants et 200
chefs d’État ou de gouvernement, aura deux centres névralgiques.
Le premier se situera quai du Commerce. C’est là que se situeront
les principaux espaces dédiés au sommet: une zone d’accueil de
375m2, trois modules d’exhibition d’un ou deux étages totalisant une
surface de 8 500m2, 9 000m2 supplémentaires pour l’espace
innovation, un restaurant de 600m2 ainsi qu’un espace presse de
800m2, le tout agrémenté d’une promenade sur les quais.
Un amphithéâtre de 2 400 places assises
Si ce premier secteur est placé sous la gouvernance du GIP, la Ville
de Nice gardera la maîtrise de l’aménagement du quai Infernet, de
l’autre côté du port. C’est là que situera l’espace VIP de 1 000m2,
trois modules d’échanges internationaux de 500m2, mais surtout la
salle plénière de 4 500 à 5 000m2 qui a vocation à perdurer.
"Les structures prévues sur ce quai ont vocation à être
maintenues sur le moyen terme afin de recevoir des événements de
type séminaires et congrès", confirme le cahier des charges qui
précise que "cette notion de pérennisation des structures est à
prendre en compte dans les réflexions conduites et, à ce titre
notamment, la plus grande attention sera à apporter."
Le maire de Nice avait promis "une salle Apollon ++".
L’assistance à maîtrise d’ouvrage en définit les contours: "Un
amphithéâtre de 2 400 places assises, y compris les espaces
techniques, complété par des salles d’accueil connexes de capacité
totale de 2 000 personnes, ainsi qu’un espace VIP."
Telle est en tout cas l’ambition du projet. Car il appartiendra au
prestataire désigné dans le cadre de cet appel d’offres d’en évaluer
la faisabilité technique et juridique.
Il est d’ailleurs d’ores et déjà prévu que certains aménagements non
indispensables au One Ocean Summit puissent n’être livrés que dans
un deuxième temps.


La Corniche d’Or, cette route entre Saint Raphaël et Cannes à
travers l'Estérel, fête ses 120 ans

Après cinq années d’études et de travaux, la route de la corniche
d'or, qui relie par le bord de mer Saint-Raphaël à Cannes, est
inaugurée le 11 avril 1903
Le 11 avril 1903 était inaugurée la route de la Corniche d'or qui
relie Saint-Raphaël à Cannes. Ce mardi 11 avril 2023 seront célébrés
les 120 ans de cette voie sculptée entre le porphyre rouge de
l’Estérel et bordée par la grande bleue ! Menu des festivités et
retour sur cette aventure.
La route de la Corniche d’or, avec sa vingtaine de kilomètre de
littoral, représente un attrait touristique incontestable de la Côte
d'Azur.
Côté terre, elle offre différentes portes d’entrées au massif de
l’Esterel. Côté mer, ses 11 kilomètres de sentier du littoral
desservent les ports pittoresques du Poussaï et d’Agay.

La route de la corniche d'or a été sculptée de 1898 à 1903 entre
le porphyre rouge de l’Estérel et la grande bleue.
Enfin, ses ouvrages d’Art tels que sa route, ses ponts, le viaduc à
Anthéor, ou le phare d’Agay, constituent un véritable patrimoine
d'ouvrages d'art mis en lumière il y a 120 ans par la réalisation de
cette route.

Le Touring Club de France à son origine
À l’origine, au même emplacement, plus ou moins, de l'actuelle
corniche, se trouvait le fameux chemin vicinal numéro 7. Il partait
de la commune de Saint-Raphaël et se faufilait entre l’Estérel et la
mer jusqu’à Théoule-sur-Mer.
Au printemps 1897, Abel Baliff, le premier président du Touring club
de France demande à l'école des Ponts et chausées de Draguignan dans
le Var l'étude d'un projet pour réaliser un chemin d’un mètre de
large qui relierait Saint-Raphaël à Cannes.
Le maire de l’époque, Léon Basso, prend connaissance du projet.
Visionnaire, il le rejette.
Selon, Jean-Luc Guillet, rédacteur employé de la mairie de
Saint-Raphaël, Léon Basso aurait rétorqué : "Mais non, ce n’est
pas ce qu’il faut faire ! Moi, je veux une route d’au moins cinq
mètres de large minimum ! Parce que, quand cette voie sera ouverte,
cela attirera un grand nombre de touristes et facilitera le tourisme
dans l'Estérel. Si nous ouvrons une vraie route, maintenant, nous
n’aurons plus besoin d’y revenir ".
Léon Basso, maire de Saint-Raphaël fin XIXe :
"Moi, je veux une route d’au moins cinq mètres de large minimum !
Cela facilitera le tourisme dans l'Estérel."
Son but : l’accès à l'Estérel
Dès les années 1890, le massif de l'Estérel est, relativement bien,
aménagé en pistes. Les vélos peuvent y rouler, les calèches
également et le chemin est pourvu de panneaux indicateurs pour
éviter aux promeneurs de s'y perdre.
Abel Baliff est un amoureux et un habitué de l'Estérel. Il y
pratique le vélo avec les membres de son club parisien. D’où cette
idée d’aménager ce chemin cyclable et carrossable qui permettrait
aux sportifs et aux touristes de pénétrer dans le massif de
l'Estérel.
Pas bête, mais pas assez large pour le maire de l'époque !
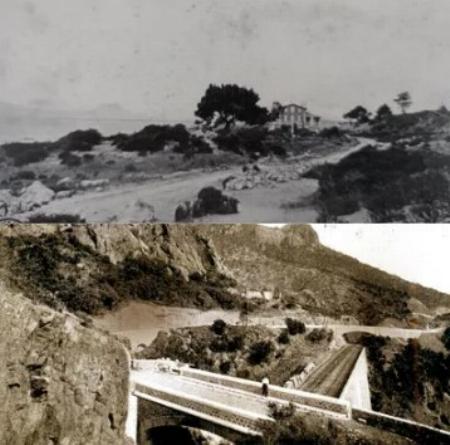
Photo du haut : avant la création de la corniche d'or, le chemin
vicinal 7 à Santa Lucia.
Photo du bas : 1903, les ponts après construction à Anthéor
Un projet pharaonique de 500 000 Francs anciens
"Les Ponts et Chaussées" travaillent d'arrache-pied sur ce projet
colossal. La route est à inventer, à construire. La roche rouge est
à percer. Des tunnels et des ponts sont à réaliser.
Coût du projet : 500 000 Francs anciens (2 134 477 d'euros).
Un appel à la souscription
Devant cette somme, gigantesque pour l’époque, Abel Ballif propose
son aide au maire de Saint-Raphaël. Il lui propose de trouver les
financements et de s'occuper de tout le côté administratif du
dossier. À savoir, les relations avec les administrations telles que
la compagnie du PLM, puisque le tracé est parallèle à la voie
ferrée, les Eaux et Forets, le Ministère de l’agriculture.
Ce qui fût dit, fût fait. Abel Ballif organise pour le financement
un appel à la souscription auprès des membres de son club et, mais
aussi des particuliers. Au début du XXe siècle, pratiquement tous
les propriétaires de villa Belle-époque vont apporter, qui de
l’argent sonnant trébuchant, qui des parcelles de terrain pour
faciliter le tracé.
C’est ainsi qu’à partir de 1898 les travaux sont engagés. 150
ouvriers d’origine italienne construisent ponts, murs de soutènement
et parapets.
En hommage à cet homme, les mots suivants ont été gravés dans le roc
: "A Abel Ballif, 1er Pdt du Touring Club pour son rêve de Corniche
d’Or". Une plage porte également son nom du côté du Trayas.
5 ans d’études et de travaux
Ce qui est intéressant, à ce début du XXe siècle, c’est qu’il se
passe exactement la même chose du côté de Mandelieu. Le maire de
l’époque réfléchit à un tracé qui irait de Mandelieu au Trayas, le
dernier quartier de Saint-Raphaël. Tout se met donc, en place, en
même temps.
Cette partie de la réalisation de la route engendre des travaux
titanesques qui vont percer la roche d’Anthéor, du Trayas et de
Théoule-sur-Mer pour offrir une voie enfin carrossable aux
hippomobiles, aux cycles et à l’automobile naissante.
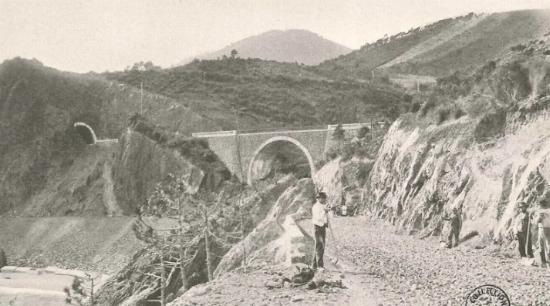
Ouverture de la tranchée près du pont Notre-Dame.
Inauguration le 11 avril 1903
Le 11 avril 1903, après cinq années d’études et de travaux, la route
est inaugurée en grande pompe. Le ministre des travaux public, suivi
d'une escorte parisienne d’une centaine d’invités, de personnalités
éminentes telles que le Grand Duc Michel de Russie, qui habitait
Cannes sont présents. Plus de 200 véhicules sont mobilisés et mis à
disposition par les différents clubs automobile de l’époque. Des
centaines et des centaines de cyclistes, d’hippomobiles, de curieux
et de locaux sont présents.
Tout ce petit monde part en procession jusqu’à cannes avec un arrêt
au Trayas pour inaugurer la plaque souvenir.

Dès le 11 avril 1903 les premiers automobilistes empreintes la
route de la corniche d'or. Vue du Trayas.
Un long chemin de 1903 à 2006
Un an seulement après sa création, en 1904, la route est intégrée à
la route nationale 7. Trente ans après, la circulation étant devenue
trop importante, la nationale 7 reprend son itinéraire initial.
En 2006, la route de la corniche intègre la Nationale 98, pour être
ensuite déclassée en départementale.

La route de la corniche d’or, avec sa vingtaine de kilomètre de
littoral, représente un attrait touristique incontestable de la
Côte-d'Azur.
La corniche d'or fait son cinéma
De nombreux films ont eu la corniche d'or comme décor : Le Corniaud,
Le Clan des Siciliens, L'Arnacœur.
Des séries comme "Extrême Limite", des spots pub, ou bien la
chanteuse Angèle a tourné son clip de la “Thune” autour du Rocher St
Barthelemy.
Récemment, la Corniche d'or a servi de lieu de tournage dans le
feuilleton “Comme mon fils” avec Tomer Sisley.
120 ans : ça se fête !
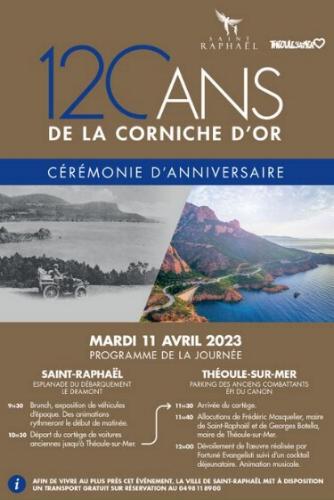
Pour cet anniversaire, les Villes de Saint-Raphaël et de
Théoule-sur-Mer proposent une journée d'animations et de festivités
le 11 avril :
9h30 : Rendez-vous sur l’esplanade du Débarquement au Dramont où un
brunch et des animations avec une ambiance d'époque seront proposés
avant le départ d’un cortège vers Théoule-sur-Mer.
10h30 : Départ d’un cortège en direction de Théoule-sur-Mer. Une
vingtaine de voitures de collection, de l'Automobile Club de Cannes,
sillonnera la route de la corniche pour rejoindre l’esplanade du
bord de mer à Théoule-sur-Mer. Des navettes gratuites sont prévues
par la ville au départ du parking du Débarquement, sur réservation
au 04 98 11 89 00. Attention, il semblerait que les bus sont déjà
complets à ce jour ! Pour la petite histoire, lors de l’inauguration
de 1903, elles étaient deux cents !
11h30 : Arrivée à l’esplanade de la Rose des Vents à Théoule-sur-Mer
où une exposition retraçant l’histoire de la corniche d’or, en dix
panneaux, sera proposée au public. Elle sera à nouveau installée au
Centre Culturel de Saint-Raphaël, début juin.
Vous pourrez repenser à cette épopée sculptée dans le porphyre et
l’azur en flânant sur la route.


Cinquantenaire de la mort de Picasso : en
images, le parcours du peintre sur la Côte d'Azur
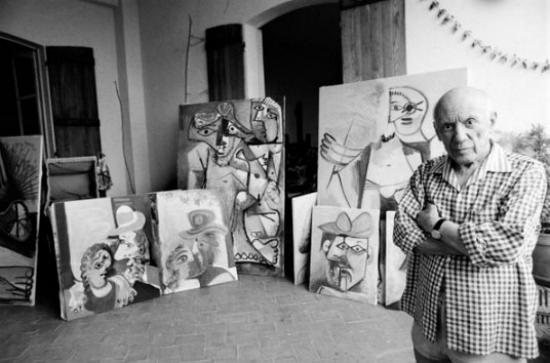
Le 13 octobre 1971, Picasso est photographié par
Raph Gatti à sa maison de Mougins, là où il peignait. • © RALPH
GATTI / AFP
L'un des plus grands artistes du XXe siècle a achevé sa vie sur la
Côte d'Azur, à Mougins, le 8 avril 1973. De son œuvre, il reste des
couleurs, des lieux et des esquisses qui ont façonné l'héritage de
l'Espagnol. Picasso s'est installé sur la Côte d'Azur en 1946. Ce
seront 27 années d'intense création.
Il est des destins qui croisent des territoires, qui s'en
imprègnent. On connait la période rose de Picasso, la bleue, il y
eut aussi celle couleur azur. Loin de son Espagne natale, et de
Malaga qui l'a vu naitre, le maitre du Cubisme a trouvé sur le
littoral azuréen une source d'inspiration et de nombreux lieux de
villégiature. À Antibes, Vallauris ou Golfe-Juan et Juan-les-Pins,
les traces de son passage demeurent indélébiles, 50 ans après sa
mort.
En images, le parcours du génie dans la région.
Là où tout a commencé
Ce prodigieux inventeur de formes, qui a réalisé plus de 60.000
œuvres, est né le 25 octobre 1881 à Malaga, dans le sud de
l'Espagne. Il aurait adopté le nom d'origine italienne de sa mère.
Entré aux Beaux-arts de Barcelone où son père enseignait, puis passé
à ceux de Madrid, sa prodigieuse virtuosité ne passe pas inaperçue.
Picasso passe ses premières vacances sur la Côte d’azur en 1919. Il
séjourne alors à Saint-Raphaël et Juan-les-Pins. Son travail tourne
alors autour de natures mortes cubistes. En 1923, il revient à
Antibes et peint "Flûte de pan".
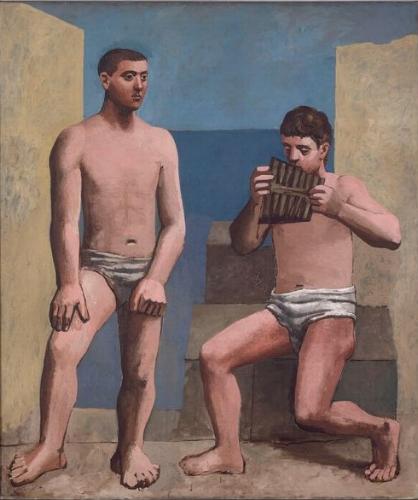
Antibes
Il revient 10 ans plus tard dans la cité des Remparts. Picasso y
reste toute une année. Il s’installe pour un an au Château Grimaldi,
qui deviendra son musée dédié, inauguré de son vivant.
En 1946, Picasso crée avec un grand bonheur dans cette ville devant
la mer.
Le lieu est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1928.
En juin 1947, le conservateur du musée d'Antibes, Romuald Dor de la
Souchère, commande une œuvre à Pablo Picasso pour la salle d’honneur
du Château. Il crée Ulysse et les sirènes en trois jours.

Vallauris - Golfe Juan
Picasso découvre en 1936 celle que l’on appelle aussi la "Cité
aux cent potiers". Il s’y installe de 1948 à 1955 et commence à
modeler la terre en 1946. Notamment dans l'atelier de céramique
Madoura. Une fructueuse collaboration qui donnera naissance à près
de 3 600 céramiques.
Au mois d’août 1946, Picasso réside à Golfe-Juan. C'est sur cette
commune qu'il dessine des scènes mythologiques, des faunes, des
centaures ou encore des nymphes.

Céramiques et linogravures témoignent de son génie tel que le
rappelle le Musée Magnelli-Musée de la Céramique de la ville. En
1959, il peint La Guerre et la Paix dans la chapelle romane du
château. La ville lui doit aussi la statue L’Homme au mouton que
l’on peut voir Place du marché.
En 1952, à Vallauris, Picasso réalise une peinture - La Guerre et la
Paix - de très grandes dimensions. Cette œuvre conserve une
dimension indéniablement allégorique.
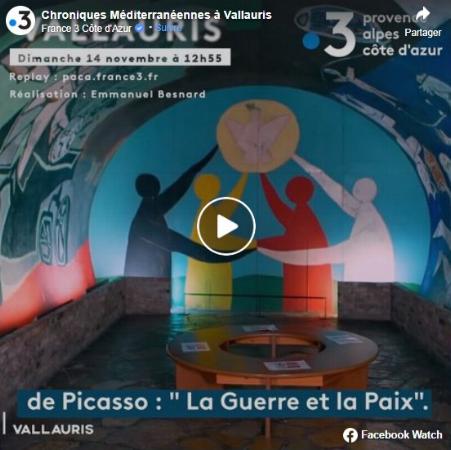
L'œuvre de Picasso est installée dans la chapelle du château de
Vallauris en 1959.
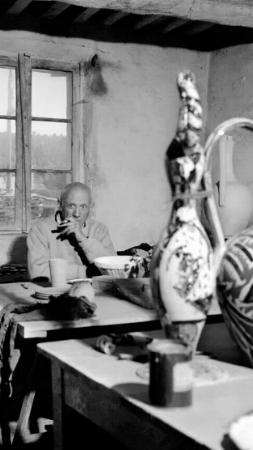
Pablo Picasso posant avec ses poteries en 1949, réalisées dans
l'atelier Madoura de Vallauris.
Pablo Picasso posant avec ses poteries en 1949, réalisées dans
l'atelier Madoura de Vallauris. • © AFP
De son très long séjour sur les rives de la côte, il reste des
images, des photos ou encore des films. Par son travail, l'artiste
célèbre la Méditerranée jusqu'à sa mort en 1973 à Mougins.
Mougins, dernier sanctuaire
Tout au long de l'hiver de ses 90 ans, c'est dans sa villa de
Mougins "Notre Dame de Vie" qu'il se préserve du monde.

Jacotte Capron est la femme de Roger Capron, l'un des plus célèbres
céramistes de Vallauris.
Elle-même artiste, elle a beaucoup côtoyé
Pablo Picasso dans les années 50.
Rencontre filmée en aout 2018

Dans sa retraite volontaire, entouré des siens, de quelques amis, de
ses pinceaux et de ses crayons, il s'était préservé du rythme
agressif de cette fin de siècle.

Le Mas Notre-Dame-de-Vie est la dernière résidence du peintre, il y
est mort en 1973, à Mougins. • © VALERY HACHE / AFP
Durant sa dernière décennie de vie, il va dessiner et peindre à un
rythme échevelé.
50 ans après sa mort, "La Célestine", "Dora Maar au chat", "Le
garçon à la pipe", "Les noces de Pierrette", "Maya à la poupée", "Nu
au plateau de sculpteur", "Le vieux Guitariste aveugle", et tant
d'autres toiles restent au firmament de la peinture mondiale.
Il existe pas moins de sept musées en Europe qui portent son nom
Paris, Antibes, Vallauris, Barcelone, deux à Malaga, un à Münster en
Allemagne.


Le chantier d'Iconic entre dans sa dernière ligne
droite à Nice, on a demandé aux riverains ce qu'ils en pensaient

Iconic, le diamant de verre, doit être livré à la
fin de l'été à Nice
Les 20.000 m2 sur six niveaux avancent, bardés de vitrages et
d’aluminium brossé de couleur bleue. Futuriste, énorme, la maison de
verre proche de la gare est aussi clivante.
Réactions
Plus clivant que le bâtiment Iconic, il n’y a pas, actuellement, à
Nice et ses environs.
Normalement livrée à la fin de l’été, la maison de verre trônant
entre la gare Thiers et l’avenue Jean-Médecin, est en train de
prendre son vrai visage. Énorme. Futuriste. La construction pensée
par l’architecte Daniel Libeskind fait parler.
Pas seulement à cause du retard de deux ans accumulé par le
chantier. Pas seulement à cause des perquisitions opérées au sein de
locaux de la Métropole Nice Côte d’Azur et municipaux dans le cadre
d’une information judiciaire et à la suite d’une enquête sur les
conditions de passation de plusieurs marchés, dont celui d’Iconic.
En effet, d’un point de vue esthétique, ce complexe destiné à
abriter un hôtel Hilton "4-étoiles plus", des restaurants, des
enseignes en vue, des bureaux, une salle de spectacle, et dont la
vocation est de commercialiser le haut de l’avenue Jean-Médecin, ne
suscite pas l’unanimité.
On le savait avant même que ce diamant pointe ses angles vers le
ciel. À quelques mois de la livraison globale et finale, cela se
confirme…
"C’est un parking ?"
"Je viens voir ça… C’est pas possible, scande Michel Isidore,
commerçant niçois à la retraite.
"Un
hôtel Hilton ici ? Non. Moi, touriste, je n’y vais pas. Non, ça ne
me plaît pas. C’est trop volumineux. Oui, c’est novateur, mais il
fallait construire cela dans un autre quartier, plus récent."

Michel Isidore. Photo Ch. R.
Starbucks et Uniqlo ?
Des commerçants refusent de nous donner leur sentiment. D’autres
sont plus diserts et leurs remarques ne manquent pas de pertinence,
comme dans l’établissement de téléphonie que David Brin tient sur
Jean-Médecin, juste en face la façade en losange la plus
extravagante de l’édifice: "Cinquante fois par jour, les gens
s’exclament : ‘‘Oh ! C’est un parking ? ’’ Iconic est clivant
par rapport au reste de la ville, mais il faut bien un changement à
un moment. Après, fallait-il l’envisager avec du style ancien, mais
faux, ou du vrai moderne qui divise ? On verra vraiment ce que ça
donne à la fin de la construction, mais ça peut attirer la clientèle
dans le quartier."

David Brin. Photo Ch. R.
D’autant que des noms d’enseignes populaires fuitent. En effet, un
Starbucks Café et un Monoprix pourraient s’installer derrière les
panneaux vitrés, ainsi que la célèbre marque japonaise de
prêt-à-porter "Uniqlo, sur trois étages", lâche un riverain
se disant dans la confidence de certains ouvriers du chantier
Iconic.
Attraction et repoussoir
Déjà, des touristes asiatiques et rieurs mitraillent à coups de
smartphone l’ouvrage aux mille reflets, star de selfies. Eux
semblent apprécier le phénomène qui redessine l’urbanisme pluriel du
secteur. Une opinion que ne partage pas forcément Kevin, chef de
secteur chez Maxi Bazar: "Au-delà du retard pris par le chantier,
du bruit, de la poussière, de l’inconfort des travaux, en tant que
citoyen, je pense que ça fait tache."
À l’hôtel de Berne, au début de l’avenue Thiers, Victoria, manager,
est le relais d’une clientèle qu’elle dit plutôt maussade: "Pour
le moment, que des mauvais commentaires à cause des nuisances du
chantier. Après, je ne trouve pas la structure choquante. Elle peut
nous apporter le reflet du soleil."
Côté ambiance, Victoria "espère un engouement pour le quartier
". Sur le pas de la porte du restaurant Mi-Am, on n’y croit pas,
à l’attraction. Jacob, le gérant, ne mâche pas ses mots: "C’est
plus propre, plus assaini, car ce coin était pourri, mais c’est
horrible à tout point de vue. Il aurait fallu faire quelque chose
dans l’esprit de la gare Thiers qui est un monument magnifique. Je
n’ai jamais vu un truc aussi moche. Ce n’est pas avec ça qu’on va
faire de la pub au quartier."
À côté de lui, son adjoint abonde: "Un hôtel Hilton dans un
quartier populaire, ça ne va pas. On avait une belle esplanade
devant la gare avec de la verdure, ça va tout tuer…"
Des passants, de tous âges, s’arrêtent, regardent, parlent à voix
haute. Si les plus jeunes ne kiffent pas les rotondes, les moulures
Belle Époque environnantes et approuvent au contraire le modernisme
du diamant déstructuré, les plus vieux, pour la plupart, n’adhèrent
pas au monument à facettes: "Écrasant… Mastoc… Mégalo…"
Le côté pratique n’est pas oublié: "ça va coûter une fortune en
entretien, toutes ces façades de verre…"
Du temps pour intégrer la nouvelle vision
Iconic fait jaser. C’est comme ça. Et c’est presque normal,
notamment dans un fief niçois où les vieilles constructions ont le
dessus. La gare centrale Thiers en est le splendide exemple. Et
c’est elle qui cohabite au plus près avec cette géométrie
excentrique à reflets bleutés.
Iconic n’a pas l’exclusivité de la contre-publicité. Jadis, en leur
temps, les triangles concaves de Marina-Baie-des-Anges, à
Villeneuve-Loubet, Beaubourg ou la Pyramide du Louvre, à Paris,
firent également couler beaucoup d’encre et peut-être même de
larmes. Que de critiques négatives s’abattirent alors sur ces
réalisations, osées pour l’époque et les mentalités.
Imaginons qu’on les détruise aujourd’hui. Impensable ! Tous les
repères urbanistiques s’effondreraient et, à coup sûr, on
assisterait à une levée de boucliers.
Il a fallu apprivoiser ces nouvelles visions, les intégrer, les
digérer, mais c’est désormais chose faite et les constructions,
jugées rocambolesques voilà quelques décennies, font à présent
partie du paysage où elles sont implantées. Il en sera probablement
de même avec Iconic.
.


Le nouveau tunnel de Tende devrait être percé
mi-mai

Dans le nouveau tube du tunnel de Tende, il ne reste plus que 240
mètres à creuser. • © Anas
Selon l'Anas, la société qui gère le réseau routier italien, il
reste "environ 240 mètres" du nouveau tunnel à creuser. Dans
la vallée de la Roya, les habitants commencent à trouver le temps
long et attendent impatiemment le retour des visiteurs étrangers.
"Le creusement du nouveau tube du tunnel de Tende progresse."
L'Anas, la société qui gère les routes nationales italiennes, se
veut rassurante sur ce chantier qui dure depuis maintenant huit ans.

Dans le nouveau tube du tunnel de Tende, les travaux d'étanchéité
avancent. • © Anas
"L'étanchéité, le revêtement en béton et la construction du
radier progressent également ", poursuit l'Anas, contactée par
France 3 Côte d'Azur. "Ainsi que le creusement des 13 'by-pass'",
ces accès de secours qui permettront des liaisons (piétons et
véhicules) entre les deux tubes.

L'un des 13 "bypass" qui permettront des connexions entre les 2
tunnels pour les piétons et les véhicules de secours • © Loïc Blache
FTV
Selon l'avancée mesurée la semaine dernière, 1 844 mètres ont été
creusés du côté italien, 1 136 mètres du côté français.
Anas : "Au total, environ 240 mètres du nouveau tunnel
restent à creuser."
Quant au tunnel historique, "des consolidations sont en cours
afin de permettre son agrandissement et de l'amener aux dimensions
du nouveau tube".

Les travaux du percement du nouveau tunnel par les Italiens, en
août 2020. • © Loïc BLACHE/FTV
En parallèle de ces avancées, les travaux pour construire le viaduc
côté français qui remplacera la route détruite par la tempête Alex
ont commencé "en décembre 2022".
L'Italie à moitié prix
Dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), les habitants
commencent à trouver le temps long. Car, au-delà du retard
occasionné par une affaire politico-judiciaire il y a quelques
années, depuis le passage de la tempête Alex une nuit d'octobre
2020, il n'est plus possible de relier directement par la route le
Piémont voisin.

La route des 46 lacets, qui mène de Tende au Col de Tende. C'est
le seul chemin pour relier la France et l'Italie depuis que la
tempête Alex a emporté la route qui mène au tunnel de Tende. La
circulation y est très réglementée. • © Loïc BLACHE/FTV
Seule la route des 46 lacets peut être ouverte aux beaux jours,
moyennant une circulation très réglementée.
Un chamboulement pour toute une vallée, tant dans son quotidien que
dans son économie.
Pour certains habitants et professionnels de la Roya, aller chez le
voisin italien avait certains avantages.
Jean-Louis Molinaro, propriétaire d'un camping : "Pour réparer
nos machines agricoles (tracteurs, tronçonneuses...), nous allions à
Cuneo car, là-bas, la mécanique, c'est moitié moins cher !"
"Aujourd'hui, pour y aller, on met 3h30, en passant par
Vintimille, Imperia et le col de Nava", poursuit Jean-Louis
Molinaro, le propriétaire depuis 12 ans du camping Le Pra Réound à
La Brigue.
Julia Bonnet, elle, allait en Italie chercher du foin pour sa
cinquantaine de chevaux. La responsable des Randonneurs du
Mercantour a donc dû démarcher "d'autres fournisseurs".
Julia Bonnet, propriétaire de chevaux : "On a réussi à trouver du
foin de meilleure qualité et à un coût avantageux dans les
Alpes-de-Haute-Provence."
Mais, "pour les céréales, je préfère les prendre dans le Piémont
car elles sont produites localement et, même s'il faut faire un long
détour, le coût reste moins élevé qu'en France".
Seul accès par le train
Pour les courses et les démarches du quotidien, il reste le train.
Mais les grèves de ces dernières semaines en France ont perturbé ce
moyen de transport. Exemple avec les collégiens de
Saint-Dalmas-de-Tende, qui devaient skier cet hiver à Limone trois
jours par semaine.

Sur les pistes de ski de la station de Limone Piemonte (Italie),
en décembre 2021. • © Loïc BLACHE/FTV
Malo Cherrin, professeur d'EPS : "On a annulé 4 semaines sur les
10 prévues. Alors on a pris la décision d'aller à Auron, mais cela
faisait 3h de route aller et 3h retour, alors que la station de ski
de Limone est à 15-20 minutes du collège ! "
Résultat, seuls les 32 collégiens de la "section ski " ont pu
s'y rendre 3 mercredis de suite. "La route, ça les fatigue,
certains ne sont pas venus à toutes les séances", poursuit Malo
Cherrin, leur professeur de sport. "Même pour moi, car je me
levais à 5 h 30 et rentrait chez moi à 21 h 30 !"
Où sont les touristes étrangers ?
Et puis, il y a le tourisme. "Il nous manque la clientèle suisse
et allemande, qui venait en juin et septembre, hors saison.
Aujourd'hui, ils passent ailleurs et s'arrêtent... ailleurs",
regrette le Brigasque Jean-Louis Molinaro.
Ce que confirme l'office du tourisme de Tende. "Les touristes
d'Europe du Nord qui aiment les randonnées et les parcs nationaux ne
peuvent plus venir chez nous", complète Carole Tosello.
C'est une perte incommensurable pour nous. Sans compter les Italiens
qui ont des résidences secondaires ici. Certains viennent avec le
train, mais ils sont moins nombreux.
Carole Tosello, référente office de tourisme à Tende : "Aujourd'hui,
l'office du tourisme dénombre entre 16 et 18 000 visiteurs par an ;
ils étaient entre 18 et 24.000 avant la crise sanitaire et la
tempête Alex."
C'est peu dire que la fin des travaux du tunnel et du viaduc est
grandement attendue. Selon l'Anas, le nouveau tube du tunnel de
Tende devrait rouvrir à la circulation "d'ici octobre 2023 ".
Le viaduc au nord de Tende devra donc être, lui aussi, terminé pour
cette date. Quant au tunnel historique, agrandi et remis aux normes,
il faudra attendre "juin 2025 ".
.


Où en est le tunnel raccordant la voie Mathis à
l'A8 à Nice
On fait le point sur le chantier
Le chantier de raccordement de la voie Mathis à l’autoroute A8, à
l’ouest de la ville, avance à grandes foulées pour une livraison en
deux phases: fin 2024 et 2e semestre 2026.

Le chantier du tunnel, à la sortie ouest de la voie Mathis, mardi
4 avril 2023.
D’en haut, on pourrait presque avoir l’impression que le chantier
n’avance pas. Eh bien non: le raccordement de la voie Mathis à
l’autoroute progresse et le calendrier sera tenu, assure la
municipalité.
Le tunnel, la première phase entamée en 2021 - celle qui changera
vraiment la vie des automobilistes - sera terminé à la fin de
l’année 2024.
La seconde phase sera achevée courant 2026: c’est le raccordement de
la sortie du tunnel à l’A8. Escota, le réseau gestionnaire de
l’Autoroute, poursuit actuellement ses études.
La priorité des Niçois
"Nous sommes absolument dans les délais depuis l’ouverture du
chantier", martèle Christian Estrosi.
Il faut dire que c’était un peu l’Arlésienne, alors que de manière
constante depuis dix ans, lors de toutes les enquêtes Ipsos, c’était
- avec la ligne 2 du tram - le chantier le plus attendu des Niçois.
Mais il avait fallu négocier avec la SNCF la cession d’une partie
des voies. Pas simple… et long.
"La SNCF devait déplacer les appareils qui régulent les
aiguillages, on avait pourtant proposé de financer la délocalisation",
se souvient le maire de Nice.
600 mètres de tunnel
Actuellement, c’est un tunnel de 600 mètres de long qui est en cours
de réalisation. Mais le projet global s’étale sur 1.200 mètres. "Le
tunnel débutera de la gare de Saint-Augustin pour remonter en
surface, boulevard du Mercantour, au niveau de La Poste",
explique Laure Erbisti, chef de projet "SOVM", comprendre: Sortie
Ouest Voie Mathis.

Le tunnel remontera à la surface sur le boulevard du Mercantour.
Photo Cyril Dodergny.
Le tunnel sera partiellement découvert. À terme, les voitures qui
sortent de la voie Mathis pourront l’emprunter. Les services de la
Ville ont fait des calculs. "Il va fluidifier le trafic. Il fera
gagner 9 minutes lors des heures de pointe sur le temps de parcours
entre la sortie Grinda et l’entrée de l’autoroute. Et cela va
améliorer aussi toute la circulation du port de Nice à l’autoroute
A8", annonce-t-il. Mais pas seulement.
13.000 véhicules de moins en surface chaque jour
"De quoi, aussi, enlever de la surface "95% de la circulation",
assure Christian Estrosi. Soit environ 13.000 véhicules par jour. "Le
niveau des nuisances sonores va considérablement baisser pour les
riverains des immeubles alentour ", se félicite-t-il.
"Le tunnel qui longera la route de Grenoble, entre l’avenue
Grinda et le boulevard du Mercantour, permettra également,
dit-il, une réduction de 6.500 tonnes de CO2 dans l’atmosphère".
Laure Erbisti précise: "Ce tunnel sera un tunnel à gabarit réduit."
Les poids lourds et les bus n’y seront pas autorisés. Ils auront, en
parallèle, ce qu’elle appelle "une voie de secours".
150 arbres, 10.000 arbustes
L’emprise du chantier, une fois terminée, sera "largement
végétalisée", se félicite Christian Estrosi. "Il y aura 2.500
m2 de sols perméables dans la zone du Grand Arénas. Nous allons
planter 150 arbres et 10 000 arbustes."
Ce mardi, environ 80 ouvriers étaient à l’œuvre sur le chantier. Au
lancement des travaux, ils ont pu être jusqu’à plus de 120.
L’ouvrage est entouré de parois moulées de 25 mètres environ. "On
avance par plot ", commente la spécialiste.
Au sol, les ferrailles sont installées; le béton sera coulé ensuite.
Les immenses silos à béton sont visibles un peu plus loin que
l’entrée du futur tunnel, face à l’immeuble Connexio. Ils alimentent
la totalité des travaux.

Une autre partie du chantier, avec les silos, en face de
Connexio. Photo Cyril Dodergny.
165 millions d’euros
Des travaux dont le coût, "après les surcoûts liés à
l’augmentation des matières premières et de l’énergie", indique
Christian Estrosi, atteint 165 millions d’euros.
La seconde phase du chantier livrée en 2026
La phase 2 sera le prolongement du tunnel en tranchée ouverte et
couverte avec une sortie permettant de rejoindre le boulevard du
Mercantour et une sortie conduisant directement sur la bretelle
d’entrée de l’autoroute A8. La Ville précise que "des discussions
sont en cours avec Escota et avec l’État pour intégrer la phase 2 de
l’ouvrage à la concession".
Dans cette hypothèse, Escota pourrait financer 100% du coût de cette
tranche "par adossement ".
Une première étude d’opportunité avait été rendue en mai 2019 et
démontrait la nécessité de réaliser cette partie-là du chantier. "Cette
opportunité doit être consolidée avec une nouvelle étude du réseau
d’autoroute, en cours de réalisation", précise la Ville.


C’est le plus grand chantier de la Côte d’Azur:
on fait le point sur le projet Joia à Nice

Le projet Joia Méridia se poursuit sans baisser de rythme. On fait
le point sur le plus grand chantier de la Côte d’Azur qui doit faire
décoller le nouveau quartier à l’ouest de Nice.
C’est le plus grand chantier de la Côte d’Azur. À l’ouest de Nice,
au cœur de l’Ecovallée, le projet Joia, dans le quartier Méridia,
doit devenir l’épicentre du "nouveau quartier " de la "nouvelle
ville", comme l’a décrit le maire Christian Estrosi.
Dans cette plaine du Var, le président de l’établissement public
d’aménagement Xavier Latour voit qu'"économie et écologie
cohabitent pour créer des conditions durables d’attractivité et
offrir une nouvelle centralité qui s’intègre parfaitement au reste
de la ville, notamment grâce aux transports en commun".
Sous la dizaine de grues qui ont poussé sur l’emprise de près de
trois hectares de la plaine du Var, ce sont 73.500m² de logements,
commerces, bureaux et services qui doivent constituer le centre de
gravité de la vie dans la technopole de l’ouest niçois.
Parkings terminés
Lancé il y a 18 mois, le chantier s’est d’abord focalisé sur un
sous-sol très proche de la nappe phréatique du Var qu’il a fallu
imperméabiliser. Un défi gigantesque qui a notamment nécessité la
pose de 700 pieux afin de s’assurer de la bonne stabilité des
immenses structures qui seront construites dessus. Après les travaux
de terrassement, l’heure est au gros œuvre sur l’emprise qui borde
l’avenue Simone-Veil.
Les niveaux de parking en sous-sol sont réalisés (1.150 places à
terme). Les premiers bâtiments commencent à sortir de terre,
notamment le lot M2 de l’architecte niçoise Anouck Matecki. Une
structure de 58 logements, à l’angle du cours de l’Université et de
la rue Emmanuelle-Grout, l’entrée sud de la future place Méridia.
Si ça s’active sur la zone sud, les superstructures de la zone nord
devraient commencer à pousser d’ici le mois de juin comme l’ont
appris nos confrères du Moniteur.
Livraison entre l'été 2024 et l'été 2025
Alors que la livraison avait été initialement annoncée en 2021,
lorsque le projet avait été dévoilé en 2018, elle est finalement
prévue entre l’été 2024 et l’été 2025. Le premier élément qui
devrait être finalisé sera la résidence étudiante de 170 chambres:
le Campus Joia.
Aucun changement n’a été apporté au projet mené par le groupement
Pitch promotion et Eiffage immobilier, dont la coordination
architecturale a été confiée à l’agence Lambert-Lenack.
Le budget atteint, lui, les 150 millions d’euros, dont "90% ont
bénéficié à des entreprises maralpines", indiquent les services
de la Ville.
Un projet hors norme en quelques chiffres
- 780: les appartements prévus, dont 20% de logements à vocation
sociale.
- 7: les équipes d’architectes et paysagistes, venant de France,
d’Italie et du Japon, qui ont imaginé les ensembles, coordonnées par
l’agence Lambert-Lenack.
- 300: le nombre de compagnons qui travailleront sur le site au plus
fort du chantier.
- 12: bâtiments construits au total, dont 2 immeubles de 17 étages.
- 80: le nombre d’entreprises qui évoluent ensemble sur l’immense
chantier.
- 150 millions: le budget en euros de Joia Méridia, déjà relevé de
20% par rapport aux prévisions de départ selon les informations de
Tribune Côte d’Azur.
- 36: depuis l’arrêt Méridia, sur la ligne 3 du tramway
métropolitain, il faut 36 minutes pour rejoindre le centre-ville
(d’après Lignes d’Azur). Et 15 minutes pour rejoindre le terminal 2
de l’aéroport Nice Côte d’Azur.
- 4000 m2: la superficie réservée à l’agriculture urbaine, dont
2.000 m2 de jardins cultivés parfois sur les toits des immeubles.
"Ici, on construit la ville nouvelle", avait lancé Christian
Estrosi lors de la pose de la première pierre du chantier Joia
Méridia, le 29 juin 2022. Ce nouveau quartier a été conçu pour être
le cœur et le phare de l’Ecovallée de la plaine du Var, un moteur
pour l’ouest de Nice.
Des places publiques
Pour faire battre le pouls de ce nouveau quartier, trois nouvelles
places publiques ont été imaginées pour structurer le tout. à
l’entrée est, sur l’avenue Simone-Veil, tournée vers la ligne 3 du
tramway, la place métropolitaine se veut "l’accroche du quartier
". On y retrouvera les immeubles les plus hauts. Au centre du
quartier, la place Méridia. "C’est la place Garibaldi version XXI
siècle", avait glissé le maire de Nice. Cerclée de bâtiments
plus bas, elle doit être bordée de commerces, restaurants et cafés
pour donner "la sensation d’une échelle plus conviviale",
indiquaient les promoteurs du projet. Au bout de ce cheminement, le
Patio. Un espace à la végétation qui veut rappeler le vallon obscur
de Nice-Nord, au cœur d’un immeuble-ilôt qui abritera un programme
de bien-être et de loisirs. Il est question d’une vague de surf
artificielle, une résidence étudiante et une maison médicale.
Des immeubles emblématiques
Pour situer Joia Méridia, deux immeubles à l’architecture
emblématique ont été sélectionnés sur concours. Le bâtiment signal
Hana ("fleur ", en japonais), dix-sept étages de baies
vitrées et de terrasses percées et ondulantes avec vue sur mer et
montagnes, imaginé par l’architecte nippon Sou Fujimoto sur le toit
duquel sera posée une piscine. Il fera face aux dix-sept niveaux du
Reva de Cino Zucchi. La première réalisation de l’architecte italien
en France accueillera un hôtel 4-étoiles Moxy (groupe Marriott)
surmontée d’une tour.
5 images pour saisir à quoi va vraiment ressembler le projet Joia
à Nice, le plus grand chantier de la Côte d’Azur

Sous la dizaine de grues qui ont poussé sur l’emprise de près de
trois hectares de la plaine du Var, ce sont 73.500m² de logements,
commerces, bureaux et services qui doivent constituer le centre de
gravité de la vie dans la technopole de l’ouest niçois.
Des places publiques
Pour faire battre le pouls de ce nouveau quartier, trois nouvelles
places publiques ont été imaginées pour structurer le tout.
A l’entrée est, sur l’avenue Simone-Veil, tournée vers la ligne 3 du
tramway, la place métropolitaine se veut "l’accroche du quartier
". On y retrouvera les immeubles les plus hauts.
Au centre du quartier, la place Méridia. "C’est la place
Garibaldi version XXI siècle", avait glissé le maire de Nice.
Cerclée de bâtiments plus bas, elle doit être bordée de commerces,
restaurants et cafés pour donner "la sensation d’une échelle plus
conviviale", indiquaient les promoteurs du projet.

La place Méridia
Au bout de ce cheminement, le Patio. Un espace à la végétation qui
veut rappeler le vallon obscur de Nice-Nord, au cœur d’un
immeuble-ilôt qui abritera un programme de bien-être et de loisirs.
Il est question d’une vague de surf artificielle, une résidence
étudiante et une maison médicale.

Le Patio
Des immeubles emblématiques
Pour situer Joia Méridia, deux immeubles à l’architecture
emblématique ont été sélectionnés sur concours.
Le bâtiment signal Hana ("fleur", en japonais), dix-sept
étages de baies vitrées et de terrasses percées et ondulantes avec
vue sur mer et montagnes, imaginé par l’architecte nippon Sou
Fujimoto sur le toit duquel sera posée une piscine.

L’immeuble Hana
Il fera face aux dix-sept niveaux du Reva de Cino Zucchi. La
première réalisation de l’architecte italien en France accueillera
un hôtel 4-étoiles Moxy (groupe Marriott) surmontée d’une tour.

L’immeuble Reva
Au rez-de-chaussée de ces deux réalisations: près de 300m2 de locaux
commerciaux et d’activités.


Alpes-Maritimes et Var, sur le podium des
départements les plus boisés de France

Les Alpes-Maritimes et le Var font partie des départements les plus
boisés de France, comme le révèle l'IGN dans un rapport publié en
octobre 2022 et mis en avant à l'occasion de la journée
internationale des forêts, mardi 21 mars. Diversité des groupes
d'arbre, volume de bois produit, taux de mortalité des arbres,
exploitation... Voici les derniers chiffres à propos de ces deux
départements et plus largement de la région.
Petite devinette : quel est le département de Provence-Alpes-Côte
d'Azur le plus boisé de France ? La réponse n'est pas aussi évidente
qu'elle n'y parait.
Derrière la Corse du Sud et ses 70 %, suivent les Alpes-Maritimes
(65 %) et le Var (64 %). C'est plus que la moyenne de la région (52
%) et plus de deux fois plus que la moyenne du pays (31 %), selon
les résultats récents de l'inventaire forestier réalisé par l'IGN
(l'Institut national de l'information géographique et forestière)
sur la période 2017-2021. "Des peuplements influencés par la
Méditerranée et les Alpes", selon Nathalie Derrière, chef du
département des résultats d'inventaire forestier à l'IGN.
Et la part forestière ne cesse d'augmenter dans les Alpes-Maritimes
et le Var depuis 1985 : +47 % (!) dans le premier département, +15 %
dans le second, où "le taux de boisement était déjà important",
d'après Nathalie Derrière, qui avance une explication principale. "Cela
correspond à l'abandon des terres, des alpages et des pâturages
abandonnés. Avec une pression moindre des moutons, le paysage se
referme et se recolonise par les forêts. La forêt a gagné du terrain
sur les terres agricoles."
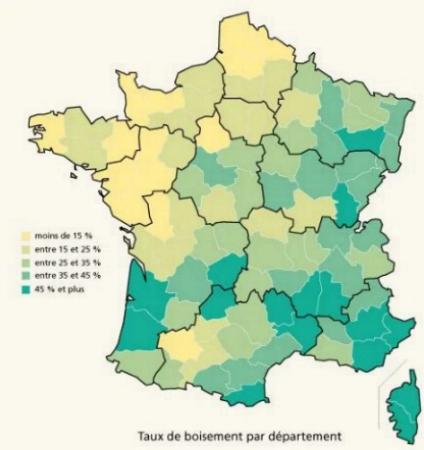
Le taux de boisement par département. Quatre départements ont un
taux de boisement supérieur à 60 % : les Alpes-de-Haute-Provence, le
Var, les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud.
Nathalie Derrière, chef du département des résultats d'inventaire
forestier à l'IGN :
"Le climat méditerranéen n'aide pas les arbres à croitre dans des
conditions favorables. Et la croissance est ralentie par le manque
d'eau."
Mais ces chiffres sont à tempérer si l'on regarde le volume de bois
produit. Avec 126 millions de m³ de bois produit, la région PACA est
seulement la 7e. Et a le plus faible volume à l'hectare : 89 m³ par
hectare, loin des 174 m³ par hectare en moyenne en France.
"En PACA, c'est même un peu moins dense qu'en Corse. Les arbres
sont petits en hauteur et en dimension de tiges et ne grandissent
pas vite. Le climat méditerranéen n'aide pas les arbres à croitre
dans des conditions favorables. Et la croissance est ralentie par le
manque d'eau", explique l'experte de l'IGN. Sans compter "des
sols pas forcément très profonds et riches qui ne permettent pas de
se développer autant que dans le nord-est par exemple". Mais
avec un taux de mortalité des arbres stable, quand les autres
régions françaises voient ce taux augmenter voire exploser, "la
région sort un peu du lot, c'est une bonne nouvelle", avance
Nathalie Derrière.
Logiquement, le climat qui règne dans la région engendre des
conséquences sur les différents groupes d'arbres présents. C'est la
seule région à avoir une part aussi importante d'arbres feuillus que
de résineux.
C'est la région la plus résineuse (49 % contre 26 % au niveau
national). Les Alpes-Maritimes et le Var illustrent bien ce point.
D'influence alpine, les Alpes-Maritimes abritent majoritairement des
pins sylvestre, assez loin devant le chêne pubescent et le mélèze,
cette espèce de conifère typique des montagnes qui perd ses
aiguilles en hiver. Dans le Var, le chêne pubescent est majoritaire,
devant le chêne vert et le pin d'Alep.
En PACA, le podium est dominé largement par le chêne pubescent, bien
plus important que le pin sylvestre et le pin d'Alep.
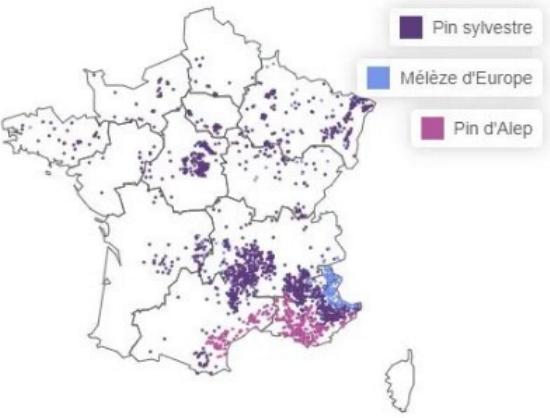
La répartition de pin sylvestre, mélèze d'Europe et pin d'Alep en
France.
De grandes difficultés d'exploitation
Un paradoxe émerge, selon Nathalie Derrière : les peuplements sont
peu diversifiés puisque 58 % ne contiennent une essence d'arbre,
mais en se déplaçant à des dizaines de kilomètres, il est possible
de tomber sur des essences d'arbres très différentes. "Dans le
Var par exemple, 100 km après avoir vu un hectare de chênes verts,
il est possible de voir du mélèze, ce qui n'a rien à voir. Ça semble
très uniforme, on a l'impression que tous les arbres sont
identiques, mais en se déplaçant un peu, on change d'échelle et on
peut arriver sur un autre peuplement, pur."
Ce rapport de l'IGN met en tout en cas en avant la difficulté
d'exploitation au sein de la région. "Il y a pas mal de relief,
de pente, rien que ça rend l'accès compliqué. Plus le terrain est
pentu, plus c'est dangereux pour les forestiers et bûcherons. Avec
le manque de routes, les tracteurs et camions ne peuvent pas
forcément circuler ", explique Nathalie Derrière, qui lie ce
phénomène à des contraintes économiques et à la qualité du bois.
"Construire une piste a un coût. Si le bois n'a pas de valeur, ne
répond pas aux critères pour la construction (c'est le cas du chêne
vert, qui ne grossit pas assez pour pouvoir construire des poutres),
ce n'est pas rentable économiquement de construire une route. Et
comme la forêt ne croît pas très vite, qu'il y a deux fois moins de
bois qu'une autre région où l'accès est plus facile, les forestiers
et bûcherons vont ailleurs", conclut l'experte, qui vante tout de
même la singularité du mélèze. "Certains ébénistes et menuisiers
sont intéressés par un bois qui pousse plus doucement. Le mélèze est
recherché notamment pour les toitures."


Surprise, Christian Estrosi annonce la création
d’un palais des congrès... sur le port de Nice

Visuel du projet de réhabilitation du port
annoncé en juin 2022 et qui sera modifié pour prendre en compte le
cahier des charges de l’ONU
Alors que le palais Acropolis est en cours de
démolition, la Métropole Nice côte d'Azur annonce qu’elle va livrer
dès juin 2025 de nouvelles infrastructures sur le port pour le
Sommet de l’Océan, notamment un grand auditorium, qui auront
vocation ensuite à devenir "un centre des congrès".
On disait les négociations entre la chambre de commerce et la
Métropole houleuses. La première gère le port de Nice dans le cadre
d’une convention dont le terme n’est prévu qu’en 2038. La seconde,
propriétaire des lieux, a dévoilé en juin dernier son projet de
réaménagement du bassin Lympia et annoncé, du même coup, son
intention de reprendre la main. Pour cela, les deux devaient
fusionner au sein d’une nouvelle société portuaire dont la CCI, la
Métropole, mais aussi la Région allaient devenir actionnaires. Il
n’en est plus rien!
L’annonce, en février, de la venue à Nice en 2025 du "One Ocean
Summit ", la conférence des Nations Unies sur les océans, a
rebattu les cartes. Même si Christian Estrosi souffle, avec
satisfaction, que ce joker-là il l’avait dans sa manche "depuis
un an": "Je ne pouvais pas abattre mes cartes au risque de
tout faire capoter. Mais, dans mon coin, durant tout ce temps, je
souriais en voyant tout le monde s’agiter ", ironise le
président de la Métropole. La pique est directement destinée à ses
opposants qui, de tous bords, l’attaquent sur la démolition
d’Acropolis.
Car aujourd’hui, c’est la construction d’un "nouveau centre des
congrès" et d’une "salle Apollon plus plus" que l’élu
niçois annonce… Non pas à l’ouest de la ville, mais sur le port de
Nice! Et ce, dès 2025. Avant le 5 juin même, date d’ouverture de la
conférence internationale.
"L’équivalent d’une salle Apollon plus plus"
Le "One Ocean Summit " est une grosse machine. Le président
de la Métropole en détaille les contours: "Il y aura d’abord un
sommet scientifique de quatre jours qui va réunir des chercheurs du
monde entier; puis la conférence elle-même, où sont attendus une
centaine de chefs d’État et de gouvernements et plus de 20.000
délégués; suivie pour la première fois d’un sommet des grandes
villes littorales qui devrait déboucher sur les accords de Nice."
Or, l’organisation de ce type de manifestations ne doit rien au
hasard. C’est l’ONU qui fixe le cahier des charges… "Et c’est
l’ONU qui a exigé que le sommet se déroule sur le port", assure
Christian Estrosi, qui y voit une "opportunité formidable".
Celle d’avoir non plus un, mais deux pôles dédiés au tourisme
d’affaire: "Un à l’ouest avec le futur palais des expositions en
lieu et place de l’actuel MIN Fleurs", et désormais "un à
l’est, davantage dédié aux congrès".
"Financé à 90% par les Nations Unies"

Visuel du projet de réhabilitation du port annoncé en juin 2022
et qui sera modifié pour prendre en compte le cahier des charges de
l’ONU
.
Car, pour les besoins de la conférence, il va falloir construire un
auditorium. "L’équivalent d’une salle Apollon plus plus". Un
équipement d’une capacité d’au moins 2.400 personnes qui trouvera sa
place au niveau de l’actuel parking Infernet. Pas question dès lors
de faire du provisoire. "Ce sera notre héritage", martèle
Christian Estrosi. Tout comme les espaces techniques et les salles
de réunion nécessaires au sommet. Au total, près de 10.000m2 vont
être réaménagés. "Sans que les contribuables niçois n’aient à en
supporter le coût puisqu’il sera financé à 90% par les Nations Unies",
assure le président de la Métropole.
La facture, estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros, sera
en fait réglée par un groupement d’intérêt réunissant l’ONU, la
France et le Costa Rica, Nice et la Région. La part assumée de la
collectivité locale devrait être de 5 à 6 millions d’euros. Contre
13 millions déboursés par l’État. "Le reste revenant à la charge
des Nations Unies et de mécènes privés", assure la Métropole.
Le port passe en régie
Mais pour cela, encore fallait-il être maître des lieux. Ce sera
fait dès juillet. "Nous allons reprendre en régie le port ",
annonce au passage Christian Estrosi, sans que la CCI ne s’en
offusque le moins du monde. Après plus d’un an d’âpres négociations
avec la Métropole, la chambre semble avoir finalement trouvé un
terrain d’entente.
Son président, Jean-Pierre Savarino, évoque "un partenariat
gagnant-gagnant ", "une opportunité majeure" même. Car si
la CCI perd la gestion du bassin Lympia, elle devrait y gagner à
terme celle des deux futurs pôles des congrès ainsi créés: l’espace
du quai Infernet et le futur palais des expos du MIN. La chambre et
la Métropole annoncent avoir passé "une convention" en ce
sens.


Nice accueillera la conférence des Nations unies sur les océans en
juin 2025
Organisée par la France et le Costa Rica, la prochaine conférence
des Nations unies sur les océans aura lieu à Nice du 5 au 15 juin
2025.
Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur des pôles et des enjeux
maritimes en charge de l’organisation de ce grand rendez-vous
mondial, avait prévenu lors des Assises de l’économie de la mer, à
Lille en novembre : "La conférence des Nations unies sur les
océans se tiendra dans une grande ville du littoral en 2025."
Après Marseille, qui avait accueilli le congrès mondial de la nature
de l’UICN en septembre 2021, et Brest, où s’était déroulé le One
ocean summit en février 2022, place à Nice, donc, pour un retour sur
la façade méditerranéenne. Emmanuel Macron espère que la troisième
conférence de ce type, après New York en juin 2017 et Lisbonne au
début de l’été 2022, sera l’occasion de "signer un accord pour
protéger l’océan comme bien commun de l’humanité", son mantra
déjà évoqué lors de sa venue appréciée aux Assises de l’économie de
la mer en 2019 à Montpellier, rendez-vous annuel du monde maritime
organisé par le marin et le groupe Ouest France.
En attendant 2025, d’autres rendez-vous majeurs devraient permettre
de mieux protéger l’océan, victime du réchauffement climatique et de
la pollution plastique. En premier lieu, d’aucuns espèrent que la
prochaine conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine
des zones situées au-delà des juridictions nationales (BBNJ), qui se
réunira du 20 février au 3 mars à New York, verra enfin l’adoption
d’un traité pour la haute mer. En 2023 et 2024, les prochaines Cop
pour le climat, du 30 novembre au 12 décembre à Dubai, et pour la
biodiversité, l’an prochain en Turquie, marquent elles aussi
l’espoir d’avancées pour les océans, toujours mieux pris en compte
dans ces conférences transverses. Enfin, les discussions
diplomatiques autour des grands fonds marins pourraient conduire dès
cette année à l’adoption d’un moratoire concernant leur
exploitation.
Il conviendra donc, d’ici Nice en juin 2025, de ne pas manquer ces
autres grands rendez-vous internationaux qui, plus que des étapes
intermédiaires, sont de véritables occasions pour avancer sur la
protection des océans et permettre au monde maritime de mieux
contrer les effets du dérèglement climatique et autre pollution
marine.


À la découverte des 5 monuments les plus
insolites de Nice
Nice, ce n'est pas seulement la promenade des Anglais. La capitale
de la Côte d'Azur possède une histoire riche, qui se découvre à
travers son architecture. Tom, du compte Instagram Nicestorique,
nous dévoile 5 monuments insolites niçois à (re)découvrir.
Statue de la liberté
Pour remercier les Etats-Unis d’avoir soutenu la France en 1917 lors
de la Première Guerre mondiale, la Ville de Nice baptise une partie
de son front de mer "Quai des Etats-Unis" avec un symbole universel
de l’amitié franco-américaine: la statue de la liberté.
Cette réplique de la célèbre statue offerte par la France aux
Etats-Unis était le dernier exemplaire que détenait la fonderie de
Coubertin.
Elle a été achetée par la Ville de Nice en 2011. Elle aurait coûté
près de 100.000 euros.
Cathédrale orthodoxe
L’idée de cette construction revient à l'archiprêtre Lubimoff qui,
en 1896, arrive à convaincre la tsarine Maria Feodorovna, résidant à
Cap-d’Ail. L'inauguration a lieu le 17 décembre 1912. La
construction a coûté plus de 1.500.000 franc-or.
C’est aujourd’hui, par le nombre et la qualité des œuvres d’art
qu’elle abrite, un véritable musée de l’art orthodoxe russe. C’est
le plus grand et le plus bel édifice de ce type hors des régions où
le culte orthodoxe est majoritaire.
Croix de Marbre
Qui pourrait soupçonner aujourd’hui que cette croix fut le théâtre
d’un événement d’exception. Depuis 1568, un monument modeste mais
frappé au sceau de la grand Histoire: une croix de marbre blanc.
Elle célèbre la Paix de Nice, ratifiée le 18 juin 1538, entre
Charles Quint et François Ier, mettant fin à la huitième guerre
d’Italie.
La Croix en marbre blanc est classée monument historique par arrêté
du 13 août 1906.
Colonne du pape
La colonne du pape est une colonne commémorative érigée à Nice dans
les années 1820 pour commémorer les deux brefs passages du pape Pie
VII dans la ville, en 1809 et 1814.
Le pape Pie VII est passé à Nice à deux reprises: du 7 au 9 août
1809 à la suite de son arrestation par les troupes de Napoléon Ier à
Rome, et du 9 au 11 février 1814 à la suite de sa sortie de
Fontainebleau.
Le choix d'ériger cette colonne commémorative est formulé dès 1815.
La colonne est érigée le 4 septembre 1823. Elle est classée au titre
des monuments historiques par arrêté du 26 décembre 1906.
Chaise bleue de Sab
La chaise bleue est aussi emblématique que le palmier sur la
promenade des Anglais.
L'histoire commence en 1950, c’est cette année-là que Charles Tordo
se voit confier la fabrication de 800 chaises par Monsieur
Ballanger, détenteur de la concession des chaises de la promenade,
dont l'usage était payant.
Depuis, des générations entières de Niçois et de touristes s'y sont
reposées pour admirer la Grande Bleue de la Riviera.
L'œuvre de Sab représente symboliquement les mythiques chaises
bleues disposées face à la mer, que les Niçois aiment tant. Cette
chaise, c’est Sabine Geraudie, artiste peintre, qui l’a imaginée.
Depuis octobre 2014, cette sculpture géante est installée sur la
promenade des Anglais.
Pourquoi votre journal a choisi les vidéos de Tom ?
Tom est un Niçois passionné. Encore étudiant en histoire, il a lancé
son compte Instagram Nicestorique où il raconte le passé de la ville
de manière ludique.
À travers des lieux, personnages ou dates, Tom réussit à intéresser
les jeunes (et les moins jeunes) à l'histoire riche de notre
territoire.
Embarquement immédiat !



AVANT/APRÈS. Dix photos pour vous montrer la
métamorphose du quartier depuis la démolition du TNN
La physionomie du quartier Garibaldi - promenade du Paillon a
considérablement évolué avec la destruction de l’ancien bâtiment du
Théâtre national de Nice.

Le 4 février 2022, le TNN avant le début des travaux. Photo
Nice-Matin

Février 2023: les derniers gravats sont évacués. Dessous, le
parking reste et sera recouvert par l’extension de la promenade du
Paillon... plus de traces du
TNN entre la promenade du Paillon et le Mamac. Photo Nice-Matin.
La démolition du bâtiment qu’occupait le TNN sur la traverse de la
Bourgada a fait couler beaucoup d’encre l’an dernier. Quoi qu’on en
pense, c’est fait. Et cela modifie totalement l’aspect du quartier.
Désormais, en venant de la promenade du Paillon, on ne se retrouve
plus face à un imposant bloc de marbre mais devant la géométrie du
Mamac qui se découpe dans le ciel.
Nous vous proposons ici de retrouver les perspectives avant - après
la disparition de l’édifice. Le temps passe vite et l’on oublie
rapidement à quoi les lieux ressemblaient, il y a quelques mois
encore.
D’autant que d’ici deux ans, les lieux vont de nouveau se modifier
avec la destruction d’Acropolis et la création de la "forêt
urbaine" dans le prolongement de la coulée verte.

Le TNN vu depuis le kiosque
À gauche: le 16 décembre 2021, la vue depuis le kiosque du TNN à
l’entrée de la promenade du Paillon, côté Bourgada.
À droite: Le 10 janvier 2023, la même photo prise depuis le même
endroit, devant le kiosque du TNN.
Depuis le Mamac

À gauche: le 4 février 2022, le TNN avant le début des travaux.
À droite: le 1er février 2023, depuis le Mamac, on aperçoit
désormais la promenade du Paillon. Photo Nice-Matin.
De la place Toja

À gauche: le 17 janvier 2022, depuis la place Toja.
À droite: Le 10 janvier 2023, depuis la place Toja. Photo
Nice-Matin.
De l’aire de jeux de la promenade du Paillon

À gauche: Le 16 décembre 2021, ici depuis l’aire de jeux de la
promenade du Paillon.
À droite: Le 10 janvier 2023, ici depuis l’aire de jeux de la
promenade du Paillon. Photo Nice-Matin.
Depuis les airs

Février 2023: les derniers gravats sont évacués.
Dessous, le parking reste et sera recouvert par l’extension de la
promenade du Paillon...


Nice, Cannes et Antibes veulent recycler les eaux
usées pour faire face à la sécheresse
C'est la solution des collectivités publiques face à une sécheresse
qui s'installe dans le sud de la France. Les villes se lancent dans
des projets d'économie des eaux grises pour l'arrosage, le lavage
des bus ou des rues pour limiter la consommation d'eau potable.
C'est une lame de fond qui touche les collectivités du sud-est :
économiser l'eau par tous les moyens.
En visite au MIPIM à Cannes, Christophe Béchu, le ministre de la
transition écologique félicite les édiles pour leurs idées
novatrices : "Quand je regarde juste ici le maire de Nice et le
maire de Cannes qui ont tous les deux des idées d'application
immédiate, si demain les décrets passent, pour aller nettoyer les
voies entre Cannes et Antibes ou pour arroser les espaces verts, ce
sont des choses simples mais qui éviteraient d'utiliser de l'eau
potable."
Le ministre l'a rappelé, en Europe, la France fait partie des
mauvais élèves dans le traitement des eaux usées (cf.carte)
Espagne : 14 %, Italie : 8 %, Allemagne : 1,5 %, France : 0,1 à 1%
Car le problème de la sécheresse n'est pas nouveau dans les pays
méditerranéens. Etés caniculaires, manque de pluie, nappes
phréatiques en baisse.
L'année 2022 a battu des records de chaleur, 2023 s'annonce d'ores
et déjà comme une année catastrophique pour cette ressource vitale.
Lundi 13 mars, la préfecture des Alpes-Maritimes a placé le
département en alerte sécheresse, à une semaine du début du
printemps. Une situation grave et inédite.
Face à ce problème environnemental, les maires sont en première
ligne pour assurer à la population l'accès à l'eau potable. Et
depuis longtemps, les communes traitent des eaux usées des habitants
qui sont rejetées en mer.
70.000 m3 d’eaux usées réutilisées par an
A Antibes, le projet entre dans une phase concrète. Dès lundi 20
mars, des travaux auront lieu à la station d'épuration de Véolia
pour créer un deuxième réseau de distribution. Des machines à
filtration seront prochainement livrées, la borne située devant la
station sera changée avec un badge d'accès pour que les agents se
servent directement.
Actuellement, 9 millions de m³ des eaux usées, une fois propres,
sont rejetées en mer, à 1km du rivage d'Antibes.
Cette eau, la ville veut la réutiliser pour arroser les parcs,
jardins et massifs fleuris et voirie.
Au total, plus de 70.000 m3 d’eaux usées traitées pourraient être
réutilisées par an pour le lavage de la voirie de la commune
d’Antibes
Le dossier d'autorisation est toujours en cours avec la préfecture
et avec l'Agence Régionale de Santé.

Station d'épuration Véolia d'Antibes : l'un des 3 bassins de
clarification des eaux usées.
Autre domaine : le lavage des véhicules de transport collectif.
Dans le nouveau dépôt du réseau de transport urbain Envibus, 27
lignes de bus et 64 lignes scolaires, un dispositif de recyclage a
été mis en place dans le quartier des Trois Moulins.
Résultat :
95% des eaux de lavage des carrosseries de bus sont recyclées pour
ne pas dépasser 3.500 m³ de consommation annuelle.
"l'urgence climatique est bien réelle"
Dès 2019, l’agglomération Cannes Lérins a amorcé un projet de
réutilisation des eaux usées traitées.
La réutilisation de l’eau traitée par la station d’épuration
Aquaviva de l’Agglomération Cannes Lérins, soit 18 millions m3 d’eau
par an, est au cœur du projet.
Une procédure très longue et très lourde pour les collectivités.
Comme le soulignait David Lisnard, président de l’Agglomération
Cannes Lérins et maire de Cannes.
David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire
de Cannes :
Les délais administratifs et procédures imposées par l’Etat ont
malheureusement retardé considérablement nos démarches pour la mise
en place de ce dispositif alors même qu’il aurait été plus que
nécessaire l’été dernier puisque nous avons connu une période de
sècheresse intense. Cela est difficilement acceptable et je le
répète l’urgence climatique est bien réelle et nous ne pouvons nous
permettre d’attendre encore des années pour réagir.
Des lourdeurs administratives qui ont ralenti les démarches. Mais
différentes études ont montré que l’utilisation de l’eau usée
traitée est compatible avec l’usage d’irrigation agricole et le
nettoyage des voiries.
D'après l'agglomération, la station Aquaviva est parvenue à un haut
niveau de qualité, grâce à des membranes d’ultrafiltration des
particules fines de plastique.

Le gazon du golf "Old course" de Mandelieu sera arrosé par des
eaux usées et traitées de la station d'épuration.
Ainsi, l’intercommunalité a lancé la phase d’irrigation du golf "Old
Course" de Cannes. L’objectif est de réaliser de rationner l’eau
tout en préservant la qualité du gazon. Une bonne opération pour les
golfeurs, mais d'autres économies doivent être réalisées :
- le nettoyage des voiries et des véhicules industriels de service
public (bennes, laveuses, balayeuses ) sur les communes de Cannes et
de Mandelieu-La Napoule pour juin 2023
- l’irrigation des espaces verts proches de la station d’épuration
Aquaviva, comme le Stade de Saint-Cassien et les jardins publics de
Mandelieu-La Napoule
- l’irrigation de l’agriculture en basse vallée de la Siagne, par la
création d’un bassin de stockage des eaux traitées ainsi que d’un
réseau d’irrigation pour arroser des espaces verts
"Protection de nos ressources en eau"
A Nice aussi, on étudie cette question depuis longtemps. Dans un
communiqué, le maire de Nice se félicite de l’annonce du
gouvernement sur la possibilité de réutiliser les eaux usées
traitées, les eaux de pluie et les eaux grises. Cette mesure avait
été demandée à Elisabeth Borne, Première ministre, dès l’été 2022.
Christian Estrosi, maire (Horizons) de Nice :
Il ne peut pas y avoir d’avenir et d’attractivité pour un
territoire, si nous ne garantissons pas le verdissement d’un côté et
la protection de nos ressources en eau et de nos littoraux de
l’autre.
Dès la publication du décret, la Métropole Nice Côte d’Azur pourra
accélérer le déploiement de ce dispositif. L'expérimentation prévue
cet été, vise à arroser les espaces verts de la station et les
espaces verts publics du parc Carras attenant.
La Métropole va également demander les autorisations nécessaires
afin de pouvoir utiliser des camions citernes mobiles qui partiront
d’Haliotis pour arroser d’autres espaces publics urbains grâce à
cette nouvelle unité.
Elle va également étudier la faisabilité d’un branchement sur les
espaces verts du parc Phoenix et a d’ores et déjà inclus une unité
de traitement dédiée dans le projet Haliotis II, à hauteur de 4,8
millions de mètres cube par an.
Voyage en Israël, pays pionnier
Même initiative à l’échelle régionale. Lors d'une visite au Salon de
l'Agriculture, Renaud Muselier, président de la région PACA, a
annoncé le lancement d’une expérimentation régionale pour la
réutilisation des eaux usées traitées. Ces eaux seraient utilisées
pour l’irrigation agricole ou le refroidissement industriel.
C'est pour l'instant un projet. A ce stade, ni les objectifs
chiffrés ni le financement ne sont précisés.
Un diagnostic sera établi cette année et des investissements seront
réalisés en 2024.
Un partenariat sera noué avec l’université Aix-Marseille pour
rechercher les dispositifs de traitement les plus pointus.
Dernière idée, Renaud Muselier se rendra en Israël, pays pionnier
dans ce domaine, afin d'observer les solutions déployées sur place.
Pour économiser cette précieuse ressource, toutes les idées sont
bonnes à prendre.


Voies de circulation en moins, stationnements
supprimés: l'impact des travaux d'extension de la promenade du
Paillon dans le centre-ville de Nice

Christian Estrosi a lancé ce vendredi la première étape de
l'extension de la promenade du Paillon sur le secteur de la
Bourgada. Un chantier qui se poursuivra sur le jardin Sosno et
Acropolis, avec des axes majeurs de Nice impactés.
Voici tout ce qu'il faut savoir.
Les travaux de l'extension de la promenade ont été lancés ce
vendredi par Christian Estrosi depuis le secteur de la Bourgada. Ce
chantier, qui doit transformer un espace aujourd'hui minéral en "forêt
urbaine", aura un impact sur les voies de circulation parallèles
au Paillon.
Christian Estrosi lance les travaux sur les gravats du TNN, première
étape de l'extension de la promenade du Paillon de Nice
Secteur Bourgada
Les travaux de construction du belvédère au pied de la façade sud du
Mamac démarrent le 27 mars. La livraison est prévue à fin juin 2024.
La traverse de la Bourgada sera alors rouverte à la circulation sur
une voie, avec une piste cyclable sécurisée.
Secteur Sosno
Le jardin Sosno, au nord du Mamac, au pied de la Tête Carrée, va
être réaménagé. Les 70 oliviers du jardin vont être transplantés la
semaine prochaine. Pour ce faire, des grues seront positionnées sur
les boulevards Risso, Saint-Sébastien et Saint-Jean-Baptiste, des
deux côtés du Paillon, jusqu'à la fin du mois de mars.
Des travaux de curage et de désamiantage puis d'étanchéité et enfin
d'aménagement du jardin doivent être réalisés sur ce qui fait office
de toit de la bibliothèque Louis-Nucéra.
Pour ce faire, la circulation sera réduite à partir du 3 avril sur
les boulevards Risso, Saint-Sébastien et Saint-Jean-Baptiste, qui
seront requalifiés. Les emplacements habituellement réservés au
stationnement sur ces deux axes très fréquentés seront interdits
pour permettre la circulation uniquement sur la voie la plus à
droite. Soit une réduction à deux voies: une voie générale et une
voie bus.
Fin des travaux prévue fin juin 2024 pour l'arrivée du Tour de
France.
Secteur Barla
Le gros morceau de cette extension de la promenade du Paillon: la
destruction du palais Acropolis. Celle-ci doit durer jusqu'en
décembre 2025. Si le boulevard Risso ne sera pas fermé à la
circulation (sauf opérations exceptionnelles), les travaux seront
réalisés "sous fermeture de contre-allée Gallieni, avec
suppression de la piste cyclable", soit une voie de circulation
en moins pour les véhicules à moteur.
La traverse Barla passera finalement à deux fois deux voies à la fin
des travaux.
Secteur De-Lattre-de-Tassigny
Entre juin 2023 et le premier trimestre 2024, les travaux (sondages,
dévoiements de réseaux, étanchéité, aménagements paysagers) seront
réalisés "sous restriction ponctuelles de circulation sur les
voiries périphériques", communique la Ville de Nice qui indique que
"les voiries au nord de la traverse Barla seront en travaux sur le
mandat suivant".
Christian Estrosi s'attend à une réduction "choisie" de "30%
de la circulation" avec la livraison de l'extension de la
promenade du Paillon. Photo Cyril Dodergny.
Le maire de Nice entend "créer de l'apaisement " avec la
réduction des voies de circulation. Christian Estrosi voit dans ces
aménagements routiers une "amélioration des conditions" qui
permettra de "fluidifier " le trafic notamment dans le
secteur Barla.
"Il faut laisser la voiture à ceux qui en ont besoin", a
renchérit l'adjoint Richard Chemla, délégué à la Transition
écologique et énergétique, à la Santé et au Bien-être, qui estime
que ces changements ont été réalisés en douceur. "C'est comme dans
le corps humain, quand on bouche brutalement ça bloque, ce n'est pas
le cas ici."
Christian Estrosi table sur "30% de circulation en moins" à
Nice après la livraison de l'extension de la promenade du Paillon. "C'est
de l'incitation, a ajouté le maire. Les gens choisiront et la
circulation va baisser de manière choisie. Ils auront envie de
laisser la voiture pour marcher dans ce parc ou prendre le vélo. Et
puis conduire sera aussi plus agréable avec une vitesse apaisée."


Christian Estrosi lance les travaux sur les
gravats du TNN, première étape de l'extension de la promenade du
Paillon de Nice
C'est l'un des projets phares de Christian Estrosi à Nice: la
prolongation de la promenade du Paillon débute ce vendredi. Après la
destruction du TNN, c'est le secteur de la Bourgada qui va être
entièrement réaménagé.
C'est la première étape de la prolongation de la promenade du
Paillon: le réaménagement du secteur de la Bourgada démarre ce
vendredi à Nice.
Objectif: construire un belvédère pour rejoindre l'esplanade des
Arts par des restanques boisés, jusqu'au pied du Mamac.
Christian Estrosi y a inauguré à cette occasion un lieu où les
Niçois pourront retrouver "toutes les informations sur les grands
projets de l’hyper-centre en cours et à venir (promenade du Paillon
saison 2, hôtel des polices, rue Cassini, trames vertes…) et faire
part de leurs doléances liées à ces chantiers".
Ce point Info Travaux est ouvert sur l'esplanade de la Bourgada,
face au chantier.
Le calendrier prévu
Il faudra attendre 2025 pour fouler le vaste parc paysager qui sera
aménagé à la place de l’ancien TNN et d’Acropolis, dans le
prolongement de la promenade du Paillon, à l’esplanade
De-Lattre-de-Tassigny, devant le palais des expositions.
Pour la partie Théâtre national de Nice (TNN) / Mamac, les travaux
seront normalement achevés en mai 2025 et pour le secteur Acropolis,
jusqu’à fin 2025.
En février 2023, Acropolis sera désamianté et détruit. Entre la fin
2023 et le début 2024, les travaux de requalification du Mamac, de
la bibliothèque Louis-Nucéra et du parking des Arts seront
enclenchés.
À l’été 2024, les dernières pierres d’Acropolis devraient être
tombées. Et, à l’automne de la même année, les travaux du parc sur
ce secteur commenceront. Tout devrait être livré à la fin de cette
année-là.
Ce qu'il faut savoir du projet
Très concrètement, l’extension de la promenade du Paillon est un
revêtement végétalisé, composé de diverses passerelles. Tout partira
du futur palais des Arts et de la culture qui sera livré à l’horizon
2026, en lieu et place de l’actuel palais des expositions. Un
premier pont permettra de passer au-dessus de la traverse
Jean-Monnet. Sur les visuels, l’esplanade Kennedy deviendra une
forêt urbaine.
Puis, en découlera l’extension de la promenade du Paillon. Elle
continuera jusqu’à la traverse de la Bourgada, en passant par le
toit de la bibliothèque Nucéra, le premier étage du Mamac et le toit
du parking des Arts.
L’objectif des architectes est de se balader le long de la promenade
du Paillon, sans qu’aucun élément ne soit un obstacle.


On vous explique pourquoi les chenilles
processionnaires sont une calamité pour les humains et les animaux

Au printemps, les chenilles processionnaires
sortent de leur cocon et représentent un réel danger pour les
animaux et les humains
Elles reviennent à chaque printemps avec leurs poils urticants
particulièrement dangereux pour les chiens mais aussi pour les
humains.
Elles semblent bien inoffensives quand elles cheminent en file
indienne au pied des pins. A l'approche du printemps, les chenilles
processionnaires quittent leur cocon pour s'enfouir dans le sol et
devenir papillons. Leurs processions démarrent plus ou moins tôt
selon les climats des régions, et de plus en plus prématurément
selon les spécialistes en raison du réchauffement climatiques. En
Provence-Alpes Côte d'Azur, on est actuellement en plein pic. Leurs
poils très irritants représentent un danger en cas d'ingestion ou de
contact avec les muqueuses. France 3 Provence-Alpes vous explique
pourquoi les chenilles processionnaires sont une calamité pour les
humains et leurs compagnons à quatre pattes.
Comment les reconnaît-on ?
Au détour d'un sentier dans la colline, ou dans un jardin, la
chenille processionnaire se rencontre partout où il y a des pins.
Son nom scientifique, c'est Thaumetopoea pityocampa. Cette larve de
papillon de nuit, originaire du pourtour méditerranéen, fait partie
de la famille des Notodontidae, et elle est classée nuisible depuis
2022.
La chenille mesure quelques millimètres au stade larvaire 1 et
jusqu'à 40 cm de long au stade 4 ou 5. Brune noirâtre, elle est
reconnaissable à ses tâches rougeâtres sur le dessus et les flancs,
et à son ventre jaune. Surtout, elle présente sur son corps
fortement velu, des poils urticants et allergisants qu'elles
dispersent au gré du vent par ses "miroirs" et peuvent s’accrocher
comme des harpons aux habits ou à la peau.
Ces soies sont urticantes et allergisantes et il n'est pas besoin de
les toucher car la chenille projette ce qu'on appelle des miroirs
qui se plantent dans tout ce qu'ils touchent.
Ces chenilles doivent leur nom à leur façon de marcher sur le sol en
procession, à la sortie de leurs nids de soies facilement visibles
aux extrémités des branches de pins.

Quels sont les risques pour l'homme ?
Selon une étude publiée en juin 2020 par l'Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses), sur la base des cas enregistrés dans les
centres anti-poison entre 2012 et 2019, il y a eu environ 1 300 cas
symptomatiques d’exposition aux chenilles processionnaires.
Selon ce rapport de toxicovigilance, la grande majorité des
expositions aux poils de chenilles processionnaires entraîne des
éruptions cutanées avec démangeaisons, oedème localisé, conjonctives
ou irritations des voies respiratoires. Les symptômes sont sans
gravité dans plus de 9 cas sur 10. Deux cas de forte gravité sont
rapportés, celui d'un enfant de 3 ans ayant ingéré une chenille et
une surréaction d'un homme de 51 ans allergique aux hyménoptères.
Aucun décès n'a été observé.
L'Anses souligne que les expositions sont de plus en plus
fréquemment observées en France métropolitaine, et peuvent concerner
des enfants de moins de 5 ans "qui peuvent facilement s'exposer
du fait de leur comportement exploratoire, attraper la chenille,
puis en porter les mains à la bouche et/ou aux yeux."
En prévention, l'Anses fait quelques recommandations. En promenade,
dans un endroit où il y a des pins, de janvier à mai, porter des
vêtements longs, ou éviter les zones à risques. Ne pas approcher ni
toucher les chenilles ou leurs nids et garder les enfants à
distance. Et ne surtout pas balayer une procession de chenilles au
risque de créer un nuage de poils urticants.
Au jardin, il est recommandé de porter des gants pour le jardinage,
d'éviter de faire sécher le linge à proximité d’arbres infestés, et
laver les fruits et légumes cueillis. Éviter aussi de se frotter les
yeux et se laver les mains au retour de la promenade.
Que faut-il faire en cas d'exposition ?
En fonction de la gravité des symptômes il convient d'alerter les
secours. En cas de détresse respiratoire ou de réaction allergique
grave : appeler le 15 ou le 112.
Si un enfant en bas âge a porté une chenille à la bouche, il est
recommandé de consulter immédiatement le service des urgences.
En cas d’autres symptômes (rougeur, démangeaisons…), il faut appeler
un centre antipoison ou consultez un médecin.
En cas de suspicion d’exposition : ne pas se toucher les yeux,
prendre une douche, enlever ses vêtements et les laver à plus de
60°C.
Est-ce dangereux pour les animaux domestiques ?
Les consultations se multiplient en ce moment chez les vétérinaires
de la région, même si le pic n'est pas encore atteint. Les chenilles
processionnaires sont très dangereuses pour les animaux domestiques.
Les chats sont moins concernés que les chiens, qui vont avoir
tendance à aller renifler les chenilles et leurs soies urticantes.
"Si c'est gueule fermée, ça va toucher la face, on aura
simplement ce qu'on appelle un myxoedème, un oedème de la face
généralisé, et ça n'épargne pas d'avoir une réaction systémique
complète, avec l'oedème de Quincke", explique Eric Bonnifay,
vétérinaire de la région Paca, à France 3 Provence-Alpes.
Si le chien renifle la chenille gueule ouverte, l'affaire est encore
plus grave. "Les miroirs vont se planter sur la langue, on va avoir
des gros œdèmes de la langue, des lésions plus ou moins étendues et
plus ou moins profondes avec possiblement des pertes de morceaux de
langue."
L'exposition aux chenilles processionnaires peut aussi entraîner des
kératites (des inflammations de la cornée) ou des atteintes
oculaires graves, avec risque de nécrose, qui nécessitent une
consultation en urgence.
Dr Eric Bonnifay, vétérinaire
"La première chose à faire, c'est un rinçage abondant gueule, et
de la face, à l'eau froide pour décongestionner et rincer les
toxines, et on appelle très rapidement le vétérinaire le plus
proche."
Les signes qui doivent alerter, c'est un chien qui salive
énormément, la langue tellement grosse qu'il ne peut plus la rentrer
dans la gueule, ou des yeux complètement fermés avec une
inflammation des paupières.
Que dois-je faire si mon chien est atteint ?
"En cas de moindre doute, la première chose à faire, avant même
d'aller chez le vétérinaire, c'est un rinçage abondant gueule, et de
la face, à l'eau froide pour décongestionner et rincer les toxines,
et on appelle très rapidement le vétérinaire le plus proche",
souligne le docteur Bonnifay, qui recommande un suivi les 24 à 48
heures pour éviter les risques de nécrose.
"Si le chien est très atteint ou très sensible, on peut avoir des
oedèmes de Quincke, c'est une urgence vitale, parce que toute la
gorge gonfle, il a du mal à respirer et l'étouffement peut arriver
", ajoute-t-il.
En fonction du type d'atteinte, et de l'état des dégâts parfois très
lourds, le vétérinaire déterminera le traitement adapté. "Le
pronostic vital peut-être engagé", rappelle le docteur Bonnifay.
Pour éviter ces risques, le vétérinaire conseille, en balade comme
chez soi d'être vigilant. "S'il y a beaucoup de nids dans les
pins, on regarde parterre et on tient le chien en laisse, on marche
plutôt sur les pistes forestières en colline et chez soi ; si on n'a
pas de pins on regarde chez le voisin, surtout qu'avec le vent les
nids peuvent tomber, et il faut surveiller régulièrement le jardin
parce qu'il est déjà arrivé qu'une procession de chenilles traverse
le salon d'une maison, c'est très rare mais on peut très bien
croiser une procession de chenille sur une terrasse sans avoir de
pins chez soi."
Quelle est la période à risques ?
Selon l'Observatoire des chenilles processionnaires - Fredon France,
en zone méditerranéenne, la période à risques se situe en
février-mars, au moment des descentes massives des chenilles qui
quittent le nid pour s’enfouir sous terre.
Les autorités locales appellent d'ailleurs à la vigilance comme la
préfecture du Var, qui donne des conseils pour s'en protéger et
lutter contre leur prolifération.
L’Anses préconise notamment de mettre en place des mesures de
détection de la présence des papillons processionnaires à l’aide de
pièges à phéromones en été. Et en cas de détection de mâles dans les
pièges, de procéder à une lutte curative en privilégiant la
destruction des nids, les pièges autour des troncs pour les
chenilles et les nichoirs pour les mésanges et les chauves-souris
qui en raffolent.
Les écologistes dénoncent "le saccage
environnemental" de l’estuaire du Var, voici la réponse de la
préfecture des Alpes-Maritimes
..

..
L’estuaire du Var, principale zone humide du département et escale
privilégiée des oiseaux migrateurs, fait l’objet de travaux. Les
associations écologistes dénoncent un “saccage environnemental
”.
La préfecture leur répond.
Sollicitée, la préfecture des Alpes-Maritimes explique que les
travaux menés dans l’estuaire du Var s’inscrivent "dans le cadre
de l’intérêt général lié à la protection des biens et des personnes".
Les services de l’État précisent que "ces travaux de traitement
de l’atterrissement le long de la digue", dont le Smiage
[Syndicat mixte pour les inondations l’aménagement et la gestion de
l’eau] assure la maîtrise d’ouvrage, "ont pour objectif de
redonner au fleuve Var ses capacités hydrauliques à des fins de
protection contre les inondations. La technique mise en œuvre
correspond à la création de plusieurs chemins d’écoulement..."
Un écologue missionné pour assurer le suivi du chantier
"Ces travaux ont permis également une dépollution du site avec
l’enlèvement de divers matériaux métalliques charriés par les
différentes crues", ajoute la préfecture qui assure qu’ils "sont
encadrés par l’arrêté de protection du biotope embouchure du Var
’’.
"En vue de minimiser l’impact milieu, le Smiage a missionné un
écologue pour assurer le suivi du chantier. Les interventions
[qui doivent s’achever entre le 15 et 31 mars] tiennent compte
des différentes périodes de reproduction des espèces protégées afin
de ne pas perturber leur cycle naturel et favoriser ainsi leur
conservation."
Les services de l’État se proposent de rencontrer
"de
nouveau les associations environnementales dans les prochains jours
pour leur expliquer les objectifs des travaux et les précautions
prises."
.
“C’est Beyrouth!”: les écologistes dénoncent le
“saccage” de l'estuaire du Var, la petite Camargue azuréenne
..
.
L’estuaire du Var, principale zone humide du département
et escale privilégiée des oiseaux migrateurs, fait l’objet
de travaux.
"C’est Beyrouth ! " Daniel Narcy, membre de l’association
Green et animateur de l’aquarium des flots bleus à
Saint-Laurent-du-Var, n’y va pas par quatre chemins. Depuis le début
des travaux, il y a quelques semaines, il documente, photos à
l’appui, ce qui pour lui est une "grave atteinte à l’environnement".
Mi janvier, des pelleteuses ont débarqué dans l’estuaire du Var. "Ils
sont en train de creuser des tranchées de 20 mètres de long et de 2
mètres de profondeur ", déplore Daniel Narcy. Dans une zone
protégée. Le site est en effet surnommé la "petite Camargue"
azuréenne. "C’est la première zone humide du département,
rappelle-t-il. On y dénombre 260 espèces d’oiseaux."
Pour protéger Cap 3000 des inondations ?
La "petite Camargue" de l’estuaire du Var fait d’ailleurs
l’objet d’un arrêté de Biotope depuis 2019. "On ne peut même pas
aller s’y balader sans risquer de prendre un PV, souffle Airy
Chrétien du collectif Citoyen 06. Pourtant là c’est à la pelleteuse
qu’ils attaquent ce site classé Natura 2000." Le collectif vient
de publier un communiqué de presse demandant au préfet des
Alpes-Maritimes de prendre "de toute urgence" des mesures
conservatoires.
Ce sont pourtant les services de l’Etat qui ont autorisé ces travaux
qu’ils financent d’ailleurs à hauteur de 50% avec le Smiage
(Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de
l’Eau maralpin). De quoi laisser supposer aux associations
environnementales que l’objectif de ce chantier est moins "la
mise en défend des espèces protégées", comme l’indique
l’affichage apposé sur le site, que protéger Cap 3000 des
inondations.
Un recours au tribunal administratif
Dès l’automne dernier, une autre association environnementale avait
elle aussi tenté de s’opposer à la réalisation de ces travaux. "Le
14 novembre 2022 nous avons déposé un recours contre l’arrêté
préfectoral autorisant ces travaux, explique Geneviève Andréa,
la nouvelle présidente de CAPRE 06. Arrêté qui n’a même pas été
publié au recueil des actes administratifs. Du moins nous n’en avons
pas trouvé trace."
Le recours est resté lettre morte. Voilà Capre 06 a décidé de saisir
le tribunal administratif de Nice le 20 janvier dernier.
L’association attaque le préfet pour "excès de pouvoir ".
Selon Geneviève Andréa, les services de l’Etat ne pouvaient
s’exonérer de réaliser au préalable des études d’impact.
L’affaire est donc désormais entre les mains de la justice. Mais en
attendant, les travaux se poursuivent dans la zone protégée de
l’estuaire du Var.
..
..
L’estuaire du Var, principale zone humide du département et escale
privilégiée des oiseaux migrateurs, fait l’objet de travaux


Sur les traces de Baptiste, "le sorcier des
Merveilles" dans La Roya
L’auteur Jacques Drouin vient de publier un livre jeunesse relatant
l’histoire d’un berger dans la Roya à l’époque médiévale. Entre
fuite, apprentissage, complots, et croyances populaires.
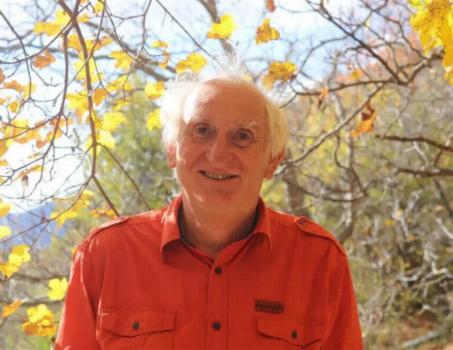
Jacques Drouin a découvert la montagne pour la première fois à 12
ans, dans la vallée de la Roya
À l’origine, les histoires du jeune berger tendasque Baptiste
Lantero n’avaient pas vocation à être publiées. Jacques Drouin les
avaient imaginées quand il était instituteur à Ascros. "J’avais
accompagné mes élèves dans la vallée des Merveilles. Plutôt que de
raconter l’histoire classiquement, j’avais écrit ce petit récit,
d’abord sous forme de conte. Ça leur a plu. Puis ça a plu à des
éditeurs. Quand je venais rencontrer des classes, la question est
souvent revenue de savoir s’il y aurait une suite. À force
d’entendre ça, la graine qui avait été semée a germé…",
raconte-t-il. Alors que son roman jeunesse Le Sorcier des Merveilles
- retravaillé par rapport à une première version datant de 2010 -
vient de sortir aux éditions niçoises Campanile. Complétant une
jolie liste d’ouvrages signés de sa plume - une quarantaine au total
- aux côtés des récits pour adultes et des guides de randonnées.
Une vallée maudite ?
Dans celui-ci, Jacques Drouin plonge son personnage dans l’époque
médiévale. Pour une question de contexte ; la vallée était alors
considérée comme maudite. En témoignent les appellations encore en
vigueur : Val Masca, Val d’enfer, cime du diable… Et parce que d’un
point de vue plus pragmatique, dans une visée pédagogique, l’auteur
souhaitait étudier ce pan de l’Histoire avec ses élèves.
Le résumé du livre tient en quelques phrases :
"Baptiste a douze ans quand il entre au service du comte Robert
de Tende. L’été, il a la charge de garder le troupeau seigneurial.
Seul dans la montagne, il doit faire face aux loups et aux orages.
Malheureusement, une série de malheurs l’oblige à fuir pour éviter
la terrible colère du comte. Il trouve refuge au pied du mont Bégo,
dans le Val des Merveilles. Une vallée maudite où, selon les
croyances populaires, le diable aurait laissé son empreinte en
gravant la roche de milliers de signes cornus et de poignards. Mais
ces roches cachent un secret que Baptiste va tenter de percer avec
l’aide d’Aymeric, le vieux sage, et de Flavia, la jolie bergère
qu’on dit fille de sorcière…"
On y devine la série de rebondissements qu’un roman d’aventures
requiert. L’intervention de personnages venant en aide à Baptiste,
et d’autres qui lui nuisent en fomentant des complots. Les menaces
qui rôdent. Les coups de théâtre. Les épisodes de fuite, les
épreuves d’apprentissage. L’apparition de créatures bienveillantes,
en opposition à la malveillance véhiculée par les superstitions.
Dans la deuxième partie de son roman, celui qui a découvert la
montagne à 12 ans, en gambadant dans la Roya, explique avoir fait un
rapprochement entre les gravures du mont Bégo et celles du Val
Camonica (en Italie). "Quand je m’y suis rendu au début des
années 2000, j’ai retrouvé la même symbolique. Même si les cerfs
dans le Val Camonica remplacent les taureaux des Merveilles. Les
gravures se trouvent aussi sur des dalles lisses - mais grises. Les
gravures de Naquane ne sont pas si lointaines, elles se trouvent de
l’autre côté de la plaine du Pô. Alors j’ai voulu faire la liaison
entre ces cultures. J’ai imaginé une rencontre entre les deux."
Jacques Drouin explique avoir puisé dans les légendes de la Roya -
récoltées dans des revues ou directement auprès des habitants - pour
écrire Le Sorcier des Merveilles. Et comme le nom de l’ouvrage
l’indique, il y est toujours question de sorcellerie en toile de
fond. "C’était l’époque. Dès qu’elles touchaient aux plantes, les
femmes étaient accusées de sorcellerie. Parce qu’il y a les essences
qui soignent, mais aussi les vénéneuses. Pour un autre livre sur les
métiers de montagne, j’ai rencontré une femme qui travaille avec les
plantes et qui me disait "nous ne sommes pas sorcières, mais
sourcières" souligne l’auteur. Attaché, justement, à
déconstruire les mythes et fausses croyances au fil des pages.
Préférant mettre l’accent sur le bienfait des savoirs d’antan et le
respect de la nature. "Pendant longtemps, la vallée était
maudite. Les troupeaux y étaient même envoyés en quarantaine. Alors
qu’il s’agissait d’un lieu de culte pour les anciens."
Jacques Drouin consacre d’ailleurs les deux dernières pages de son
livre à une explication des gravures les plus connues. "J’aurais
pu en mettre plus, mais c’est aussi un site à découvrir par
soi-même. Sur place ou au musée des Merveilles."
Rencontre avec une classe de Saint-Dalmas
En février, l’auteur rencontrera des élèves de 6e du collège de
Saint-Dalmas. L’occasion de revenir sur les contes liés à la vallée,
et de parler de son livre. "J’aime ces rencontres dans les
classes. L’écoute est surprenante. Quand je raconte une histoire,
ils ont les yeux grands ouverts et il n’y a pas un bruit. Preuve que
les enfants peuvent encore rêver. Et ils posent des questions très
pertinentes."
Jacques Drouin se souvient notamment d’un élève qui lui avait
demandé pourquoi il mettait des titres aux chapitres, donnant de
fâcheux indices sur la suite de l’histoire. L’auteur projette,
depuis, de ne plus en mettre, ou de privilégier des termes plus
mystérieux.
Mais s’il fallait malgré tout tirer le fil rouge du Sorcier des
Merveilles, on retiendra une phrase tirée du roman: "Ces
montagnes ne sont pas le repaire d’êtres malveillants. Mais dans la
vallée, on n’est pas près de l’admettre. Un jour, pourtant, les gens
comprendront enfin où sont leurs racines."
Savoir+
Le Sorcier des Merveilles est paru le 12 janvier aux éditions
Campanile.
On peut le retrouver en librairies ou directement sur le site de la
maison d’éditions:
https://editions-campanile.fr - Tarif : 15 euros.


Tout ce que l’on sait sur l’édition 2023 du
Carnaval à Nice
On en sait plus sur le couple royal, les nouveautés grandioses et
les défilés qui paraderont à Nice du 10 au 26 février. Un 150e
anniversaire sur fond de merveilles du monde en lien avec l’Unesco.

Le roi du Carnaval de Nice 2023 trône sur les trésors du monde.
Visuel Ville de Nice
Un roi, énorme, cumulant les merveilles du globe. Une reine à
plusieurs bras battant la chamade de l’évolution humaine. On en sait
davantage sur le Carnaval de Nice, dont on célébrera la 150e édition
du 10 au 26 février sur le thème de "Roi des trésors du monde",
en lien avec l’Unesco, au patrimoine duquel la ville de Nice et ses
beautés sont inscrites.
C’est le maire (prêt à céder temporairement les clés de sa ville au
géant bariolé et couronné), et Pascal Condomitti, son adjoint à
l’événementiel, qui ont dévoilé, lors d’une conférence de presse à
la Villa Masséna, les secrets de cette édition 2023, réunissant, le
jour de l’ouverture, un défilé unique rassemblant, des chars
carnavalesques et fleuris, cinq corsos illuminés de 16 chars, cinq
batailles de fleurs également de 16 chars, près d’un millier
d’artistes. Et toute une série de surprises, nouvelles autant que
traditionnelles (lire par ailleurs). Une fiesta suivie,
habituellement, par 100.000 spectateurs.
À ce sujet, les choses s’annoncent plutôt bien puisque Christian
Estrosi évoque à ce jour "près de 30% de réservations hôtelières en
plus à la même époque, 95% de taux de remplissage en tribunes, des
ventes très dynamiques en promenoirs et plus 83% de ventes en lignes
par rapport à 2020". Il devrait donc y avoir foule pour suivre les
tribulations du carnaval au thème très large et très inspirant : "Que
Nice soit ce lieu pour toutes les rencontres de l’universalité des
plus beaux patrimoines du monde, explique les raisons de cet
engouement ", pronostique le premier magistrat.
Pyramide, Taj Mahal et compagnie
Alors, ce roi, qui est-il, comment est-il? Un visuel laisse
apparaître une créature plurielle. "Il représente tout
l’imaginaire d’une quête autour du monde et de ses trésors, note
Pascal Condomitti. Qui n’a jamais rêvé tenir une pyramide dans sa
main tout en étant assis sur le Colisée en enjambant le Taj Mahal ?
"
Son épouse? Là encore, plusieurs énergies se dégagent de la beauté
sculpturale au look de déesse indienne: "Elle reprend à son
compte les mystères des civilisations passées, de l’Égypte ancienne
aux Rapa Nui de l’île de Pâques, des dragons de l’Asie aux vestiges
engloutis de la Grèce antique."
Derrière ces deux chars personnifiés, 14 vaisseaux remplis de
personnages, d’animaux, de bâtiments trimbalant avec malice,
esthétique, impertinence, d’autres trésors (samba, bestiaire
fantastique, jardins de Babylone... ) exprimeront le talent des
ymagiers qui les ont dessinés, et celui des carnavaliers qui les ont
concrétisés. En version 3D, toujours aussi impressionnante. Cette
année, les quatre familles Povigna, Pignataro, Ruzziconi et Durant
se sont regroupées en collectif solidaire. Du jamais vu!
Ce savoir-faire sera concurrencé par celui des fleuristes, qui ont
la charge de 16 chars piqués d’espèces végétales méditerranéennes et
exotiques: le groupement Nouvelle Vague, conduit avec passion par
Nicole Bravi et Garden Expo représenté par Laurent Orecchini. Une
belle équipe aux mains d’or, que supervise Caroline Constantin,
directrice du carnaval. Voilà... Dans les ateliers en surchauffe de
la halle Spada, à Saint-Roch et de la Maison du carnaval, à Riquier,
des mains véloces peaufinent la monarchie censée transgresser les
règles habituelles et mettre un joli chaos en ville.

La reine, déesse des civilisations. Visuel Ville de Nice
Manelle, reine... en vrai!
Il y a la reine démesurée. Celle du char. Il y a l’autre. La vraie
reine humaine du carnaval. Aux mensurations de rêve, élue par un
jury, qui a dû départager six candidates.
Il s’agit de Manelle Souahlia, 22 ans, autoentrepreneuse venant
d’Antibes. Alliant le charme et l’élégance. Gourmande aussi, la
ravissante reine. En effet, en 2020, lors de l’édition carnavalesque
"Roi de la mode" la jeune fille avait défilé, revêtue d’une
robe en chocolat. Cette fois, elle sera parée et entourée de fleurs
et sera toujours aussi craquante.
Manelle paradera sur son char lors des batailles de fleurs en
compagnie de deux dauphines: la première, Alicia Cardelli, 21 ans,
Niçoise, étudiante en lettres modernes et la seconde, Alixia Cauro,
23 ans, chanteuse lyrique (soprano) de Cannes. Lors du couronnement
des trois demoiselles, le maire a félicité Caroline Roux, costumière
en chef des batailles de fleurs, pour la qualité artistique des
vêtements, qu’elle et son équipe confectionnent chaque année. De
vrais trésors.

La reine du Carnaval et ses dauphines, venues de toute le
département. Photo Dylan Meiffret.


Saviez-vous que le Carnaval de Nice célébrait
ses 150 ans ?
On vous raconte son histoire...
On célèbre, cette année, le siècle et demi du lancement du grand
événement niçois, le 23 février 1873.
Coup d’œil dans le rétro.

Le corso de 1875 semblable à celui de 1873, sur
la place de la Préfecture.
Soudain, sur la place de la Préfecture, apparut le char du Soleil.
La foule, qui avait pris place sur des tribunes aménagées pour la
circonstance, explosa en vivats. Des oriflammes étaient agitées aux
fenêtres. Une pluie de confetti s’abattit sur le char. En ce 23
février 1873 le "nouveau carnaval " faisait son entrée dans
sa bonne ville de Nice. C’était il y a cent cinquante ans. On
célèbre cette année le siècle et demi de son lancement.
La préfecture se trouvait alors dans le Palais Sarde. À cette
époque, le corso carnavalesque suivait le cours Saleya, tournait sur
la place de la Préfecture et repartait par la rue Saint-François de
Paule. Il se déroulait dans ce qu’on appelle le "Vieux Nice".
Derrière le char du Soleil suivaient ceux de la "Marmite du
Diable" et de l’ "Olympe" (avec Vénus et Jupiter en
personne, s’il vous plaît!) ainsi que les quatre cavalcades des "Carabiniers
d’Offenbach", des "Brigands", des "Mousquetaires"
et des "Templiers". On entendait le piétinement métallique
des sabots ferrés des chevaux sur le sol. Les cavaliers étaient
dotés d’uniformes et de bonnets carnavalesques. Les Niçois
accueillaient leur nouveau carnaval, mais la fête, elle-même, était
ancienne.
Dès le XIIIe siècle
On en trouve trace dès 1294 lorsque le comte de
Provence Charles II, duc d’Anjou, vint y "passer des jours
joyeux". Des bals s’y déroulaient à tout va – bals de la
noblesse, des marchands, des artisans, des pêcheurs et des ouvriers.
L’Église interdisait aux prêtres "de danser, de regarder danser,
de porter des cheveux longs, une barbe, des masques et des souliers
rouges ou verts ! "
Peu à peu, avec le temps, des cortèges de voitures à chevaux
apparurent. L’histoire de Nice se souvient de celui de 1821 lorsque
la Cour de Sardaigne vint passer les fêtes à Nice; de celui de 1830
qui se déroula en présence du duc de Savoie Charles-Félix; de celui
de 1856 qui eut lieu devant la mère du tsar de Russie Alexandra
Feodorovna. Après l’annexion de Nice à la France en 1860, la fête
fut encore plus belle. Mais la guerre de 1870l’éteignit. De même, la
période trouble qui suivit, au cours de laquelle Garibaldi voulut
faire revenir Nice à l’Italie, lui fit perdre sa joie.
Création du comité des fêtes
Il fallait redonner à Nice le goût de la fête! Un
homme s’y employa. Ce fut Andriot Saëtone. Ce responsable du secteur
social et des orphelins à la Préfecture, qui fut par ailleurs consul
de Grèce et consul d’Argentine mourut jeune, à l’âge de 49 ans. Il
eut pourtant le temps de créer à Nice, en 1873, le comité des fêtes.
Convainquant le maire Auguste Raynaud qu’il fallait "rendre à
Nice son ancienne splendeur ", il créa un "grand carnaval",
ainsi que le raconte Annie Sidro dans ses indispensables ouvrages
sur le sujet.
Le comité des fêtes comprenait des nobles niçois et des membres de
l’importante colonie étrangère: les comtes d’Aspremont, Arson de
Saint -Joseph, Garin de Cocconato, Diesbach (dont la villa se
trouvait à l’emplacement de l’actuelle Villa Masséna), le baron
Roissard de Bellet, le banquier Avigdor (dont la splendide villa
trônait au milieu de la Promenade des Anglais), le noble Léonard
Rozy qui hébergeait la famille du tsar lors de ses séjours niçois
dans sa Villa Peillon (actuelle clinique du Parc Impérial).
Pour faire vivre le carnaval, on fit aussi appel aux dotations
étrangères. C’est ainsi que la Société des Bains de Mer de Monaco
apporta une contribution financière qui devint, avec les années,
aussi importante que celle de la Ville de Nice. Cela faisait dire au
Journal de Monaco que "le carnaval était autant monégasque que
niçois". Cette participation financière faillit être compromise
lorsqu’en 1877 François Blanc, créateur du Casino de Monte-Carlo,
apprit qu’il allait être caricaturé sur un char de carnaval. On dut
retirer le char pour ne pas perdre la subvention.
Toute allusion religieuse prohibée
En 1873, la municipalité niçoise, inquiète des
débordements que pouvait susciter l’arrivée du nouveau carnaval,
prit cet arrêté: "Les personnes qui prendront part aux amusements
ne pourront lancer que des fleurs ou des dragées de petite taille...
Il est interdit de lancer tout objet qui puisse blesser, endommager
ou salir les vêtements tels que des œufs remplis de quelque matière
que ce soit... Toute allusion politique, religieuse ou militaire est
rigoureusement interdite et tout déguisement qui pourrait blesser la
décence ou les mœurs..."
Le Journal de Nice du 24 février 1873 s’éblouit. Bien avant notre
actuelle spécialiste du carnaval à Nice-Matin, Christine Rinaudo, le
chroniqueur de l’époque raconte: "Les cavalcades ont fait dans la
foule un merveilleux effet. On lance des fenêtres, des tribunes, des
torrents de confetti, c’est une vraie bataille... Le soir, la ville
et le château illuminé n’étaient qu’un ruban de feu." Le nouveau
carnaval de Nice était lancé!

"Interdiction d’insulter ou de provoquer!"
Lors du premier carnaval, la municipalité de Nice avait pris des
dispositions d’ordre public. Outre ceux publiés dans notre récit,
voici quelques articles de l’Arrêté de la Ville de Nice du 20
février 1873:
Article 3 : Toute personne masquée, déguisée ou travestie, qui se
montrera soit dans les rues soit dans les bals ne pourra porter
aucun bâton ni arme d’aucune espèce...
Article 4 : Il est défendu à toute personne masquée, déguisée ou
travestie, d’insulter ou de provoquer qui que ce soit ; d’entrer
dans les maisons ou boutiques contre le gré des habitants ; de
chanter dans les rues ou lieux publics des chansons injurieuses ou
qui, sans renfermer des injures proprement dites, contiendraient des
désignations offensantes.
Article 5 : Toute cavalcade dans les rues de la ville, au Cours ou
dans les faubourgs, devra cesser avant la chute du jour.
Article 6 : Tous les bals devront cesser à une heure après minuit,
au plus tard, à moins d’une autorisation spéciale de la police.


Voilà à quoi ressemblera la future "forêt urbaine"
de Nice entre le TNN et Acropolis

Ici la vue du parc avec au fond les hôtels de
l’esplanade Kennedy.
Il faudra attendre 2025 pour fouler le vaste parc paysager qui sera
aménagé à la place de l’ancien TNN et d’Acropolis, dans le
prolongement de la promenade du Paillon à Nice.
Le maire de Nice Christian Estrosi a dévoilé ce mercredi après-midi
de nouveaux visuels de la "forêt urbaine". Ce parc s’inscrit
dans le prolongement de l’actuelle promenade du Paillon.

Une bambouseraie est prévue dans la forêt urbaine.
Il va relier la coulée verte existante au Mamac (Musée d’art moderne
et d’art contemporain); le bâtiment abritant le Théâtre national de
Nice ayant été démoli en 2022. Et se poursuivra ensuite à la place
de l’Acropolis, qui va lui aussi disparaître.

Des patios seront aménagés près de la bibliothèque Louis Nucéra.
La philosophie du projet est de supprimer les îlots de chaleur en
végétalisant. Pour cela, des arbres et arbustes seront plantés. "Des
essences absorbant le CO2 seront privilégiées", ajoute Christian
Estrosi.

Sur le boulevard Risso, les trottoirs seront plus larges pour les
piétons et les commerçants.

L’entrée de la bibliothèque se fera ici, par le jardin Sosno.

La vue aérienne de l’ensemble.

Plusieurs types d’espaces seront aménagés pour différents usages.

La vue sur la traverse Barla.

L’accès au belvédère de la Bourgada par les restanques.

La vue sur le Mamac depuis l’actuelle promenade du Paillon.
Photos : Alexandre Chemetoff et associés.


Près de 71.000 visiteurs pour découvrir Hokusai
et sa vague au Musée des arts asiatiques de Nice
Des chiffres record presque jamais égalés dans l'histoire du Musée
des arts asiatiques de Nice. 70.929 visiteurs ont parcouru les
allées du musée pour aller à la rencontre de la vague la plus
célèbre de l'histoire de l'art. Un raz de marée signé Hokuzai !

Le Musée des arts asiatiques accueillait depuis le mois de
septembre dernier et jusqu'au 29 janvier, l'exposition "Hokusai :
voyage au pied du mont Fuji ".
Un événement, car pour la première fois, la célèbre vague de
l'artiste japonais était exposée à Nice, parmi 126 estampes. Une
œuvre datant de 1830 qui a connu un beau succès.
"En effet, avec près de 71 000 visiteurs, c'est le record de
fréquentation pour le musée depuis son ouverture en 1998 ", nous
précise ce 1er février Adrien Brossard, conservateur du patrimoine
et directeur du Musée départemental des arts asiatiques. Il espère
aujourd'hui que 20% de ces visiteurs reste fidèle au lieu.
Des gens sont venus de loin... Nous aurions même fait plus d'entrées
en la proposant durant l'été, mais ma volonté était vraiment de
l'offrir sur un temps scolaire pour que les écoles en profitent et
les habitants de la région aussi en priorité,
Adrien Brossard : "70.929 visiteurs ont parcouru les allées du
musée pour aller à la rencontre de la vague la plus célèbre de
l'histoire de l'art. Un raz de marée signé Hokuzai ! "
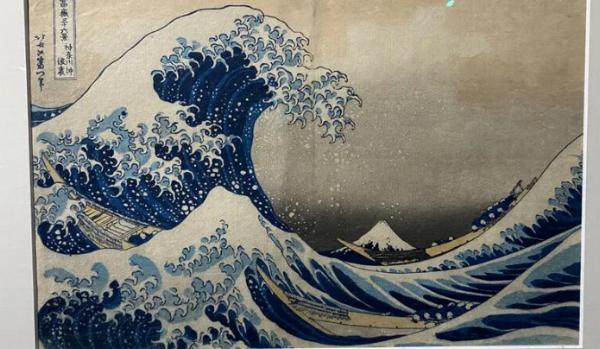
Si parfois les files d'attente étaient un peu longues et la boutique
de souvenirs vidée de ses catalogues et objets liés à l'exposition,
Adrien Brossard, s'en excuse mais rassure les amateurs de gadgets et
beaux livres : "nous en sommes au 5e réassort ! Donc, oui,
catalogue et affiches sont de retour ! "
Plus de 3 000 catalogues ont d'ailleurs été vendus.
Tout savoir sur cette oeuvre... et les autres !
C'est la vague la plus célèbre du monde. Elle a inspiré de nombreux
artistes dont Van Gogh, Monet, Debussy ou Renoir. Elle sera exposée
à Nice pendant quatre mois au milieu de 126 autres estampes de son
auteur, le célèbre Hokusai.
L'œuvre intitulée "Sous la vague au large de Kanagawa" est
une estampe issue d'une série baptisée "Trente-six vues du Mont
Fuji " datant de 1830.
Une estampe est une impression à l'encre sur du papier.
Adrien Brossard : "Le résultat final, c'est le papier, mais c’est
tout un processus de fabrication de création très spécifique. Il y a
beaucoup d’étapes. Au départ, il y a un artiste qui peint et ensuite
cette peinture, cette image qui est créée de l’esprit de l’artiste
est transposée sur des planches en bois qui sont utilisées pour
imprimer patiemment les différents tirage."
Au 17e siècle au Japon, la technique nommée " ukiyo-e",
traduit par "monde flottant" gagne en popularité.
Edo la future Tokyo est en pleine effervescence. La ville, en pleine
construction, voit se développer les combats de sumos, les théâtres
Kabuki, et les lieux de plaisir ou courtisanes accompagnent les
hommes dans leur vie en dehors du travail.
"Les concepts de vie éphémère, et l'envie de vivre dans l'instant
présent se développent " raconte Adrien Brossard.
"Il y a tout un monde d'amateurs de l’estampe qui se créait. Car
on a tout un monde qui n’est plus de la noblesse, qui correspondait
plutôt à une bourgeoisie qui est plus ou moins aisée, et qui a envie
de s’entourer de belles choses. Et parmi ces belles choses qui les
fascinent, on a ces images de l’ukiyo-e, les images du monde
flottant."
Cette estampe leur rappelle un sentiment de liberté en dehors de
leur vie très dure. Ça leur permet de s’évader et c’est là qu’on
retrouve le côté flottant
Trente-six vues du Mont Fuji
Les estampes connaissent de beaux succès aux 17 e et 18 e siècles.
Mais celui qui va faire connaître l'estampe japonaise dans le monde
entier arrive au 19 e. Avec sa série "Trente-six vues du Mont Fuji"
en 1830, Hokusai relance la fascination autour du monde flottant.
Et l'élément qui va le démarquer de ses paires, est tout droit venu
d'Occident : le bleu, omniprésent.
"La caractéristique à cette série, c'est l’argument de vente,
puisqu’on a tracé d’une publicité qui annonce le lancement de cette
série et l’éditeur savait que ça allait cartonner. L’argument phare,
c’était : regardez, il y a un nouveau pigment, et ce pigment vient
de l’occident ! C’est un bleu de Prusse qu’on appelle aussi bleu de
Berlin."
Le pigment met un certain temps à arriver au Japon et à devenir
abordable pour les artistes. Un des premiers à l'utiliser, c'est
Hokusai. "C’est ce qui fait toute la force, toute la puissance de
cette série inédite en 1830 ".
Le paysage n'est plus un simple décor, mais devient le sujet à part
entière. Les personnages admirent le Mont Fuji, ce plus haut sommet
du Japon.
La série est un succès au Japon, mais s'exporte aussi jusqu'en
Occident.
Adrien Brossard : "Cette vague est dans l’imaginaire
collectif depuis plus de 200 ans."
La "vague" fait le tour du monde
"Dès le 19 e, cette estampe va inspirer des artistes en occident.
Avec notamment "La mer" composée par Debussy. Et cette fascination
va montrer aux Japonais à quel point ils ont une production
artistique extraordinaire. Et c’est resté" explique Adrien
Brossard.
Impossible aujourd'hui d'être passée à côté de cette œuvre. Dans un
livre, un film, un documentaire, affiché chez un de vos amis, vous
avez forcément croisé la route de la fameuse "vague" d'Hokusai.
La culture pop a beaucoup participé à cette popularisation. Elle se
décline même en briques Lego :

"Il y aura une relance au 20 e siècle puisque la vague va être
réutilisée, elle va être réinterprétée, on va la détourner. On va
aussi l’utiliser pour faire des logos de marques. Et c’est une image
efficace, c’est une vague, une montagne, du bleu. C’est la marque
des grandes œuvres d’être simple, d’être efficace et en fait, tout
le monde l’a vu au moins une fois dans sa vie" précise Adrien
Brossard.
Le directeur du musée, amoureux de la culture asiatique, est très
fier d'avoir pu accueillir le tableau à Nice.
"Je me rappellerai toute ma vie de la première fois que je l’ai
vu cette vague et c’est un moment que j’ai envie de partager avec le
public."
Une oeuvre pour la première fois exposée dans la région et qui va
repartir d'où elle vient avec les 125 autres estampes : dans la
collection de Jerzy Leskowicz
Pour ceux qui regrettent déjà le bleu prusse et les détails des
oeuvres, voyez
la
galerie en ligne
;-)


Les travaux de la construction du viaduc pour
relier la route au tunnel de Tende ont commencé

Depuis le passage de la tempête Alex en octobre
2020, l'accès à l'Italie via le tunnel de Tende est fermé
Lors de la tempête Alex, en octobre 2020, la route qui amenait les
habitants de la Vallée de la Roya au Piémont italien a été détruite.
Pour relier Tende au nouveau tunnel, il faudra bientôt passer par un
pont au-dessus du vallon de la Cà. Sa construction a commencé cet
hiver.
Près de deux ans et demi après le passage de la tempête Alex dans la
Vallée de la Roya, les dégâts qu'elle a causé n'ont toujours pas
fini d'être réparés. Il manque toujours le viaduc qui doit passer
au-dessus du vallon de la Cà qui permettra de relier la France au
Piémont par le tunnel de Tende. Les travaux viennent de débuter.
La construction de ce pont a été décidée en mai 2021. Il fera 65
mètres de longueur et prendra la forme d'un arc. Il permettra de
passer par-dessus l'éboulement créé par la tempête. C'est l'Italie
qui est chargée de sa construction. "Le carottage pour la
construction de la cloison de micro-pieux destinés à consolider
l'endroit côté France est en cours", a indiqué l'Anas, la
Société nationale pour les routes.

Pour enjamber l'éboulement causé par la tempête Alex et relier la
RD6204 au tunnel de Tende, la France et l'Italie ont validé la
construction d'un viaduc de 65 mètres de long
Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya, se réjouit du début des
travaux :
"C'est ce qu'on attend aujourd'hui avec le plus d'impatience. La
quasi totalité des chantiers sont achevés mais le vrai point noir en
termes de déplacement c'est l'accès au tunnel de Tende pour aller
dans le Piémont italien."
L'accès à ce tunnel est essentiel pour le dynamisme de la Vallée de
la Roya. "Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec des
fournisseurs et des clients situés dans le Piémont ", explique
le maire de Breil-sur-Roya.
"La Vallée vivait en partie grâce à ce transit ",
insiste-t-il.

Depuis le passage de la tempête Alex en octobre 2020, l'accès à
l'Italie via le tunnel de Tende est fermé
Actuellement, les deux tunnels du Col de Tende sont toujours en
travaux. L'ancien tunnel doit être remis aux normes et le nouveau
tunnel est en train d'être creusé. La circulation dans le nouveau
tunnel est prévue pour octobre 2023 et l'ouverture de l'ancien
tunnel rénové et sécurisé est prévue pour 2025.
Sébastien Olharan dit rester dubitatif face au planning prévisionnel
des travaux : "On nous annonce une possibilité de pouvoir
circuler dans les tunnels en octobre, ce serait très bien, même
inespéré. On a vu que les délais étaient extrêmement longs,
notamment pour se fournir en acier."

Le tunnel de Tende (au fond de l'image à
droite) est inaccessible pour aller en Italie. La tempête Alex a
détruit sa route d'accès en octobre 2020
À cause de la tempête Alex qui a condamné l'accès à l'ancien tunnel,
le temps de trajet pour se rendre en Italie a été largement
rallongé.
"La solution la plus rapide est de prendre un train depuis Tende",
indique Sébastien Olharan. "En été, on a pu circuler sous
certaines conditions sur l'ancienne route historique du col de Tende
avec ses 46 lacets, ajoute-t-il. Mais c'est impossible en hiver à
cause de la neige."
En hiver, en voiture, l'unique moyen d'y accéder est de faire un
grand détour par Vintimille.

La route des 46 lacets, qui mène de Tende au Col de Tende. C'est
le seul chemin pour relier la France et l'Italie depuis que la
tempête Alex a emporté la route qui mène au tunnel de Tende. La
circulation y est très réglementée
Un train des neiges va être mis en place, "avec
la gratuité pour les scolaires", promet-il.
Deux autres ponts ont déjà été construits entre Breil-sur-Roya et
Fontan en octobre dernier. La circulation sur ces ponts devait être
ouverte en janvier, mais les conditions météorologiques n'ont pas
permis de finir à temps.
Côté français, le département des Alpes-Maritimes a promis de voir
s'achever "tous les travaux d’infrastructures" en 2023, soit
trois ans après le passage de la tempête Alex.


L'incroyable découverte d'un site préhistorique
dans les Alpes-Maritimes
Une "mini vallée des Merveilles" a été découverte à
Valdeblore. Cette fois il ne s’agit pas de gravures mais de
peintures rupestres. Tracées du bout du doigt par des hommes du
néolithique... Il y a 4.000 ans !

120 peintures rupestres, vieilles de 4.000 ans, ont été
découvertes au-dessus du hameau de La Roche à Valdeblore. Photo
Sébastien Botella
Il s’agit d’une découverte majeure: 120 peintures rupestres. Des
motifs représentant des guerriers du néolithique et tracés du bout
doigt par nos ancêtres il y a 4.000 ans.
Les pigments utilisés ne présentent aucune trace de modernité. Il
s’agit de Cargneule broyée, un agrégat rocheux qui constitue le
socle de Valdeblore.
C’est là, entre Tinée et Vésubie, que les fresques ont été
découvertes. Grâce à la passion de deux enfants du pays, les judokas
Marcel et Loïc Piétri.
Une trouvaille authentifiée par l’Institut de Préhistoire et
d’Archéologie Alpes Méditerranée dont le président, Claude Salicis,
souligne le caractère exceptionnel de cette découverte.

L’un des sites les plus importants de toute la Provence
"À vingt kilomètres à vol d’oiseau du Mont Bégo et de ses
célèbres gravures. Sauf qu’il s’agit cette fois de peintures
rupestres. Or il n’en avait été identifié que deux à travers tout le
département. Ici nous en avons trouvé 120 d’un coup. Ce qui fait de
ce site l’un des plus important de toute la Provence", insiste
le président de l’IPAAM.
Et pourtant elle est passée inaperçue lorsqu’il y a quelques années
des voies d’escalade ont été aménagées sur ces falaises surplombant
le hameau de La Roche à Valdeblore.
La paroi avait alors été en partie décroûtée, endommageant du même
coup certaines représentations. Des motifs classiques du néolithique
qui semblent témoigner de la violence de cette époque
post-glaciaire.
Une Histoire vieille de plus d’un million d’années
Le site de Valdeblore était sans doute un lieu de recueillement, un
sanctuaire pour guerriers celto-ligures. Au fond de grottes votives,
comme à Levens, au sommet d’une colline comme à La Plastra, les
chercheurs ont mis au jour d’autres traces de la présence de l’homme
sur la Côte d’Azur.
Elle remonterait même à plus d’un million d’années. Depuis tout ce
temps, l’homme n’a cessé de modeler ce territoire. Même si les
traces de son passage sont parfois tombées dans l’oubli.
Comme à Valdeblore, il faut parfois un petit coup de pouce du destin
pour réécrire le grand livre de notre Histoire.
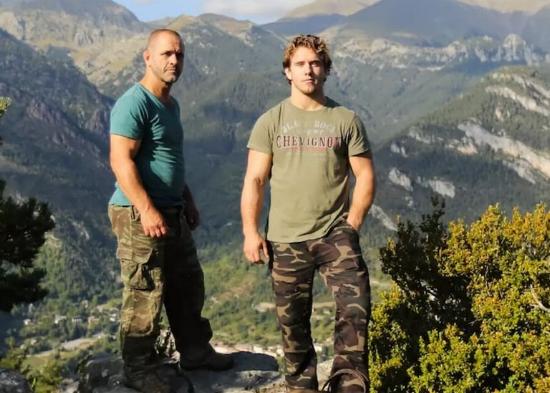
Marcel et Loïc Pietri, les "inventeurs" des peintures rupestres
de Valdeblore, leur terre d’élection... Photo DR.


120 peintures rupestres, vieilles de 4.000 ans, ont été
découvertes au-dessus du hameau de La Roche à Valdeblore. Photo
Sébastien Botella.


Le noyau interne de la Terre se serait mis à
tourner à l'envers : faut-il s'inquiéter du phénomène ?
.
.
.
Une étude scientifique montre que le cœur de notre planète se
serait même arrêté de tourner avant de changer son sens de rotation.
Il y a de quoi avoir le tournis. D'après une étude scientifique
publiée le 23 janvier 2023 dans Nature Geoscience, le sens de
rotation de la Terre pourrait changer...
Une information qui pourrait paraître anodine, mais qui d'un point
de vue scientifique serait fascinante. Et un tel phénomène pourrait
aussi avoir quelques conséquences planétaires.
Qu'est-ce que le noyau interne ?
Déjà avant de comprendre en quoi cette découverte pourrait être
exceptionnelle il faut savoir ce qu'est le noyau interne terrestre.
Le noyau terrestre est la partie centrale de notre planète qui
occupe 17 % de son volume et représente 33 % de sa masse, environ.
Il est constitué de deux parties : le noyau externe, liquide et le
noyau interne appelé "graine", solide essentiellement
constitué de fer métallique.
C'est ce dernier qui a été étudié. Cette boule métallique est
entourée du noyau liquide donc, et "flotte" en quelque sorte.
Cette sphère dont les températures avoisinent les 6 000 °C tourne
comme la planète Terre avec une rotation qui lui appartient et
aurait une taille équivalente à la planète Pluton. Ce noyau est
situé à quelque 5 000 km sous la surface.
Une hypothèse à étudier
Dans cette étude, les chercheurs chinois tentent de démontrer avec
des calculs mathématiques issus notamment des données sur les ondes
sismiques, que le noyau interne de la Terre changerait de sens de
rotation tous les 35 ans, comme le rapporte Le Parisien.
Avec "l'analyse des ondes sismiques répétées du début des années
1990 ", ils ont déduit que "toutes les trajectoires qui
présentaient auparavant des changements temporels significatifs ont
peu changé au cours de la dernière décennie. Ce schéma globalement
cohérent suggère que la rotation du noyau interne s'est récemment
interrompue".
Pour eux, la rotation du noyau s'est arrêtée en 2009 pour repartir
dans le sens opposé. Une autre étude scientifique avait démontré
qu'un changement de cet ordre s'était produit en 1970.
Le cycle complet de ce noyau serait donc de 70 ans, pour revenir
dans le sens de départ, comme le rapporte TF1.
Des résultats sujets à controverse
Les scientifiques chinois ont publié cette étude très sérieuse en
restant très prudents sur les conclusions qui en découlent mais qui
pourraient permettre d'être approfondies.
D'autres chercheurs ont d'ailleurs tenu à expliquer que cette
publication était à prendre avec des pincettes. L'hypothèse divise
les scientifiques. Certains avancent que ce cycle pourrait être plus
rapide, d'autres que les outils utilisés sont complètement
insuffisants pour émettre la moindre hypothèse sur le sujet.
Des conséquences concrètes ?
Sans être une preuve, pour les chercheurs chinois, les résultats
publiés correspondent parfaitement avec des changements géophysiques
observés.
"Cette périodicité multidécennale coïncide avec des changements
dans plusieurs autres observations géophysiques, en particulier la
durée du jour et le champ magnétique", précisent-ils.
En effet, même si cela peut paraître anecdotique, ce changement de
rotation et même son arrêt pourraient avoir des conséquences sur le
champ magnétique terrestre mais aussi sur la longueur d'une journée,
de quelques fractions de seconde par an.
Mais cet écart de temporalité est aussi dû à d'autres facteurs : la
gravité de la Lune, les mouvements des océans...
Des conséquences déjà prises en compte : un réglage de l'heure
universelle a été effectué pour respecter le temps réel de la
rotation de la Terre. Ainsi 27 secondes "intercalaires" ont
été ajoutées au temps universel coordonné (UTC) depuis les années
1970.


L'impressionnante démolition du Théâtre
National de Nice en images

Quand le TNN était encore debout en janvier
2022
Il n’aura fallu qu’une dizaine de mois pour que tombe le Théâtre
national de Nice. L’édifice conçu il y a une trentaine d’années
n’est plus, et cela change la physionomie des lieux.
Lorsque l’on sort de la promenade du Paillon par la traverse de la
Bourgada, une nouvelle perspective saute aux yeux.
Le TNN n’est plus et laisse désormais le champ libre au Mamac. Le
changement est saisissant et, ces jours-ci, rares sont les passants
à ne pas s’offrir une courte halte pour admirer ce panorama inédit.
Les Niçois vont probablement vite s’y habituer, comme ils se sont
accoutumés à apercevoir le lycée Masséna depuis le boulevard
Jean-Jaurès lorsque la gare routière avait cédé la place à la coulée
verte. Le cœur de ville a évolué ces dernières années et le
processus se poursuit.
Le Paillon qui coulait à ciel ouvert a été recouvert. Puis ont été
aménagés des édifices aujourd’hui disparus ou voués à l’être: la
gare routière, le TNN, Acropolis. Seul subsistera le musée au milieu
d’une nouvelle "forêt urbaine".
Quoique l’on pense de ces opérations, il est à parier que les
usagers s’approprieront bien vite ces jardins et c’est avec
nostalgie qu’ils se souviendront de la physionomie des lieux au
début 2022. Car il aura fallu moins d’un an pour que tout change.
1. Le Mamac désormais visible

Le Mamac vu désormais depuis la coulée verte Photo Sébastien
Botella.
Désormais, la façade du Mamac est visible depuis la promenade du
Paillon. L’occasion de se rendre compte qu’on avait peu l’habitude
de la voir. Et que, finalement, ses couleurs font écho au dallage de
la Bourgada.
2. Effeuillage, désamiantage et vidage des lieux

Alors qu'il vit ses derniers jours, le TNN à Nice
est immortalisé par de nombreux passants

La façade du TNN a d'abord été effeuillée avant de désamianter
les lieux et de les vider. Photo Cyril Dodergny.
Le 25 novembre, on aperçoit une mini-pelle qui a été grutée sur le
toit du TNN. Étant donné son emplacement, impossible de faire
imploser le bâtiment.
Sa façade a d’abord été effeuillée: les plaques de marbre ont été
déposées. Ensuite, l’intérieur a été désamianté et vidé avant que
les murs tombent.
3. L'écrêtage

Le 5 décembre dernier, les engins d'acier grignotaient petit à
petit le TNN Photo. J.-F. Ottonello.

"C’est impressionnant de voir cette machine
grignoter les murs": face à ce qu’il reste du TNN, les passants
entre curiosité, nostalgie et amertume
La technique de l’écrêtage a été utilisée pour démolir le TNN. Comme
il est positionné sur une dalle au-dessus du Paillon, le poids est
limité.
Il a donc fallu utiliser des engins pas trop lourds qui ont grignoté
l’édifice du haut vers le bas.
D’où cette impression d’assister au repas gargantuesque de monstres
d’acier dévorant le bâtiment, ici le 5 décembre.
4. La démolition impressionne

Le TNN éventré Photo Frantz Bouton.
Le 13 décembre, on a l’impression de voir un théâtre éventré. Image
surprenante où le passant semble être sur scène, face à la salle
rouge où se tenaient jadis les spectateurs.
5. Quand le TNN était encore debout

Le TNN, le 18 janvier 2022 Photo Eric Ottino.
Le 18 janvier 2022, la façade en marbre du TNN se dresse encore à la
sortie de la promenade du Paillon.
C’est le lendemain qu’a été affiché le permis de démolir.
Le bâtiment avait été dessiné par l’architecte Yves Bayard. Sa
fille, Martine Bayard, avait formé un recours pour s’opposer à sa
destruction, en vain.


Un jeu pour la sensibilisation au milieu marin, bientôt sur plateau
.
.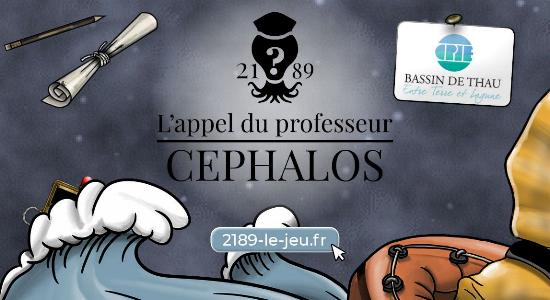
.
Plonger dans l'univers d'un bateau et résoudre des énigmes :
l'escape game inventé par le CPIE du Bassin de Thau aborde les
enjeux de demain de manière ludique.
"Vous êtes en 2189. Vous captez un S.O.S. de Céphalos. Ce
scientifique a été pris dans une terrible tempête. Son navire menace
de sombrer emportant avec lui son carnet de recherches. Votre
mission : retrouver ce carnet et sortir indemne du voilier !
Acquisition de connaissances garantie ! "
L’escape game "2189, l’appel du professeur Céphalos" est une
création du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) du Bassin de Thau. Accessible en ligne, il aborde des thèmes
en lien avec la préservation de la biodiversité marine : changement
climatique, érosion littorale, élévation du niveau de la mer,
pollution plastique, espèces envahissantes, destructions d’habitats…
Autant de difficultés que pourraient rencontrer les générations
futures.
À noter : une version jeu de plateau sort début 2023.
D’ici là, il est à découvrir sur :
2189-le-jeu.fr
ou sur :
https://view.genial.ly/6272aab16ca7ed001eff745c


Décryptage : le vin de garde ou le mystère
d’une alchimie, de la vigne au jour de l'ouverture de la bouteille
..
..
..
Longtemps, le Languedoc a traîné une réputation de vignoble
et de vins ordinaires, que depuis trois décennies
l’inlassable travail de vignerons et caves coopératives a
battue en brèche, élevant la renommée de leurs flacons et
démontrant leur savoir-faire. Avec leurs terroirs variés,
exigeants, leur identité, le Languedoc et le Roussillon ont
aussi pris pied sur un territoire que le grand public voyait
réservé aux bordeaux, aux côtes-du-rhône ou aux bourgognes,
celui des vins de garde. Dans l’Hérault, à Montpellier, pour
prouver que ce n’était pas usurpé, le Département a créé une
œnothèque dont chaque année on extrait quelques trésors que
l’on ausculte.
Sur les cols anonymisés, un simple numéro. Des crachoirs sur
les tables rondes du château d’O et des bouteilles alignées
devant des dégustateurs, nez fin perdu dans les larges
verres, un stylo à la main. Ils sont œnologue, vigneron,
sommelier, critique professionnel, là pour trancher sur ces
rouges dont on espère qu’ils ont bien vieilli. "Il ne
s’agit pas de savoir, leur a-t-on intimé, si celui-ci est
meilleur que celui-là, mais de conclure, in fine, à sa
capacité de garde…"
1 - Un vin de garde : de quoi parle-t-on ?
Vin de pays, AOP, cru classé ou vin de cépage, peu importe : un vin
de garde ne connaît pas ces classifications. Il s’agira plutôt de
rouges, "les rosés et blancs tiennent moins longtemps",
justifie l’œnologue Benoît Calmels. Et c’est aussi ainsi qu’il en va
"dans l’imaginaire des gens, dit Didier Ollé, enseignant à
Montpellier SupAgro. Certains s’y essaient, mais le problème du
blanc, outre l’absence de certaines molécules, c’est la couleur
qu’il prendra, tirant sur un brun qui peut dérouter le consommateur."
Et le temps ? "Un an, c’est un vin de garde. Ce n’est pas
nécessairement associé à une durée considérable", il faut aller
chercher une définition ailleurs. Érudite : "C’est un vin qui
traversera le temps dans un esprit d’échange et de structure de la
mémoire climatique", envisage le sommelier Thierry Boyer.
Factuelle : "C’est un vin qui a une marge d’amélioration, qui va
s’affiner, se patiner, se compléter avec l’action du temps",
résume son collègue Sergio Calderon, du restaurant Le Suquet, à
Laguiole.
A lire aussi : Sergio Calderon, sommelier
chez Bras : "Le vin ce ne sont pas des mathématiques, il faut une
part de hasard "
Une chose est sûre : il ne vieillit pas "il s’élève, au sens
littéral, vers plus haut ".
2 - Une œuvre qui va débuter à la vigne
Par essence, le vin de garde est une exception, "le prestige, la
rareté, 2 à 3 % de la production d’un domaine comme d’une
appellation", observe Thierry Boyer. Guillaume Daumond, le
vigneron de Folle Avoine, à Vendargues dans l’Hérault n’excède
jamais 1 200 cols par an de ses deux cuvées de garde. "Et encore
pas tous les ans, ça dépend de la qualité du raisin."
Car la matière première est ici plus essentielle que jamais. "Ça
se construit à la vigne", insiste Marc Esclarmonde, œnologue
conseil. "En fonction de son style, comme un peintre avec sa
palette, décrit Serge Navel, dégustateur pour le magazine Terre
de vin, le vigneron choisira ses meilleures parcelles, son
encépagement, sa taille" pour réduire le rendement.
La récolte pèsera sur la maturité des raisins, notamment des pépins
– "mûrs, ils s’écrasent sans laisser d’amertume".
Le vigneron continuera à la cave en choisissant sa macération, son
procédé de vinification, tel type de cuves, il “boisera” ou
pas, etc. Il va "échafauder " le vin pour lui donner les
capacités de franchir les années, plus de tanins, un certain degré
d’alcool, une acidité marquée. La suite est affaire de chimie.
3 - Oxydation, réduction tanins, anthocyanes
Une fois dans la bouteille, l’histoire va continuer, "complexe"
et en partie "mystérieuse", dit Didier Ollé : "Il y a plus
de mille molécules aromatiques. Comment savoir comment chacune
évolue individuellement, leurs interactions ? " Imaginons une
bouteille à l’horizontale : "En bas, pas d’oxygène, il se produit
une réduction. En haut, un ciel gazeux entre le vin et le bouchon de
liège, perméable, et des échanges de gaz à travers celui-ci avec la
pièce : vous avez une oxydation." Ces transformations
physico-chimiques vont affecter structure, arômes et couleur.
Les tanins "vont se polymériser, s’additionner les uns aux autres
et moins réagir ensuite à nos protéines buccales", explique
Sébastien Pardaillé, du laboratoire Natoli & Associés.
4 - Ce qu’il y gagne et ce qu’il peut y perdre
Le succès n’est pas écrit, "il y a plus à perdre qu’à gagner si
dans la cave la température fait le yoyo ! ", lâche Marc
Esclarmonde. Mais si tout se passe bien, "l’élevage noble fait
acquérir au vin une belle patine et comme un meuble il se fait doux
au toucher ", sourit Sébastien Pardaillé. La couleur des rouges
tendra à aller "du violet vers l’orange et le brun", observe
Nicolas Calmels.
Sergio Calderon : "Le passage du temps va révéler son origine,
effacer les arômes primaires, fruités, et faire ressortir des arômes
secondaires, voire tertiaires. Des notes d’évolution qui vont donner
plus de complexité, des tanins beaucoup plus suaves, laisser place
au terroir."
Didier Ollé parle "d’arôme de bouquet typique", Marc
Esclarmonde de notes d’humus et de sous-bois, chocolatées, voire de
torréfaction. "S’il se bonifie ? Je ne sais pas, c’est à
l’appréciation de chacun. Il n’y a pas de mauvais vin, il y a des
vins à défaut."
Bibliothèque de vins
Faire des vins de garde, "les vignerons en étaient sûrs. Mais
après avoir pris le virage de la qualité, il fallait encore le
démontrer et gagner ces quartiers de noblesse." Directrice de
l’Observatoire viticole départemental, Gisèle Soteras est l’une des
pilotes de l’Oenothèque, un projet de suivi du vieillissement des
vins sans équivalent à cette échelle géographique.
Il y a tout juste dix ans, dans les tréfonds de Pierresvives, à
Montpellier, le Département a rangé sur des étagères en pierre de
Beaulieu 1 728 bouteilles, soit 24 unités de 72 domaines héraultais
qui avaient répondu à un appel à candidature. 32 vignerons se sont
ajoutés en 2012, une nouvelle vague de flacons est entrée dans le
lieu l’année suivante. "Nous avons environ 2 300 bouteilles
aujourd’hui ", conservées dans le noir à température (16°) et
hygrométrie régulées et télésurveillées.
Chaque année, une dégustation est organisée, examens visuel,
olfactif et gustatif assortis d’un jugement global. "Toutes les
données, indique Gisèle Soteras, font l’objet d’un traitement
statistique pour savoir comment se comportent les vins, comment ils
évoluent " et la présence de trois millésimes offre de faire de
la "répétition. Cela permet de savoir si un cru s’avère un grand
vin de garde par le hasard du millésime ou par le savoir-faire du
vigneron et la qualité du terroir."
Considéré comme l'un des meilleurs sommeliers de la planète -
l'association Les grandes tables du monde l'a consacré en ce sens
l'an passé -, l'Argentin Sergio Calderon, responsable de la cave du
Suquet, le restaurant de la famille Bras à Laguiole, en Aveyron,
livre quelques conseils sur la manière de conserver puis déguster un
vin de garde, regrettant que l'on consomme souvent le vin trop tôt.
Quelle est votre définition d'un vin de garde ?
C'est un vin qui a une marge d'amélioration, qui va s'affiner, se
patiner, se compléter avec l'action du temps. Pour un vin rouge, le
passage du temps va révéler son origine, effacer les arômes
primaires, fruités, et faire ressortir des arômes secondaires voire
tertiaires. Des notes d'évolution qui vont donner plus de
complexité, des tanins beaucoup plus suaves, laisser place au
terroir.
Pourquoi certains vignobles français ont-ils davantage de
réputation que d'autres en la matière ?
Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, on effectuait moins
d'interventions, on pouvait jouer sur le temps de cuvaison mais on
avait moins de techniques œnologiques ; c'était davantage le
millésime qui dictait le temps de garde d'un vin. Malgré tout,
certaines régions, le Bordelais avec ces cépages cabernets, merlot,
malbec, le Rhône avec la syrah et la grenache, produisaient des vins
qui nécessitaient du temps pour s'affiner. À partir de 1985, 1986,
l'œnologie moderne, avec l'apparition de la table de tri, de la
régulation de la température au cours de la vinification, a fait que
l'on a un peu lissé le phénomène du millésime.
Si l'on va vers le Languedoc-Roussillon, on faisait des vins au
rendement plus important, on abreuvait un petit peu le consommateur,
mais depuis une vingtaine d'années, on affine la vinification et on
obtient des vins beaucoup plus complexes qui nécessitent du temps
pour donner toutes leurs caractéristiques.
Garder des vins reste-t-il une pratique très répandue ?
Dans beaucoup de pays, constituer une cave, c'était constituer un
patrimoine ; il y a souvent beaucoup de sentimental dans cet acte,
pendant les guerres on cachait les vins pour ne pas se les faire
piller. On a beaucoup perdu, on est dans l'instant, on a tendance à
boire les vins trop jeunes, alors que le vin a un rapport
extraordinaire avec le temps. Il permet de le remonter.
Dans la région, on a tendance à les consommer trop rapidement. À
tort, je pense, parce que si ces vins sont bien conservés on en aura
un autre aperçu.
Bien conservés, c'est-à-dire ?
Dans les conditions optimales. À une température de 12-14° toute
l'année sans variation, avec une hygrométrie de 70-80 %, on
parviendra à un épanouissement.
Comment savoir qu'il est temps de le consommer ?
Il y a une courbe de maturation du vin, donc comment le savoir :
lorsqu'on met un vin en bouche, que les tanins sont encore un peu
agressifs, anguleux dans notre jargon, il faut attendre. Lorsque la
courbe est au sommet, que le vin a atteint son apogée, il devient
tout autre, plus expressif et plus harmonieux en bouche. Le vin
s'achète chez le producteur, chez les bons cavistes, où l'on délivre
un conseil et le mien est de ne jamais acheter une seule bouteille.
Par trois, par six, cela permet de goûter, voire que le vin est
peut-être en devenir, y revenir quelques années après, suivre son
évolution jusqu'à déterminer qu'il est optimal.
.


Sergio Calderon, sommelier chez Bras :
"Le vin ce ne sont pas des mathématiques, il faut une part de
hasard"
..
..
..
Considéré comme l'un des meilleurs sommeliers de la planète -
l'association Les grandes tables du monde l'a consacré en ce sens
l'an passé -, l'Argentin Sergio Calderon, responsable de la cave du
Suquet, le restaurant de la famille Bras à Laguiole, en Aveyron,
livre quelques conseils sur la manière de conserver puis déguster un
vin de garde, regrettant que l'on consomme souvent le vin trop tôt.
Quelle est votre définition d'un vin de garde ?
C'est un vin qui a une marge d'amélioration, qui va s'affiner, se
patiner, se compléter avec l'action du temps. Pour un vin rouge, le
passage du temps va révéler son origine, effacer les arômes
primaires, fruités, et faire ressortir des arômes secondaires voire
tertiaires. Des notes d'évolution qui vont donner plus de
complexité, des tanins beaucoup plus suaves, laisser place au
terroir.
Pourquoi certains vignobles français ont-ils davantage de
réputation que d'autres en la matière ?
Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, on effectuait moins
d'interventions, on pouvait jouer sur le temps de cuvaison mais on
avait moins de techniques œnologiques ; c'était davantage le
millésime qui dictait le temps de garde d'un vin. Malgré tout,
certaines régions, le Bordelais avec ces cépages cabernets, merlot,
malbec, le Rhône avec la syrah et la grenache, produisaient des vins
qui nécessitaient du temps pour s'affiner. À partir de 1985, 1986,
l'œnologie moderne, avec l'apparition de la table de tri, de la
régulation de la température au cours de la vinification, a fait que
l'on a un peu lissé le phénomène du millésime.
Si l'on va vers le Languedoc-Roussillon, on faisait des vins au
rendement plus important, on abreuvait un petit peu le consommateur,
mais depuis une vingtaine d'années, on affine la vinification et on
obtient des vins beaucoup plus complexes qui nécessitent du temps
pour donner toutes leurs caractéristiques.
Garder des vins reste-t-il une pratique très répandue ?
Dans beaucoup de pays, constituer une cave, c'était constituer un
patrimoine ; il y a souvent beaucoup de sentimental dans cet acte,
pendant les guerres on cachait les vins pour ne pas se les faire
piller. On a beaucoup perdu, on est dans l'instant, on a tendance à
boire les vins trop jeunes, alors que le vin a un rapport
extraordinaire avec le temps. Il permet de le remonter.
Dans la région, on a tendance à les consommer trop rapidement. À
tort, je pense, parce que si ces vins sont bien conservés on en aura
un autre aperçu.
Bien conservés, c'est-à-dire ?
Dans les conditions optimales. À une température de 12-14° toute
l'année sans variation, avec une hygrométrie de 70-80 %, on
parviendra à un épanouissement.
Comment savoir qu'il est temps de le consommer ?
Il y a une courbe de maturation du vin, donc comment le savoir :
lorsqu'on met un vin en bouche, que les tanins sont encore un peu
agressifs, anguleux dans notre jargon, il faut attendre. Lorsque la
courbe est au sommet, que le vin a atteint son apogée, il devient
tout autre, plus expressif et plus harmonieux en bouche. Le vin
s'achète chez le producteur, chez les bons cavistes, où l'on délivre
un conseil et le mien est de ne jamais acheter une seule bouteille.
Par trois, par six, cela permet de goûter, voire que le vin est
peut-être en devenir, y revenir quelques années après, suivre son
évolution jusqu'à déterminer qu'il est optimal.
Après ce ne sont pas des mathématiques, ce serait trop simple. Il
faut une part de hasard, d'inattendu.
Une part de risque.
Bien sûr, celui que la bouteille ait mal évolué. Il y a aussi un
paramètre qu'on oublie souvent, c'est le fait que le dégustateur
soit lui-même ou pas en pleine forme, bien accompagné pour déguster
le vin et ça c'est déterminant !
Faut-il prendre des précautions lorsque l'on ouvre une bouteille
longtemps gardée ?
Absolument, une bouteille que l'on a gardée précieusement peut être
mal servie et abîmée. Dans la manipulation, lorsqu'un vin a un
certain âge, dix ans et plus, je préconise de sortir la bouteille de
la cave et la mettre debout dans un endroit frais deux jours avant
de la boire. La déboucher délicatement un peu avant de la servir et
la goûter pour décider ou pas de la carafer ou la décanter.
Puisqu'on parle de vin du sud, riche en alcool, il vaut mieux le
servir deux petits degrés plus frais que l'on ne souhaiterait le
boire - 14 ou 15°-, il gagnera les deux degrés qui lui manquent dans
le verre.
Vous êtes argentin ; les vignerons du Nouveau Monde, d'Océanie,
aujourd'hui largement reconnus pour leurs vins, vont-ils aussi sur
ce créneau de la garde ?
Petit à petit, oui. Du vin boisson, on passe à des vins affinés,
bâtis pour la garde, pour avoir plus de complexité. C'est tout à
fait dans l'air du temps.
.


Le chantier s'accélère: les images
impressionnantes de la destruction du Théâtre national de Nice
Le bâtiment qui abritait le Théâtre National de Nice diminue à vue
d’œil. Une grosse pelle mécanique le grignote chaque jour et bientôt
il n’en restera plus rien. .
..
..
Le TNN bientôt rayé de la carte
Difficile de ne pas y prêter attention. Le bâtiment abritant
le TNN à côté du Mamac diminue chaque jour. Ce lundi matin,
les mâchoires d’acier d’un engin dédié à la tâche
grignotaient ce qui reste des murs de l’ancien théâtre.
Les passants sont nombreux à jeter un œil voire carrément à
s’arrêter pour prendre en photo la démolition du bâtiment.
..
..
En ce début de semaine, les murs de l’ancien théâtre
tombent à vitesse grand V
Il s’agit là de l’écrêtage, une phase primordiale du projet. Très
clairement, l’immeuble avait été au préalable vidé, ne restait que
les enceintes.
Et ce sont ces murs extérieurs qui sont en train de tomber, du haut
vers le bas.
Une très grosse pelle mécanique cisaille et arrache les pans tandis
qu’un jet d’eau évite la dispersion de poussières.
..
..
..
Cette procédure est un peu plus longue qu’une démolition à
l’explosif par exemple, c’est parce qu’on est situé là sur
une dalle. Impossible d’acheminer des engins trop massifs
qui pourraient fragiliser l’ensemble à moins de se retrouver
directement dans le lit du Paillon qui passe en dessous.
Il s’agit là de la dernière ligne droite. Avant la fin de
l’année, il ne restera plus rien de l’ancien TNN et début
2023, c’est Acropolis qui sera détruit, malgré l’opposition
que suscite le projet.
..
..
..


3.000m² supplémentaires, parking de 700 places,
aménagement routier...
On vous explique le méga chantier de Leroy
Merlin à Nice
..
..
..
Dans la plaine du Var, l’énorme chantier en cours
va permettre à l’enseigne dédiée à la maison, de s’agrandir de 3.000
m² en bénéficiant d’un aménagement routier qui allégera le trafic.
Aller à Leroy Merlin dans la plaine du Var ? Depuis début septembre,
c’est un peu compliqué d’y accéder, puis de s’y orienter et enfin de
s’y garer. Mais normalement, fin 2023, l’infrastructure routière en
création pour desservir le site sera livrée et, dans le courant de
l’été 2024, le magasin nouvelle formule sera opérationnel.
Nouvelle formule ? L’enseigne longeant la route métropolitaine 6202,
à Lingostière, dédiée à la maison de A jusqu’à Z – construction,
aménagement, bricolage, jardin, etc. – s’agrandit. Sa surface de
vente de 5.500m² va passer à 8.400m². Un parking de quatre niveaux
permettra le stationnement gratuit de 200 véhicules supplémentaires.
Enfin, une route et deux ronds-points vont faciliter le trafic, non
seulement dans l’enceinte du complexe commercial, mais également
autour des enseignes voisines.
Décryptage de l’énorme ouvrage en gestation en compagnie du
directeur Jean-Luc Boschard.
Pourquoi ce chantier ?
..
 . .
Jean-Luc Boschard, directeur du magasin, gère
un énorme chantier réalisé par des entreprises locales.
Le magasin de la plaine du Var existe depuis 1985. Edifié sur un
terrain de 40.000m² appartenant à Leroy Merlin, c’est un des trois
premiers magasins de France de l’enseigne. Cette enseigne est
affiliée au groupe Adeo, dirigé par la famille Mulliez possédant
également Décathlon, Auchan, Norauto, etc. "Depuis deux ans,
l’enseigne est plébiscitée par le public considérant que nous avons
une utilité plus importante que d’autres, une qualité relationnelle
majeure via nos équipes de vente." Chez Leroy Merlin, les
clients profitent de "35.000 références disponibles immédiatement
et de plus de 500.000 à la commande".
Des critères qui génèrent du passage: "1,5 million de visiteurs
dans l’année – soit la population du département – pour un flux
journalier de 4 à 5.000 visiteurs." Il faut donc pousser les
murs. "On agrandit car le magasin est un peu éloigné des
standards de l’entreprise. Depuis son ouverture, il n’a jamais été
refait. On agrandit afin d’offrir un parcours d’achat et
expérientiel amélioré pour nos clients et nos 350 collaborateurs."
Vers une meilleure visibilité intérieure
Le magasin est en réfection. Sur la partie
arrière, celle qui fait face à la colline. Suivra la partie
latérale, côté montagne. À quoi vont servir les 3.000m²
supplémentaires, restant de plain-pied, même si une surélévation
partielle est prévue pour les bureaux ? "A davantage de mise en
ambiance. On augmente la partie inspirationnelle. Celle des
show-rooms. Parallèlement, les allées de circulation et les
capacités de stockage seront plus grandes." La zone jardinage
sera couverte. Quant à la zone de retrait des marchandises, elle
change d’endroit: "Actuellement, cette zone a été transférée à
Carros. À terme, lorsque les travaux seront finis, elle reviendra
mais sera positionnée plus loin sur le terrain." Un coin
restauration niçoise et buvette est prévu.
..
..
Cette photo, prise du toit du bâtiment, permet
de visualiser l’emplacement du futur parc de stationnement pour 700
véhicules, accessible dès la route métropolitaine 6202.
Aider à la rénovation énergétique
Afin d’aider la clientèle azuréenne à améliorer son habitat sous le
prisme des économies d’énergie, un univers accompagnement va avoir
sa place dans le bâtiment. Le directeur parle d’une "théâtralisation
de cette volonté d’amélioration économique". Concrètement, ce
département existe déjà mais il sera renforcé et encore plus
institutionnalisé pour élaborer des diagnostics énergétiques de
l’habitat, faire entrer des produits tels que pompes à chaleur,
panneaux solaires ou photovoltaïques, etc. "Aujourd’hui, l’État,
le Département, la Métropole proposent des aides mais les
consommateurs ont du mal à s’y retrouver, d’où notre souhait de les
guider davantage notamment dans le montage des dossiers."
Parking de quatre étages
Devant le bâtiment, s’activent des engins. C’est là que va être
érigé un parking aérien de 4 étages, gratuit, accessible depuis la
RM 6202 par un futur rond-point. "Il comprendra 700 places, soit
200 de plus que précédemment et sera équipé pour les voitures
électriques, le stationnement des deux-roues, etc. La toiture
accueillera des panneaux photovoltaïques." Actuellement, un
parking provisoire a été dessiné tout au bout du terrain. Sa
destinée finale est tout autre: "L’espace sera végétalisé avec
possibilité d’animer, avec la Métropole Nice Côte d’Azur, une ferme
biologique de 10.000m². Notre projet reperméabilise une grande
partie de la surface."
..
..
La partie jardinage (à droite du cliché) sera
recouverte. La zone affectée au retrait des marchandises sera
décalée plus loin sur le terrain.
Circulation plus fluide
..

Au-delà de l’actuel parking provisoire, une
route à deux sens, construite ex nihilo, facilitera le flux des
véhicules.
Depuis le début du chantier, la circulation sur la
RM 6202 est réduite de deux à une voie entre la fin de Carrefour
Lingostière et la fin de Leroy Merlin. Argument du directeur: "Cette
réduction est destinée à faciliter le passage des engins et des
ouvriers qui créent une nouvelle voie de contournement du magasin
par le côté et par l’arrière." Au troisième trimestre 2023,
l’accès se fera par un premier rond-point sur la RM 6202. De ce
rond-point, partira une route transitant par un second rond-point.
Cette route passera sur le côté et derrière Leroy Merlin. Utilisable
dans les deux sens, elle rejoindra un 3e rond-point, déjà existant:
celui de Carrefour Lingostière, qui permet de rejoindre l’autopont.
"Lorsque cette route et ces ronds-points seront faits, le trafic
sera plus fluide. L’autopont et la zone de Carrefour seront
soulagés. On n’aura plus à utiliser la voie d’accès à la zone
commerciale, ni la contre-allée débouchant sur notre magasin."
Plus la peine de sortir par Carrefour. On ira directement sur la
route.
Précision de Jean-Luc Boschard: "Cet aménagement routier a été
possible grâce à la cession à la Métropole d’une partie de notre
terrain."
On a également pensé aux piétons, aux PMR et aux cyclistes: un mode
d’accès qualifié de "doux" facilitera leur cheminement entre
Leroy Merlin et Carrefour, sous l’autopont, qui, lui, ne sera pas
démoli.


Pour Amandine Marshall, "on est tellement
admiratifs de l'Egypte antique qu'on refuse d'en voir les côtés
sombres"
.
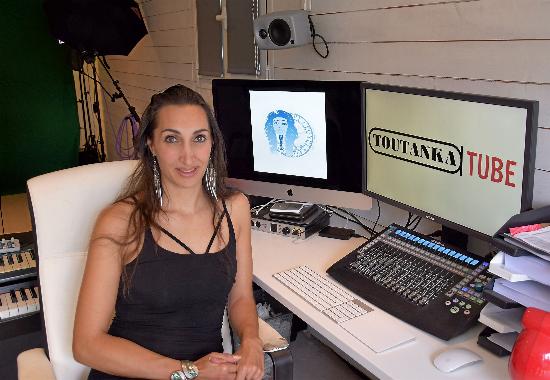
.
Docteur en égyptologie de renommée mondiale, auteur d'une trentaine
de livres pour adultes et enfants et à la tête de deux chaînes
Youtube, Amandine Marshall est en conférence à Sète, ce mardi 29
novembre, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, "Toutânkhamon,
l'envers du décor".
Vous venez de sortir un livre intitulé "Toutânkhamon, l'envers du
décor" sur lequel portera la conférence de ce mardi 29 novembre à
Sète, à l'occasion du 100e anniversaire de la découverte de son
tombeau, le 4 novembre 1922. Qu'entendez-vous par "envers du décor"
?
Je propose au lecteur une enquête qui va consister à récupérer tous
les indices dans la tombe de Toutânkhamon pour reconstituer
l'histoire des pillages antiques de sa tombe. Contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, la tombe n'était pas intacte quand Howard
Carter l'a découverte. Des pilleurs antiques étaient déjà rentrés,
très peu de temps après les funérailles du roi. Il n'y a pas eu un,
mais deux pillages entre quelques semaines et maximum cinq mois
après ses funérailles. Et on a des indices qui nous permettent de
savoir qui étaient ces voleurs, comment ils ont agi et ce qu'ils ont
pris. On sait aussi que la seconde fois, ils ont bénéficié de la
complicité des medjayou, policiers qui faisaient les patrouilles
dans la Vallée des rois. Et qu'ils se sont fait attraper et ont été
condamnés à mort.
Était-ce courant de piller les tombes des rois dans l'Egypte
antique ?
Non. La première qui a été pillée, c'est celle de Toutânkhamon. Et
je pense que ce n'est pas anodin, parce qu'il n'était pas du tout
apprécié par son successeur, qui ne va manifestement pas faire les
choses comme il faut pour protéger la tombe. Toutânkhamon n'a pas
réussi à tourner la page de la période amarnienne, celle du règne
d'Akhenaton. Il a été estampillé "fils de" et n'a pas réussi à se
décoller de cette étiquette.
Pour autant, le nom de Toutânkhamon est entré dans l'Histoire.
C'est étroitement associé à la découverte de sa tombe, avec tout ce
qu'on a trouvé à l'intérieur, dont ce masque que 99 % des gens sont
capables de relier à Toutâkhamon, même sans en savoir plus.

Les raisons de sa mort, ses tares physiques, sa courte vie, ont
aussi alimenté beaucoup de publications.
Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de lui. Toutânkhamon est un
roi qui a eu une vie relativement pourrie. Il est orphelin très
jeune de mère et de père. Dû aux problèmes de consanguinité dans sa
famille, il lui manquait des os au niveau des pieds, il avait des
ossements qui se nécrosaient, des difficultés pour marcher : on a
retrouvé plus de 300 cannes dans sa tombe. On sait qu'il a perdu
avec la reine, qui était sa demi-sœur, deux enfants, et qu'il est
décédé entre 18 et 20 ans. Quant à sa mort, il s'est fracturé la
jambe et ça a entraîné une infection qui s'est généralisée. Il est
mort d'une septicémie, mais on a absolument aucune idée sur comment
il s'est fait cette fracture. Et on ne le saura jamais.
Pourquoi l'Egypte antique garde un côté fascinant encore de nos
jours ?
Je l'explique de plusieurs façons. On est sur une filiation quand
même assez magique : entre les momies, les pyramides, on ne peut
qu'être fasciné. On est aussi sur un peuple extrêmement ancien, le
seul à avoir laissé autant de monuments, d'objets, de textes qui
nous sont parvenus. En France, nous sommes aussi dans un pays
d'Histoire, de culture. Les Français aiment beaucoup ça. Et l'Egypte
a à la fois un côté fascinant et un autre estampillé énigmes,
secrets, malédictions complètement fantaisistes. Elle satisfait
ainsi toutes les curiosités, à la fois historiques, culturelles,
mais aussi ésotériques.
On a aucune des tombes des ancêtres de Cléopâtre et on ne découvrira
certainement pas la sienne !
Vous luttez beaucoup contre les "fake news" autour de l'Egypte
antique.
Ce qui me tient à cœur, c'est de sortir des fantasmes et des idées
reçues. Les émissions de télévision où on voit à chaque fois les
mots mystère, malédiction, m'insupportent. Comme si les gens étaient
trop stupides ou superficiels pour s'intéresser à l'Egypte sans ces
mots ! L'Égypte est d'une richesse absolue, elle n'a pas besoin de
ça. Sur mes chaînes Youtube, pour les enfants comme pour les
adultes, j'essaie de prendre ce contrepied et intéresser les gens
sans ces généralités ou ces fantasmes qui ne correspondent à rien.
À quel type de fantasmes pensez-vous par exemple ?
Par exemple, sur les pyramides ou sur Cléopâtre. J'avais fait une
vidéo sur les cinq fake news antiques autour de la mort de
Cléopâtre. À cette époque, les historiens étaient des gens payés
pour raconter des histoires, ce n'était pas des historiens comme on
l'entend de nos jours. On ne sait pas du tout comment Cléopâtre est
morte, mais on a une dizaine de versions différentes dans
l'Antiquité. On en a fait une reine-pharaon sulfureuse. Elle n'a
jamais été pharaon. Pour rester reine et conserver son trône, elle a
quand même épousé son fils qui était un bébé, on a tendance à
l'ignorer. On sait aussi qu'elle a eu une liaison avec Jules César,
mais que Césarion n'est pas son fils. On a créé un mythe autour de
Cléopâtre, parfois très éloigné de la réalité. Dans l'Antiquité,
c'était la personne à abattre, elle était très mal vue par les
Romains qui la prenaient pour une prostituée décadente. On va faire
de Marc Antoine, son mari, une brute épaisse alcoolique, alors que
c'était un des plus grands généraux de son époque. Il faut prendre
du recul par rapport aux textes antiques.
Et, parfois, déconstruire ce qui nous a été enseigné.
Ça, c'est notre boulot en effet. Et quand je vois des émissions où
l'on raconte n'importe quoi, ça me fait hurler.
Quel a été votre regard face à ce bruissement survenu il y a
quelques jours autour d'une possible découverte de la tombe de
Cléopâtre dans le cadre de l'expédition menée par l'archéologue
Kathleen Martinez ?
On présente ça comme un mystère qui va enfin être levé, alors qu'on
ne la découvrira pas. On a aucune des tombes des ancêtres de
Cléopâtre et on n'aura certainement pas la sienne. Le général Octave
n'avait absolument aucun intérêt à faire enterrer Cléopâtre dans sa
tombe et en faire une espèce de mausolée martyre avec une reine
morte pour sauver son peuple. Mais les gens veulent y croire.
Qu'est-ce qui nous manque à savoir aujourd'hui sur l'Egypte
antique ?
Tellement de choses ! Surtout sur la vie quotidienne. On a par
exemple aucune idée des plats égyptiens. On connaît leurs légumes,
leurs fruits, les racines, mais pas du tout comment ils les
cuisinaient. Pour les Egyptiens, la nourriture est tellement
triviale que ça ne vaut pas le coup de perdre du temps à commenter
ce qu'on va manger. Alors que les Grecs ou les Romains le faisaient.
On surfantasme aussi la médecine antique : on n'arrachait pas les
dents par exemple. Quand on voit l'état de la dentition de Ramsès
II, pas besoin d'être un expert pour voir qu'il y a un problème. On
surfantasme aussi le statut de la femme. La femme n'était pas
l'égale de l'homme, loin de là. On est tellement admiratifs des
Egyptiens qu'on refuse de voir les côtés sombres. La justice
égyptienne était tout sauf juste. Les gens, on les torturait d'abord
et on les interrogeait après. L'inceste chez les pharaons était
courant et cela n'avait rien de choquant.



Des pingouins aperçus à Nice, Antibes,
Villefranche-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.
Vous les pensiez sur la banquise mais ce samedi, des plongeurs ont
pu observer des petits pingouins sur le port de Nice ou encore à
Antibes ce dimanche, dans la rade de Villefranche-sur-Mer et à
Saint-Laurent-du-Var.

Ce pingouin Torda a été aperçu à nouveau ce dimanche à Nice


A quoi pourrait ressembler la future salle de
spectacle annoncée par Christian Estrosi aux Arènes de Cimiez ?
Le maire de Nice, Christian Estrosi, annoncé, lundi 21 novembre, son
intention d'installer la salle de spectacle prévu dans le complexe
Iconic... aux arênes de Cimiez.
C'est une double annonce de Christian Estrosi. Le maire de Nice a
enterré le projet de salle de spectacle dans le complexe Iconic,
près de la gare du centre. Mais dans le même temps, l'élu a dégainé
un plan B : cette salle de spectacle se fera... dans les arènes de
Cimiez.
Ce nouvel espace culturel devrait voir le jour à l'entrée des
arènes, au milieu des actuelles ruines de l'amphithéâtre romain.
"L’amphithéâtre doit devenir une scène à part entière tournée
vers le spectacle vivant, que nous confierons au Théâtre de Nice
pour y produire notamment un festival dédié à la tragédie antique,
sur le modèle de celui de Syracuse", a déclaré Christian
Estrosi.
Et le maire de Nice de diffuser des premiers visuels, précisant
qu'ils n'étaient pas définitifs.
.
.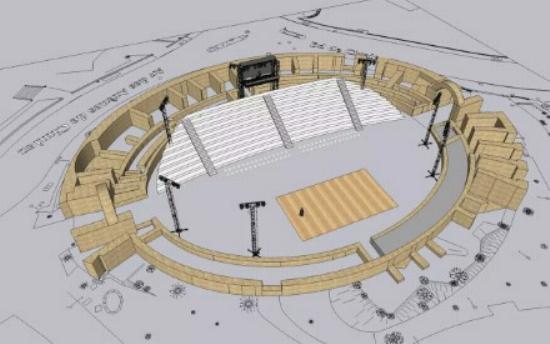
..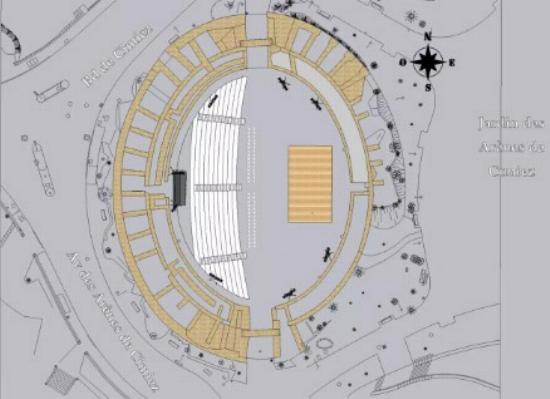
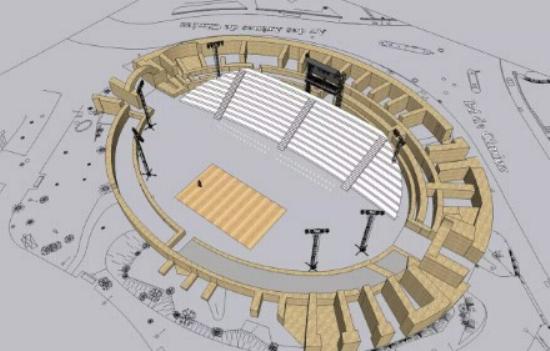
.
Objectifs affichés par Christian Estrosi ?
"Mettre le site à l'abri de la dégradation et vivre une
expérience théâtrale en extérieur ", a-t-il notamment expliqué.
.


Coup de théâtre: la Ville de Nice abandonne la
salle de spectacle d’Iconic au profit des Arènes de Cimiez !
Le site archéologique, vieux de 2.000 ans, deviendra un théâtre
antique, dans lequel Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre
national de Nice, pourra créer un festival international dédié à la
tragédie antique.
C’en est fini de la salle de spectacle d’Iconic, intégrée dans le
programme immobilier du même nom, quartier de la Gare, et qui devait
servir de troisième site au Théâtre National de Nice, avec la salle
des Franciscains, dans le Vieux-Nice, et la salle de La Cuisine,
dans la plaine du Var.
"Aucune valeur ajoutée"
Le projet d’Iconic version planches est abandonné. Motif invoqué par
Christian Estrosi: "Le TNN et le ministère de la Culture ne sont
pas demandeurs. L’option que nous avions posée sur la future salle
de spectacle d’Iconic ne peut pas correspondre techniquement à nos
attentes. Les plafonds sont trop bas, la scène trop petite, etc.
Pour l’usage du TNN, cette salle n’aurait apporté aucune valeur
ajoutée."
Création d’un théâtre antique à Cimiez
Le maire de Nice a fait cette déclaration ce lundi matin aux arènes
de Cimiez. Un lieu choisi, voulu, pensé puisque le premier magistrat
niçois a annoncé que, dans le cadre de la restauration des espaces
patrimoniaux environnants, l’amphithéâtre de Cimiez, qui abrita
jadis le tonitruant festival de jazz, allait devenir une sorte de
théâtre antique.
En effet, ce sera une scène à part entière, tournée vers le
spectacle vivant, confiée au TNN pour y produire notamment un
festival international dédié à la tragédie antique, sur le modèle de
celui de Syracuse (Italie). En somme, elle deviendra la troisième
salle, à ciel ouvert, devant combler l’éclatement du vieux TNN en
cours de démolition. L’idée de cette scène en péplum vient de Muriel
Mayette-Holtz "qui en avait fait un élément central de sa
candidature au poste de directrice du TNN ".
L’amphithéâtre fermé au public prochainement
À court terme, il y aura d’abord une expérimentation conduite dès
l’été 2023 par le TNN et dévoilée par Muriel Mayette-Holtz: "Il
s’agira d’abord d’une configuration modeste, avec environ cinq cents
places [le nombre initialement prévu à Iconic] de gradins pas
très hauts. On installera une scène à l’est et non plus au sud comme
on en avait l’habitude. On fera des essais pour préparer le festival
de la tragédie antique, qui, lui, aura lieu en juin-juillet 2024."
Pour mener à bien ce projet, l’enceinte de l’amphithéâtre des arènes
de Cimiez sera définitivement fermée aux promeneurs. On ne sait pas
encore quand exactement.
..


Quand le tramway révolutionnait le quotidien
des Niçois... au XIXe siècle
..
..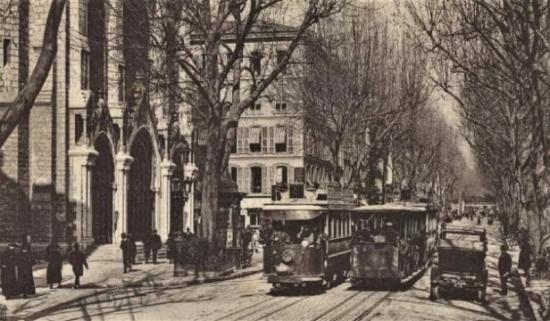
..
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle déjà, Tobias
Smollett, inventeur de la Côte d’Azur, déplorait qu’il
n’existe pas de transport intra-urbain et que seules chaises
à porteur ou chevaux permettent de se déplacer...
Dès 1833, les hivernants souhaitent pouvoir se déplacer
aisément, aussi le directeur de l’Hôtel de France prend
l’initiative d’organiser un service d’omnibus tracté par
trois imposants percherons qui effectuait deux fois par jour
le trajet entre le centre-ville et le Pont du Var.
En 1864, avec l’arrivée du train, Nice voit un accroissement
de la population ce qui nécessite de nouveaux transports
urbains.
Rapidement, les frères Loupias fondent L’Entreprise générale
des omnibus de la ville et des chemins de fer qui ouvre les
deux premières lignes régulières, entre le port et la gare
PLM et entre la place Charles Albert et le quartier
Saint-Barthélemy.
La demande étant toujours de plus en plus forte, le problème
des transports devient une question d’utilité publique. Il
faut attendre 1870 pour que le conseil municipal envisage
l’installation d’un tramway pour parcourir la ville.
En 1871, une commission municipale envisage la création d’un
réseau composé de voitures tirée par un à deux chevaux et
roulants sur une voie ferrée encastrée dans la chaussée.
La place Masséna, cœur du réseau hippomobile
Le 9 septembre 1875, un décret d’utilité publique autorise la ville
à créer un réseau de voies ferrées. Le projet comprend trois lignes
au départ de la place Masséna qui, en devenant le cœur du réseau des
tramways, consolide sa position clef entre la vieille ville et la
nouvelle ville.
..
..
Dès la mise en place du tramway électrique, la place
Masséna est devenue le cœur du réseau. (Carte postale
Giletta vers 1890-1905)
Le 3 mars 1878 à 10 heures du matin, la municipalité inaugure un
tracé qui sera installé progressivement entre 1879 et 1880.
À l’origine, le tracé comprend quatre lignes. La première ligne
baptisée "ligne A" part vers les rues Masséna et de France avec cinq
déviations: Croix de Marbre, Pont Magnan, place Sainte-Hélène et le
terminus à la Californie. Il y a aussi la ligne 2 qui rejoint le
quartier Saint-Maurice et passant par l’avenue de la Gare. La ligne
3 qui, d’abord, ne circule qu’entre la place Masséna et la place
Garibaldi, sera prolongée jusqu’au quartier Risso. La ligne 4,
reliant la Gare à la place Masséna, fera ensuite la jonction avec la
ligne 2 pour rejoindre le port.
Très vite, le parc des tramways hippomobiles s’étoffe avec des
voitures dites d’hiver, fermées, à charpente en bois avec deux
banquettes longitudinales, baies vitrées latérales et prévues pour
douze à dix-huit passagers assis et possibilité de se tenir debout
sur les plateformes.
Les voitures dites d’été sont entièrement ouvertes et les voitures à
impériale comportent des plateformes ouvertes de chaque côté, vingt
places assises, dix debout au niveau inférieur et dix-huit places
assises au niveau supérieur.
Toutes ces voitures de remorque tractées par une paire de percherons
sont montées sur un châssis à deux essieux avec une plateforme
ouverte et un cocher.
Naissance du tramway électrique
Mais le tramway hippomobile, avec ses difficultés à desservir les
dénivelés, ne suffit plus aux besoins de l’urbanisation des collines
environnantes de Nice. Aussi, lorsqu’en 1883-1884, l’exposition
internationale de Nice présente l’énergie électrique, baptisée la
"fée électricité", celle-ci est l’innovation attendue pour
développer le réseau.
De plus, le premier tramway à traction électrique présenté par le
pavillon Edison, décide les élus à passer à l’électrique. Le 18
septembre 1897, l’électrification du réseau urbain niçois est
confiée à la Compagnie des tramways de Nice et du littoral (TNL),
associée à Thomson-Houston.
La direction locale puis le dépôt-atelier et l’usine motrice sont
installés dans le quartier de Riquier, à l’emplacement de l’actuel
centre commercial Nice TNL.
..
..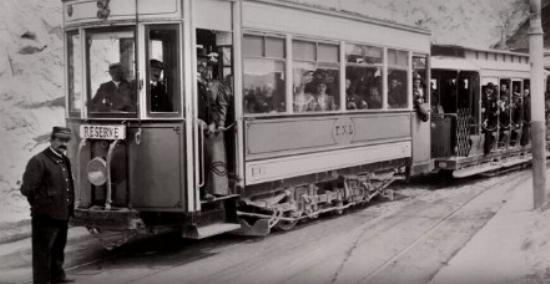
Les TNL ont employé jusqu’à mille agents répartis en
quatre services. (Photo Archives départementales 06)
Le réseau de base, celui des quatre lignes à traction hippomobile
est évidemment réintégré dans le réseau. Il a fallu y ajouter la
ligne expérimentale de Cimiez qui, surnommée "la pagode " ou encore
sur un ton plus humoristique "la limace de Biasini", fut ouverte le
13 janvier 1900.
Les travaux sont engagés avant même la validation formelle du
projet, en tenant compte de l’interdiction de travailler pendant la
saison hivernale pour ne pas incommoder les touristes. Il est prévu
que l’écartement des rails soit d’un mètre, le gabarit en largeur de
1,90mètre et la vitesse maximale de 20km/h. Une double voie est
préconisée sur toutes les sections urbaines.
Un vaste chantier est alors ouvert et la plupart des lignes sont
construites en moins d’un an.
Place Masséna, il est établi une gare terminus à cinq voies sur une
boucle comprenant trois positions de départ et d’arrivée. Il ne
faudra que deux ans pour poser 94 kilomètres de réseau sur 150
kilomètres de voies et, le 31 décembre 1899, les essais de la
première motrice sont effectués dans l’enceinte du dépôt de
Sainte-Agathe.
Des motrices américaines
La société américaine Thomson Houston, spécialisée dans les
constructions électriques et plus particulièrement dans le domaine
des tramways, va, en devenant le principal actionnaire de la Cie
TNL, fournir cent motrices dotées de deux moteurs de 35 chevaux.
D’une longueur de 7,90mètres, elles présentent une caisse de couleur
jaune et blanc.
Les différentes lignes sont repérables par un code couleurs, soit
une plaque carrée avec des motifs (rond, carré, barre verticale ou
horizontale, etc.) de manière à être reconnue par la population
illettrée.
En 1901, la tente installée provisoirement pour les voyageurs au
centre de la place Masséna fut remplacée par un kiosque à
l’architecture pittoresque. La convention de concession ne fut
signée que le 18 février 1902, à l’achèvement des travaux. L’offre
du réseau urbain se caractérisait par une forte amplitude horaire du
fait de l’activité urbaine croissante, de l’important trafic
maraîcher et de la vie nocturne liée au tourisme.
Ainsi, le service débutait à 5h30 pour se terminer vers minuit.
L’exploitation évoluait rapidement, les TNL souhaitant proposer un
service circulaire en utilisant les différents raccordements entre
les lignes. Le 6 décembre 1903, une nouvelle extension du réseau
urbain était mise en service avec la desserte du Parc Impérial.
Les motrices vont rapidement subir des transformations. Les motrices
T1 vont offrir onze places supplémentaires et vont être remplacées
par des T2 permettant un accès plus pratique sur les côtés.
Au terme de dix années, les cent motrices vont être adaptées aux
besoins des voyageurs. À partir de 1925 le tramway n’a plus
l’exclusivité. Une première ligne d’autobus, contraction des termes
omnibus et automobile, est créée le 28 mai 1925. En 1928, les hommes
qui ont porté le tramway ont disparu et celui-ci va finir par
disparaître progressivement. Au sortir de la guerre, la situation du
réseau est des plus précaire puisque, entretenu a minima, il
nécessite de lourds investissements et les moyens manquent. Les TNL
décident de l’abandonner au profit du trolleybus et de l’autobus. Et
c’est une nouvelle aventure qui commence…
Source: La Révolution des transports à Nice, le tramway, Archives
départementales 06.
..
..
La rue Gioffredo, en janvier 1953. Sur les vitres
latérales, une affiche annonce la fin imminente (ici 7
jours) de l’exploitation des tramways. (Photo Archives
départementales 06)
..
..
En 1953, on note le vestibulage de la motrice avec une
allure atypique: les versions s’étaient succédées avec plus
ou moins d’élégance dans les transformations au fil du
temps. (Photo Archives départementales 06)
Les hommes du tramway
Pendant toutes ces années, la compagnie TNL a été l’une des sociétés
les plus pourvoyeuses d’emplois. À la veille de la Première Guerre
mondiale, les effectifs de la Cie TNL avoisinaient mille agents sans
compter l’augmentation des effectifs pendant la saison hivernale. Le
personnel était réparti en quatre services : administration,
mouvement, matériel, voies et services électriques. Le personnel
roulant était composé de wattmen, chargés de la conduite des
tramways, et de conducteurs, chargés de la vente des titres de
transport, dénommés ensuite receveurs. Beaucoup d’anciens cochers de
place furent formés et intégrés au personnel de la compagnie comme
conducteurs. Ainsi, l’introduction du tramway ne se fit pas au
préjudice des anciens corps de métier. Enfin, les aiguilleurs et les
trappeurs étaient chargés de l’abaissement et du relevage pour faire
la jonction entre l’alimentation par le sol (reconnaissables à la
présence de trois rails comme sur la place Masséna et l’avenue de la
Gare) et l’alimentation par caténaire (reconnaissable aux deux rails
complétés par le câble aérien comme sur la rue de France ou le
boulevard de Cimiez).
"Des abeilles pour demain" : le documentaire à
voir pour comprendre pourquoi (et comment) protéger les abeilles
Les abeilles sont en grand danger. Mais en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, des femmes et des hommes imaginent des solutions pour
enrayer leur disparition. Bruno Sevaistre les a rencontrés et signe
un film pédagogique et porteur d’espoir.
"L’abeille, c’est la vie". Une petite phrase qui résume à
elle seule le rôle primordial de cet insecte fascinant. "Aujourd’hui,
80% de la production agricole, un tiers de ce que nous consommons,
dépendent des abeilles" explique Thierry Dufresne. Le président
de l’OFA, l’Observatoire Français d’Apidologie, connaît bien la
question et il fait partie de ces interlocuteurs passionnés à qui le
film donne la parole.
Oui, les abeilles sont au cœur de nos vies, par leur travail de
pollinisation. Sans elles, point de sécurité alimentaire.
Sentinelles de la biodiversité, elles sont indispensables à l’Homme.
Mais elles sont aujourd’hui gravement menacées. Partout dans le
monde. Pesticides, infections parasitaires, pollution, réduction des
superficies, changement climatique… Les taux de mortalité des
colonies atteignent 30 % par an.
Bruno Sevaistre : Les insectes pollinisateurs n'ont pas vraiment
besoin de nous mais nous avons terriblement besoin d'eux.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur n’est pas épargnée. C’est l’une
des toutes premières régions apicoles françaises : près de 165.000
ruches, quelque 4.500 apiculteurs et une production de miel qui
avoisine les 2.000 tonnes par an, soit 8% de la production
nationale. Mais ici, comme dans tout l’Hexagone, l'apiculture est
touchée de plein fouet par le déclin des colonies d'abeilles.
Aujourd’hui, c’est à l’Homme d'aider les abeilles à accomplir leur
mission.
..
..
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des premières
régions apicoles françaises
"Ce documentaire n'est ni une enquête, ni un film sur
l'apiculture". Préoccupé par les questions environnementales, le
réalisateur Bruno Sevaistre s’est penché sur la disparition
inquiétante des abeilles.
Mais au-delà du constat alarmant et des causes, clairement exposés
dans le film, il souhaite mettre en lumière les solutions qui se
dessinent. "J’ai voulu donner la parole à ces femmes et ces
hommes qui cherchent et trouvent des solutions pour enrayer la
spirale macabre et assurer un renouveau pour les abeilles de demain".
Ils sont apiculteurs, agriculteurs, chercheurs, scientifiques ou
entrepreneurs... Le chantier est vaste, mais ces passionnés du
vivant ne veulent plus être spectateurs et se battent, à leur
niveau, pour comprendre les raisons du déclin des abeilles et y
remédier à l'échelle locale.
..
..
Tournage sur le plateau de Valensole : des apiculteurs ont
imaginé un système ingénieux pour mieux protéger les abeilles
pendant les récoltes de lavande
On découvre ainsi, du côté d'Avignon, comment certains concentrent
leurs travaux sur "l’effet cocktail " des pesticides. A
Marseille, grâce à des "hôtels" à insectes, des chercheurs
passent au crible les parcs et jardins pour capturer et identifier
les abeilles sauvages qui les fréquentent. Sur le plateau de
Valensole, des apiculteurs ont imaginé un système ingénieux pour
mieux préserver les abeilles pendant les récoltes de lavande, sans
gêner les lavandiculteurs. Au cœur de la Sainte-Baume, un
entrepreneur a créé un isolat exceptionnel pour favoriser
l'apidologie, l'étude du comportement des abeilles...
Pour eux, accompagner le travail des abeilles, c’est construire un
monde pérenne pour les générations futures.
Très pédagogique, le documentaire nous apprend aussi beaucoup sur
cet insecte social et son univers, avec des images étonnantes. Le
réalisateur a utilisé des techniques de prise de vues lui permettant
de filmer au plus près, jusqu'à l’intérieur des ruches, sans
déranger les abeilles.
..
..
Filmer au plus près les abeilles pour mieux comprendre leur
univers
Mieux connaître pour mieux protéger… Par son regard humain et
résolument optimiste, Bruno Sevaistre espère modestement faire
réfléchir, peut-être éveiller les consciences. "Oui, il est
possible de défendre cet insecte si utile à la bonne marche du
monde. Chacun peut à son niveau avoir un comportement différent,
être plus vigilant. Et si ce film, en suscitant des vocations,
contribuait à "sauver le soldat abeille", alors il trouverait tout
son sens".
"Des abeilles pour demain"
Un documentaire de 52’ écrit et réalisé par Bruno Sevaistre.
Coproduction France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur / Mars Production /
L'Eolienne.
Diffusion le 9 novembre 2022 à 9h05 sur France 3 Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
"Toute la population de poisson est en train de
s’effacer": situation "gravissime" au lac du Broc
Les mois passent et rien ne change : le niveau de cette étendue
d’eau qui longe le Var ne fait que baisser. La situation est "gravissime"
et la population piscicole serait "en train de s’effacer ".
.
....
Les quelques jours de pluie qu’il y a eu ces dernières semaines
n’ont rien changée pour le lac du Broc. Pire, la situation
s’aggrave. Les poissons doivent faire face à une nouvelle menace.
Plus il se vide, plus les difficultés s’accumulent au lac du Broc
(1). En fin d’été, alors que l’étendue avait perdu 8mètres d’eau,
deux oxygénateurs avaient été placés à l’endroit le plus profond.
L’objectif était de sauver les tonnes de poissons. Cette opération a
porté ses fruits puisque la population piscicole a tenu le coup.
Jusqu’à maintenant…
Les oiseaux, une nouvelle menace
Une nouvelle problématique vient de voir le jour: l’arrivée des
cormorans. "Il y en a 50 à 60. Ces oiseaux mangent entre 400 et
500 grammes de poissons par jour ", a expliqué ce vendredi,
Christophe Barla, le directeur de la fédération de pêche des
Alpes-Maritimes. Cormorans et poissons ont l’habitude d’évoluer dans
le même milieu à cette période-là. Mais, en règle générale, il y a
de l’eau dans le lac... "Le souci maintenant, c’est qu’il n’y a
plus d’herbiers, puisque le niveau de l’eau est en dessous. Les
poissons ne peuvent plus se cacher, les cormorans n’ont qu’à se
servir. C’est un garde-manger ."
Christophe Barla est très pessimiste quant à la suite: "Toute la
population du lac du Broc est en train de s’effacer ". Ce
professionnel ne voit pas de solution. Une pêche de sauvegarde? La
réponse est non. "La sécheresse n’est pas finie, les autres
étendues d’eau souffrent aussi."
Quid des dernières pluies ?
Les (rares) jours de pluie du début de cet automne ne semblent
pas avoir permis de renflouer les nappes. La situation reste "gravissime".
La sécheresse joue les prolongations et le niveau n’en a pas fini de
baisser. "On perd 4 centimètres par semaine, on est à moins
10,7mètres d’eau. On est passé de 24 hectares d’étendue d’eau à 1,5
hectare", détaille, la voix grave, Christophe Barla.
Le lac se transforme petit à petit en dunes de sables sans que ce
professionnel ne puisse l’expliquer totalement. "Cet été, l’eau
s’évaporait à cause des fortes chaleurs. Mais maintenant, les
températures se sont adoucies donc il ne devrait plus y avoir
d’évaporation. Pourtant, la nappe continue de baisser et on ne
comprend pas. On a demandé au Smiage (2) [Syndicat Mixte pour
les Inondations l’Aménagement et la Gestion de l’Eau], à des
géologues de chercher parce que ça commence à être un mystère."
1. Le lac du Broc n’est pas naturel car il a été creusé par l’homme
mais il puise son eau douce dans la nappe phréatique du Var.
2. Sollicité, le Département (dont le Smiage dépend) n’a pas été en
mesure de répondre à notre sollicitation.
La Madone de Fenestre, dans le Mercantour, à nouveau accessible en
voiture
C’est une bonne nouvelle pour les amoureux de la montagne et ceux
qui fuient la canicule. Depuis Saint-Martin-Vésubie on peut enfin,
après de colossaux travaux, rejoindre le Sanctuaire de la Madone. La
tempête Alex avait emporté la route en de nombreux endroits.
..
..
..
C’est l’un des grands sites du Mercantour. La tempête Alex du 2
octobre 2020 avait emporté 5 km sur les 12 km allant du village de
Saint-Martin-Vésubie à la Madone. "A cause de la rivière, il y
avait 14 brèches sur l’ensemble de la route et donc l’accès à la
Madone était impossible", explique l’un des responsables de la
direction territoriale de la Métropole.
La reconstruction de la route
Les travaux sur ce tronçon ont démarré vers mars/avril de cette
année et ont permis la réouverture de la route depuis le 8 juillet.
Mais, pour les véhicules légers seulement.
En fait, la route depuis le village, jusqu’à la barrière qui permet
l’accès à celle de la Madone passe pour le moment devant l’hôpital
St Antoine. Le départ par la route classique se fera à partir du 22
juillet. A cette date-là, les minibus et autres camions de
ravitaillement pourront accéder à leur tour. Leur tonnage ne devra
pas excéder 19 tonnes.
Les travaux ne sont pas entièrement terminés, mais la route est
accessible tout l’été jusqu’à la mi-septembre. A partir de cette
date, elle sera à nouveau fermée pour continuer la reconstruction,
notamment la réalisation de 2 ouvrages d’art.
Les services de la Métropole Nice Côte d’Azur devront faire vite
car, comme traditionnellement, la fermeture hivernale sera active de
novembre à avril pour cause de neige et de risques dus aux couloirs
d’avalanche.
..
..
Le paradis de la Haute Montagne à 1.904 m
d'altitude
L’inauguration de la réouverture de la route de la Madone de Fenêtre
devait avoir lieu vendredi 8 juillet. La mort accidentelle de Marine
Clarys a endeuillé la vallée. La jeune femme de 35 ans, guide de
haute montagne, est décédée à la Cougourde, lors d’une course avec
un client.
L’inauguration officielle de la réouverture de l’accès estival au
Sanctuaire de la Madone de Fenestre aura lieu mercredi 13 juillet à
11h, au niveau de la barrière d’accès au chantier. L’ensemble des
maires et élus de la Métropole ont, d’ores et déjà, répondu présent.
La cérémonie sera suivie d’une procession en voiture vers la Madone
pour un moment de convivialité.
La procession du vendredi 15 Juillet 2022
«On va enfin refaire ce que traditionnellement on faisait avant la
tempête Alex et le Covid», annonce joyeusement le Père Fréderic
Appiano, curé de la Paroisse de la Vésubie et Doyen des Vallées du
Haut-Pays Niçois. "C’est une procession mariale. Elle consiste à
remonter la statue de la Vierge en cèdre du Liban polychrome du 14e
siècle. Cette dernière séjourne l’hiver à l’église de
Saint-Martin-Vésubie, Notre Dame de l’Assomption. Une prière y sera
célébrée à 7h30 vendredi et le départ de la procession à travers les
rues du village commencera à 7h40."
La population locale et celle du Piémont attendent depuis 2 ans la
reprise de cette très ancienne tradition. Plus d’une centaine de
personnes sont attendues.
Les nombreux miracles attribués à l’apparition de la vierge Marie en
ces lieux expliquent le culte que lui vouent les populations
alentours lors des processions annuelles
"Nous ferons un arrêt à l’hôpital pour prier avec les résidents,
explique le Père Appiano, parce que la plupart d’entre eux ont connu
cette procession durant leur jeunesse et que c’est donc
particulièrement important. Notre marche est rythmée par la
récitation du chapelet et par des temps de méditation. L’idée c’est
de marcher tous ensemble sur un même chemin, à la suite de Marie.
Peu importe nos différences, nos cultures, nos caractères, nos
particularités. Et, lorsque nous arriverons vers 11h30, un apéritif
sera offert par l’Association des Amis de la Madone et par
l’Association de l’Hôtel des Pèlerins."
..
..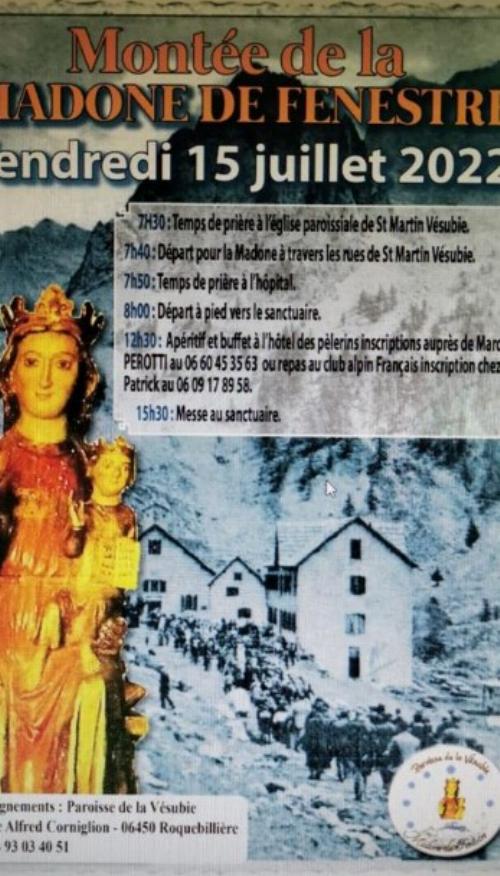
La montée de la Madone de Fenestre au
Sanctuaire
Paradis de la Haute Montagne à 1904 m
d’altitude
Le site de la Madone de Fenestre, entouré de montagnes (le point
culminant des Alpes-Maritimes est la cime du Gelas à 3.143 m), est
le point de départ de nombreuses promenades vers les lacs
d’altitude, jusqu’en Italie (1h de marche) ou, au-delà, vers la
Vallée des Merveilles.
C’est une ouverture rectangulaire située sur le haut de l’arête
nord-est du grand Cayre de la Madone, un gros rocher (où serait
apparue la Vierge) dominant le sanctuaire qui lui donne son nom de
Fenestre.
Des cartes antérieures à l’an 1000 attestent déjà du nom de Col de
Fenestras. Ce dernier culmine à 2.474 m et relie la France à sa
voisine italienne par un sentier qui passe près du Lac de Fenestre
(2.266m).
Information de dernière minute : la représentation de la Madone en
cèdre du Liban fait des émules. Le samedi 23 juillet, dans le
village de Saint-Martin-Vésubie, l'Association Mon Liban d'Azur
offre et plante un authentique cèdre du Liban. Tout droit venu du
nord de Beyrouth, depuis le village de Bcharré, il rappelle l'amitié
franco-libanaise et offre un souvenir des écrits du grand poète
Gibran Khalil Gibran.
La "Bataille de Gilette" : 19 octobre 1793
..
..
..
La bataille de Gilette, ou combat de Gilette, se déroule
le 19 octobre 1793 et voit la victoire de l'armée française
du général Dugommier contre l'armée austro-sarde du général
de Wins.
Premier combat de Gilette
Les austro-sardes ont leurs arrières à Malaussène et Clans.
Leur gauche tient Toudon, Revest, Bonson et Tourette. Leur
droite tient la vallée de l'Estéron à Sigale, Cuébris et
Conségudes. La liaison est assurée par Puget-Théniers et
Ascros.
Le 30 septembre le général de Wins ordonne au commandant
Belmont de s'emparer avec 4 000 hommes de Gilette. C'est une
position stratégique de laquelle il est possible en
traversant le Var au gué de Saint-Martin de descendre en six
heures trente de marche à Nice. À l'époque il n'y a pas de
route pour la contourner le long du Var par le défilé de
Chaudan. Les Français défendent Gilette avec un ensemble de
retranchements et une petite garnison réduite à deux cents
hommes par les absences et la maladie.
Les austro-sardes surprennent les Français à quatre heures
du matin. Ils capturent la plupart des vingt hommes gardant
le rocher escarpé du Cucuglia et pénètrent dans le village.
Mais les Corses du château de l'Aiguille leur opposent une
fusillade nourrie. Les gardes nationaux du Broc et des
Ferres accourent. Une brusque sortie des Corses scelle la
victoire des Français.
Belmont est capturé avec cinquante de ses hommes.
..
..
..
Rapport du 22 octobre 1793
Avantage remporté par l'armée d'Italie sur les Piémontais à
l'affaire de Gilette, les dix-huit et dix-neuf octobre l'an 2e de la
République1.
"Depuis la lâche entrée des Anglais dans le port de Toulon, le
despote préméditait, de concert avec eux, une attaque combinée pour
couper entièrement la communication de l'armée d'Italie avec la
France.
Il fallait, pour y parvenir, pénétrer entre le Var et Entrevaux, et,
s'emparant du pont jeté sur cette rivière, se réunir aux troupes que
l'escadre anglaise aurait pu mettre à terre.
L'instant paraissait favorable, depuis surtout qu'une division de
3 000 hommes au moins, détachés de l'armée d'Italie, avait marché
contre la ville rebelle de Toulon. Mais l’œil attentif du
patriotisme et le courage des Enfants de la Liberté ont anéanti ce
beau projet au moment de son exécution ".
" Les attaques des ennemis, plus fréquentes depuis l'arrivée des
Anglais, ont constamment été malheureuses jusqu'à présent. Celles
qu'ils entreprirent le 8 septembre dernier, en attaquant en même
temps tous les camps occupés par nos troupes, leur fit perdre
beaucoup de monde et nous produisit 200 prisonniers, y compris 14
officiers. Depuis cette époque, ils n'ont pas été plus heureux et
l'avantage a (sic) toujours resté de notre côté, lorsqu'ils ont fait
des tentatives ".
" Les Piémontais croyant enfin le moment favorable pour exécuter
leur projet et jugeant que la gauche de notre armée n'était pas en
force, le général de Wins, à la tête de près de 4 000 hommes,
presque tous Autrichiens, et six pièces de canon, marcha le 16
octobre sur cette gauche, où, après s'être rendu maître de toutes
les positions qui pouvaient intercepter notre communication avec le
poste de Gilette, point principal sur lequel il voulait diriger son
attaque et qui n'était défendu que par 700 hommes, sans canons,
l'ennemi vint s'emparer du village de Conségudes, d'où le faible
détachement s'était déjà replié sur celui des Ferres. Il essaya de
se rendre maître de ce dernier. Cent hommes, commandés par le
capitaine Campan, formaient toute la force de ce village. Cet
officier, en demandant du renfort qui lui a été bientôt envoyé par
le chef du bataillon Martin, écrivait qu'il était résolu à fondre
sur l'ennemi avec la baïonnette, si les cartouches lui manquaient.
Plusieurs parlementaires lui avaient déjà été envoyés pour le sommer
de se rendre, mais sa fermeté et ses réponses énergiques, en faisant
perdre à l'ennemi l'espoir de le réduire, obligea ce dernier à
diriger toutes ses forces sur Gilette, dont la conquête lui devenait
d'autant plus importante qu'elle devait lui faciliter l'exécution de
ses projets sur le pont du Var ".
" Le 18 octobre, l'ennemi ne s'occupa qu'à environner Gilette,
qui le fut effectivement de manière qu'il n'était plus possible d'y
rien faire pénétrer. Ce poste fut attaqué dès le matin et canonné
vigoureusement 10 heures de suite. Cette canonnade n'ayant abouti
qu'à consommer ses munitions, il se détermina à 4 heures après-midi
à l'enlever de vive force et, pour cet effet, fit marcher plus de 1
200 hommes qui furent si bien accueillis par le feu de Gilette et du
château qu'ils ne tardèrent pas à se retirer et à prendre la fuite.
Le chef de bataillon Hadon, qui y commandait, et dont la troupe
manquant déjà de munitions, était réduite à se servir de pierres,
fit sur eux une sortie si à propos qu'il leur fit 88 prisonniers.
Cet avantage parut être le moment favorable pour introduire dans la
place des munitions de guerre et de bouche. Le chef de bataillon
Martin en profita pour lui en faire passer. Cette démarche hardie
ayant réussi, procura au poste de Gilette les moyens de soutenir
l'attaque que l'ennemi, toujours très supérieur en nombre,
paraissait devoir faire le lendemain ".
" Le général Dugommier, commandant l'aile gauche de l'armée
d'Italie, arrivé la veille avec un renfort, joint à ceux que le
général en chef avait envoyés, jugeant par la manière dont Gilette
était investi que le meilleur parti qu'il eût à prendre était
d'attaquer l'ennemi le lendemain pour dégager ce poste, fit ses
dispositions en conséquence.
Il divisa sa troupe en trois colonnes :
les chasseurs du 28e, et ceux du 50e régiment, commandés par le
capitaine Parral, formaient celle de droite.
Les chasseurs du 91e et ceux du 11e, commandés par le capitaine
Guillot, formait celle du centre
et Le citoyen Cazabonne, à la tête de la compagnie franche de
Clairac, formait celle de gauche.
Cette troupe ne se montait pas à plus de 500 hommes.
Les colonnes, s'étant mises en marche à 4 heures du matin le 19
octobre, quoiqu'elles essuyassent plusieurs décharges des ennemis,
marchèrent toujours avec la plus grande intrépidité sans tirer un
seul coup de fusil, conformément à l'ordre qu'ils avaient de ne
faire feu que lorsqu'ils seraient à portée de pistolet de l'ennemi.
La compagnie franche de Clairac, parvenue à cette distance, ayant
reçu alors ordre de tirer, fit un feu de file suivi de la charge, la
baïonnette en avant. Il n'y eut dans ce moment à ce poste que deux
Autrichiens tués, quelques blessés et prisonniers de fait. Le
surplus des ennemis gagnaient la première redoute à toutes jambes.
Alors, la colonne du centre s'étant jointe avec celle de la gauche,
les poursuivit et sautèrent ensemble dans le retranchement, dans
lequel tout succomba ou prit la fuite.
Pendant ce temps, celle de droite entourait l'ennemi, qui, se
trouvant investi en partie et poursuivi à grands coups de fusil
jusqu'à la redoute où était le canon, mit bas les armes et se
rendit. Toutes les redoutes étant prises, nos braves chasseurs,
après avoir fourni une escorte suffisante pour emmener les
prisonniers, au nombre de 500, ayant été joints peu de temps après
par la garnison de Gilette, poursuivirent l'ennemi à plus d'une
lieue et demie dans les montagnes, en firent un grand carnage qui ne
se termina qu'à la nuit et les mirent dans une déroute complète.
Cette victoire est remarquable autant par le courage de nos braves
républicains que par la grande disproportion des combattants,
puisque près de 4 000 hommes, munis de six pièces de canon,
retranchés sur des hauteurs avantageuses, ont été complètement
battus et mis en déroute par 500 hommes qui leur ont fait 600
prisonniers, y compris 22 officiers, parmi lesquels se trouve le
Prince de Marsico-Nuovo, fils de l'envoyé de Naples à la Cour de
Turin. Le nombre des tués et blessés dans cette affaire est évalué à
800 hommes. On leur a pris 3 pièces de canon, un nombre considérable
de fusils, cartouches et autres effets.
Je dois à la vérité d'assurer que ce récit n'est pas exagéré,
qu'il est au contraire très fidèle et que nous n'avons eu que 35
hommes au plus tués ou blessés. On ne s'étendra pas sur l'éloge des
chefs ni des braves républicains qu'ils ont conduits au combat. Tous
se sont comportés de manière à montrer aux despotes coalisés à
quelle hauteur de courage l'amour de la Liberté peut porter ceux qui
combattent sous ses drapeaux ".
" Les ennemis, le même jour de l'attaque du poste de Gilette, ont
fait une diversion à la droite de notre armée. Un coup de canon,
tiré à minuit, en fut le signal. Ils attaquèrent à 4 heures du matin
tous nos postes avancés qui les attendaient. L'adjudant général
Macquard, commandant le camp, ayant fait marcher une pièce de 4 et
s'étant porté en avant, fit tirer quelques coups de canon qui
produisirent le meilleur effet en obligeant une colonne ennemie, qui
s'avançait sur le grand chemin de Saorgio, à rétrograder et à
prendre la fuite.
Nos troupes, s'en étant aperçu, sortirent de leur retranchement,
en fondant sur l'ennemi la baïonnette au fusil, enlevèrent le poste
qu'ils occupaient à la gauche des chasseurs corses avec une telle
impétuosité qu'on fut obligé de faire battre la retraite pour
arrêter celle (sic) du soldat qui l'aurait conduit au camp que les
ennemis occupent sur les hauteurs, où ils auraient infailliblement
succombé. La bravoure qu'ils ont montrée dans cette journée, ne doit
pas être ignorée de l'armée. Le nombre des ennemis tués est de 15
hommes, avec une grande quantité de blessés. On a fait sept
prisonniers, parmi lesquels un officier piémontais, transporté à
Brelio (Breil), y est mort de ses blessures. Nous avons eu 11
blessés légèrement, dont un officier des volontaires de la Drôme
".
"Nice, le 1er jour du 2e mois de l'an 2e de la République
française une et indivisible.
Le Chef de l'état-major de l'armée d'Italie,
Signé : GAUTHIER KERVEGUERN ".
Il pêche un silure record de plus de 2 mètres
au lac de Saint-Cassien
.. Un
animateur de la fédération de pêche du Var a mis 45 minutes pour sortir ce
monstre de l’eau avec sa canne à pêche. Impossible de le glisser à bord de son
bateau, il a rejoint la berge.
..
..
"C’est la plus grosse prise du lac et sûrement du département",
témoigne Freddy Frémond.
Ce n’est pas l’histoire du monstre du Loch Ness, mais ça y ressemble. Jeudi
matin, Freddy Frémond, Niçois de 39 ans, sort tranquillement son bateau en
aluminium avec un ami sur le lac de Saint-Cassien, où il a ses habitudes. "On
était partis pour attraper des carnassiers", raconte ce guide de pêche
indépendant et animateur à la Fédération de pêche du Var. Son arme? Un leurre de
20 centimètres, simulant la nage d’un vrai poisson. Il est 11h30 quand ça mord
enfin.
"J’ai vite compris que ce n’était pas un brochet, poursuit notre expert. Il
est directement parti au fond, dans les 15mètres. Et a tiré le bateau sur
100mètres. A chaque fois que je gagnais un mètre, il en reprenait quatre."
Ce qu’il appelle un "combat " aura duré 45 minutes, le "temps de
fatiguer ce gros poisson". D’autant plus que Freddy Frémont n’avait pas
vraiment le matériel adéquat. Avec une crainte, que sa canne "casse". Une
fois à la surface, impossible de monter le silure à bord avec une simple
épuisette.
L’équipage fait donc route vers la berge la plus proche. "J’ai dû m’y
reprendre à 4 ou 5 fois pour l’attraper par la bouche avec des gants, rapporte
celui qui est fan de pêche depuis ses 7 ans. Une fois hors de l’eau, on l’a pesé
et mesuré." Verdict: 2m26 pour 80kg. "C’est la plus grosse prise du lac
et sûrement du département, précise-t-il. Mon précédent record était un silure
de 1m80, l’année dernière." Freddy Frémond relâche toujours ses prises. Le
temps d’immortaliser "M. Glane" (le diminutif de silure en latin) et cinq
minutes plus tard, il était de nouveau à l’eau.
Ce qui permettra peut-être d’établir un nouveau record l’année prochaine ou que
ce silure géant soit capturé par un autre. Notre pro de la pêche dévoile même
l’endroit où il pourrait retourner: le bras nord du lac, "où il y a le plus
de profondeur ". C’est de ce côté-là que l’écho sondeur du guide de pêche
avait détecté quelques brochets entre plusieurs silures de belle taille. "C’est
mon plus beau trophée, je ne suis pas prêt de l’oublier ", ajoute celui qui
fêtera bientôt ses 40 ans.
Pas de quoi inquiéter les baigneurs pour autant. "S’il vous passe entre les
jambes, un silure peut vous paraître impressionnant, témoigne Freddy
Frémond. Mais il n’attaque pas l’homme."
..
..

..
Son prochain défi : capturer une autre légende du lac de
Saint-Cassien, un silure albinos de plus de 2 mètres.
Espace : les images des Piliers de la création
prises par le télescope spatial James Webb
..
..
Les Pilliers de la création capturés en 1995 (à gauche), la même
image prise par Webb en 2022(à droite)
Des clichés extrêmement détaillés des célèbres colonnes de
poussières interstellaires connues sous le nom de "Piliers de la
création" pris par le télescope spatial James Webb ont été
dévoilés mercredi par la Nasa.
Une nouvelle image du télescope spatial James Webb vient de nous
parvenir et, une fois de plus, elle ne peut que nous laisser sans
voix. La Nasa vient de dévoiler un splendide cliché des Piliers de
la création, que l'on n’avait pas revu depuis presque 30 ans. Une
première photographie de ces impressionnantes structures gazeuses au
milieu des étoiles avait été prise en 1995 grâce au télescope
Hubble.
Les instruments du télescope Webb ont permis de mettre en évidence
de nouvelles étoiles ainsi que de détailler les contours de ces
grandes structures de gaz et de poussières regorgeant d'étoiles en
formation.
Les Piliers de la création sont situés dans la nébuleuse de l'Aigle,
dans la constellation du Serpent, à environ 6 500 années-lumière de
la Terre.
Des "formations rocheuses majestueuses"
"Les piliers tridimensionnels ressemblent à des formations
rocheuses majestueuses, mais sont beaucoup plus perméables. Ces
colonnes sont constituées de gaz et de poussières interstellaires
froids qui apparaissent – parfois – semi-transparents dans le
proche infrarouge", détaille la Nasa.
Ces nouvelles images "permettront aux chercheurs de revoir leurs
modèles de formation stellaire en identifiant un compte bien plus
précis d'étoiles nouvellement formées, ainsi que la quantité de gaz
et de poussière dans cette région", a expliqué la Nasa dans un
communiqué.

Repreneur, travaux, nouveaux restaurants...
On sait quand la gare du Sud pourrait rouvrir à
Nice
..

Le site qui n’a jamais su trouver son rythme de croisière a été
confié à un nouveau repreneur, IT Trattoria.
Des travaux doivent être lancés, notamment, pour améliorer le
confort thermique de la halle gourmande de Nice.
Sur le papier, ça ne pouvait pas échouer: réhabiliter la gare du Sud
pour en faire un bâtiment abritant commerces et restaurants, dans
une ambiance branchée avec moult événements pour attirer le chaland
de tous âges et de tous horizons.
Et pourtant, entre les problèmes de température (étouffant l’été,
glacial l’hiver) et d’hygiène, la halle a fini par fermer en
catastrophe le 1er avril. Seul IT - Italian Trattoria Nice Gare du
Sud avait pu garder ses portes ouvertes grâce à sa cuisine
indépendante.
Le gestionnaire d’alors, Bannimo, avait été accusé de ne pas avoir
respecté les termes du contrat.
Finalement, un repreneur a été trouvé. L’agrément a été donné par la
Ville au repreneur du bail emphytéotique de la halle, IT France
(Italian trattoria France) et le groupe Iera, lors du conseil
municipal du 30 juin. L’avantage de ce système – plutôt que de
récupérer la gestion en direct – est financier: cela rapporte
200.000 euros de loyers à la Ville.
Le maire, Christian Estrosi, tablait d’ailleurs sur l’expertise du
groupe qui "s’engage à faire des investissements considérables"
pour "donner à la gare du Sud l’attractivité qu’elle mérite d’ici
la fin de l’année".
Si l’on a encore peu de détails, des visuels ont été projetés lors
du conseil municipal du jeudi 13 octobre. L’on peut y voir la halle
gourmande, sans énormes changements structurels, mais avec une déco
dans l’esprit bohème, très à la mode depuis quelque temps.
Mobilier en bois, abat-jour en fibres naturelles et beaucoup de
plantes d’intérieur.
École de formation et espace associatif
..
..
Vue sur un restaurant
On retrouvera encore des restaurants axés sur la gastronomie
méditerranéenne, qu’elle soit niçoise, italienne, libanaise,
espagnole, orientale ou grecque. De quoi séduire les palais des
gourmets.
Un espace sera dédié à une école de formation pensée comme un
incubateur de talents pour tous les passionnés de cuisine. Au même
niveau, les associations pourront s’approprier les lieux et
organiser des événements culturels et artistiques.
Le groupe Iera compte également mettre l’accent sur l’animation en
proposant concerts et expositions tout au long de l’année.
Évidemment, des travaux seront engagés pour l’amélioration du
confort thermique.
La réouverture de la halle gourmande est très attendue par les
Niçois.
Il faudra attendre encore quelques mois. Sa réouverture est annoncée
pour le printemps 2023.
Du retard sur le chantier du raccordement de la
voie Mathis à l’autoroute A8 à Nice ?
Voici ce que l’on sait...
Depuis la passerelle de la gare provisoire Nice Saint-Augustin, un
autre chantier crucial de l’ouest de la ville est en vue. Le
raccordement qui doit désengorger la route de Grenoble et l’avenue
Grinda, et faire gagner du temps entre la sortie ouest de Nice et
l’autoroute A8, est très attendu par les usagers.
Lancé en avril 2021, la date de livraison du projet était prévue
pour juin 2024.
..

Vue du chantier en mai 2022
Elle aurait "trois mois de retard " livrait le maire
Christian Estrosi lors la réception des travaux de la nouvelle gare
Saint-Augustin. Son adjoint délégué à la circulation, Gaël Nofri
annonçait lui "six mois de retard " au micro de France Bleu
Azur le 30 août.
"Comme pour tout projet, et plus particulièrement dans le cadre
des grands chantiers structurants s’étalant sur une vaste emprise et
nécessitant des interventions techniques très délicates, les dates
de livraison sous soumises à des aléas, et restent donc
prévisionnelles", assure la municipalité. Qui détaille: "En
raison d’aléas géotechniques sur la zone de chantier, des
adaptations ont récemment été mises en œuvre dans le mode de
réalisation des travaux".
Ainsi "la mise en service de cette première phase du projet [...]
est estimée au second semestre 2024 ", concluent les services de
la Ville.
Le temps des bouchons aux heures de pointe n’est pas encore révolu.
"Il ne reste plus rien": les images hallucinantes
du lac du Broc quasiment à sec
.
.
.
Touché par la sécheresse qui frappe le département des
Alpes-Maritimes depuis janvier 2022, le lac artificiel du Broc a
aujourd'hui quasiment disparu.
Il est presque rayé de la carte. Touché par la sécheresse qui frappe
le département des Alpes-Maritimes depuis janvier 2022, le lac du
Broc a quasiment disparu.
Les clichés publiés sur les réseaux sociaux par Météo Côte d'Azur
sont effarants. D'une superficie de 25 hectares, ce lac artificiel
n'est aujourd’hui plus qu'une addition de flaques d'eau. "Il ne
reste plus rien du lac. Place désormais à une vaste étendue
caillouteuse et quelques rares parcelles d'eau", alerte Météo Côte
d'Azur.
Les averses du mois de septembre n'ont pas eu d'effet
Les images vues du ciel sont également dramatiques. Des images
satellites, récupérées par Nice-Matin, permettent de prendre
conscience de l'évolution de la situation depuis un an.
Les quelques pluies et orages du mois de septembre sur les
Alpes-Maritimes n'ont pas réussi à inverser la tendance.
..
..

..
Au total, le lac du Broc a perdu près de 8 mètres d'eau
depuis l'année dernière. "Le niveau baisse de
6 centimètres par jour ", avait assuré en septembre
Christophe Barla, le directeur de la fédération de pêche des
Alpes-Maritimes.
Des mesures inédites ont également été prises pour sauver
les poissons du lac du Broc. Des oxygénateurs ont été
installés dans les poches d'eau restantes.
Le président du Conseil départemental, Charles Ange Ginésy a
aussi annoncé la création d'un Observatoire de l’eau dans
les Alpes-Maritimes.
La célèbre vague d'Hokusai exposée au Musée des
arts asiatiques de Nice
Le Musée des arts asiatiques accueille l'exposition "Hokusai :
voyage au pied du mont Fuji ". Pour la première fois, la célèbre
vague de l'artiste japonais est exposée à Nice, parmi 126 estampes.
On vous explique comment cette œuvre de 1830 a connu le succès dans
le monde entier.
..C'est
la vague la plus célèbre du monde. Elle a inspiré de nombreux artistes dont Van
Gogh, Monet, Debussy ou Renoir. Elle sera exposée à Nice pendant quatre mois au
milieu de 126 autres estampes de son auteur, le célèbre Hokusai.
Une estampe, c'est quoi ?
Une estampe est une impression à l'encre sur du papier.
... L'œuvre
intitulée "Sous la vague au large de Kanagawa" est une estampe issue
d'une série baptisée "Trente-six vues du Mont Fuji " datant de 1830.
Adrien Brossard, conservateur du patrimoine et directeur du Musée départemental
des arts asiatiques :
"Le résultat final, c'est le papier, mais c’est tout un processus de
fabrication de création très spécifique. Il y a beaucoup d’étapes. Au départ, il
y a un artiste qui peint et ensuite cette peinture, cette image qui est créée de
l’esprit de l’artiste est transposée sur des planches en bois qui sont utilisées
pour imprimer patiemment les différents tirage."
Au 17e siècle au Japon, la technique nommée "ukiyo-e", traduit par "monde
flottant " gagne en popularité.
Edo la future Tokyo est en pleine effervescence. La ville, en pleine
construction voit se développer les combats de sumos, les théâtres Kabuki, et
les lieux de plaisir ou courtisanes accompagnent les hommes dans leur vie en
dehors du travail.
..
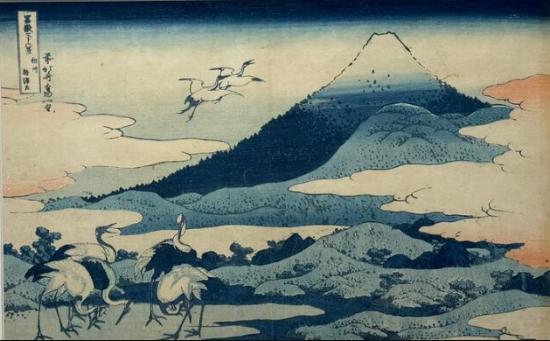
.. Les
estampes japonaises connaissent un succès au 17e siècle et permettent aux
travailleurs de s'évader de leur quotidien.
"Les concepts de vie éphémère, et l'envie de vivre dans l'instant présent se
développent " raconte Adrien Brossard.
"Il y a tout un monde d'amateurs de l’estampe qui se créait. Car on a tout un
monde qui n’est plus de la noblesse, qui correspondait plutôt à une bourgeoisie
qui est plus ou moins aisée, et qui a envie de s’entourer de belles choses. Et
parmi ces belles choses qui les fascinent, on a ces images de l’ukiyo-e, les
images du monde flottant."
Adrien Brossard : "Cette estampe leur rappelle un sentiment de
liberté en dehors de leur vie très dure. Ça leur permet de s’évader
et c’est là qu’on retrouve le côté flottant."
Trente-six vues du Mont Fuji
Les estampes connaissent de beaux succès aux 17e et 18e siècles.
Mais celui qui va faire connaître l'estampe japonaise dans le monde
entier arrive au 19e. Avec sa série "Trente-six vues du Mont Fuji
" en 1830, Hokusai relance la fascination autour du monde
flottant.
Et l'élément qui va le démarquer de ses paires, est tout droit venu
d'Occident : le bleu, omniprésent.
..
..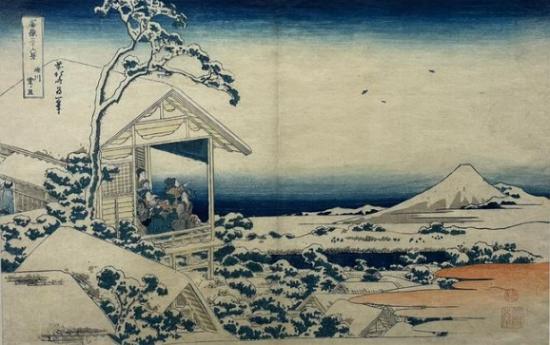
Le pigment bleu, importé d'occident, a donné une
puissance et un renouveau au travail d'Hokusai.
"La caractéristique à cette série c’est l’argument de
vente, puisqu’on a tracé d’une publicité qui annonce le
lancement de cette série et l’éditeur savait que ça allait
cartonner. L’argument phare, c’était : regardez, il y a un
nouveau pigment, et ce pigment vient de l’occident ! C’est
un bleu de Prusse qu’on appelle aussi bleu de Berlin."
Le pigment met un certain temps à arriver au Japon et à
devenir abordable pour les artistes. Un des premiers à
l'utiliser, c'est Hokusai. "C’est ce qui fait toute la
force, toute la puissance de cette série inédite en 1830
".
Le paysage n'est plus un simple décor, mais devient le sujet
à part entière. Les personnages admirent le Mont Fuji, ce
plus haut sommet du Japon.
La série est un succès au Japon, mais s'exporte aussi
jusqu'en Occident.
Adrien Brossard - directeur du musée des arts asiatiques :
Cette vague est dans l’imaginaire collectif depuis plus de 200
ans
La "vague" fait le tour du monde
..
..
.."Sous
la vague au large de Kanagawa", la plus célèbre estampe japonaise de l'artiste
Hokusai est à Nice jusqu'au 29 janvier 2023
"Dès le 19e, cette estampe va inspirer des artistes en occident. Avec
notamment "La mer" composée par Debussy. Et cette fascination va montrer aux
Japonais à quel point ils ont une production artistique extraordinaire. Et c’est
resté " explique Adrien Brossard.
Impossible aujourd'hui d'être passée à côté de cette œuvre. Dans un livre, un
film, un documentaire, affiché chez un de vos amis, vous avez forcément croisé
la route de la fameuse "vague" d'Hokusai. La culture pop a beaucoup participé à
cette popularisation.
..
..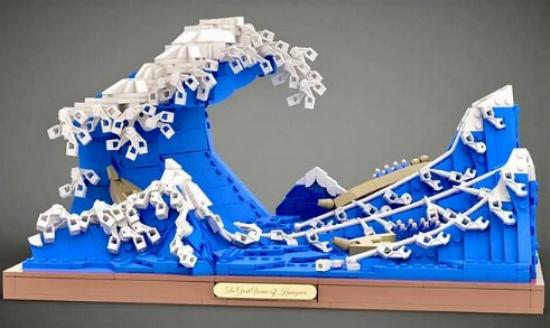
Elle se décline même en briques Lego
.."Il
y aura une relance au 20e siècle puisque la vague va être réutilisée, elle va
être réinterprétée, on va la détourner. On va aussi l’utiliser pour faire des
logos de marques. Et c’est une image efficace, c’est une vague, une montagne, du
bleu. C’est la marque des grandes œuvres d’être simple, d’être efficace et en
fait, tout le monde l’a vu au moins une fois dans sa vie" précise Adrien
Brossard.
..
..
L'exposition "Hokusai : Voyage au pied du mont Fuji" présente 126 estampes de
l'artiste japonais au musée des arts asiatiques à Nice
Le directeur du musée, amoureux de la culture asiatique est très fier
d'accueillir le tableau à Nice.
"Je me rappellerai toute ma vie de la première fois que je l’ai vu cette
vague et c’est un moment que j’ai envie de partager avec le public."
..
..
..
Elle est à découvrir avec 126 autres estampes d'Hokusai jusqu'au 29 janvier
2023 au Musée des arts asiatiques à Nice.
..
..
L'inauguration s'est déroulée ce jeudi 29 septembre, en grande pompe
A découvrir tous les jours de 10 heures à 17 heures sauf le mardi.
.
Hérault : l'incroyable odyssée de la tortue de
Valras et ses 110 œufs pondus sur la plage
L'événement rarissime sur cette partie de la
Méditerranée a suscité un engouement collectif inédit pendant deux
mois.
.
.
Près de 95 tortillons ont gagné la mer après
leur éclosion
"On était en veille sur la plage, à jeter un coup d'œil près du
nid de temps en temps et vers 20 h je me suis dit, tiens, ce serait
le bon moment, ça peut sortir. Là, je mets les pieds dans l'eau, je
tourne la tête et je vois les tortillons sortir des œufs... J'ai mis
quelques secondes à réaliser, à voir si je n'hallucinais pas... ça
faisait 57 jours qu'on attendait ! ". Alors ce 7 septembre à
Valras (Hérault), Jean-Michel Pellerin, bénévole au CestMed (Centre
d'étude et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée) a crié
à tous ceux qui l'entouraient, bénévoles comme badauds, "les
tortues sont là ! ".
.
.
Les caouannes pondent habituellement en Grèce ou Turquie
"C'était un truc de malade"
L'Héraultais a aussitôt sorti son téléphone pour filmer cette
incroyable éclosion des tortillons qui, guidés par leur instinct né
il y a 100 millions d'années, ont rapidement franchi les sept mètres
les séparant de la mer depuis le sable. Ce moment d'émotion pure a
été l'aboutissement du feuilleton de l'été depuis que la "tortue
de Valras" a été aperçue par le plus grand des hasards en train
de s'enfouir dans le sable pour pondre 110 œufs.
.
.
La tortue a pondu à Valras plage dans la nuit
du 16 au 17 juillet
Et sans Alain, restaurateur dans le Lubéron, elle
serait restée un grand secret : sortant de la fête foraine de Valras
avec ses deux petits enfants, ce 16 juillet, il a vu une Caouanne "immense"
sortir de l'eau. "Elle est venue là où elle est née il y a 40
ans, on n'a pas fait de bruit, elle s'est mise à creuser avec ses
pattes arrière puis s'est mise en position de ponte, on voyait les
œufs sortir, c'était un truc de malade " se rappelle-t-il.
La rareté du moment résulte des cycles habituels de ce reptile marin
peu enclin à mettre bas sur nos côtes. Pensez donc, seules trois
observations de ponte de Caretta Caretta ont été observées, à
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) en 2018, Fréjus et Saint-Aygulf,
sur la Côte d’Azur, en 2020.
.
Des dizaines de bénévoles ont surveillé les
lieux pendant 57 jours
"C'est exceptionnel parce que le golfe du Lion
n'est pas habituellement un site de ponte mais un endroit de
Méditerranée où les tortues viennent s'alimenter l'été avant de
repartir en Grèce ou en Libye pour pondre" détaille
Jean-Baptiste Sénégas, directeur du CestMed basé au Grau-du-Roi.
"Elles ont un cycle de deux ans, après leur ponte elles
mettent tout l'hiver à venir ici, elles font 30 km par jour, elles
passent l'été à s'engraisser et repartent l'hiver suivant vers la
Grèce".
Au parc national de Zakynthos, en mer Ionienne,
1024 nids ont été tout récemment comptabilisés.
Réchauffement climatique
Alors comment expliquer le phénomène de Valras ?
"Les conditions météo s'y prêtaient et c'est un hasard, combien
de pontes ratons-nous ? Bien malin qui pourrait le dire, ça va nous
obliger à être plus vigilant " pointe Renaud
Depuy-de-la-Grandrive, directeur du milieu marin d'Agde. Le
réchauffement climatique a pu jouer un rôle. "On a eu un été très
chaud, merveilleux pour nos petites tortues et en Italie il y a eu
30 nids cette année, ça commence à faire" abonde Jean-Baptiste
Sénégas.
Il montre dans sa main les coquilles d'œuf récoltées dans le sable
et dont les expertises génétiques montreront à quelle population
appartient la Caouanne. Et combien de"papas" ont fécondé
cette femelle qui stocke leur semence pendant des années. Le
directeur compte aussi sur la puissance des réseaux sociaux pour que
le centre soit alerté dès qu'une nouvelle suspicion de ponte sera
signalée, comme à Saint-Pierre-la-Mer (Aude) le 17 août, alors que
ses équipes ont prospecté les plages à la recherche de nids, tout
l'été, en vain, y compris avec des chiens renifleurs.
.

Les coquilles d'oeufs vont être expertisées génétiquement pour
déterminer la catégorie de tortue caouanne
"C'est exceptionnel parce que le golfe du Lion n'est pas
habituellement un site de ponte mais un endroit de Méditerranée où
les tortues viennent s'alimenter l'été avant de repartir en Grèce ou
en Libye pour pondre" détaille Jean-Baptiste Sénégas, directeur du
CestMed basé au Grau-du-Roi. "Elles ont un cycle de deux ans, après
leur ponte elles mettent tout l'hiver à venir ici, elles font 30 km
par jour, elles passent l'été à s'engraisser et repartent l'hiver
suivant vers la Grèce".
Au parc national de Zakynthos, en mer Ionienne, 1024 nids ont
été tout récemment comptabilisés.
Engouement populaire
Un engouement populaire exceptionnel a aussi accompagné la tortue de
Valras dont les œufs ont été couvés par des milliers de curieux et
200 volontaires pour surveiller le site pendant 57 jours offrant une
exposition inédite à cet animal marin menacé et protégé. "On a eu
la chance d'avoir cette ponte, on voulait en être digne" lance
Sébastien Vieu, adjoint à l'environnement de Valras, qui, avec
l'association de sauvegarde du littoral des Orpellières, a organisé
le gel des lieux et leur surveillance 24 h sur 24 tout en faisant de
l'éducation à l'environnement via des grands panneaux explicatifs
sur la Caretta Caretta.
"Nous faisons le parallèle avec l'engouement pour l'orque ou le
bélouga dans la Seine, il y a cette capacité à s'émouvoir et se
sentir concerné car ces animaux sont des ambassadeurs des océans et
ils vivent sous notre nez" analyse de son côté Lamya Essemlali,
la présidente de l'association environnementaliste Sea Shepherd qui
a activement participé à la "couvade". "Ce moment magique
est un facteur d'espoir et de frustration aussi, car ces histoires
n'ont de sens que si elles éveillent les consciences sur ce qui se
passe en mer, avec les problèmes de surpêche et des macrodéchets
plastique qui impactent notamment les tortues".
Tunnel de Tende : "les travaux vont monter en puissance",
selon le ministère de la transition écologique
.
.
Les opérations d'excavation du nouveau tunnel de
Tende ont redémarré dans le tonneau en construction côté français
Sous présidence française, une nouvelle Commission
intergouvernementale (CIG) des Alpes du sud s'est tenue cette
semaine. Une CIG entièrement consacrée à l’examen des travaux du
tunnel de Tende.
Les travaux avancent dans le tunnel de Tende. La dernière Commission
intergouvernementale (CIG), qui s'est déroulée le 6 septembre
dernier, a permis de faire un point sur le planning de ce chantier
qui dure depuis plusieurs années, sous maîtrise d'ouvrage italienne.
Depuis le 3 novembre 2021, le percement du tunnel se poursuit
toujours côté italien. Des travaux qui se font désormais au "marteau
mécanique, en raison de la présence d’un matériau pas assez compact
pour utiliser l’explosif ", expliquait en avril l'Anas, la
société qui gère le réseau routier italien.
Début août 2020 (avant le passage de la tempête Alex), nous avions
pu filmer ces travaux aux côtés des ouvriers italiens :
.

.
Côté français, les travaux ont recommencé le 22 avril de cette
année. Il reste désormais 911 mètres au total à creuser.
Questions de sécurité
Deux ans après le passage de la tempête Alex, qui a notamment
détruit la route qui mène jusqu'au tunnel de Tende côté français,
les enjeux de sécurité sur ce chantier se sont multipliés.
.

L'un des 13 "bypass" qui permettront des connexions entre les 2
tunnels pour les piétons et les véhicules de secours
Dans un communiqué, le ministère de la transition écologique
détaille les trois points principaux : "la prise en compte des
risques naturels liés à l’instabilité des terrains et au double
risque hydraulique de la Roya et de la Ca [le vallon qui se trouve à
la sortie du tunnel côté français, NDLR], la sécurité des usagers
tant au titre du tunnel que de la géométrie du projet et enfin la
robustesse des solutions techniques".
Fin des travaux en 2025 : un "objectif prioritaire"
Malgré "des études [...] à approfondir" et "un dossier de
sécurité [...] à finaliser", "les travaux devraient pouvoir
monter en puissance", assure le ministère. "Le chantier se
poursuit à ce jour dans des conditions satisfaisantes."
Prochaines étapes à mettre en place : reconstruire la plate-forme
d'accès au tunnel côté français détruite par la tempête Alex et
réaliser un pont en arc de 70 mètres de long pour enjamber le vallon
de la Ca et rejoindre la RD 6204.
Le calendrier est, pour l'heure, respecté. L'ouverture à la
circulation du nouveau tunnel est prévue pour "octobre 2023"
; celle de l'ancien tunnel rénové et sécurité est prévue "en 2025".
"Ces échéances sont désormais des objectifs prioritaires",
indique le ministère français.
La route des 46 lacets, qui mène de Tende au Col de Tende. C'est le
seul chemin pour relier la France et l'Italie depuis que la tempête
Alex a emporté la route qui mène au tunnel de Tende. La circulation
y est très réglementée.
.

Actuellement, le seul moyen de relier Tende dans les Alpes-Maritimes
et le Piémont italien, c'est d'emprunter la route des 46 lacets qui
serpente sur le col de Tende.
Mais cette ancienne route militaire, étroite et peu entretenue, est
réservée aux habitants de Tende et de La Brigue.
Mort d'Elizabeth II : les trois histoires qui
ont rendu la Côte d'Azur anglaise
.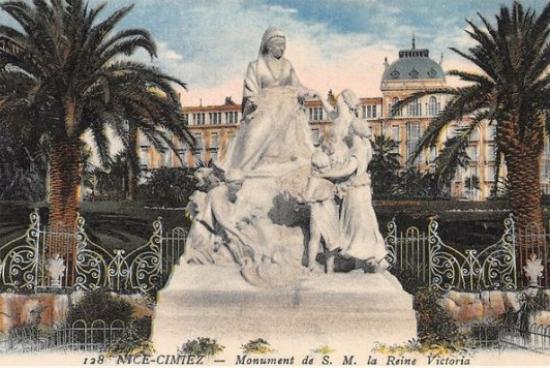
Le monument à la reine Victoria, dans le quartier de Cimiez à
Nice, a été érigé en 1912 par le sculpteur Louis Maubert pour rendre
hommage à la souveraine, qui a fréquemment hiverné à Nice de 1887 à
1899 et contribué à la réputation de Cimiez
Ah, la French Riviera ! Haut lieu de villégiature des aristocrates
anglais du XVIIIème siècle, savez-vous qu'on leur doit beaucoup ?
Retour sur une page de l'histoire de la Côte d'Azur au lendemain du
décès de la reine Elizabeth II.
On raconte même qu'ils ont inventé la Côte d'Azur !
Voici trois exemples, entre légendes et vérités, des nombreuses
empreintes britanniques entre Saint-Tropez et Menton.
Cannes, découverte par un Anglais
Il s'appelle Lord Henry Brougham, il est un homme politique et
écrivain.
En 1834, il prend la route de l'Italie avec sa fille malade,
Eleonore-Louise Brougham. Mais, lorsque le père et la fille arrivent
à la frontière, à cette époque située au fleuve du Var, les
douaniers leur refusent le passage, pour cause de choléra, ils font
alors demi-tour.
C'est un matin de décembre 1834, qu'Henry Brougham et
Eleonore-Louise Brougham arrivent à Cannes, qui n'est alors qu'un
village de pêcheurs concentré autour du Suquet.
En 1830, la ville ne compte que 3.000 habitants. Le charme opère.
Séduit par le panorama, le bleu azur et la douceur de vivre,
l'aristocrate acquiert un terrain dès janvier 1835 dans l'actuel
quartier de la Croix-des-Gardes. Il y fait construire une somptueuse
villa qui portera le nom de sa fille, décédée le 10 août 1835 avant
la pose de la première pierre de la villa Eleonore-Louise.
.
. 
Villa Eleonore
C'est la première résidence de villégiature à Cannes. L'homme y
invite ses amis de l'aristocratie anglaise. La ville de Cannes est
née. Lord Henry Brougham décède au printemps 1868, enterré au
cimetière du Grand Jas.
Il possède désormais sa statue à côté du palais des festivals.
.
.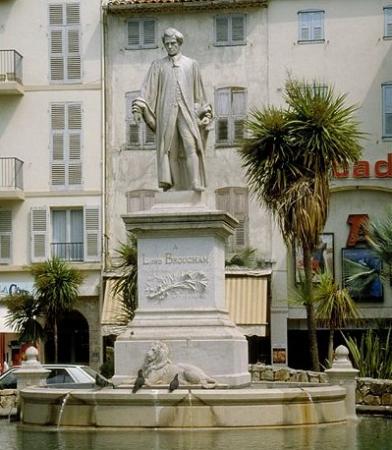
Statue Henry Brougham 31/01/20
La Prom tant désirée des Anglais
À partir du XVIIIème siècle, de nombreux aristocrates britanniques
viennent passer leurs hivers à Nice. A l'époque, la ville est
réputée pour son climat doux. Ils font alors construire des villas
le long de la baie des anges.
Mais voilà, à Nice, il n'y a pas de sentier pour se promener en bord
de mer.
.
.
Peinture promenade des anglais
L'une des hypothèses consiste à dire que les Anglais, pris de pitié
pour le peuple niçois après un hiver rigoureux et de mauvaises
récoltes, ont financé la construction d'une promenade en bord de
mer.
C'est le révèrend Lewis Way, qui après avoir tracé la dite
promenade, a collecté des fonds afin d'employer des chômeurs et
mendiants de 1820 et 1821.
Les travaux se terminent en 1924. Elle est baptisée "Strada del
littorale", mais les niçois la surnomment rapidement "El
camin dei Inglés".
C'est ce nom qui sera retenu lors de l'annexion du comté de Nice à
la France en 1860.
Mais selon Hervé Barelli, spécialiste de l'histoire de Nice, au même
moment les anglais font construire une église anglicane. "Ils
font une sorte d'opération de communication pour faire avaler la
construction de l'édifice dans un pays catholique comme Nice, donc
en même temps, ils font construire la promenade", explique-t-il.
Canon, ces britanniques !
Autre emblème niçois, le coup de canon de midi. La tradition remonte
à 160 ans, Sir Coventry passe ses hivers à Nice. Mais, exaspéré de
ne pas voir sa femme à l'heure pour le déjeuner, il demande à la
mairie de Nice l'autorisation de tirer un coup de canon. L'idée, la
prévenir qu'il est l'heure de rentrer.
.
.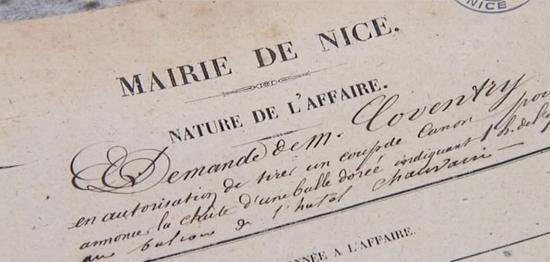
Coup de canon
C'est ainsi que le maire de l’époque, M. Malausséna, accepta l’idée
de l'ancien colonel de l'armée anglaise, car le lord prenait tout à
ses frais, l’artillerie également.
L’histoire ne nous dit pas comment a réagi l’épouse en question.
Les niçois adoptèrent la tradition. C'est ainsi qu'en 1885, alors
que le lord ne séjourne plus à Nice l'hiver, le maire dépose un
arrêté municipal "Lou Canoun de Miejour".
Depuis, tous les jours de l'année, sauf le 14 juillet, pour rendre
hommage aux victimes de l'attentat de Nice, retentit un coup de feu,
le canon ayant été remplacé par une bombe d’artifice .
Trois bonnes raisons de voir ou revoir le
documentaire "Alaïs, tortue sauvage de Provence"
Au cœur du massif des Maures, sur la Côte d’Azur, Jean Yves Collet
raconte l’histoire d’Alaïs, une tortue ayant atteint l’âge canonique
de 82 ans. Un récit captivant, tourné au plus près d’une espèce
menacée d’extinction. Que vous soyez passionné d'animaux ou non,
voici pourquoi on vous recommande ce film.
.
.
.
1. Parce que les tortues sont fascinantes et attachantes
Les premiers ancêtres de la tortue sont apparus sur terre il y a
plus de 240 millions d’années, en même temps que les premiers
dinosaures ! Pourtant, son allure débonnaire et pacifique font de
cet étonnant reptile l’une des créatures les plus aimées du monde
animal.
Aujourd’hui, les collines du massif des Maures, au nord du Golfe de
Saint-Tropez, sont le dernier refuge de la tortue d’Hermann, ou
tortue des Maures, la seule tortue terrestre sauvage de France.
.
.
Depuis 1979, la tortue des Maures est légalement protégée au plus
haut niveau par les instances françaises et internationales
Ces dernières décennies, les activités humaines ont largement réduit
sa population, au point qu’elle est désormais protégée comme un
trésor national.
Difficile, donc, de ne pas s’attacher à la paisible Alaïs, dont le
film reconstitue les aventures et prérégrinations des années 40
jusqu’à nos jours...
2. Parce que l’on est totalement immergé dans son univers
C’est un récit à hauteur de tortue. Dans ce film, la caméra est en
permanence "du côté" des tortues : les rares humains et les grands
animaux sauvages ou domestiques que croise Alaïs sont perçus comme
des géants.
Le parti pris de narration – un découpage en quatre séquences
relatant les phases les plus marquantes de son existence - permet
d’aborder divers aspects du comportement naturel de l’espèce et de
son milieu de vie. On apprend ainsi beaucoup sur les moeurs de ce
petit animal discret et solitaire.
.
.
Un film tourné à hauteur de tortue
Pour ce tournage, des moyens techniques spécifiques ont été pensés
et créés, avec un véritable "studio naturel" mis en place dans la
région. Une façon de capter tout le caractère extraordinaire de la
vie de cette tortue des Maures et de son territoire exceptionnel de
beauté.
Précision d’importance : aucune tortue sauvage n’a été dérangée pour
les besoins du film ! Ce dernier bénéficie d’ailleurs de la caution
d’une équipe de conseillers animaliers et scientifiques, sous la
direction du biologiste Marc Cheylan, spécialiste des reptiles.
3. Parce que ce documentaire nous donne à réfléchir
Habitué des documentaires animaliers – notamment sur la tortue
d’Hermann en 2016 - Jean-Yves Collet mène un travail de réalisation
original et sa manière de traiter des sujets graves avec une grande
douceur continue de nous séduire dans cette nouvelle aventure
atypique.
.
.
Alaïs a survécu au grand incendie de 1990, contrairement à nombre
de ses congénères, mais subsister dans un environnement dévasté ne
sera pas facile
Résolument pédagogique, jamais moralisateur, son film nous incite à
réfléchir, plus que jamais, à notre impact sur l’environnement, la
faune et la flore. A prêter plus ample attention à ces animaux en
péril qui nous entourent, sur notre propre terrain, et que nous
avons tendance à négliger.
Car si la tortue des Maures a des prédateurs naturels, les grands
dangers qui la menacent ont bien une origine humaine...
Alaïs, tortue sauvage de Provence
Un film de 52’ écrit, filmé et réalisé par Jean Yves Collet.
Une coproduction France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur / Flair
Production.
Diffusion jeudi 8 septembre 2022 à 22h50 sur France 3
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bruit et vitesse sur la route de la Bonette :
le Parc National du Mercantour veut protéger sa faune
.
.
.
Elle relie la Côte d'Azur aux Alpes-de-Haute-Provence et c'est la
route la plus haute d'Europe. La route de la Bonette est fréquentée,
au point que le Parc National du Mercantour lance un appel : le
trafic génère trop de nuisances sonores pour la faune.
Entre la vallée de la Tinée dans les Alpes-Maritimes, et la vallée
de l'Ubaye dans les Alpes-de-Haute-Provence, il y a un ruban
d'asphalte au milieu de paysages de toute beauté. C'est la route de
la Bonette, du nom du col qui culmine à 2 802 mètres d'altitude.
Elle est située dans le périmètre du Parc National du Mercantour.
Cet axe d'environ 50 kilomètres est fermé l'hiver en raison de la
neige, mais pendant les beaux jours, il est très fréquenté.
Automobilistes, cyclistes, motards empruntent de nombreux lacets.
Le Parc National du Mercantour a d'ailleurs fait le compte ( il y a
deux compteurs routiers ) : 100 000 passages pendant les 5 mois
d'ouverture parmi lesquels 20% de vélos et 25% de motos.
.
. . .
Motards et automobilistes dans le viseur
Et ce sont bien ceux qui font du bruit qui sont visés par le Parc du
Mercantour et la gendarmerie. Les décibels produits par les
accélérations ou décélérations des véhicules résonnent dans toute la
montagne. Or, la route métropolitaine (côté Alpes-Maritimes) est
située dans la zone de sensibilité majeure ( ZSM ) du Parc.
La faune est importante, chamois, bouquetins, marmottes, et il y a
aussi le gypaète barbu.
.
.
Un gypaète barbu en plein vol
Il s'agit d'un rapace, l'un des plus grands
d'Europe avec une envergure de 2 mètres 90 qui a
été réintroduit dans cette zone voilà 30 ans. Il
chasse dans un rayon de 250 kilomètres autour de
son nid.
Lever le pied
En 2017, une étude acoustique le long de la route de la Bonette a
démontré que le niveau de nuisance sonore était équivalent à celui
d'un parc urbain de la ville de Rouen, indique le Parc National du
Mercantour dans un post. De quoi perturber les animaux, de quoi
déranger les randonneurs, en quête de quiétude au milieu des sommets
!
.
.
.
Le Parc indique donc qu'il veille, accompagné
par les forces de l'ordre. Il est question de
respect de l'environnement, et d'accidentologie.
Parc National du Mercantour
La limite de vitesse a été baissée de 80 km/h
à 50 km/h depuis le camp des Fourches jusqu'à
Jausiers, limitant le bruit de roulement des
véhicules, mais aussi par rapport à
l'accidentologie.
Et attention si vous êtes adeptes de la vitesse
! Des contrôles ont eu lieu, il y en aura
d'autres.
Cette année, plusieurs contrôles routiers sont
réalisés... La conformité des pots d'échappement
des motos sont également contrôlés, notamment la
présence de chicanes (pièce du pot d'échappement
qui permet de limiter le bruit). En retirant
cette pièce du pot d'échappement, le bruit
généré peut être supérieur de 20 à 30 dB. Un pot
non conforme est passible au minimum d'une
amende de 135 €.
Parc National du Mercantour
.
.
La route est la plus haute d'Europe et est
empruntée par de nombreux cyclistes, mais aussi
des motards et des automobilistes.
Alors un message du Parc : prenez le temps, regardez le paysage au
lieu de jouer sur la vitesse !
Il y va de la quiétude des animaux, et de la sécurité sur la route !
Sécheresse: le lac du Broc presque à sec, des
oxygénateurs installés pour sauver les poissons
.
.
.
C'est un triste spectacle pour les amoureux de la nature. Le Lac du
Broc, situé sur les hauteurs de Nice, est quasiment à sec. Face aux
conséquences pour la faune et la flore, des oxygénateurs ont été
installés en urgence.
C'est d'ordinaire une belle étendue d'eau, aux reflets turquoise,
située entre Carros et La Roquette-Sur-Var, à l'ouest du fleuve Var.
Le lac du Broc est bien connu pour les amateurs de randonnée, de
pêche et de détente en plein air.
Jean-Luc Cerutti, président de la Fédération de pêche des
Alpes-Maritimes : "C'est
bien simple, je ne l'ai jamais vu aussi bas, alors que je pêche
depuis l'âge de 12 ans"
Une véritable catastrophe écologique, pour la faune comme pour la
flore. D'autant que le lac est directement relié à la nappe
phréatique.
.
.
.
Pêche et accès interdits
.
.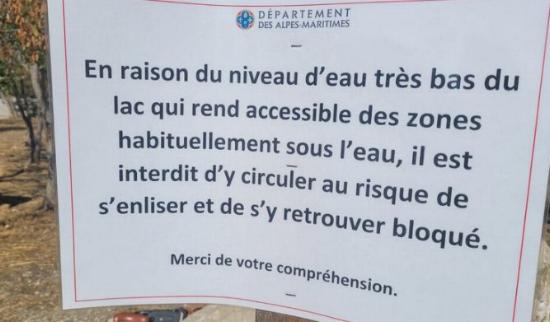
.
Le lac du Broc, bien connu des pêcheurs, abrite d'ordinaire de
nombreux poissons. Notamment des carpes et des brochets.
Mais face au manque d'eau, leur place pour vivre a été
considérablement réduite. D'ailleurs, il y a deux semaines, la pêche
a dû y être tout simplement interdite, pour éviter de décimer ce
qu'il reste de poissons.
L'accès au lac est également très restreint, et il est d'ailleurs
interdit d'y pénétrer à pied. Une mesure de sécurité, face au risque
d'enlisement dans la vase
Des oxygénateurs installés
.
.
.
Aujourd'hui, face au risque de disparition complète du lac, des
mesures d'urgence ont dû être prises.
A commencer par l'installation de plusieurs oxygénateurs d'eau grand
format par la Fédération de pêche des Alpes-Maritimes. Ces drôles de
machines ont été installées dans la poche d'eau principale, où les
poissons se sont regroupés. Ils fonctionnent de 18h à 6h du matin,
lorsqu'il n'y a plus de vent.
"Ce sont des grosses hélices, qui provoquent des remous et
permettent d'apporter de l'oxygène dans l'eau", explique le
président de la Fédération de pêche des Alpes-Maritimes.
Sauver un maximum de poissons
En tout, selon la Fédération de pêche, il pourrait y avoir 40 tonnes
de poissons dans ce bassin réoxygéné par deux machines. Et il est
crucial d'en sauver un maximum.
Car ils ont un rôle majeur sur l'évolution du lac. "Sans ces
poissons, qui agissent comme des régulateurs, on obtiendrait de
l'eau "morte", sans vie, et qui va rapidement devenir verte et
envahie par les algues", explique Jean-Luc Cerutti.
Reste à savoir si ces oxygénateurs seront suffisants.
Seul espoir face à cette situation: de possibles pluies, attendues
dans les prochains jours, pourraient permettre d'éviter une
catastrophe écologique annoncée.
Des traces de pas, datant d'avant les
dinosaures, ont été découvertes dans les Alpes-Maritimes
.
.
.
A Saint-Etienne-de-Tinée, dans les Alpes-Maritimes, un promeneur a
fait une découverte originale : des empreintes de reptile remontant
à 242 millions d'années.
Un nouveau Jurassic Park ?
Tout commence en septembre 2020, lorsqu'un promeneur découvre en
bord de route, des traces de pas surprenantes. Elles sont comme
incrustées dans la roche, aux abords de Saint-Etienne-de-Tinée, dans
les Alpes-Maritimes.
Des scientifiques sont alors appelés pour analyser ces traces et
déterminer leur origine. Les paléontologues du laboratoire du
Lazaret, attribuent ces empreintes à un "Chirotherium barthii
", un reptile long de 3 à 4 mètres, qui peuplait les terres arides
et hostiles des Alpes-Maritimes, il y a 242 millions d'années.
On a pu observer qu'il était quasiment en train de devenir
bipède, car les traces de pattes sont plus enfoncées à l'arrière.(Emmanuel
Desclaux, archéologue du laboratoire départemental du lazaret)
Seulement des dizaines dans le monde
Ces découvertes ont pu être précisées grâce à l'usage de nouvelles
technologies. Les empreintes du reptile ont été numérisées en 3D.
Pour affiner la période, une étude du terrain a également été
réalisée.
Historiquement, ce qui a permis de conserver ces traces, c'est la
géologie. Il a fallu qu'un de ces grands reptiles, laisse une trace
à un endroit précis, que les crues la recouvrent en y déposant des
sédiments. C'est un phénomène rare. (Emmanuel
Desclaux, archéologue du laboratoire départemental du lazaret)
Ainsi des traces datant de cette période, n'ont été observées que
quelques dizaines de fois, dans le monde. A l'époque, les
Alpes-Maritimes étaient une zone très aride. Elles se situaient au
sud de ce continent unique, limitrophe avec la mer, appelé la
Pangée. Les températures s'élevaient à 35 degrés, et les pluies se
faisaient rares.
Mais ce n'est pas la première fois que des traces préhistoriques
sont découvertes dans la vallée des merveilles, celles de plus
petits reptiles avaient été observées dans les années 2000. Elles
appartenaient au "Varanopus", un reptile vivant à une période
située entre - 299 et -252 millions d’années. Elles sont les plus
anciennes traces de vie animale connues dans le département.
"Nous rentrons dans une nouvelle ère d'extinction"
A cause du manque d'eau, des traces de pas de dinosaures jusqu'ici
dissimulées et probablement vieilles d'environ 113 millions d'années
sont apparues au grand jour dans le lit d'une rivière asséchée au
Texas (Etats-Unis). Comme pour notre reptile, ces profondes traces
étaient préalablement enfouies, remplies de sédiments et recouvertes
d'eau, ce qui a aidé à leur conservation.
"A cause de conditions de sécheresse excessives cet été, la
rivière s'est complètement asséchée dans la plupart des endroits, ce
qui a permis de révéler de nouvelles traces dans le parc", a
déclaré Stephanie Salinas Garcia, du Département en charge des parcs
et de la faune du Texas.
Sur Youtube, nos confrères du Parisien, partagent la vidéo de cette
découverte :
.
Lorsque nous interrogeons Emmanuel Desclaux, sur des découvertes
similaires sur notre territoire à cause de la sécheresse et du
réchauffement climatique, il répond : "Nous n'avons pas les mêmes
conditions géographiques qu'au Texas, ni la même typologie, donc on
ne peut affirmer qu'il y aura les mêmes phénomènes."
Néanmoins, les traces découvertes dans la vallée seront exposées en
2023 pour sensibiliser le grand public à certains changements.
La paléontologue ajoute : "Nous rentrons dans la 6e ère
d'extinction du vivant ! "
L'exposition permettra de revenir sur cette découverte, mais aussi
d'expliquer les origines de l'extinction de ces espèces et d'évoquer
les nouveaux défis auxquels l'humanité sera confrontée dans les
décennies à venir.


On sait ce qui est arrivé à la madone
mystérieusement disparue près de la frontière italienne dans le
Mercantour
.
.
.
Une statue de madone placée en haut du collet des Bresses dans le
parc du Mercantour a disparu depuis une dizaine de jours au moins.
Ce lundi 22 août, la maire de Valdeblore souhaite rassurer les
randonneurs : la madone n'a finalement pas été volée !
Plus de peur que de mal ! La maire de Valdeblore Carole Cervel se
réjouit, ce lundi 22 août. Elle sait désormais où se trouve la
statue de la madone qui a disparu au milieu du mois d'août.
Située près des lacs des Bresses, tout proche du lac Nègre, cette
statue de 80 cm veille sur le collet des Bresses depuis presque
quinze ans. Des randonneurs ont signalé sa disparition le 12 août
sur les réseaux sociaux. Il ne restait alors plus que son socle
rouillé.
Il y a de quoi être déçu quand on sait que ce point peut être
atteint après trois à quatre heures de marche.
.
.
.
La réponse au mystère reçue par e-mail
Alertée, la maire de la ville comptait porter plainte.
Elle n'a pas été volée !
Carole Cervel, maire de Valdeblore
Toutefois, une personne s'est manifestée d'elle-même auprès de la
mairie, après avoir vu que la disparition de la madone faisait
parler. "J'ai reçu un e-mail de la part de la personne qui l'a
déposée à cet endroit en 2008", détaille la maire. Cette
personne l'a récupérée pour la restaurer !
Une autre statue en bois sera placée provisoirement le temps de
la restauration.
Carole Cervel, maire de Valdeblore


Il reste moins d'un kilomètre à creuser au tunnel
de Tende
..
..
D’après la presse italienne, le nouveau tube sera
prêt pour octobre 2023. Une réunion entre les deux pays devra être
organisée pour pouvoir lancer les travaux du viaduc d’accès côté
français.
En affirmant devant la presse italienne (*) que la tenue d’une
commission intergouvernementale (CIG) ne serait pas indispensable
pour lancer le chantier de construction du viaduc d’accès au tunnel
de Tende – côté français –, le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo,
a créé une petite polémique. Sous entendant que la bureaucratie
freine toujours (et encore) l’avancée du projet. Quand les Italiens
affirment que c’est le souhait français de créer un rond-point en
sortie de tunnel qui a ralenti les choses.
Une commission finalement convoquée
Mais cet accroc avec les Transalpins aura au moins
permis d’en savoir plus sur les travaux engagés depuis des années
entre France et Italie.
Suite aux propos du Tendasque, les maires de la Vermenagna et les
autorités concernés se sont en effet réunis à Robilante. En lien
avec le commissaire exceptionnel pour le tunnel de Tende, Nicola
Prisco, resté à Milan. Ce dernier a rappelé qu’une CIG serait bel et
bien nécessaire à l’approbation et au démarrage des travaux du
viaduc. Mais qu’elle serait convoquée dans les prochains jours.
La Stampa rapporte les éléments concrets évoqués lors de ces
échanges. D’abord sur les questions financières: le pont et les
travaux annexes (justifiés par la destruction totale de la voie
d’accès au col lors de la tempête Alex fin 2020) représenteront un
surcoût de 76 millions d’euros, pour un total de 255 millions.
Puis sur le calendrier: le nouveau tunnel et le viaduc devraient
être prêts pour octobre 2023. Tandis que le tube historique devrait
être reconstruit à l’horizon juin 2025.
"On avance à raison de 4 mètres par jour"
Lors de cette réunion, la parole a été donnée à
l’ingénieur Nicolò Canepa, en mesure de résumer l’avancée des
travaux. "Ils tournent à plein régime, avec 60 employés. Côté
italien, 1.558mètres ont été creusés et il manque 161mètres pour
atteindre la frontière, indique-t-il dans les colonnes de La Stampa.
En France, où, grâce à une roche plus compacte, on avance à raison
de 4mètres par jour, nous sommes à 686mètres de profondeur – soit à
815m de la frontière."
À cette occasion, les élus ont également fait savoir qu’ils
aimeraient un point d’information mensuel, et un dialogue plus
assidu avec les autorités en charge du chantier. Un point sur lequel
Français et Italiens restent, pour le coup, totalement en phase.


Les fresques énigmatiques de Notre-Dame des
Fontaines
.
.
.
Au premier abord, ce site classé ne laisse rien présager de sa
beauté intérieure. Pourtant, vous allez vivre une visite qui se
rapproche plus du voyage dans le temps. Située sur la commune de La
Brigue, cette chapelle est un choc. Les artistes Canavesio et
Baleison nous livrent ici une vision exceptionnelle. Leurs fresques
du XVe siècle sont une "sacrée" bande-dessinée, illustrée du sol au
plafond…
.
.
Elle se contemple sur 220 m² : surprenante, captivante, envoûtante
.

.
Ces fresques racontent la vie de Jésus. On y retrouve tous les codes
de la BD, avec ses méchants aux visages caractéristiques, et ses
gentils dotés d’auréoles. Ces codes manichéens permettaient de
marquer les esprits.
.
UN SANCTUAIRE ISOLÉ
A pied, en remontant le sentier d’interprétation depuis le village,
on peut ressentir l’ambiance sereine de ce lieu. Le site est isolé à
4 kilomètres du village, aux portes du vallon du Mont Noir.


A découvrir dans les Alpes-Maritimes : le mont
Gélas, point culminant du Mercantour .

Avec
ses 3143 mètres de haut, le mont Gélas domine le parc naturel du
Mercantour.
Il y a plusieurs années, des sportifs un peu fous avaient décidé de
rejoindre son sommet en partant de Nice à vélo et à ski.
"Si on a de la chance, au sommet du Gélas on peut apercevoir le
Mont Blanc d’un côté et la Corse de l’autre", décrit Jean
Capitant, guide de montagne, membre de l’association Guide 06. Ce
sommet se trouve dans le parc naturel du Mercantour, à mi-chemin
entre les Alpes-Maritimes et l’Italie.
Son nom provient du verbe "gelà" qui signifie "geler"
en provençal/niçois et faisait référence aux anciens glaciers situés
sur l’ensemble de ces flancs, en grande partie disparus au cours du
XXème s.
La première ascension du Gélas remonte à 1864. A l’époque, toutes
les grandes cimes des Alpes étaient déjà conquises depuis longtemps
mais les sommets des Alpes-Maritimes restaient vierges. Le comte
Paolo di Saint-Robert, alpiniste et scientifique, décide de partir à
sa conquête. Il veut aussi vérifier qu’il s’agit bien du point
culminant des Alpes-Maritimes.
Après avoir passé plusieurs nuits au refuge du col de Fenestre, les
alpinistes commencent leur ascension. Cinq heures plus tard, le 17
juillet 1864, la cime Nord du Gélas sera foulée pour la première
fois par des pieds humains.
Si l’ascension du Gélas est considérée comme "facile", il
faut quand même faire un peu d’alpinisme pour accéder au sommet.
"Mais on peut se rendre au balcon du Gélas, juste en dessous, en
empruntant un circuit de randonnée, précise Jean Capitant. C’est
assez sportif, il y a 1200 mètres de dénivelé et l’ascension dure à
peu près quatre heures. Mais il n’y a pas besoin de matériel
d’alpinisme", ajoute le guide de montagne.
Le chemin part du refuge de la Madone de Fenestre, accessible en
voiture. Il ne s’agit pas d’un sentier balisé donc si on n’est pas
complétement autonome en montagne – c’est-à-dire capable de
s’orienter et de réagir en cas d’incident – il est fortement
recommandé de se faire accompagner par un guide expérimenté.
De zéro à 3143 mètres
La randonnée vous parait déjà assez difficile ? Certains ne se sont
pas arrêtés là. Pendant plusieurs années, des sportifs un peu fous
ont organisé la "Prom’ Gélas". Les coureurs partaient en vélo
de la promenade des Anglais, à Nice jusqu’au col de Fenestre, avant
de chausser des skis de randonnée pour entamer l’ascension jusqu’au
balcon du Gélas.
Avec un copain, on faisait le Gélas en ski et on a rencontré un
vieux monsieur qui allait jusqu'au refuge de la Madone de Fenestre à
vélo, et puis il chaussait ses skis pour faire le reste du parcours.
On s'est dit que c'était génial, donc on a organisé ça et ça a pas
mal intéressé le petit milieu du ski d'alpinisme niçois (Marc
Barret, organisateur de la Prom' Gélas)
"C’est le plus gros dénivelé du département, on part de zéro pour
arriver à plus de 3000 mètres ! s’exclame Jean Capitant. Il y
a au moins une centaine de kilomètres".
Aujourd’hui, cela fait plusieurs années que la compétition n’a pas
eu lieu. Depuis 2012, une réglementation limite les manifestations
publiques dans le "cœur" du parc du Mercantour - un espace
particulièrement protégé, dans lequel se trouve notamment le mont
Gélas.
"La Prom' Gélas se passait au printemps. C'est une période
particulièrement sensible pour la faune qui sort tout juste de
l'hiver, c'est aussi le moment de la reproduction", justifie
Emmanuel Gastaud, responsable de la communication au parc du
Mercantour. "Nous avons expliqué aux organisateurs que la
manifestation ne pourrait plus avoir lieu tous les ans, et ça fait
plusieurs années que nous n'avons pas eu de demandes d'autorisation",
ajoute le responsable.
Lors de la dernière édition, en 2015, l'événement avait réuni une
centaine de personnes. "C'était assez confidentiel, il faut
vraiment avoir le niveau physique", confirme Jean Capitant. Mais
les organisateurs ne désespèrent pas d'organiser bientôt une
nouvelle édition.
A découvrir dans les Alpes-Maritimes : le lac de
Fenestre, une étape sur "la route du sel"

Au cœur du massif du Mercantour, le lac de Fenestre tire son nom
d'une ouverture entre deux roches, une "fenêtre", donnant une
vue sur le ciel.
"Pour y accéder, il faut prendre un chemin qui traverse des
prairies, on croise des marmottes et des chamois, décrit Jean
Capitant, guide de montagne, membre de l'association Guide 06.
Ensuite, on arrive au lac de Fenestre, qui est installé dans un
cirque glacière".
Il fait face au sommet du Gélas, point culminant du Mercantour, qui
culmine à 3143 mètres.
Ce lac de montagne tire son nom d'une ouverture entre deux roches,
une "fenêtre", offrant une vue sur le ciel.
Pour s'y rendre, il faut emprunter un sentier balisé GR (Grande
Randonnée), qui part du Refuge de la Madone de Fenestre, à côté du
sanctuaire du même nom, à la sortie du village de
Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes).
Il faut compter une heure trente de marche jusqu'au lac.
"C’est une randonnée facile d’accès", précise Jean Capitant,
guide de montagne dans le Mercantour. Par contre, il faut être
courageux pour se baigner dans le lac : l'eau, qui provient de la
fonte des glaces, dépasse rarement les 12 degrés. En été, le lac
peut être en partie asséché.
La route du sel
Après avoir fait trempette dans le lac, il est possible de continuer
vers le col de Fenestre. On emprunte alors la fameuse "route du
sel ".
C'est un des sentiers historiques de transport de sel entre la
France et l'Italie, qui relie le Col de Tende, dans les
Alpes-Maritimes, à la ville italienne de Monesi (Jean Capitant)
Longue de 30 km, cette route est praticable en vélo, à pied ou en
véhicule motorisé, moyennant le paiement d'un péage.

Le lac de Fenestre est situé à proximité de la "route du sel",
chemin historique reliant la France et l'Italie. Ce sentier de
randonnée peut être emprunté à pied, à vélo ou en véhicule motorisé,
moyennant le paiement d'un péage.
Si on est toujours pas fatigué, on peut traverser le col de Fenestre
pour accéder au Pas des Lastres, autrement dit le "Pas des
voleurs". Les contrebandiers qui ne voulaient pas passer par la
douane empruntaient ce chemin pour passer la frontière entre la
France et l’Italie.
De là, on domine le lac de Trécolpas. Il faut compter quatre heures
en moyenne pour faire la boucle du lac de Fenestre au Pas des
Lastres, sans compter les pauses.
Pratique
Pour se rendre au départ de la randonnée, prendre à droite à la
sortie du village de Saint-Martin-Vésubie en direction de la Madone
de Fenestre sur 12 km, et se garer au sanctuaire.
A découvrir dans les Alpes-Maritimes : le Baus de
la Frema, un sommet légendaire

En plus d'offrir un beau panorama sur les massifs du Mercantour, le
Baus de la Frema est aussi connu pour abriter la première Via
Ferrata des Alpes-Maritimes.
Sujets au vertige, s'abstenir...
"Pour accéder au Baus de la Frema, il a deux versants : l'un
plutôt escarpé dans lequel est implantée une Via Ferrata - la
première du département - et l'autre qui est accessible en randonnée
classique", explique Bernard Baldassare, guide de randonnée et
président de Chemins d'Azur.
Il faut choisir quel chemin on préfère emprunter pour accéder à ce
sommet, perché à 2246 mètres d'altitude. La Via Ferrata dure entre
2h30 et 5h30, selon si on fait le sentier dans son intégralité - il
existe plusieurs échappatoires.
Cet itinéraire est considéré comme "sportif ", donc il est
recommandé de faire appel aux services d'un guide si on est
débutant. "C'est très aérien, c'est une façon de toucher le ciel
", décrit l'office du tourisme de Colmiane.
De l'autre côté, la randonnée part du parking de la Via Ferrata, au
dessus de la station de ski Colmiane, sur la commune de
Saint-Dalmas-Valdeblore. Il y a environ 600 mètres de dénivelé et il
faut compter environ 2h30 pour accéder au sommet, 4 heures pour
faire l'aller-retour.
"C'est une randonnée relativement facile", explique le guide
de montagne. "Au début, on passe sur une piste qui est parfois
empruntée par des 4X4 - avec autorisation - et ensuite, le sentier
débute. Après une boucle dans les alpages, on rejoint le sommet et
là, on est vraiment dans du minéral ", décrit Bernard
Baldassare.
De là haut : "on a une vue exceptionnelle", s'enthousiasme le
président de Chemins d'Azur.
"L'intérêt de ce sommet, c'est qu'il offre une vue panoramique
sur toute la chaîne franco-italienne et les sommets du Mercantour",
dit Bernard Baldassare.
Refus du droit de cuissage
Mais d'où vient donc ce nom à la sonorité particulière ? L'histoire
est bien connue des habitants du coin. "C'est une vieille légende
que les anciens, le soir dans la vallée, aimaient se raconter",
s'amuse Bernard Baldassare, habitant de Saint-Dalmas-Valdeblore.
"Etymologiquement, cela veut dire le rocher de la femme",
raconte le guide de montagne. "Dans un des villages de la vallée,
une jeune fille ne voulait pas se soumettre au droit de cuissage du
seigneur" , explique-t-il. Ce droit, en vigueur au Moyen-Age,
imposait aux jeunes filles de réserver leur première nuit de noces
au seigneur du village.
Donc elle aurait pris la fuite et se serait réfugiée dans une
grotte. Bien évidemment, quand l'automne est arrivé, même si les
habitants du village lui apportaient à manger, elle a compris
qu'elle ne pourrait pas y passer l'hiver donc elle est partie, en
passant par le sommet de Pépoiri (Bernard Baldassare)
Le nom de ce sommet, encore une fois, est lié à cette fameuse
légende puisqu'il veut dire "pied pourri".
Probablement que suite à une fracture ou une vilaine entorse elle
était atteinte de gangrène et elle a fini par périr sur le sommet
", raconte-t-il.
Coup de hâche
Une bien triste légende, mais qui ne s'est pas fini comme cela. "Un
jeune bûcheron, qui était son prétendant, a décidé de se venger",
explique Bernard Baldassare. "Il a fait venir le seigneur et sous
prétexte qu'il voulait lui montrer ses outils, il lui a tranché la
tête d'un coup de hache".
Une légende dont la véracité n'a bien sûr pas été prouvée, mais qui
continue d'être racontée au coin du feu ou pendant les 4 heures de
randonnée qui mènent au sommet de la Baus de la Frema.
Nice : Un site emblématique, la place Garibaldi
La place Garibaldi à Nice, tout le monde la connaît, c’est un des
lieux des plus appréciés des niçois...
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
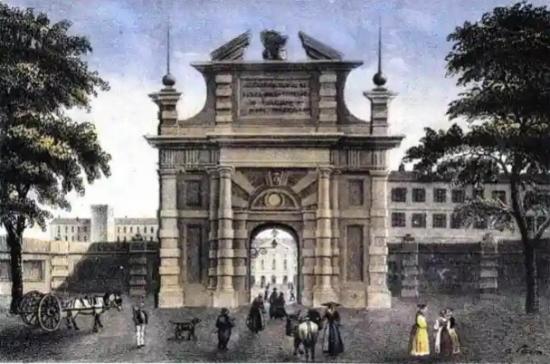
Nice : l’avenue Borriglione : de la Belle Epoque
au XXIe siècle
Cette artère nord/sud est née à la fin du XIXe siècle à une époque
où la ville commençait à s’étendre vers le nord...
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur :
Yann Duvivier
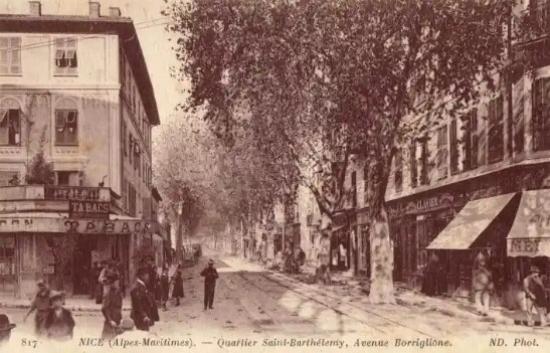
Nice : Magnan : Fragments d’une ville
Dans le quartier de Magnan , tout autour du boulevard de la
Madeleine , l’ancien quartier de la culture de la soie , celui des
magnanais disparus , subsiste comme une sorte de morcellement de
ville...
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Louis Deydier

Nice : le port, de l’anse Saint-Lambert au port
Lympia
Endroit historique de Nice.
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
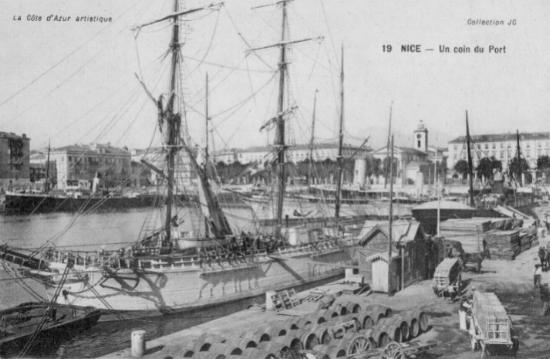
Nice : le quartier de la Croix de Marbre
A Nice, en 1431, dix nobles niçois, fervents
chrétiens, préoccupés par le fait que les Lieux Saints de Jérusalem
ne peuvent plus être visités et vénérés en toute sécurité par les
pèlerins décident d’installer dans la ville une congrégation de
franciscains Observantins traditionnellement chargés de la
protection du Saint Sépulcre.
Il va falloir trouver un terrain pour bâtir le couvent et l’église
de ces moines, projet qui va se concrétiser en 1461 en un endroit
fort éloigné (pour l’époque), à l’ouest de la cité, loin de ses
remparts protecteurs, quartier, qui de nos jours s’appelle La Croix
de Marbre.
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : la Rue Lépante
Si vous demandez à Nice où se situe la rue de Lépante, il y a de
grandes chances qu’on vous réponde : "Ah ! La rue Lépante ?".
Pourquoi cette bizarre apocope du "de" ?
Car la rue de Lépante ne s’appelle ainsi pas en référence à un
noble, mais à une bataille…
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : le Vieux Nice ou le "Babazouk" dans tous ses états ! (1ère partie)
Promenade insolite dans notre cher Vieux Nice, nous allons découvrir des aspects
inédits de notre vieille ville que l’on ne vous a sans doute jamais contés et
encore moins fait voir.
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
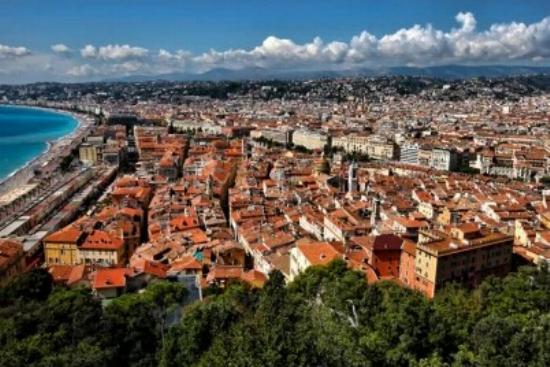
Nice : le Vieux Nice ou le "Babazouk" dans tous
ses états (2ème partie)
Flâneries studieuses dans notre cher Vieux Nice
tout plein de choses intéressantes pour qui veut voir et écouter.
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : le quartier des Musiciens
Le quartier des Musiciens fait partie du centre de Nice, à quelques
minutes à pied de la Promenade des Anglais. Il est délimité par
l’avenue l’avenue Durante à l’est et l’avenue Gambetta à l’ouest,
l’avenue Thiers au Nord et le boulevard Victor Hugo au Sud.
Peut-être est-ce le pouvoir de la musique d’unir celui qui a écrasé
la commune et l’un des plus grands écrivains français. Mystères de
la toponymie…
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : Le Quartier Saetone
A la vérité, ce quartier de Nice ne s’appelle pas
Saetone (prononcer Sétone) mais, administrativement, le quartier
Notre Dame. Comme l’ensemble de rues dont on va vous parler tournent
autour de la place éponyme, il a été baptisé "Saetone"
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : L’église du Jesù dans le Vieux-Nice
L’église Saint-Jacques-le-Majeur (JESUS), un bel
exemple d’édifice religieux baroque primitif au cœur du Vieux-Nice
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

La santé à Nice de 1820 à la Grande Guerre
A Nice, à l’orée du XIXe siècle, les problèmes de
santé de la population commencent à être pris très au sérieux par
les autorités.
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
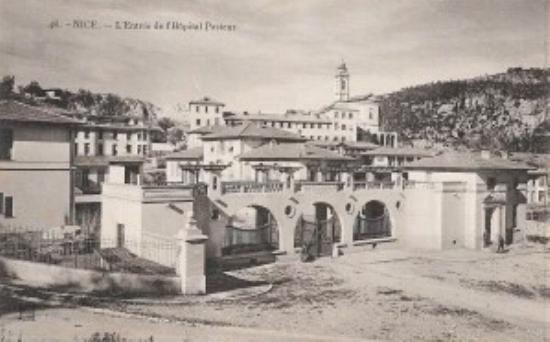
Nice : l’ancien Bagne du Port
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
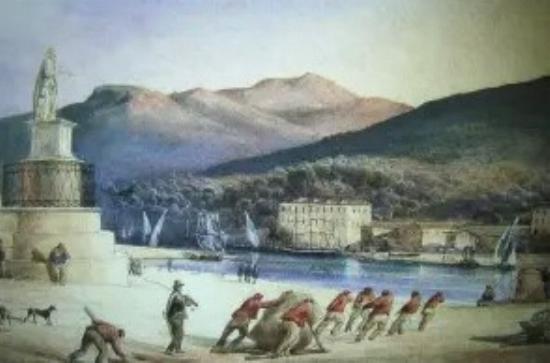
Nice, un été 1944 : l’avion-fantôme
De septembre 1943 à fin août 1944 les troupes
allemandes occupent Nice. À partir de juillet 1944, il est établi
que les alliés ne vont pas se contenter du seul front de Normandie
mais vont en ouvrir un deuxième à partir des côtes de la Provence
pour prendre la Wermarcht en tenaille.
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Eclats sur la façade de la gare des Chemins de fer
de Provence
Nice-Liserb, de la folie Belle Epoque au
lotissement des années 1970
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
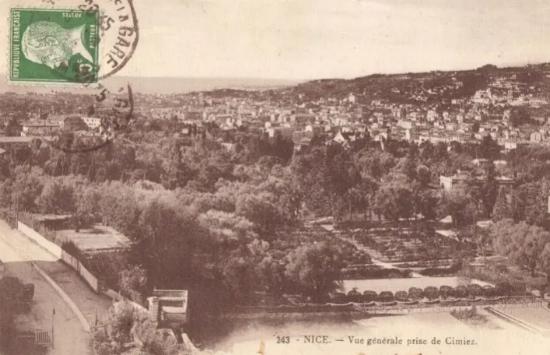
Je me souviens… des Studios de la Victorine (1ère
partie)
2019 aura été l’année du centenaire des Studios de la Victorine…
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Philippe Descottes
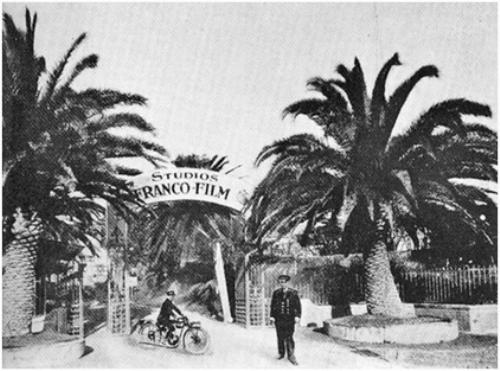
Je me souviens… des Studios de la Victorine (2e
partie)
1939. Les travaux de rénovation et de modernisation des studios de
La Victorine sont à peine terminés que la Seconde Guerre mondiale
éclate…
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Philippe Descottes

Nice : 3 mars 1952. Une tragédie aérienne en plein Carnaval !
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
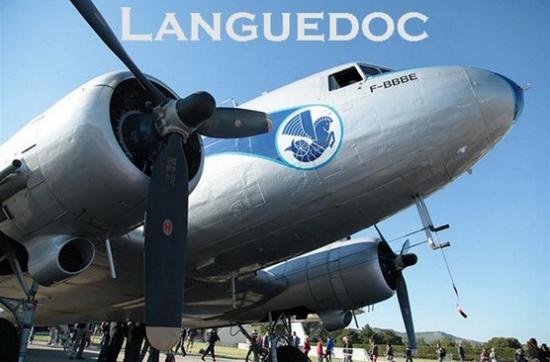
Nice : Une Histoire du Vieux-Nice à travers les noms de ses
"carriera" !
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
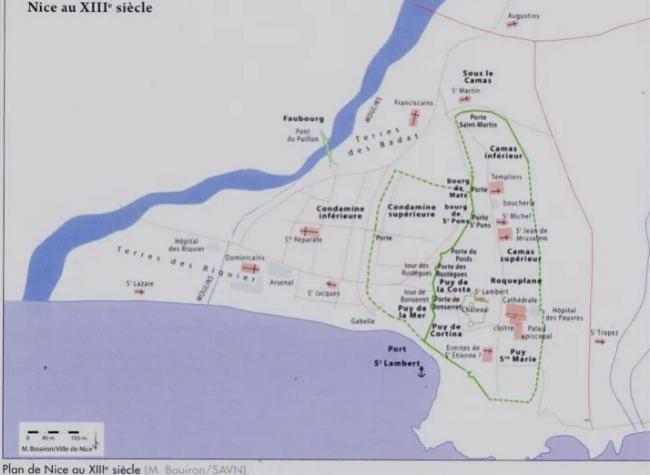
Nice : St Etienne, du village d’autrefois au quartier
moderne d’aujourd’hui
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
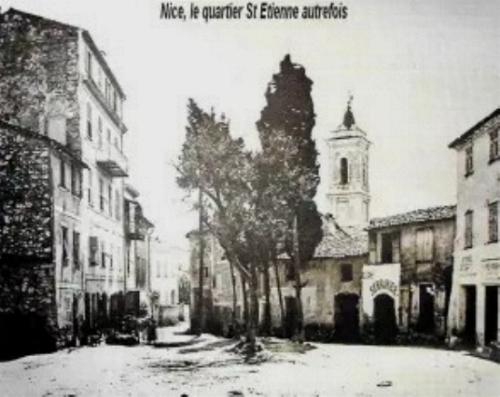
Nice : Saint-Maurice, Chambrun, l’Assomption, un
quartier plutôt préservé
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

La Pyramide de Falicon
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : Les funiculaires (Cimiez, Carabacel)
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
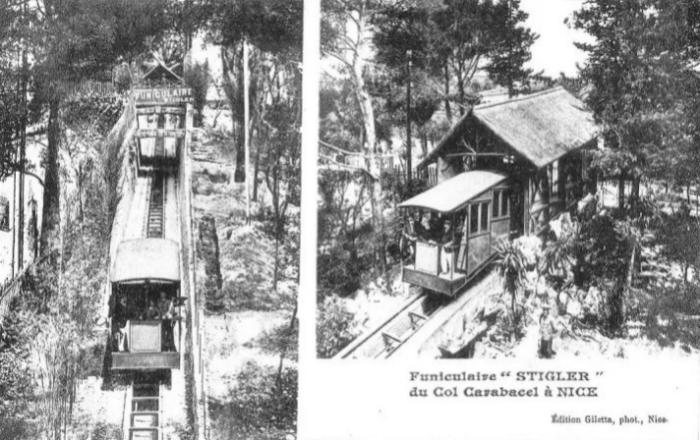
Nice : Carabacel... il n’y a pas que les funiculaires !
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : Le passage du Var à travers les âges
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
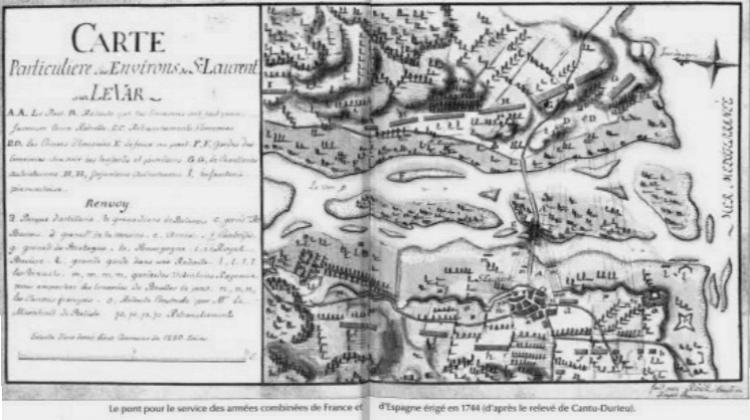
Nice le Ray, des cressonnières aux HLM…
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
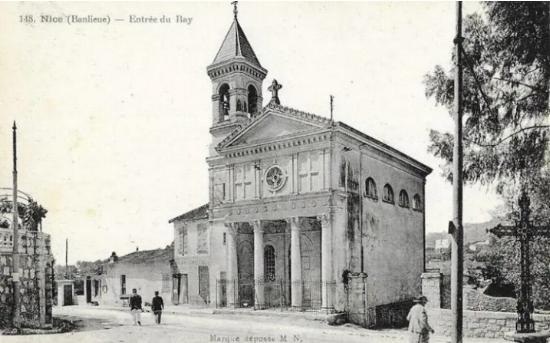
Nice : Saint-Barthélémy (1ère partie)
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : Saint-Barthélémy (2ème partie)
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier

Nice : Une visite "aérienne" du Vieux Nice à la Belle
Epoque… en deux photos !
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier


Nice : Vieux Nice, les Franciscains, de Lympia à la Place
Saint-François
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
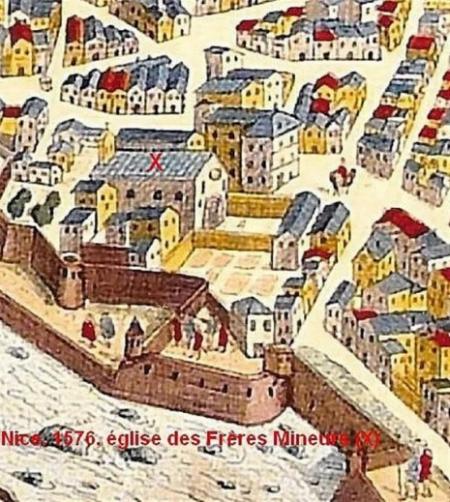
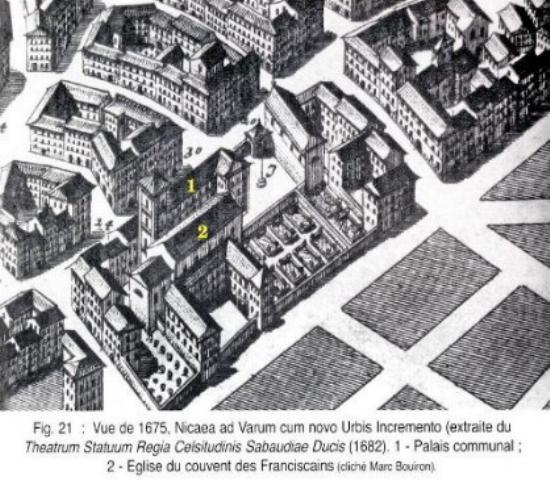
Nice Saint-Sylvestre, de l’ancien hameau
campagnard au quartier moderne
Cliquez pour accéder à l'article provenant de
ciaovivalaculture
Auteur : Yann Duvivier
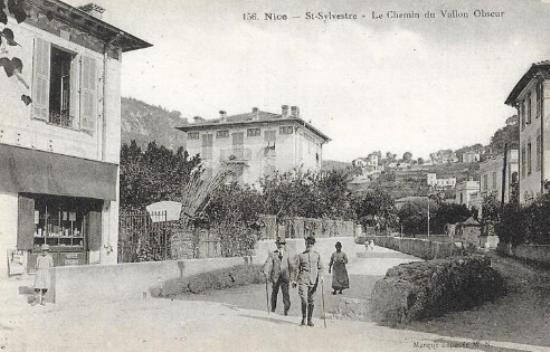
Nice : les arènes de Cimiez

Les arènes de Cimiez sont un amphithéâtre romain situé à Nice dans
le quartier de Cimiez.
L'amphithéâtre de Cimiez, monument de spectacles de la ville antique
de Cemenelum, l'un des plus petits recensés en Gaule (capacité
estimée à 4 000 spectateurs), est construit en deux étapes, sans
doute à la charnière des ier et iie siècles puis au IIIe siècle. Il
paraît abandonné au IVe siècle.
Fouillé dans les années 1930-1940 puis en 2007, site ouvert au
public, il continue d'accueillir des manifestations culturelles.
L'édifice est classé monument historique en 1965.
Sur le même site se trouvent le
Musée archéologique de Cimiez
et le
Musée Matisse
L’église abbatiale
Saint-Pons : un joyau restauré
Classée Monument historique en 1913,
l’église abbatiale Saint-Pons est l’un des plus anciens monastères de France
méridionale.
Fermé au public depuis 1999, cet édifice majeur de l’histoire et du patrimoine
niçois a fait l’objet d’un grand projet de préservation de 2016 à 2019. Revivez
de l’intérieur ce chantier de restauration.
..
..
Nice :
Fort du Mont - Alban
Perché à 222 mètres d’altitude, le Fort Mont Alban témoigne du passé de la ville
de Nice. Aujourd’hui, il offre un panorama spectaculaire sur toute la Côte
d’Azur, de la Riviera Italienne au Massif de l’Estérel.
.
 . .
.
Edifié entre 1557 et 1560 sous l’impulsion du Duc de Savoie Emmanuel Philibert,
le Fort du Mont Alban servait de frontière entre les états de Savoie et Nice.
Large de 40 mètres sur 46 mètres, cet imposant monument rectangulaire a été
occupé par des troupes militaires au fil des époques. Stratégiquement placé
entre le Château de Nice et la Citadelle de Villefranche, il domine toute la
Côte d’Azur. De la pointe de Bordighera au Massif de l’Estérel, en passant par
Cap d’Ail, Saint Jean Cap Ferrat, la Baie des Anges et Nice et la Garoupe
d’Antibes, le panorama depuis sa terrasse est tout simplement incroyable. Par
grand soleil, certains arrivent même à apercevoir la Corse …
Le fort du Mont
Alban est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1909 pour
l’enceinte, 1913 pour les murs et fossés qui l’entourent, puis 1923 pour la zone
de 250 mètres sur laquelle il est bâti.
.
TARIFS
Plein tarif : 6,10 €
Tarif réduit : 2,50 €.
Attention pas de vente sur place, merci de vous munir de votre billet
préalablement acheté au Centre du patrimoine ou sur internet.
PÉRIODES D'OUVERTURE
Du 15/07 au 15/09, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Ouvert uniquement lors des visites sur réservation.
.
.
Nice : l'histoire de la Gare du Sud
Inaugurée en 1892, la Gare du Sud est liée au développement urbain de la ville
de Nice dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est fermée au public un
siècle plus tard. La réhabilitation du bâtiment des voyageurs permet
l’installation d’une bibliothèque en 2013. La halle est restaurée et achevée
d’être remontée en 2017. Découvrez le chantier qui a permis la renaissance de ce
monument emblématique du quartier de la Libération.
Ce tournage a été réalisé avant mars 2020, les préconisations sanitaires liées à
la Covid19 n'étaient pas encore en vigueur.



.  Musée
de Préhistoire de Terra Amata Musée
de Préhistoire de Terra Amata
Dans le cadre de la série "A la découverte des collections", le musée de
Préhistoire de Terra Amata à Nice vous propose d'évoquer, en compagnie de la
paléontologue, Patricia Valensi, un petit morceau de dent d'un enfant de sept
ans qui est un des plus anciens restes découvert sur le territoire français.....
..

Nice : la Colline du Château
..
..
..
La Colline du Château fut le site choisi par les Grecs phocéens pour
établir leur comptoir et fonder ainsi laville de Nice, il y a
quelques millénaires.
..
..
..
De nos jours, grand parc paysager au cœur du Vieux-Nice, la colline
du Château tient son nom de l’imposante fortification qui y était
construite et qui fut détruite par Louis XIV en 1706. La ville
médiévale y prenait place toute entière avant que l’habitat ne
s’étende en contrebas (à partir du XIIe siècle). On y trouvait en
particulier le palais des comtes de Provence et la cathédrale, deux
éléments majeurs de la ville médiévale que les fouilles
archéologiques que s’attachent à redécouvrir.
.....
L’intérêt historique du site
Protégé depuis le XVIIIe siècle par une absence totale d’aménagement
urbain, le site renferme dans son sous-sol les vestiges de la ville
médiévale et moderne, mais également des périodes plus anciennes. Si
l’on ignore encore si la ville grecque de Nikaïa se trouve bien à
son sommet, les fouilles archéologiques mettent bien en évidence une
occupation ancienne, remontant au début de la Protohistoire, un
millénaire avant notre ère. La colline a, de tous temps, été un lieu
privilégié pour l’habitat et la surveillance d’un territoire au
contact de la mer.
Les vestiges de la fortification
..
..
..
On trouve encore dans le parc actuel quelques vestiges de l’ancienne
fortification. Mais les fragments en sont tellement rares que les
visiteurs ne parviennent pas à en comprendre la nature, et encore
moins à visualiser l’ensemble monumental auxquels ils appartenaient.
Il faut dire que la destruction ordonnée par Louis XIV, en 1706, de
l’ensemble du système fortifié de Nice (fortification urbaine,
château et citadelle) a été extrêmement radicale. C’est pourquoi il
a semblé particulièrement important d’en donner une représentation
la plus exacte possible.
..
.. La Tour Bellanda
..
..
..
Il est des lieux dont l’image fait le tour du monde. Le
panorama de la Baie des Anges depuis la terrasse de la tour Bellanda fait partie
de ces vues incontournables que de multiples peintures, photographies ou cartes
postales ont largement diffusé depuis le XIXe siècle.
Cette tour, accolée à la colline du Château, est particulièrement présente dans
le paysage local. Elle est à la fois l’un des rares témoignages du passé
militaire de Nice et un lieu de mémoire de l’histoire de la villégiature de la
ville.
Quoi de plus approprié que ce lieu patrimonial - la tour Bellanda - pour
recueillir les paroles de ce témoin privilégié qu’est la colline du Château.
Rappelant par sa présence l’ancienne tour Saint-Elme de la citadelle, cet
édifice, qui fut aussi un hôtel et un musée naval, abrite désormais Le
Bellandarium.
Il s’agit d’une évocation historique fondée sur une scénographie originale
présentant, à partir de personnages en habits reconstitués, les hommes et les
femmes qui vécurent sur cette colline, des acteurs parfois anonymes, parfois
célèbres qui ont façonné notre ville.
Vous suivrez durant votre visite un guide unique et bien renseigné en la
personne de la colline elle-même. C’est elle qui va vous parler, c’est elle qui
va se raconter.
Alors, selon la formule consacrée, "suivez le guide".
Extraits de conversation avec la colline
Antiquité
Il semblerait que l’Homme ait trouvé refuge en mon sein au moins depuis l’époque
du Néolithique voire peut-être du Paléolithique. Pour l’instant, la science nous
a appris, par des trouvailles effectuées durant des fouilles, que je fus
régulièrement occupée à partir de la fin du IIe millénaire avant J.-C.
Moyen-âge
Site défensif tout au long de l’histoire, ma position le fut d’autant plus au
Moyen Âge, époque trouble et violente. Des soldats veillaient sur les remparts
et au donjon, à l’emplacement du belvédère actuel. Il nous faut les imaginer
s’entrainant sur la place d’armes qui est aujourd’hui le plateau sportif.
..
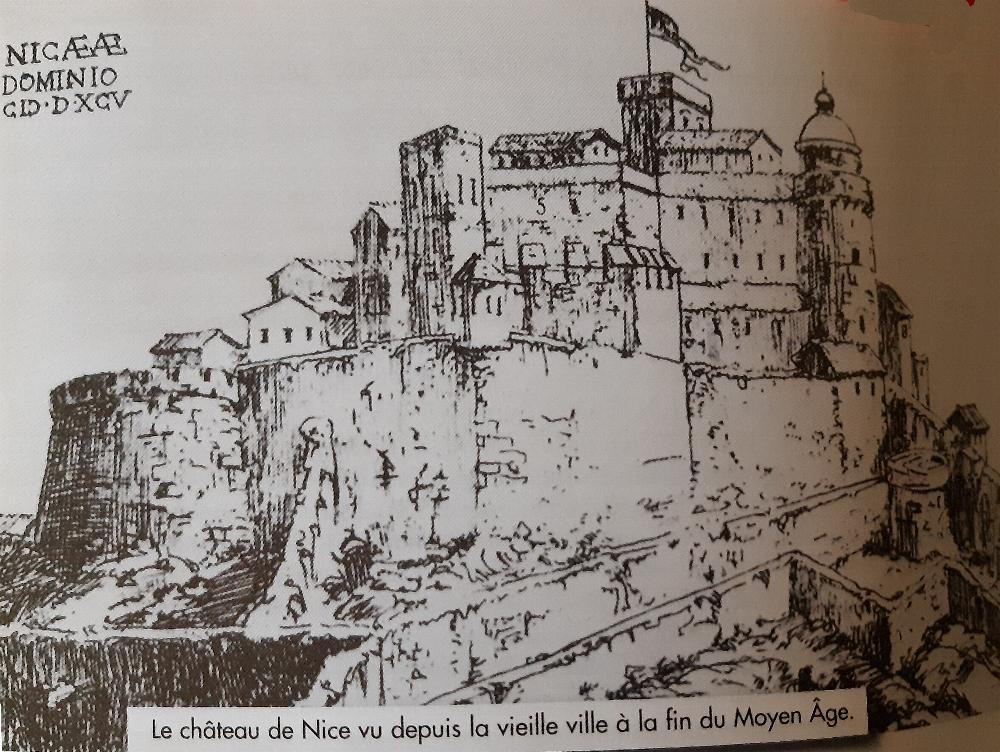
..
1543
Mais c’est au mois d’août que l’enfer se déchaina sur les Niçois. Face à 600
cavaliers, 500 lansquenets, 6 compagnies d’arquebusiers, 50 fantassins, 500
miliciens et 200 citoyens volontaires commandés par André Odinet de Monfort, les
assaillants alignaient 20 000 soldats sous les ordres du comte d’Enghien, 120
galères ottomanes et 40 galères françaises, 40 galiotes et quatre mahonnes. Le
combat allait s’engager à pratiquement un contre dix…
XVIIè siècle
En 1666, lors de la venue du duc Charles-Emmanuel II, il fut
dit que Nice était
"une admirable forteresse, première frontière de l’Italie
et grand soutien de la Royale couronne de Savoie, dans laquelle l’Art a disputé
à la Nature la faculté de la rendre également stupéfiante et inexpugnable à
toute force, aussi grande fût-elle "
Sièges 1691 et 1705
Malgré l’avis du maréchal de Vauban qui voulait la maintenir
intacte, ma citadelle connaitra la colère de Louis XIV qui ordonna alors son
démantèlement intégral. Désormais et pour les siècles à venir, Nice devient une
ville ouverte.
..
..
..
XIXè siècle
Elle passa de 20 000 habitants en 1800 à 150 000 en 1920 et
plus de 200 000 dix ans plus tard. En sommeil quelques années, me voilà à
nouveau au cœur d’un projet de revalorisation de mes paysages, de mon
architecture, de mon patrimoine pour faire honneur à Nice, ville d’art et
d’histoire !
Archéologie
Ce n’est qu’en 1875 que la zone de fouilles fut étendue par
Philippe Gény, un érudit local. Ses terrassements lui permirent de reconnaître,
dans l’enceinte de la cathédrale et à l’extérieur, nombre de sépultures
médiévales ainsi qu’une nécropole qu’il data de l’Antiquité tardive. Il
découvrit également la cuve d’un sarcophage et des éléments architecturaux de
différentes époques.
.
Pour plus d'informations : le Bellandarium
.
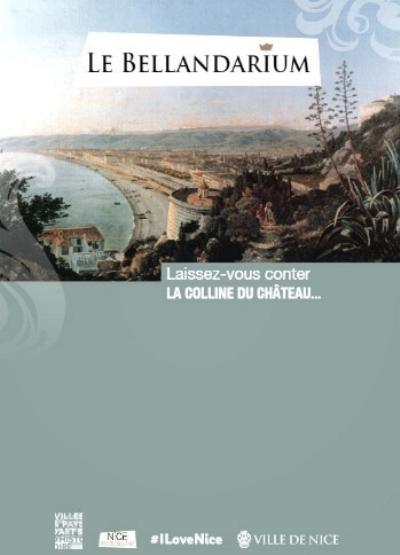
..
Nice : la place Garibaldi
.
 . .
.
La place Garibaldi est une des plus jolies
places de Nice avec ses belles façades ocre
jaune ornées de
décors en trompe l'œil.
Cette place royale sous les souverains de la maison de Savoie vous
livre ses secrets...
Nice : l'histoire du port
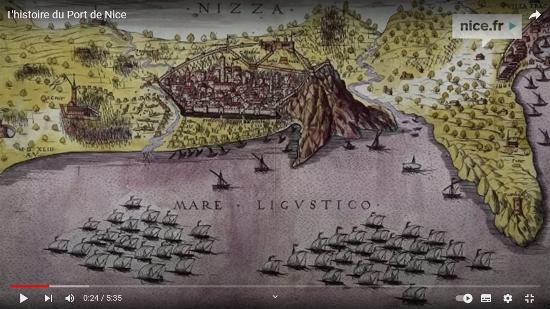
L'histoire de NICE... A toute Berzingue !
.
.
.
avec Lorant Deutsch

.
Nice : la place Masséna
.
.

.
Cette vidéo de 6 mn vous propose une flânerie
sur la place Masséna pour en admirer la beauté
et découvrir l'histoire de sa création.
.
.
Nice : le Palais Lascaris, un symbole de
l’Histoire niçoise
.
.

.
Ce palais noble a été édifié au milieu du XVIIe siècle, pour les
Comtes Lascaris-Vintimille, neveux du 57eGrand-Maître de l’Ordre de
Malte.
Il demeura la propriété de cette famille jusqu’à la Révolution
française.
Vendu en 1802, il subit d’importantes dégradations avant d’être racheté par la
Ville de Nice en 1942.
Classé Monument Historique en 1946, puis restauré, le Palais, influencé par le
style baroque génois, unit à un ensemble du XVIIe siècle des embellissements et
des modifications du XVIIIe siècle.
.
.

.
.
.
Les bâtiments s’ordonnancent autour de deux petites cours
intérieures sur lesquelles, par des baies cintrées, s’ouvre un
escalier monumental.
La voûte du vestibule d’entrée porte les armes des
Lascaris-Vintimille.
A l’étage noble, les appartements d’apparat occupent chacune des
deux ailes du bâtiment.
.
.
.
Les plafonds de cette suite de salles sont ornés de fresques à
thèmes mythologiques ou à ornements de stucs, de la fin du XVIIe
siècle.
Des tapisseries d’Aubusson et des Flandres, un mobilier des XVIIe et
XVIIIe siècles et des instruments de musique anciens sont
actuellement présentés.
Une apothicairerie fondée en 1738 a été installée au
rez-de-chaussée.
Le Palais Lascaris est le plus important et le plus somptueux des
bâtiments civils baroques du Vieux-Nice et de la région.
Palais Lascaris
15, rue Droite (Vieux-Nice)
06364 Nice cedex 4
Tél : 04 93 62 72 40
palais.lascaris@ville-nice.fr
https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais
.
Le Saut des français, lieu de mémoire…
.
.
. Le
Saut des Français est un lieu-dit situé à la sortie de Duranus, dans les
Alpes-Maritimes.
Un peu d’Histoire…
En 1792, Nice n'est pas française. Face aux troupes républicaines qui tentent
d'envahir la région, les habitants se groupent en milices, les Barbets. Ce lieu
deviendra un haut lieu de la résistance des Barbets contre l’occupation du comté
de Nice par les troupes françaises de la Révolution. Des soldats français
auraient été précipités du haut de cette falaise de 300 m dans la vallée de la
Vésubie en contrebas, en représailles des atrocités que ces mêmes soldats
avaient commises.
.
.
.
Le Saut des Français a aujourd’hui acquis le statut de lieu de
mémoire et tout au long du XIXe siècle, les récits des atrocités passées donnent
naissance à une riche tradition orale, qui permet aux Barbets de prendre place,
aux côtés des Sarrasins et de la reine Jeanne, dans le « légendaire » du pays
niçois.
Un auteur, Michel Lafelice, juge "somme toute pittoresque" avec une "tendance
à sombrer dans le macabre" la description du Saut des Français qu’il
reproduit, tirée d’un roman de Victor-Eugène Gauthier, "Les Bandits
justiciers des Alpes-Maritimes" paru fin 1870, et où les Barbets s’en
prennent à des soldats français isolés.
"Un spectacle d’une horreur indescriptible s’offre alors aux Français."
Du haut d’un petit plateau qui domine les plus gigantesques escarpements de la
Vésubie… les Barbets précipitent dans le lit rocheux du torrent nos pauvres
volontaires français. Ils sont saisis les uns après les autres par les bras et
les jambes et jetés dans le gouffre au milieu de cris d’épouvante et de rires
sataniques qui se répercutent dix fois pour une dans ces abîmes épouvantables… »
C'est au cœur de cette époque troublée que se situe l'histoire racontée par
Louis Gilles Pairault dans son livre qui porte le nom du "Saut des français".
Dans ce roman, Jacques, un militaire français, tombe éperdument amoureux
d'Elisa, niçoise d'origine modeste, alors que ses troupes combattent les
habitants de la ville.
Cette aventure, qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain couple
Shakespearien, permet donc à l'écrivain-historien de décrire cette période peu
connue de l'histoire française, au travers de l'histoire d'amour impossible des
deux jeunes gens.
A découvrir dans les Alpes-Maritimes : la
Madone d'Utelle, un sanctuaire perché à 1194 mètres d'altitude.
.
.
.
Au cœur de la vallée de la Vésubie, le
sanctuaire de la Madone d'Utelle, accessible en
randonnée, offre un panorama sur les massifs
environnants. Cet été, nous vous faisons
(re)découvrir les merveilles des
Alpes-Maritimes.
La Madone d'Utelle est un sanctuaire situé sur
un vaste plateau, perché à 1 194 mètres
d'altitude. De là, on découvre un large panorama
: " C'est à 140 degrés : on voit d’un côté la
vallée du Var, la Tinée, toutes les chaînes de
montagne et quand il fait beau, on distingue
même la mer", décrit Hélène-Marie Passeron,
adjointe chargée de la communication et de
l'événementiel à la mairie d'Utelle. Sur place,
une table d'orientation permet de se repérer.
Il est possible d'y accéder en voiture ou de
faire une petite randonnée, au départ du village
d'Utelle. En environ une heure, on accède au
sanctuaire.
.
.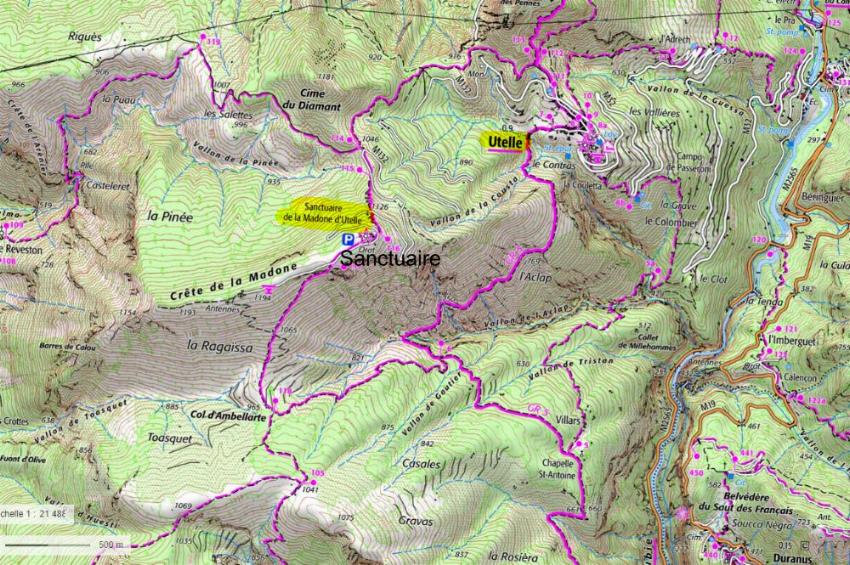
.
"C'est une très belle randonnée, pas
difficile. Je l'encadre même avec des seniors",
confirme Jean Capitant, guide de montagne et
membre de l'association Guides 06.
Actuellement, le sanctuaire est fermé. Gil
Florini, le recteur en charge de la Madone,
avait de grands projets pour le sanctuaire : il
voulait y faire construire un gîte, un
restaurant... Mais le restaurateur du village a
considéré que cela allait être de la concurrence
déloyale. En 2017, le tribunal lui a donné
raison, et, depuis, le sanctuaire n'est ouvert
que sur demande, regrette Marie-Hélène Passeron.
.
.
Une table d'orientation permet de se repérer
dans le paysage.
Apparition de la Vierge
La Madone d'Utelle fut fondée en l'an 850. La légende rapporte que
plusieurs navigateurs espagnols ou portugais, perdus dans une tempête au large
de Nice, aperçurent une lumière surnaturelle qui les dirigea vers la côte. De
retour sur terre, ils décidèrent d'installer un oratoire au sommet de cette
montagne salvatrice.
Le sanctuaire fut détruit, puis reconstruit en 1806 sous forme de chapelle et
restauré au milieu du XXème siècle. Ce n'est que depuis 1936 qu'une route
goudronnée permet d'y accéder en voiture.
Au niveau de la Madone, si on gratte le sol, on peut apercevoir de minuscules
étoiles. " Soi-disant, c’était la vierge qui les aurait mis là, mais en
réalité, ce sont des fossiles qui existent depuis des millions d’années",
explique Marie-Hélène Passeron. Il s'agit de fossiles d’animaux marins, des
Crinoïdes, proches parents des oursins.
Ce qui signifie qu'il y a plusieurs millions d'années… La mer se
trouvait à cet endroit.
Détour par le village
A l'allée ou au retour de la randonnée, on peut s'arrêter découvrir
le petit village d'Utelle. Ce fut jadis un bourg important, prospérant grâce au
commerce du sel puisqu'il se situait sur la route du sel ( pour en savoir plus,
voir l'épisode sur le lac de Fenestre).
"Le sel arrivait en bateau au port de Nice puis les sacs étaient portés par
des mulets jusqu'à Utelle avant de partir vers Chambéry ou Turin", raconte
Marie-Hélène Passeron. "Devant certaines maisons, on voit encore des crochets
pour peser le sel ", décrit l'adjointe à la communication.
Si vous vous y rendez le 16 août, vous risquez d'être surpris par l'animation
qui règne dans le village. C'est le jour du "Saut du Cepoum", tradition à
laquelle les Utellois sont très attachés. "Pendant la guerre, les hommes
mariés ont accusé les célibataires d'avoir abusé de leurs femmes quand ils
étaient au front, c'est ce qui a donné naissance au jeu", raconte
Marie-Hélène Passeron.
Le jeu consiste pour les jeunes hommes à essayer de faire passer un billot de
bois, le Cepoum, en dehors du village : les hommes mariés les en empêchent en
leur donnant de grandes claques dans le dos. "Aujourd'hui, c'est une
tradition authentique, mais avant c'était vraiment un règlement de compte",
s'amuse l'adjointe à la mairie.
Au bout d'une heure, le jeu s'arrête. Le billot est retourné et rempli d'une
bombonne de vin payée par le dernier marié du village.
"Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de jeunes à Utelle, mais ceux qui vivent
à Nice ou Marseille reviennent exprès pour le Saut du Cepoum ! ", assure
Marie-Hélène Passeron. Une tradition qui attire aussi de nombreux curieux.
On vous dit tout sur la future ligne 5 du
tramway entre Nice et Drap via la Trinité éé.
.
.
La ligne 5 partira du palais des expositions à Nice, avec un
départ toutes les 8 minutes
Cette ligne de 7,6 kilomètres comprendrait 16 stations pour un bassin de
population de 50 000 habitants. La concertation publique aura lieu du 28 janvier
au 11 mars.
C'est parti pour la ligne 5 du tramway. Elle devrait être opérationnelle d'ici
la fin 2028.
Deux terminus : le premier au Palais des expositions à Nice qui d'ici là devrait
être rebaptisé en "Palais des arts et de la culture de Nice" ; le second sera
situé sur la commune métropolitaine de Drap. Au total, 16 stations seront
desservies, sur une distance de 7,5 kilomètres.
.
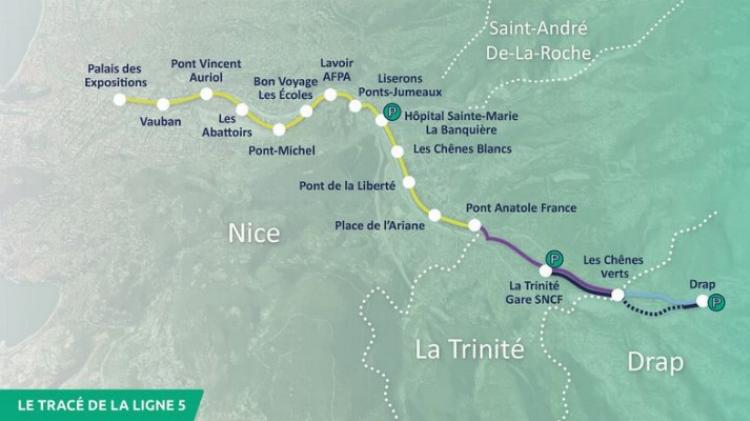
.
Voici le tracé prévu, la concertation publique aura lieu à
compter du 28 janvier.
.
La ligne circulera sur la rive gauche du Paillon jusqu'aux
Ponts-Jumeaux, puis elle traversera le fleuve, pour longer le quartier de
l'Ariane.
.
.
La ligne 5 du tramway longera le quartier de l'Ariane.
Puis cette ligne traversera une nouvelle fois le Paillon, direction
Drap et là, il y a deux tracés possibles, un tronçon en aérien ou un souterrain.
Durée du trajet : 25 minutes.
Le projet de la ligne 5 a été dévoilé ce jeudi par le maire de Nice, et
président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Christian Estrosi.
"Le T5 desservira donc un bassin de 50 000 habitants et 28 000 emplois",
explique la Métropole. Ladislas Polski, maire de La Trinité et vice-président de
la Métropole Nice Côte d’Azur est très content de ce projet.
Chacun connaît l'asphyxie des axes de circulation, très fréquente sur le
Paillon. En faisant arriver un mode de transport comme celui du tramway, c'est
non seulement faciliter les déplacements des gens, mais c'est aussi requalifier
un territoire et c'est participer à sa relance et à la création de richesses.
Ladislas Polski
maire de La Trinité, vice-président de la Métropole NCA à France 3 Côte d'Azur
Pour le patron de la Métropole, il y aurait selon ses comptes 18 000
véhicules/jour en moins soit une diminution de 20% à 25 % du trafic routier
quotidien. Ce sont donc 2000 tonnes de CO2 évitées par an.
Horizon 2028
La livraison de ce gigantesque chantier est prévue en trois étapes :
- L'Ariane Nord en 2026, avec la desserte de Bon Voyage, soit sur un linéaire de
4 kilomètres, 6 stations plus l'agrandissement du parc-relais existant de Pont
Michel de 370 places, soit 200 supplémentaires. Il est destiné à devenir un pôle
d’échanges multimodal.
- La Trinité en 2027, soit 2 stations et la création de 2 parcs-relais, l’un aux
Ponts Jumeaux de 200 places livré dès 2026, et l’autre à La Trinité d’au moins
250 places.
- La Trinité-Drap en 2028, soit une section de 1,5 kilomètre avec 2 stations et
un nouveau parc-relais de 250 places à Drap. C'est aussi en 2028 que sera livrée
la section Palais des expositions-pont Saint-Michel, 1,9 kilomètre avec 4
nouvelles stations.
Des pistes cyclables à double sens ont aussi été prévues, tout comme la
plantation d'arbres, au moins 800.
Les habitants ont la parole
La concertation publique est organisée du 28 janvier au 11 mars.
Elle se déroulera en plusieurs lieux : les mairies annexes de Bon Voyage et
Pasteur à Nice, et dans les hôtels de ville de La Trinité et Drap. Quatre
réunions publiques seront organisées en visioconférence au regard de la
situation sanitaire.
Ce sera donc le moment de donner son avis. Parmi les enjeux : les deux tracés
possibles entre La Trinité et Drap. L'un est aérien, le long de la Pénétrante du
Paillon sur 550 mètres. L'autre comprend un tronçon commun de 800 mètres
(Station de la Trinité Nord à celle des Chênes Verts) puis le reste en
souterrain jusqu'à Drap.
.
.
.
Le canal de la Vésubie
.

.
.
.
Sur les traces du célèbre sorcier des Merveilles
.
.
.
La vallée des Merveilles compte plus de 50.000 gravures. Le sorcier,
devenu l’emblème de ce site historique, fait l’objet d’une
exposition au musée tendasque. Retour sur son histoire.
Non, il n’a pas étudié à l’école de Poudlard. Il ne vole pas non
plus sur des balais. Il a un visage que l’on pourrait qualifier
d’humain. Les mains levées. Des poignards aux lames triangulaires
brandis de part et d’autre.
Son nom? Le sorcier des Merveilles. Autrefois nommé "mago" -
magicien en italien - il tend à incarner la guerre, ce qui lui a
probablement valu son appellation.
C’est à plus de 2.300 mètres d’altitude, au cœur de la vallée des
Merveilles à l’ouest du Mont-Bego, que cet intrigant petit
personnage a été gravé dans la roche il y a plus de 5.000 ans. À la
différence des autres gravures présentes sur le site, lui ne sera
sculpté qu’une seule fois.
Multiples interprétations
"Le sorcier était connu depuis toujours par les populations de la
vallée mais ils ne savaient pas l’analyser, raconte Silvia Sandrone, archéologue
et directrice du Musée des Merveilles. Surtout, ils avaient peur d’aller sur le
site car il était assimilé au diable."
Enfoui sous la terre, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que la
gravure commence à être étudiée par la communauté scientifique.
"Elle a fait beaucoup d’impression car elle rappelle l’humain donc on va lui
donner plus d’importance que les autres", explique Thibaud Duffey,
accompagnateur et animateur en montagne dans la vallée.
Sur sa signification, les versions divergent. Ce qui reste toutefois fort
probable, c’est que cette gravure atypique soit l’œuvre de bergers entre
l’époque néolithique, celle de l’agriculture et des paysans, et la période
protohistorique liée au métal, qui a conduit à la société moderne que nous
connaissons aujourd’hui.
Car sa différence vient surtout de l’ensemble des motifs qu’il comporte. Il
rappelle les corniformes - animaux avec des cornes - mais évoque aussi la
métallurgie avec ses deux poignards tenus dans les mains. Le personnage pourrait
alors marquer ce changement important de l’histoire ou bien séparer les deux
époques.
"Avec le sorcier, c’est le métal qui arrive, on entre dans une période de
transition entre la société néolithique et celle où les communautés vont
s’agrandir avec l’apparition des grandes villes vers l’âge du bronze", tente
de déchiffrer Thibaud Duffey.
"Il a sur lui tout ce qui représente les deux périodes", commente de son
côté Silvia Sandrone. On peut également imaginer que les poignards élancés vers
le ciel appellent à la pluie, faisant de lui le lien avec la terre. Certains y
verront une sorte de divinité.
"Préoccupations quotidiennes"
Mais le regard porté par ce guide de montagne reste "plus
fonctionnel ". Le sorcier pourrait refléter "les préoccupations
quotidiennes" des populations.
"Je reste persuadé que les gens souffraient, notamment des grandes
sécheresses qui frappaient le littoral. Cela avait des conséquences désastreuses
sur l’agriculture."
Dans le Mercantour, le climat s’avère bien plus propice à l’élevage des bêtes.
"Avec les sommets, la proportion de surface rocheuse et la mer à
proximité, ils se sont peut-être dit que c’était ici qu’il fallait aller."
Et pour ce féru de nature, la thèse de la représentation divine n’est pas en
reste. Dans le désespoir, "on peut se tourner vers des croyances ou des forces
supérieures".
D’un point de vue archéologique, le sorcier "sort du lot ". "On ne
peut pas le dissocier des autres gravures car il regroupe toutes les formes que
l’on retrouve dans la vallée, il relie tout ", souligne la directrice du
Musée des Merveilles qui s’efforce de rester factuelle dans son analyse.
Elle poursuit: "Des poignards, des formes, des figures, il y en a plein sur
le site mais le sorcier, il n’y en a qu’un." Voilà pourquoi ce personnage
est naturellement devenu "le totem" de la vallée. Sous forme de
tatouages, d’autocollants, de sculptures, les locaux l’arborent en toutes
circonstances.
Un symbole qui a traversé les générations. Silvia Sandrone y voit deux raisons à
cela. D’abord, pour son unicité, "il est facilement reconnaissable". Puis
pour ses traits contemporains qui peuvent faire de lui ce "chef-d'œuvre"
des temps modernes.
"Il a toutes les caractéristiques pour franchir tous les âges, c’est rare
d’avoir un emblème aussi ancien et qui à la fois reste très actuel, qui parle
aux gens."
Appel à la divinité, figure transitoire d’une époque à une autre, reflet des
difficultés rencontrées par les populations, le sorcier ne cesse de stimuler
l’imaginaire collectif. Ou peut-être, représente-t-il uniquement la volonté de
celui qui l’a dessiné de laisser une trace de son passage sur Terre?
Le mystère demeure entier et la gravure, est, elle, indélébile.
La vallée des Merveilles, un immense musée à ciel ouvert
Plus grand monument historique français classé, la vallée compte
environ 40.000 gravures datant de la fin de la période néolithique et 10.000 de
la période protohistorique, à l’âge de bronze ancien.
Le site devient alors une mine de trésors pour les archéologues. Objectif:
essayer de les comprendre. Mais la tâche s’avère ardue.
Dans ce musée à ciel ouvert, on y trouve des formes et figures gravées sur la
surface rocheuse à partir de 2.000 mètres d’altitude. Elles ont été réalisées à
partir d’une technique bien précise: ce sont des percussions directes sur la
roche avec un outil en quartz.
Ces impacts sont ce que l’on appelle des microcupules qui forment un rond.
Assemblées, elles deviennent ensuite des gravures.
Quatre types ont été décelés:
- Les corniformes qui font penser à des animaux à deux cornes et peuvent
représenter le monde agricole. Les bœufs, les taureaux, ou encore les vaches.
Ils sont gravés avec des formes géométriques. Le site en compte près de 14.000.
- Les armes et les outils qui sont majoritairement des hallebardes ou des
poignards.
- Les figures géométriques ou réticulées qui incarnent des ronds, des
rectangles, des croix, ou des soleils. Certains sont en forme quadrillée et
rappellent les parcelles de champs.
- Les anthropomorphes, c’est-à-dire des figures à la forme humaine. Ils
rappellent des hommes en perpétuelle activité et ne représentent que 0,5% des
gravures présentes sur le site (il y en a 11 seulement).
Les personnages appelés le christ, la danseuse ou le chef de tribu ont été
recensés dans la catégorie "gravures exceptionnelles et uniques". Le
sorcier en fait évidemment partie. L’exposition qui lui est consacrée est en
accès libre jusqu’au 30 octobre prochain.
Comment le voir ?
L’agence Merveilles, gravures et découvertes propose des visites
guidées régulières dans la vallée des Merveilles et de Fontanalba. Il est
possible de réserver un guide privé pour des randonnées allant jusqu’à 3 heures
de marche. Tous sont professionnels et agréés.
Les visites ont une capacité de 15 personnes maximum. Deux départs sont prévus
chaque jour: à 8 heures puis à 13 heures sur les deux sites. Le parcours n’est
pas fixe et peut être affiné selon vos envies avec votre accompagnateur. Les
prix varient : 15€ pour les adultes, 8€ pour en tarif réduit (étudiant,
demandeur d’emploi ou bénéficiaire du RSA).
Munissez-vous de bonnes baskets et venez avec de quoi vous hydrater.
Attention: les bâtons de randonnées ou cannes à bout en fer sont interdits dans
la zone archéologique. Optez plutôt pour des bouts en caoutchouc.
Également, si vous souhaitez découvrir davantage le site historique,
l’association Mercantour Roya Aventures propose des cours séjours de 2 à 4
jours.
Réservation sur
www.vallee-merveilles.com ou renseignements au 04 93 04 67 88.
.
.
32 ÉTABLISSEMENTS ONT ÉTÉ LABELLISÉS "CUISINE
NISSARDE"
.
.
.
La cuisine niçoise possède, cas unique avec Lyon, le nom de sa
ville dans son appellation : "Cuisine Nissarde, le respect de la tradition".
Cette appellation, lancée en 1998, à l’initiative de l’UDOTSI (l’Union
Départementale des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative) et de
l’association de tradition niçoise la Capelina d’or avait pour objectif de
revaloriser l’authentique cuisine niçoise en faisant acte de mémoire.
Depuis 2014, ce label est géré par l’Office du Tourisme et des Congrès depuis
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, qui a souhaité lui donner un
nouvel élan.
L’esprit a été préservé et, afin d’en garantir la pérennité,
un Comité Technique, un règlement et une grille d’évaluation ont été constitués.
Lors de la première édition du renouveau, 17 restaurants
avaient reçu le label lors d’une cérémonie officielle.
Cette année, 32 établissements, de Nice et de la région, majoritairement en
Métropole, ont été labellisés, dans deux catégories distinctes,"Restaurants" et
"Merenda & Goustaroun" soit Snacks et vente à emporter.
Un diplôme et une plaque le certifiant leur été remis par Jean-Luc Gagliolo,
adjoint à la Ville de Nice.
Les restaurants à Nice :
Acchiardo / Auberge de l’aire St Michel / Lou Balico / Lu Fran Calin / La Gaité
Nallino / Le Pois Chiche Novotel Nice / La Ratapignata / Le Safari / La Table
«à» Julie / La Table Alziari / Le Tchitchou /Chez Cane317 /Chez Davia /
A’Buteghinn’a / Chez Thérésa / Lou Pelandroun / Receta de Jou
Hors de Nice :
Le Bar des Chasseurs / La Capeline / Lou Countea / La Gaudriole / L’Estragon /
La Merenda dei Cagnec / Le Pous Café / Lou Bantry / La Passion des Mets / La
Table du Rousset / MERENDA E GOUSTAROUN / D’Aqui / Socca du Cours / Les Halles
du Mercantour / La Passion des Mets / La Raïola du Béal / Maison Galarato
..
.
On vous dit à quoi va ressembler le nouveau
port de Nice présenté ce jeudi soir par Christian Estrosi.
.
.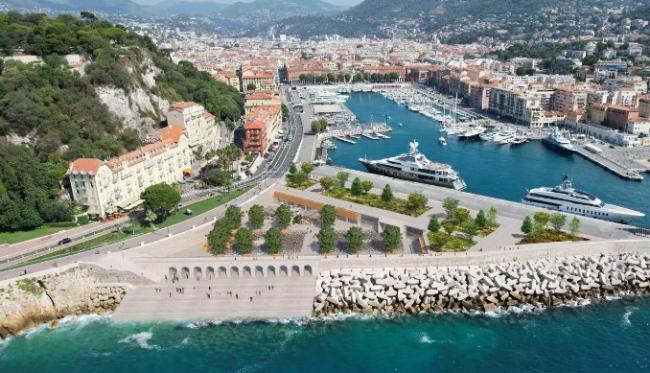
.
Ce jeudi soir le maire de Nice s’apprête à
présenter son projet de nouveau port.
En voici les principaux points.
- Création d’une aire marine protégée. Cette annonce avait été faite en
septembre dernier lors des Assises de la mer à Nice.
- La digue va être "rénovée", elle sera équipée d’un système permettant de
fabriquer de l’électricité. Coût de 33 millions d’euros.
- Réaménagement du Quai Infernet : le parking sera végétalisé et, sous le
jardin, sera réalisé une sorte de musée interactif sur le thème de la mer, avec
des expositions immersives grâce à une technologie innovante, à la manière des
carrières de lumières des Baux de Provence. Un musée pour une expérience
inédite.
- Une nouvelle grande criée pour remettre à l’honneur les quelques pêcheurs
niçois survivants.
- Création d’une piscine à l’eau de mer sur la base nautique.
- Création d’une salle de congrès de plus de 1.100 places, au design très plat
pour ne pas entraver la vue sur la mer. L’équivalent, peu ou prou, de l’espace
polyvalent Méditerranée de l’Acropolis, qui est voué à la destruction.
- Les restaurants trouveront leur place au bord de l’eau, notamment sous le
parking Infernet.
- L’association La Mouette, qui perpétue la tradition de la pêche à bord des
pointus, bénéficiera d’un tout nouveau local.
.
Vent, mer, géographie, ruelles... On vous
explique pourquoi il fait toujours bon dans le Vieux Nice
.

La fontaine de la colline du Château participe
à rafraîchir l’air qui vient de la vieille ville. Humidifié et
frais, il repart vers le Vieux Nice. C’est le phénomène de
ventilation naturelle
Grâce à un cercle vertueux. L’énergie du vent est captée pour
vider la vieille ville de sa chaleur, avant d’envoyer cette dernière
vers la colline du Château, qui la rafraîchit. Explications.
Rien n’est dû au hasard dans le Vieux Nice. Enfin, à l’époque de ses
premières fondations, quand la question de rafraîchir la ville s’est
posée. Puis ce savoir s’est perdu. Des chercheurs ont donc été
employés à le retrouver.
"L’organisation reconnue dans le Vieux Nice peut et doit servir à
bio-climatiser les quartiers nouveaux. Il faut utiliser l’énergie du
vent pour renforcer les conditions du confort estival ",
explique le paysagiste Jean-Pierre Clarac, qui a réalisé de nombreux
projets dans les Alpes-Maritimes.
Utiliser l’énergie du vent…
Tout est une question de géographie élémentaire. L’air chaud, plus
léger, monte; quand l’air froid, plus lourd, descend. Le vent est
donc un mouvement entre l’air chaud qui monte, attirant les flux
d’air froid. "Nos anciens ont remarqué que le Mistral, le vent
d’ouest dominant, prend la chaleur de la vieille ville et l’emporte
jusqu’à la colline du Château. Grâce à la fontaine et à la
végétation, l’air chaud devient humide", explique Jean-Pierre
Clarac.
Humidifié, l’air s’alourdit, redescend… et la boucle vertueuse
s’auto-entretient.
...et la capter
Entre aussi en scène le vent qui vient de la mer, s’appuie sur les
Ponchettes et recouvre la vieille ville. Cette brise de mer
maintient le courant d’air frais proche de la ville, et l’empêche de
se disperser.
Ce processus est renforcé par les rues perpendiculaires du Vieux
Nice, qui créent un effet de Venturi. "Les rues de la vieille
ville ne sont pas droites, pour que le vent ne prenne pas trop de
vitesse. Permettant ainsi à l’air chaud, contenu dans les rues
perpendiculaires à la direction du vent, dont on parlait tout à
l’heure, de rejoindre le cercle vertueux", continue Jean-Pierre
Clarac. Ces rues tortueuses diminuent également la durée
d’ensoleillement direct des chaussées et des façades.
Construire intelligemment
Outre les rues, les maisons du Vieux Nice sont aussi construites de
façon spécifique. Les portes d’entrées sont par exemple surmontées
d’une imposte arrondie, grillagée, qui communique avec les cages
d’escalier et les cours intérieures. Créant ainsi un appel d’air
entre la rue fraîche et la cour intérieure, où la chaleur s’est
accumulée par les rayons du soleil.
"Aujourd’hui, ces arrondis sont fermés et personne ne s’y
intéresse. Parce qu’on peut y glisser des pétards ou autres. La
paranoïa de chacun fait qu’on ferme tout et qu’on interdit cette
climatisation naturelle", regrette Jean-Pierre Clarac.
Le paysagiste cite l’exemple mentonnais, pour étayer son propos: "les
deux dernières rangées de bâtiments parallèles à la mer, construites
récemment, ont bloqué la ventilation naturelle de la ville
historique. La vieille ville de Menton est bien conçue, mais les
dernières installations bâties l’ont privée de cette climatisation
naturelle."
Réutiliser ce savoir
"Tout l’intérêt de savoir cela, c’est de permettre aux politiques
de s’en servir, pour bâtir des villes bio-climatiques", pose le
paysagiste. En février 1994, Jean-Pierre Clarac a publié l’étude
paysagère et urbanistique ainsi qu’un plan guide de la plaine du Var
en vue de la mise au point d’un cahier des charges, à la demande de
l’État. Il y prône notamment le fait de s’inspirer de l’exemple de
la vieille ville, en profitant de l’interaction des éléments mer et
montagne. Mais avec le fleuve, comme couloir de ventilation, cette
fois.
.
Entrée majestueuse au Mamac, forêt urbaine,
rues piétonnisées... Découvrez les nouvelles images de la future
promenade du Paillon
..
..
La nouvelle entrée monumentale du Mamac, aux
teintes dorées, qui rappellent la porte Fausse qui conduit au
Vieux-Nice
Le Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice va bénéficier
d'une rénovation complète d'ici 2025. Un projet qui s'inscrit dans
l'extension de la promenade du Paillon jusqu'au palais des
expositions. Avant/après, retrouvez comment cela pourrait
transformer le centre-ville.
"Un projet qui va faire basculer le Musée d’art moderne et d’art
contemporain de Nice (Mamac) dans le XXIe siècle". Quand Hélène
Guénin a pris la parole, ce lundi, la directrice du musée le plus
visité de la ville, rayonnait. Ce projet, décrié par certains,
présenté par l’architecte Alexandre Chemetoff et le maire de Nice,
Christian Estrosi, impressionne. La destruction du Théâtre national
de Nice (TNN) et du palais Acropolis va être couplée d’une réfection
importante du Mamac à l’automne 2023. L’institution artistique
niçoise deviendrait une "invitation à la promenade", comme
l’a évoqué Alexandre Chemetoff, au sein de la future forêt urbaine
de 20 hectares qui poussera sur le Paillon, jusqu’au palais des
expositions.
Une nouvelle entrée monumentale
La place Yves-Klein piétonnisée, embellie. Il le fallait a déclaré
Christian Estrosi : "La famille Klein a demandé à débaptiser la place si on
ne faisait pas quelque chose ".
La nouvelle entrée du Mamac se veut "attirante et monumentale".
..
..
La nouvelle entrée du Mamac, côté Garibaldi
..
Traverse Barla à l'ombre, nouvelle entrée pour la bibliothèque
Nucéra
De l’ombre et de la couleur sur la traverse Barla grâce à des
jacarandas en fleurs. Cette portion sèche, qui tombe sous le "regard" de
la Tête Carrée de Francis Chapus, Yves Bayard et Sacha Sosno, doit bénéficier
d’un renouveau. C’est sur cette pente douce que sera installée l’entrée de la
bibliothèque Louis-Nucéra. On y retrouverait un espace avec tables et chaises et
une terrasse en bois, accolée au Mamac, dédiée au théâtre et entourée de cactus.
..
..
Traverse Barla : avant/après
..
Les axes routiers nord-sud régénérés
Un boulevard Risso et une avenue Gallieni régénérés. C’est aussi le
but de ce projet d’extension de la promenade du Paillon jusqu’au palais des
expositions.
L’objectif affiché ? Que les commerces posés sur les axes routiers
qui entourent le palais Acropolis profitent d’un lieu apaisé et attirant. Sur la
première partie de la coulée verte, certaines affaires ont vu leurs chiffres
d’affaires bondir de "20 à 30 %" a déclaré Christian Estrosi. Gallieni et
Risso verront-ils aussi ce saut qualitatif ?
..
..
Boulevard Risso: avant/après
..
De nouvelles rues piétonnes
..
..
La rue Defly, qui reliera le musée au futur hôtel des
polices installé dans l'ancien hôpital Saint-Roch sera
piétonnisée
L’extension de la coulée verte du Paillon est annoncée comme une "invitation
à la promenade" par l’architecte, paysagiste et urbaniste associé au projet
Alexandre Chemetoff. Ainsi plusieurs axes du quartier devraient être rendus aux
piétons. Menant directement au Mamac, la totalité des rues Delille, Defly et
Penchienatti, mais aussi la traverse et la place Garibaldi vont être vidées des
véhicules. Il en sera de même pour la rue de l’Eau Fraîche, le passage Pauliani
et les rue Smolett, Bergondi, Barberis, Maraldi qui prolongeront les traverses
piétonnes de l’extension de la promenade du Paillon.
A noter que les axes nord-sud, des deux côtés de la future forêt urbaine seront
toujours réservés aux véhicules et accompagnés d’une piste cyclable.
Un musée hors les murs pendant deux ans
..

Au-dessus de la place Yves-Klein, une passerelle pour traverser
le Mamac et ouvrir une perspective vers la vallée du Paillon au nord et la baie
des Anges au sud.
"Il n’y aura pas d’interruption d’activité", a rassuré le
maire de Nice alors que l’institution fermera ses portes en septembre 2023 avant
de les rouvrir, transfigurées, fin 2025. La ville, candidate pour devenir la
capitale européenne de la culture en 2028, prévoit de déployer les collections
du musée via le prêt d’œuvres sur le territoire, ou encore la conception d’un
"Mamac nomade" qui sillonnerait la Métropole jusqu’à l’arrière-pays pour y
proposer les créations des artistes exposés au musée niçois.
Et la directrice le promet : "Deux ans, ça passe très vite".
.
Frontignan : un très vieux flamant rose peut en
cacher un autre
..
..
..
En décembre, à Frontignan, un flamant rose vieux de 44 ans
et demi, un record, avait été photographié. Un congénère
plus vieux vient d'y être identifié.
En photographiant Ann, en décembre 2021, dans l'étang
d'Ingril à Frontignan, Céline Laurens pensait avoir
photographié le plus vieux flamant rose jamais observé avec
ses 44 ans et demi. Le centre spécialisé de la Tour de Valat
le lui avait certifié. Sauf que.
Il avait disparu depuis 5 ans
Sauf que cette semaine la Frontignanaise a réussi à fixer
sur la pellicule la bague d'un flamant rose qui, après
vérification auprès du centre de référence gardois, s'avère
être plus vieux de trois mois qu'Ann. Adr (c'est son doux
nom) est donc désormais en tête du palmarès avec 44 ans et
neuf mois. Il faut dire que cela faisait cinq ans, depuis le
30 avril 2017 à Aigues-Mortes précisément, que ce
volatile-là n'avait pas été identifié par des scientifiques
ou des observateurs volontaires. On pouvait donc
légitimement penser qu'il s'était fait voler dans les plumes
ou qu'il se gavait de crevettes dans la Valhalla des
flamants roses. Que nenni.
Bagué en 1977 dans les Bouches-du-Rhône
Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'Adr, bagué le 20
juillet 1977 dans l'étang du Fangassier (Bouches-du-Rhône)
était venu à La Peyrade et Frontignan dès sa première année.
Il est également allé se poser à Vic la Gardiole (1980), à
Mèze (1981 et 1985), à Marseillan (1982). Adr a aussi été
observé à Huelva (Espagne) en 1983 et 1987.
Une belle longévité
En 1977, 559 flamants roses ont été bagués en France.
Vingt-quatre d'entre eux ont été observés jusqu'à encore
récemment.
Belle longévité pour ce cru. Un flamant rose sauvage dépasse
rarement les 30 ans.
.
On vous dévoile les premières images de la
future promenade du Paillon de Nice
.
.
.
La coulée verte sera prolongée à l’est de Nice, de la traverse de la
Bourgada à l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny. Le musée d’art moderne et
contemporain (Mamac) est également repensé.
Le projet aura fait couler de l’encre. Malgré l’audience en référé, fixée
mercredi matin au tribunal administratif pour statuer sur le recours déposé
contre la destruction du Théâtre national de Nice, Christian Estrosi a dévoilé,
ce lundi, les premières images du projet d’extension de la promenade du Paillon
vers l’est de Nice.
..
.
Une passerelle permettra de franchir la traverse Jean-Monnet,
pour faire le lien entre le futur palais des arts et de la culture et
l’extension de la coulée verte.
Jusqu’où s’étendra-t-il ?
De la traverse de la Bourgada à l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny,
la promenade du Paillon s’étendra sur un kilomètre. Lundi, en conférence de
presse, il a été vendu comme un "véritable corridor écologique" qui
améliore la circulation de l’air et lutte contre les îlots de chaleur urbains.
"A-t-on déjà vu une forêt urbaine sur des pots d’échappement", a
questionné l’élu d’opposition municipale écologiste, Hélène Granouillac.
Pourra-t-on toujours circuler, se garer ?
.
..
Lundi 14 février 2022, Christian Estrosi a présenté le futur projet
d'extension de la promenade du Paillon, vers l'Est de Nice. Ici, une vue depuis
la traverse de la Bourgada.
Sur les dessins mis à la disposition de la presse, on voit que la
circulation se fera toujours avenue Galieni, boulevard Risso, avenue
Saint-Jean-Baptiste et via le tunnel Liautaud.
Le parking des Arts sera maintenu sous le jardin et des places resteront
accessibles en surface, dans les quartiers voisins du projet.
Y a-t-il un calendrier prévisionnel ?
Pour la partie Théâtre national de Nice (TNN) / Mamac et pour le
secteur Acropolis, les travaux sont annoncés jusqu’à fin 2025.
Tout commencera en mars avec le désamiantage et la déconstruction du TNN. Les
travaux propres au théâtre doivent se terminer à la fin de cette année pour
commencer ceux relatifs à la promenade du Paillon, sur le secteur TNN / Mamac.
Qui seront normalement achevés en mai 2025.
En février 2023, Acropolis sera désamianté et détruit. Entre la fin 2023 et le
début 2024, les travaux de requalification du Mamac, de la bibliothèque
Louis-Nucéra et du parking des Arts seront enclenchés.
À l’été 2024, les dernières pierres d’Acropolis devraient être tombées. Et, à
l’automne de la même année, les travaux du parc sur ce secteur commenceront.
Tout devrait être livré à la fin de cette année.
Mais qu’est-ce qui change?
Très concrètement, l’extension de la promenade du Paillon est un
revêtement végétalisé, composé de diverses passerelles. Tout partira du futur
palais des Arts et de la culture qui sera livré à l’horizon 2026, en lieu et
place de l’actuel palais des expositions. Un premier pont permettra de passer
au-dessus de la traverse Jean-Monnet. Sur les visuels, l’esplanade Kennedy
deviendra une forêt urbaine.
Puis, en découlera l’extension de la promenade du Paillon. Elle continuera
jusqu’à la traverse de la Bourgada, en passant par le toit de la bibliothèque
Nucéra, le premier étage du Mamac et le toit du parking des Arts.
L’objectif des architectes est de se balader le long de la promenade du Paillon,
sans qu’aucun élément ne soit un obstacle.
.
.
.La
traverse Barla à l'horizon 2025.
"Le musée d’art moderne et d’art contemporain fera partie
intégrante de la future promenade du Paillon"
Après avoir examiné une centaine de dossiers et retenu quatre
finalistes, c’est le projet présenté par l’architecte portugais Joao Luis
Carrilho da Graça et l’architecte, urbaniste, paysagiste français Alexandre
Chemetoff, qui a fait l’unanimité du jury. Ce dernier a répondu à nos questions.
Qu’est-ce que ce projet a de particulier ?
Il a fallu travailler en symbiose avec la transformation du lit du
Paillon et l’intégration de trois bâtiments (le Mamac, la bibliothèque Nucéra et
le parking des Arts). On a donc imaginé des passerelles piétonnes, pour intégrer
les boulevards situés autour du parc.
Outre la végétalisation du secteur, l’eau tient une grande place dans vos
projections.
Les voûtes du Paillon étant étanchées, ça permet de recueillir l’eau de pluie et
de s’en servir pour arroser le jardin. On va également créer des plans d’eau
naturels, avec des poissons, des plantes, etc. et utiliser des galets pour
délimiter des calades – des chemins empierrés – et en intégrer dans les murs.
Comme on peut en voir dans les jardins de la villa Arson.
Le musée d’art contemporain est également transformé.
Déjà, les œuvres du Mamac seront repositionnées au sein du futur
parc. Ensuite, aujourd’hui la place Yves-Klein [entre le TNN et le Mamac] est
sombre et bruyante. On veut en faire le toit du musée. Elle sera ainsi plus
lumineuse et permettra de bénéficier d’un panorama à 360 degrés sur la ville. La
place serait donc le haut du musée. On a renommé la rue qui passe en dessous «
traverse Garibaldi ». Elle intégrera les vitrines du musée et son entrée. Il
fera alors partie intégrante de la promenade. À l’intérieur, on a pensé une
grande salle d’exposition, sur une double hauteur.
Et aussi
Un espace dédié au projet ouvre dès aujourd’hui au quatrième étage
de la Tête carré pour s’approprier la fameuse vue à 360 degrés que proposera la
promenade du Paillon. Des réunions d’information sur l’avancée des travaux y
seront aussi organisées.
.
.
La célèbre Tête Carrée va devenir un lieu ouvert
au public à Nice
.
..
..
La première phase du prolongement de la coulée verte débutera en
septembre, annonce le maire de Nice qui dévoile les aménagements qui
seront réalisés d’ici deux ans.
Elle abrite pour l’heure les bureaux de la bibliothèque
Louis-Nucéra. Mais les personnels administratifs vont devoir quitter
la Tête Carrée. Le maire de Nice veut rendre au public ce bâtiment
emblématique de la ville, dessiné par l’artiste niçois Sacha Sosno.
La veuve du sculpteur, Macha, ainsi que Thomas Aillagon, l’ancien
directeur du musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, devenu
directeur général adjoint de Nice en charge de la Culture, ont été
associés à la réflexion pour trouver une nouvelle vocation à la Tête
Carrée.
"Rien n’est arrêté pour le moment", assure Christian Estrosi.
Si ce n’est la destination de ce nouveau lieu. Le maire veut le
dédier à la culture. Et en faire, pourquoi pas, "un lieu éducatif"
pour les jeunes publics, voire "un espace d’exposition temporaire"
ou encore un écrin retraçant "la genèse de l’école de Nice".
Ce réaménagement s’inscrit en effet dans un projet global. Celui de
l’extension de la promenade du Paillon dont le coup d’envoi devrait
se faire "d’ici septembre". "Même si tout va se coordonner
en même temps", annonce Christian Estrosi, une première phase du
chantier concernera "la portion comprise entre la traverse de la
Bourgada et le pont Barla." L’ouverture au public de la Tête
Carrée ne sera d’ailleurs que l’une des nouveautés que le maire de
Nice annonce pour fin 2023. Voici ce à quoi cela devrait ressembler…
Un bar panoramique
La Tête Carrée va donc devenir un espace culturel destiné au public.
Mais Christian Estrosi n’exclut pas d’y intégrer un lieu de vie tel qu’un bar
panoramique – "vintage ou contemporain" – pour profiter du point de vue
privilégié dont disposera à terme cet édifice aux formes si particulières sur la
"forêt urbaine" que la Ville veut faire pousser jusqu’au palais des
expositions. Pour cela, il va falloir améliorer l’accessibilité du bâtiment et
revoir sans doute l’aménagement intérieur. Pour l’heure, la Tête Carrée est
composée de quatre étages de 150m2. Il ne faudra peut-être en conserver que deux
ou trois pour redonner du volume à chaque plateau.
Un jardin Sosno étoffé
Le jardin Sosno, qui remonte en pente douce vers le Mamac, au droit
de la Tête Carrée, va être "étoffé". Cet espace vert porte le nom de
l’artiste niçois qui a dessiné les lignes de ce bâtiment qui sert de phare au
croisement de l’avenue Saint-Jean-Baptiste et de la traverse Barla. L’idée est
d’augmenter le nombre d’œuvres qui s’y trouvent pour en faire un "espace
d’exposition en plein air". Ce cheminement sera également la nouvelle entrée
de la bibliothèque Louis-Nucera qui va faire l’objet d’une rénovation complète.
Créer une symétrie
Le jardin Sosno aura son pendant de l’autre côté du Mamac. La
municipalité veut en effet créer une pente symétrique en lieu et place du
théâtre National de Nice, voué à la démolition. Ce jardin Sosno bis, également
agrémenté d’œuvres d’art, permettra de créer une continuité avec l’actuelle
coulée verte. Cette seconde pente offre, en outre, la possibilité de conserver
le parking.
Un musée réaménagé et agrandi
La jonction entre ces deux esplanades symétriques se fera au niveau
du Mamac, au-dessus de l’actuelle place Yves-Klein. Celle-ci n’aura donc "plus
vocation d’être", souligne Christian Estrosi qui annonce que cet espace sera
comblé. Il veut en faire une extension du Musée d’art moderne qui gagnerait
ainsi 600m2. À l’occasion de ces travaux, c’est en réalité l’ensemble des salles
d’exposition qui vont être rénovées et modernisées. Cela va nécessiter la
fermeture temporaire du musée, jusqu’à la fin 2024.
"On fera en sorte qu’il y ait un espace de substitution, promet le maire
de Nice. Le 109 nous sera alors bien utile."
.
.
Frontignan : Ann, le plus vieux flamant rose
connu du monde, photographié dans l'étang d'Ingril
.
. . .
Le volatile, photographié par une
Frontignanaise, est d'après le centre de
référence, "le plus vieux flamant rose connu
bagué et sauvage du monde".
Frontignan, centre du monde. Pour les
flamants roses en tout cas.
En effet, après avoir photographié dans les marais salants de la
ville, l'un des plus vieux exemplaires connus - baptisé Pdi - accusant 41 ans,
Céline Laurens vient tout simplement de fixer sur la pellicule "le plus vieux
flamant rose connu et bagué et sauvage du monde", comme le centre de
référence français de la Tour de Valat lui a précisé.
Doyen mondial
Ann - c'est son prénom - est un flamant rose mâle âgé de 44 ans et
demi. C'est le doyen mondial des flamants sauvages bagués. Et un sacré résistant
puisque l'espérance de vie de ce volatile à l'état sauvage avoisine les 30 ans.
Il se trouve actuellement dans le secteur de l'étang d'Ingril et a donc été
identifié grâce à la bague qu'il porte sur l'une de ses pattes. Un élément
déterminant qui a permis au centre gardois de retracer son parcours en vie en
fonction des relevés des observations des scientifiques mais aussi des citoyens
(*).
Père de onze enfants
Ann est donc né en mai/juin 1977. Il a été bagué lorsqu'il était
poussin, le 20 juillet 1977 à l'étang du Fangassier (Bouches du Rhône). Il aura
été, a minima, onze fois papa, dont la dernière fois l'an dernier, à l'âge de 43
ans! La totalité des observations déclarées ont été faites entre les Bouches du
Rhône et l'Hérault. Il a d'ailleurs été vu en 1990 à Lattes (étang du Méjean),
et durant trois mois lors de l'hiver 2002/2003 dans les étangs de Frontignan.
Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas allé faire un tour à l'étranger. Il
n'a juste pas été observé. Ce n'est qu'en 1986, par exemple, que l'Espagne a
commencé à référencer les flamants roses.
Elle a déclaré 68 flamants cette année
Pour sa part, Céline Laurens en est à 68 flamants déclarés a ce
jour. "J'ai suffisamment de photos et d'historiques de vie avec des parcours
migratoires remarquables pour monter une exposition...", lance celle qui
voit beaucoup la vie en rose en ce moment.
(*) Les personnes qui observent un flamant bagué peuvent envoyer la photo à
l'adresse suivante
secretariat@ltourduvalat.org en donnant le lieu de la prise de vue et la
date.
.
.
.
Méditerranée : un barrage à Gibraltar, l'idée
folle d'un chercheur pour empêcher la montée des eaux
.
.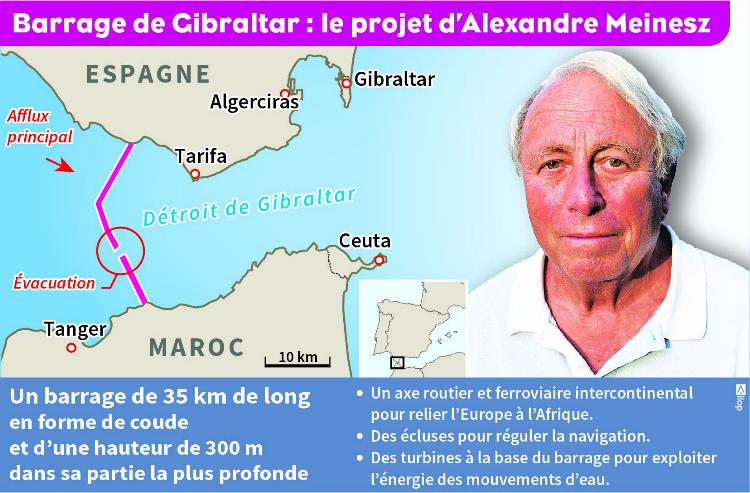
.
Alexandre Meinesz, biologiste marin au CRNS à
Nice, explique qu'il serait moins coûteux de
construire cette retenue d'eau que de financer
tous les travaux liés à la montée des eaux.
"C'est une idée un peu utopique mais quand on
compare ce que vont coûter la montée des eaux
d'un mètre et la construction du barrage, on est
dans un rapport du simple au triple".
Alexandre Meinesz est chercheur au CNRS à
l'Université de Nice, spécialiste depuis 40 ans
des questions portant sur le littoral de
Méditerranée. Et dans son dernier livre,
"Protéger la biodiversité marine" (*), il
appréhende le phénomène du réchauffement
climatique et de la montée des eaux en exhumant
un projet ancien, un peu fou mais qui serait
salvateur : celui de la construction d'un
barrage dans le détroit de Gibraltar pour faire
baisser le niveau de la Méditerranée et sauver
notre côte d'Occitanie...
À quoi ressemblerait-il ?
Dans les années 1920, l'Allemand Herman Sörgel
l'avait conceptualisé. Il s'agirait d'une
construction de 32 km entre la pointe de
l'Espagne et le Maroc, en arc-de-cercle, pour
éviter les profondeurs maximales de 800 m.
D'immenses blocs de bétons, iraient quand même
jusqu'à 300 m de fonds, avec des caissons creux
à cheval pour laisser passer l'eau, et, sur
l'édifice, seraient construites une autoroute et
une voie ferroviaire pour relier les deux
continents et en dessous des écluses pour
laisser passer les bateaux. Avec également des
turbines hydroélectriques.
"Ce barrage ferait baisser la mer de vingt
centimètres" annonce le biologiste marin.
Qui développe son argumentaire : "Il y a une
série de bombes à retardement qui arrivent comme
la fonte du permafrost qui va libérer du méthane
60 fois plus puissant que le CO2. La mer va
monter beaucoup plus vite que prévue et pour moi
c'est la pire des conséquences du réchauffement
climatique pour les régions littorales. Cela va
entraîner la construction de digues, d'épis, la
remontée des quais de tous les ports et des
estuaires avec des coûts faramineux".
Finalement, le barrage serait beaucoup moins onéreux dans cette
stratégie à long terme.
"On peut sauver les meubles chez nous, c'est très égoïste mais possible"
assène le chercheur. Il envisage également la mise en place d'écluses de l'autre
côté de la Méditerranée, sur le canal de Suez pour éviter "le déversement des
espèces invasives".
Bien sûr Alexandre Meinesz sait que la réalisation d'un tel barrage
nécessiterait une volonté commune de tous les Etats riverains pour le
cofinancer.
Il balaie en revanche l'argument écologique que l'on pourrait lui
opposer avec ces dix ans de travaux et de bétonnage en mer...
"Mais 32 km de béton, ce n'est pas comparable aux 4700 km de côte à
artificialiser" répond-il.
(*) Alexandre Meinesz "Protéger la biodiversité marine" (Odile Jacob).
.
.
Avec Lady Sapiens, une autre histoire de la femme à la
Préhistoire, active, sportive, artiste et chasseresse.
Musclée, élancée, active, coquette et... aussi active que l'homme dans une
séparation des tâches adaptée à la vie au temps de la Préhistoire.
Avec "Lady Sapiens", un projet qui associe un livre, un documentaire, et des
vidéos sur
la plateforme éducative numérique Lumni ,
la place de la femme du paléolithique supérieur, il y a 40 000 ans,
est revisitée.
Thomas Cirotteau, déjà réalisateur de "Qui a tué Néanderthal ?", a
réalisé le documentaire, à revoir sur France Télévision, et coécrit
le livre, paru aux éditions Les Arènes en septembre.

.


.
.
700 ans d'histoire
et un futur théâtre... On a visité le chantier du futur TNN sur la place
Saint-François à Nice
L’église et le couvent des
franciscains, place Saint-François, ont vocation à accueillir l’une des scènes
du futur Théâtre national de Nice... Levée de rideau dans six mois.
Le chantier s’est employé à redonner
à ces lieux chargés d’histoire leur dimension monumentale.
Visite guidée
.
 .. ..
.
..
“Les explorateurs des parcs” : le tout nouveau jeu digital pour parcourir les
parcs des Alpes Maritimes

Ce samedi 23 octobre,
Charles-Ange Ginésy a présenté le tout nouveau jeu digital “Les explorateurs des
parcs” dans le parc naturel de Vaugrenier.
Application "Les explorateurs du parc", crédit : Departement06
Lancée par le département des Alpes Maritimes, l’application de jeu "Les
explorateurs du parc", gratuite et disponible sur smartphone, permettra aux
utilisateurs de découvrir le patrimoine naturel, paysager, géologique et
historique des parcs du département.
Si le parc naturel de
Vaugrenier est pour l’instant le seul à être accessible dans l’application, il
sera très prochainement rejoint par sept autres parcs.
Le parc de la Grande
Corniche sera accessible début 2022, les parcs de l’Esterel et du Vinaigrier le
seront courant 2022, puis en 2023, il y aura les parcs de la Valmasque, du Cros
de Casté, des Rives du Loup et de la pointe de l’Aiguille.
Pour le président du département, "Les Explorateurs des parcs incarne à elle
seule les ambitions du Département des Alpes-Maritimes dans le cadre des 2
politiques majeures du SMART Deal et du GREEN Deal : préserver l’environnement
d’exception que nous offre notre territoire et apporter, par le numérique, un
meilleur service aux usagers".
Un jeu sous forme de défis
Le jeu consiste pour le joueur à relever 10 défis. Il pourra par exemple
apprendre à identifier le chêne liège par l’intelligence artificielle ou encore
à découvrir le mode de vie de certains animaux en réalité augmentée. S’il gagne,
il remporte des cartes à collectionner.
Le jeu a pour vocation de sensibiliser les joueurs aux enjeux environnementaux
tout en leur apportant une plus grande connaissance des parcs et de leur faune
et flore. L’application sera régulièrement mise à jour et proposera de nouveaux
parcours pour inciter les utilisateurs à revenir dans les parcs.
Un jeu pour toute la famille
L’application a été pensée pour convenir à tout le monde. Ainsi, dès l’âge de
huit ans, les enfants peuvent s’en servir s’ils sont encadrés par des adultes.
Le jeu conviendra également aussi bien aux familles, qu’aux professeurs ou aux
associations qui veulent par exemple mettre en place des activités pédagogiques
autour de la découverte et de la protection de nos parcs naturels.
L’application est disponible et téléchargeable dès maintenant sur l’App Store et
Google Play.
La Côte d’Azur vue
depuis l’espace !
Depuis avril 2021, l’astronaute Thomas Pesquet fait partie de l’équipage de
l’ISS (Station Spatiale internationale) pour la Mission Alpha.
Le français partage
régulièrement des photos des lieux que la Station Spatiale survole.
Ce lundi, Thomas Pesquet a survolé avec la station spatiale la Côte d’Azur comme
ça avait déjà été le cas en juillet dernier.
Comme à son habitude,
l’astronaute en a profité pour prendre plusieurs clichés et les présenter sur
ses réseaux sociaux.
Il a posté trois photos de la Côte d’Azur, la première met d’abord en lumière la
beauté de Cannes et sa baie, l’astronaute s’est émerveillé devant ce spectacle :
"Au bord de l’eau à Cannes et entre les deux îles, on repère des tâches plus
claires aux endroits où l’eau est turquoise quand on a les pieds sur Terre.
J’adore les zones bleu clair, on pourrait croire que c’est une tache sur la
photo, mais non : c’est vraiment comme ça !"

Cannes et sa baie

Nice et la baie des Anges
.
Carrières de lumières : Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait
Artiste prolifique et visionnaire, Vassily Kandinsky (1866-1944)
Peintre, poète,
théoricien de l’art et fondateur de l’art abstrait, Kandinsky révolutionne
l’histoire de l’art avec ses nombreuses compositions, aujourd’hui exposées à
travers le monde.
.
https://www.carrieres-lumieres.com/fr/home
.
.
Montage réalisé à partir d'images des "Carrières de
lumières"
..
.
Nice et sa Promenade des Anglais classées au Patrimoine mondial de l'Unesco
Une zone qui comprend notamment la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis
et les terrasses des Ponchettes. Le périmètre inclu également le mont Boron, les
collines de Cimiez et des Baumettes ainsi que la cathédrale orthodoxe russe.
Nice et son incomparable décor urbain, façonné par 200 ans d'histoire
cosmopolite et l'engouement des riches hivernants attirés par les bienfaits de
son climat en bordure de mer Méditerranée, ont été classés mardi au Patrimoine
mondial de l'Unesco. Reconnue au titre de "ville de la villégiature d'hiver de
Riviera" pour son patrimoine architectural, paysager et urbanistique, la
cinquième ville de France rejoint une quarantaine de sites en France, comme les
rives de la Seine à Paris, la cathédrale d'Amiens ou le Mont Saint-Michel. Le
périmètre classé couvre un peu plus de 500 hectares, et englobe notamment la
Promenade des Anglais, en bord de mer.
"L'histoire de Nice, à la fois enracinée et ouverte, méditerranéenne et alpine,
européenne et cosmopolite, a produit une architecture et un paysage uniques, un
modèle pour un grand nombre d'autres villes du monde", s'est félicité le maire
Christian Estrosi. "Cette inscription consacre Nice comme archétype de la
villégiature d’hiver de riviera avec son site exceptionnel, entre mer et
montagne, et les diverses influences qui ont façonné son patrimoine", a aussi
salué sur Twitter la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.
"Capitale d'hiver"
Jusqu'à l'aube du XIXe siècle, Nice était une vieille bourgade du royaume de
Piémont-Sardaigne encadrée par une colline au château détruit et la rivière du
Paillon.
Les récits de voyages de l'écrivain écossais Tobias Smollett, publié vers 1766,
vont ensuite la mettre à la mode et notamment captiver le public anglais.
Son destin change quand l'aristocratie anglaise, avide de lieux de villégiature
tempérés pour passer l'hiver, jette sur elle son dévolu.
Une ville nouvelle se développe alors pour devenir une véritable "capitale
d'hiver" pour riches oisifs, rentiers et aristocrates itinérants de toute
l'Europe pour lesquels on trace des boulevards, aménage des parcs et des
promenades pour profiter du plein air, plante des espèces exotiques, palmiers ou
orangers, sur des terrains pelés.
Avec le rattachement de Nice à la France en 1860, le train démultiplie les accès
et le nombre de ces riches résidents à la recherche de distractions et d'un air
bénéfique pour la santé, à une époque où la tuberculose fait encore des ravages.
Ce sont d'abord des Anglais puis des Russes et des ressortissants des empires
allemands et austro-hongrois. Nice accueille progressivement des visiteurs de
toute l'Europe et même des Amériques, qui en font la première représentante de
cette villégiature de riviera.
Pour eux, se sont bâtis des villas (la plus ancienne date de 1787), des hôtels
(Le Regina pour la reine d'Angleterre et sa suite) ou des immeubles d'agrément
appelés "palais" et qui forment aujourd'hui un superbe ensemble urbain environné
d'un amphithéâtre de collines typique de la géographie de Nice.
En 1900, le plaisir des bains de mer n'est pas encore inventé, encore moins
celui de la bronzette, mais la ville reçoit déjà 150.000 résidents par an, une
fréquentation sans équivalent dans les autres villes de villégiature.
Pittoresque et douceur du climat
"C'est donc à Nice qu'ont été d'abord découverts les attraits de ce qui va
devenir la Riviera au sens postérieur du terme: le pittoresque particulier des
paysages résultant de la proximité de la montagne et de la mer, la douceur du
climat hivernal, l'exotisme de la végétation et même, à un certain degré, la
singularité des modes de vie des autochtones", a rappelé la ville dans un
dossier de presse.
L'inscription au patrimoine de l'Unesco apporte à la ville un prestige
international très fort dont la municipalité espère qu'il va favoriser
l'activité touristique, déjà florissante, et l'économie locale.
Elle a aussi vocation à renforcer la sensibilité du public mais aussi la
protection contre des aménagements destructeurs, grâce à un règlement
d'urbanisme patrimonial, dans une ville qui a connu des outrages irréversibles
comme la destruction du palace Ruhl, fleuron Belle Epoque de 1912, dynamité dans
les années 1970 pour construire un hôtel aux vitres teintées à la place.
Depuis le lancement de sa candidature à l'Unesco, la ville a inventorié et
protégé plus de 300 bâtiments et a restauré des dizaines d'immeubles, de villas
et de jardins.
.
SURVOL DE
NICE EN VIDEO
..
.
A Nice,
votre rue est-elle inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ?
Voici le périmètre
concerné
La 44e session du comité du Patrimoine mondial de l’Unesco, qui se tenait en
Chine ce mardi 27 juillet, a inscrit "Nice, la ville de la villégiature d’hiver
de Riviera" sur sa liste. L’aboutissement de deux siècles d’histoire et de dix
années de candidature.
La ville de Nice a été inscrite, ce mardi, au patrimoine mondial de l’Unesco.
Seules quelques zones de la ville sont concernées, mais quelles sont-elles ?
522 hectares de la ville de Nice ont rejoint la prestigieuse liste du patrimoine
mondial de l’Unesco, au titre de "Nice, la ville de la villégiature d’hiver de
Riviera", ce mardi.
Cette zone classée part du Mont-Boron, descend vers le Cap de Nice, traverse le
port, Rauba Capeu et la colline du Château. Elle continue tout le long de la
promenade des Anglais, jusqu’à Caucade.
Quelques extensions
Voilà pour la zone littorale. L’inscription concerne aussi une partie de la
vieille ville: le cours Saleya, les Ponchettes et l’opéra de Nice. Elle continue
ensuite au cœur de la ville, entre la promenade des Anglais et la voie de chemin
de fer, gare Thiers inclue.
Cette fameuse zone englobe aussi quelques extensions comme les collines de
Cimiez, Valrose, Malausséna, la place du général De Gaulle sur la Libération, la
cathédrale orthodoxe russe et les Baumettes.
Quid de Garibaldi ?
La place Garibaldi et les ruelles du Vieux Nice ne sont cependant pas incluses
dans le périmètre reconnu, car elles correspondent à un développement antérieur
de la ville. Garibaldi était une place royale turinoise, qui existait avant le
démarrage de la villégiature à Nice.
Et une zone tampon
À ces hectares, s’en ajoutent 4.243 autres. Ils constituent la zone tampon du
bien, qui correspond à la ligne de crêtes des collines qui l’entourent.
Elle s’étend jusqu’au mont Chauve d’Aspremont. Cette dernière a pour fonction de
protéger le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Une protection
scrutée de près par la communauté internationale par le biais, notamment, d’une
commission locale du bien présidée par le préfet.
.

..
.
UN VOYAGE AU COEUR DES OEUVRES MAJEURES DE L’ARTISTE
AIXOIS
Cezanne, le maitre de la Provence
La nouvelle exposition numérique et immersive des Carrières de Lumières
présente les chefs-d’oeuvre les plus significatifs de Cezanne (1839-1906)
tels que ses natures mortes aux pommes, Les joueurs de cartes (1890-95) et
Les grandes baigneuses (vers 1906).
Embarquez pour un voyage au coeur des oeuvres majeures de l’artiste aixois,
suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire
https://www.carrieres-lumieres.com/fr/home

Montage réalisé à partir d'images des "Carrières de
lumières"
..
.
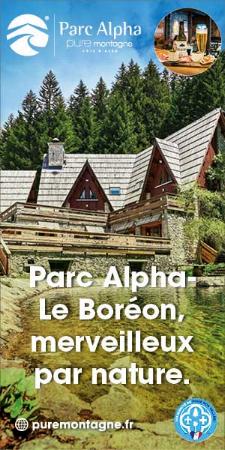
..
A 1 heure de Nice,
au cœur du Mercantour...
Les Vallées de la Vésubie et du Valdeblore proposent une offre inédite
d’activités en toutes saisons.
Pure Montagne® regroupe sur 15 km autour de Saint Martin Vésubie, activités
sportives et ludiques, indoor et outdoor, découvertes, contemplation, relaxation
: une montagne de sensations
..
.
9
raisons d'aimer les galets de la Promenade des Anglais...
..
.
.
Ne jetez pas
la pierre aux galets, ils ont plein d'avantages que la rédaction a décidé de
lister pour que vous arrêtiez de râler en été.
Mais si, vous allez aimer les galets. Entre deux bonnes respirations et un peu
de bonne volonté, cette liste vous aidera à les apprécier à leur juste valeur.
Promis.
1. Parce qu’on n’en ramène pas à la maison à la fin de la journée
Ou
si vous en avez dans les ourlets de vos pantalons et le fond de vos sacs, c’est
que vous l’avez vraiment cherché.
..
2. Parce qu'ils sont un emblème de Nice
Et
ça, ça n’a pas de prix.
..
.
..
3. Parce que si on perd ses clés, on a plus de chances de
les retrouver
Vous avez déjà essayé de retourner le sable pour trouver votre unique exemplaire
de clé de voiture?
.
.
Les galets de la Prom' sont nos amis
..
4. Parce qu’il y a des championnats de châteaux de galets
Avec une activité qui en jette autant, nul doute que
vous impressionnerez vos amis.
.
.
Bon OK c'est un peu moins précis que les
châteaux de sable
..
5. Parce que c’est l’occasion de sortir ses plus belles
sandales
Quel meilleur endroit pour sortir les méduses de son enfance qu’à Nice?
.
.
.
6. Parce qu’on peut les jeter dans la mer
Ne dites pas que vous ne l’avez jamais fait, et que vous n’avez pas
secrètement aimé.
.
.
.
7. Parce que lorsqu’on arrive dans l’eau en tombant, ça fait des souvenirs
Marcher sur les galets, une belle aventure.
.
.
8. Parce que c’est parfait pour empêcher la serviette de s’envoler
Ces galets ont décidément tout pour eux.
.

.
9. Parce que ça fait son effet sur une étagère dans votre maison de vacances
(Mais chut, il est absolument interdit d’en ramener.)
.
.

.


..
.
"La Prom"
Découvrez
le documentaire exclusif, 5 ans après l'attentat du 14 Juillet à Nice
Pour les 5 ans du 14 juillet 2016, la rédaction web de Nice-Matin propose un
documentaire mêlant témoignages bouleversants et images puissantes d’un front de
mer... touchant.
"La Prom elle est là et elle sera toujours là."
Malgré la tragédie du
14 juillet 2016. Malgré la cicatrice tracée dans le bleu de son âme et les bleus
de son cœur. Le message il est là. Émanant, telle une vague aux sentiments
mêlés, d’un documentaire, que le service Web de Nice-Matin a réalisé et propose
dès ce mardi, veille de l’anniversaire de l’attentat, sur le site nicematin.com
et sur la chaîne YouTube de Nice-Matin.
La Prom avant. La Prom pendant. La Prom après.
Au bilan inscrit en
rouge sang indélébile: 86 morts, 400 blessés, des milliers des traumatisés.
Pour en parler, 7
témoins: Christian Estrosi, maire de Nice, Yvan Gastaud, historien, Thierry
Suire, ex-chef d’agence de Nice-Matin, professeur des écoles, Anne Murris, maman
de Camille décédée dans l’attentat, Bruno Razafitrimo, époux de Mino, elle aussi
victime du barbare, Carolina Mondino, blessée violemment et dont la meilleure
amie est morte sous le camion fou, Amira Zaiter, ex-bénévole de la Protection
civile ce soir-là désormais aide soignante.
.
.
..
Découvrez
le #NosAnges
Le mémorial de Nice-Matin aux
victimes de l'attentat du 14 Juillet

..
.
REPONSES QUESTIONS DU 080723 "peuchere sud"
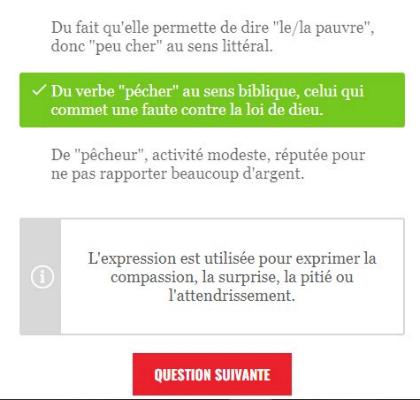
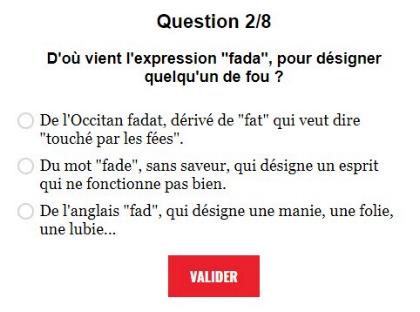
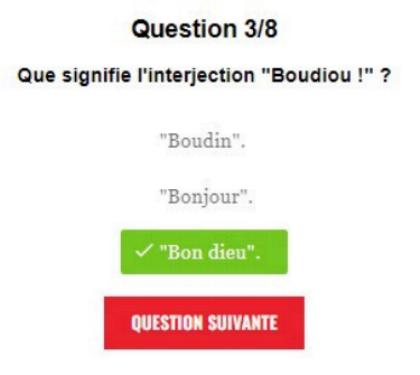
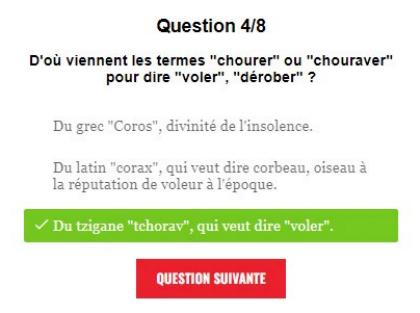
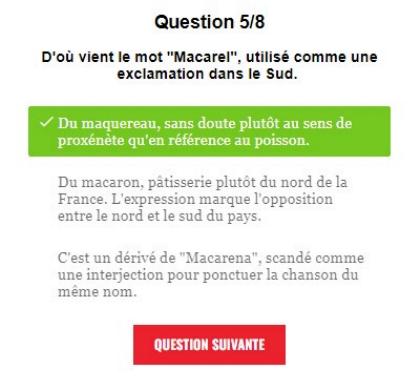
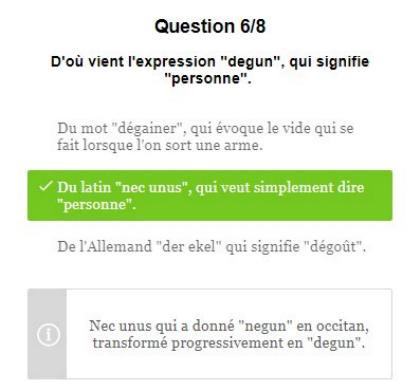
|


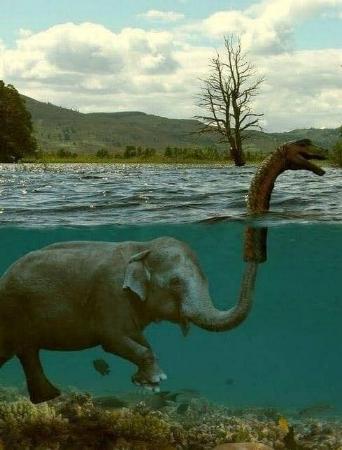





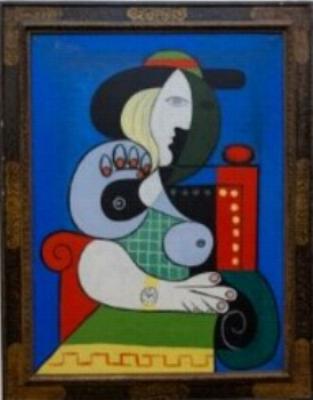










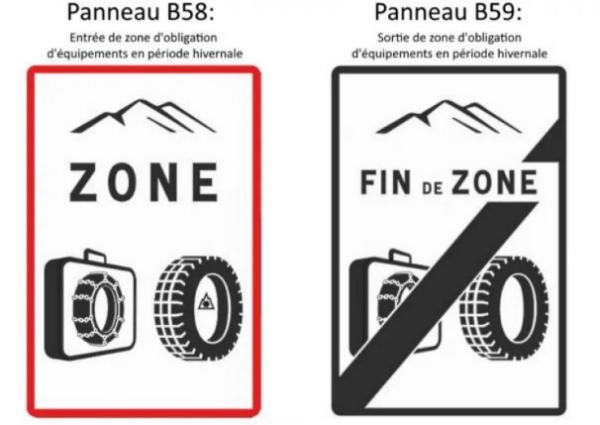
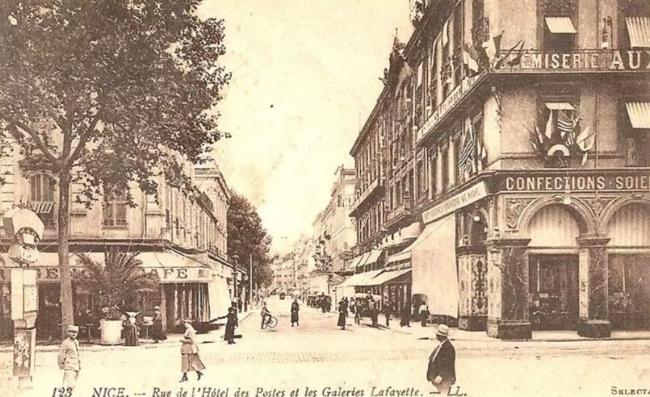
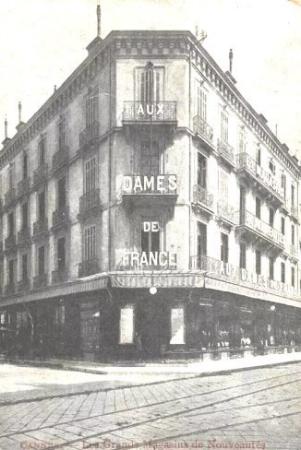




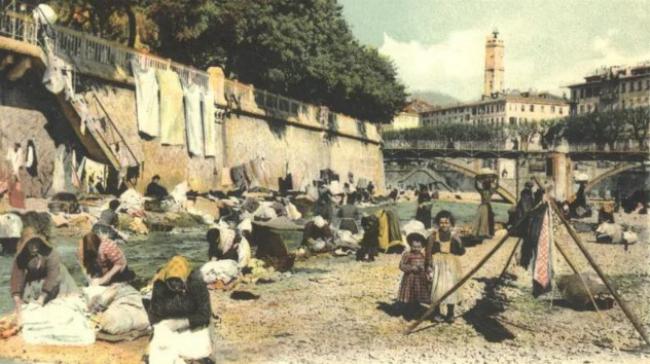




















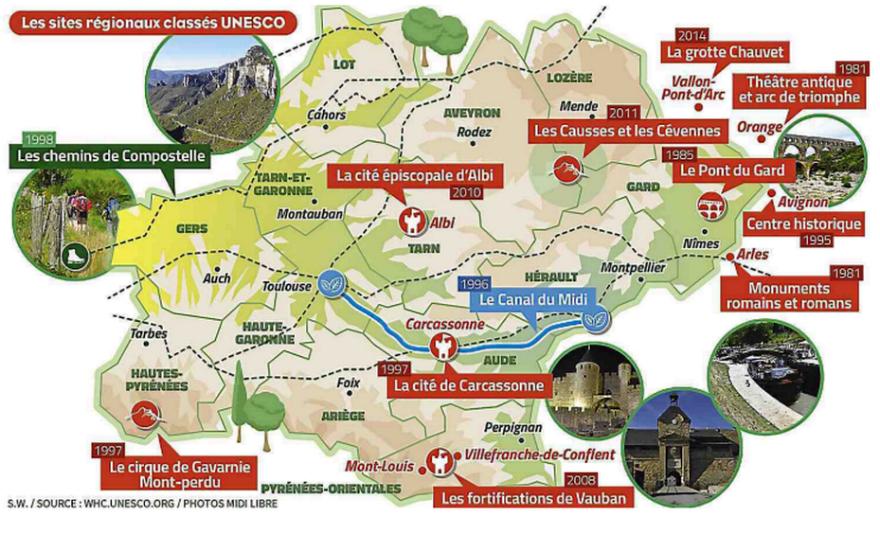
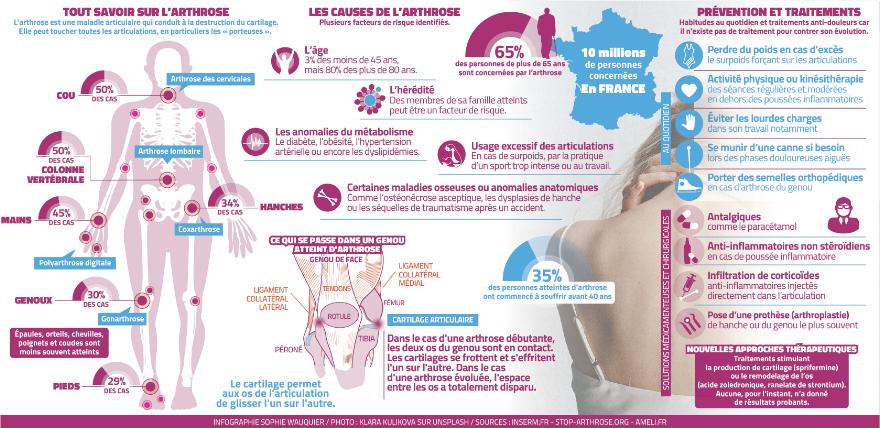















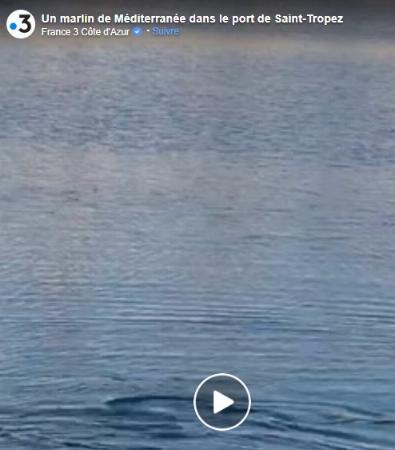




 Musée
de Préhistoire de Terra Amata
Musée
de Préhistoire de Terra Amata
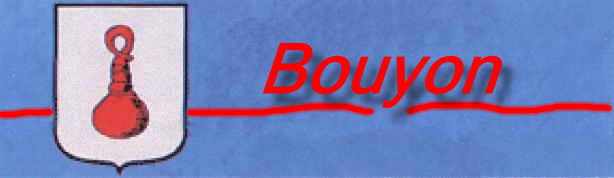




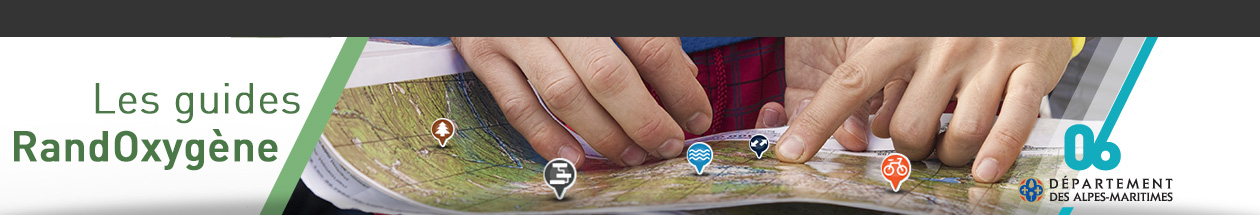
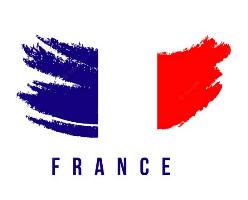
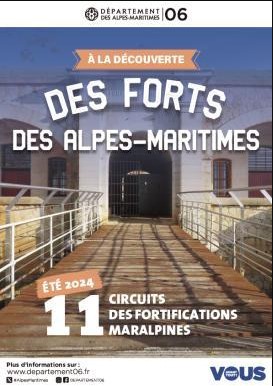






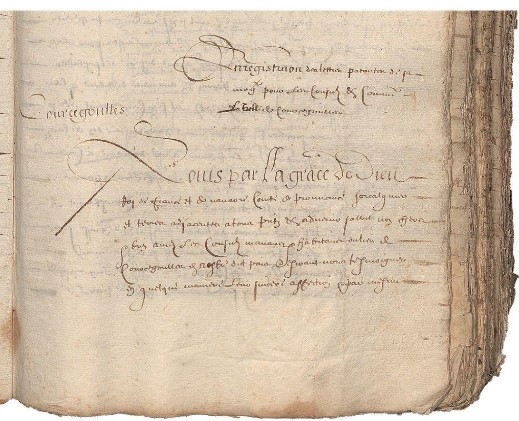
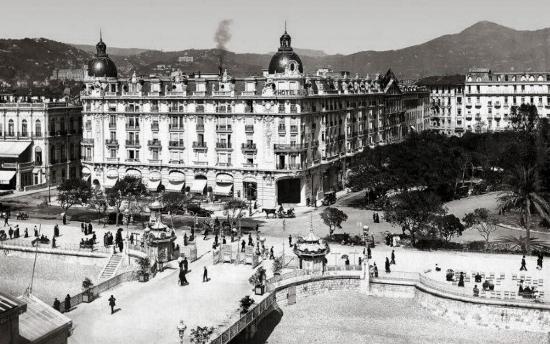
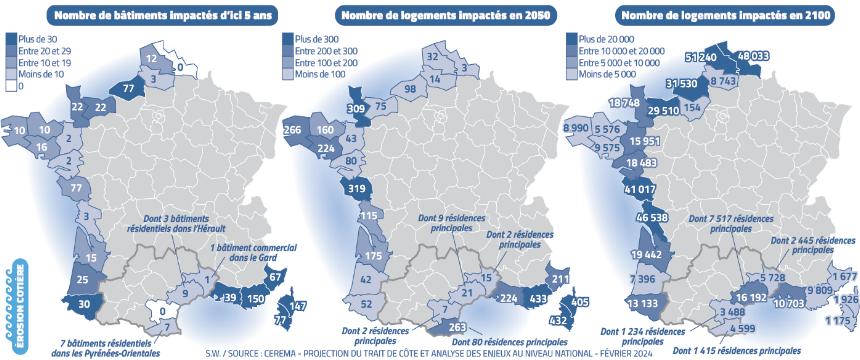



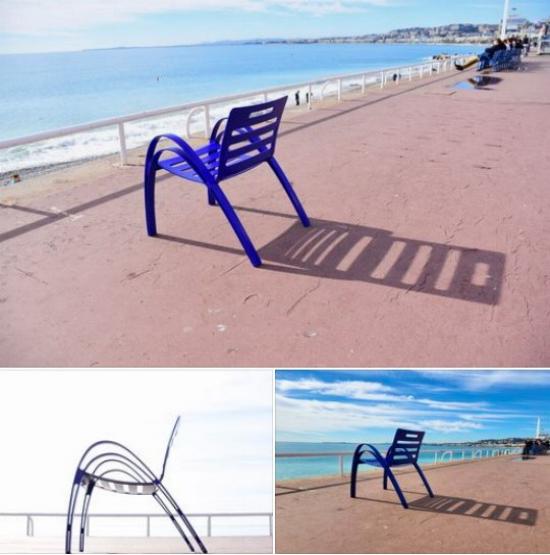
























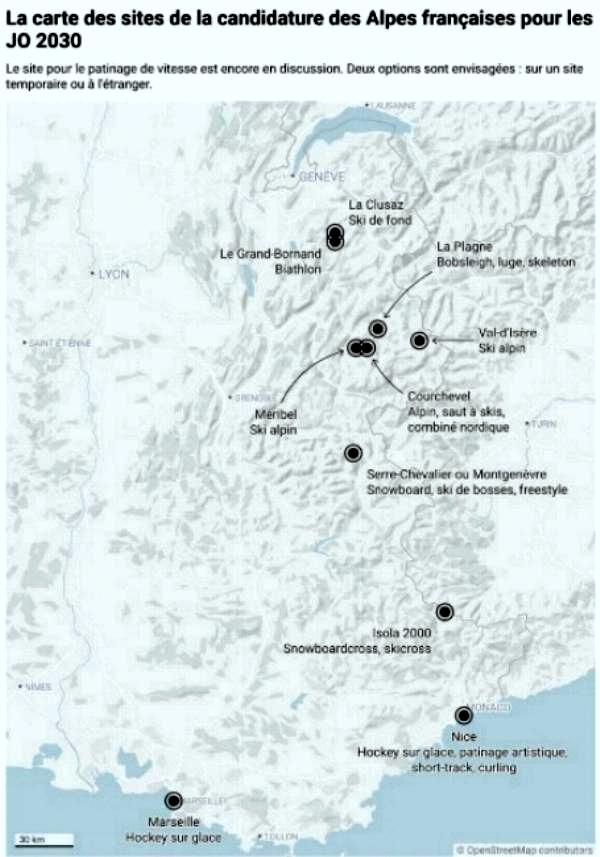


















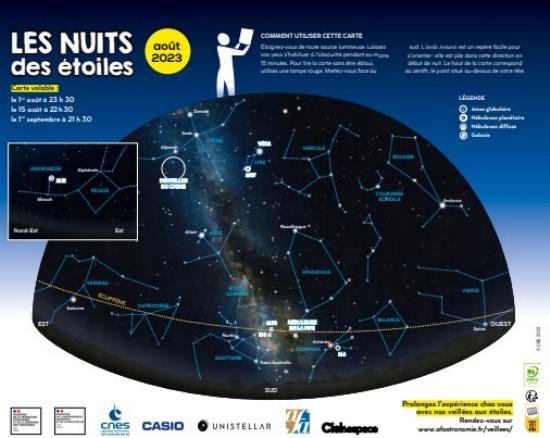





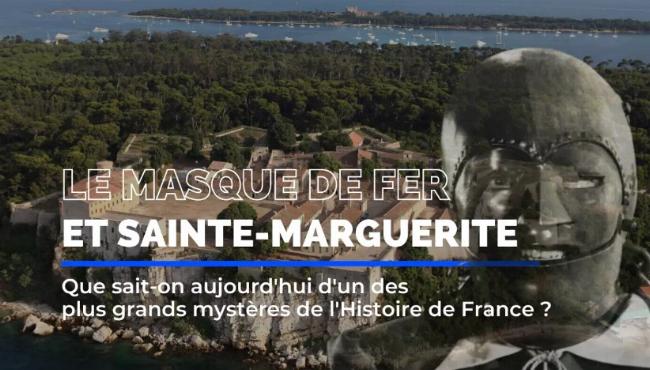
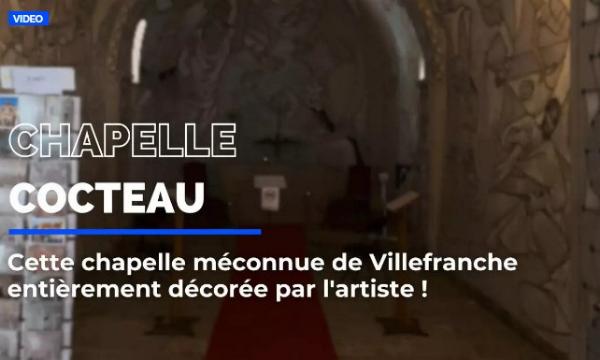















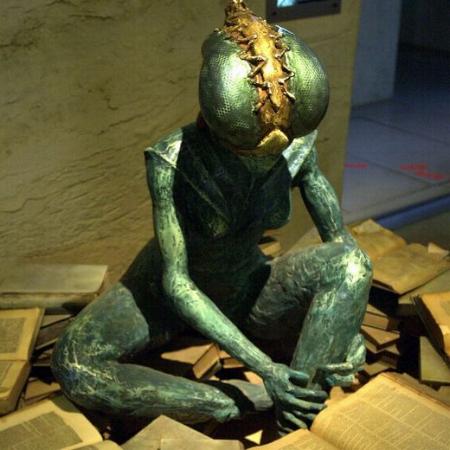





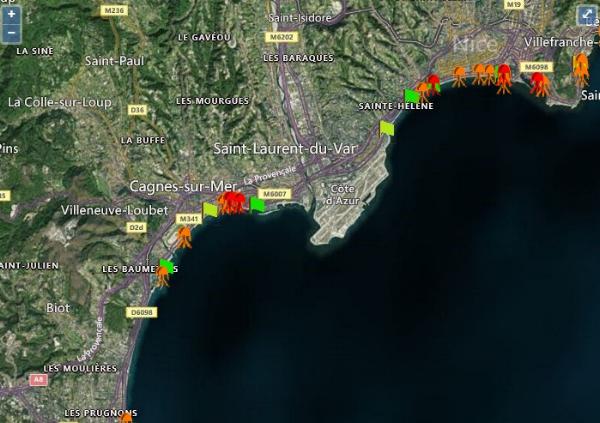









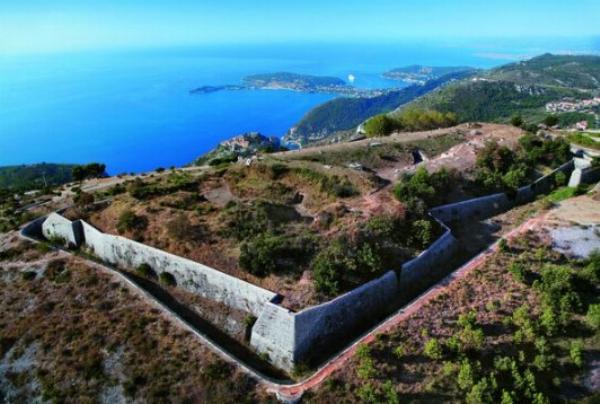
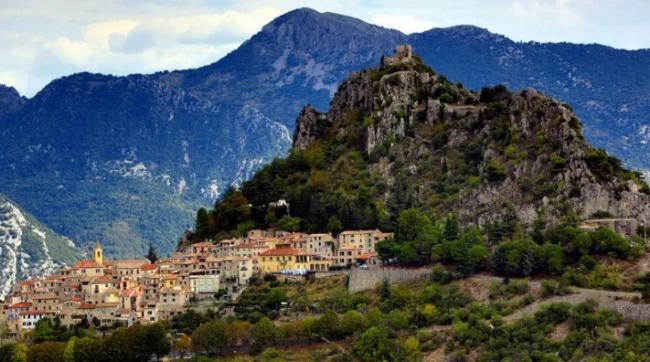



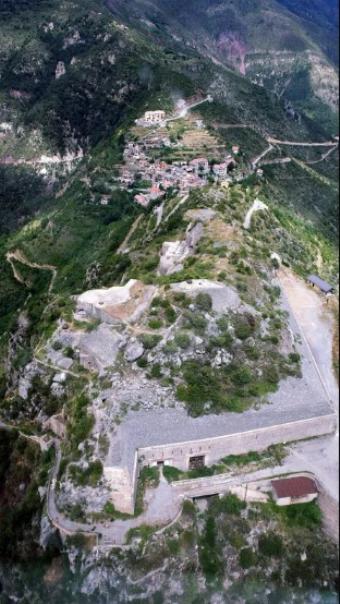

















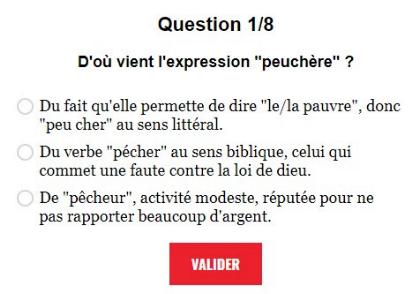
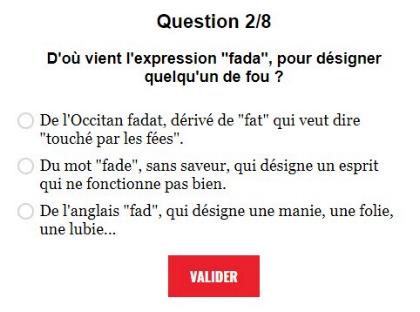
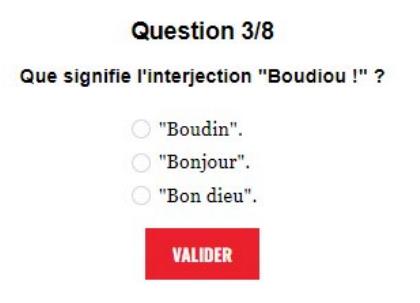
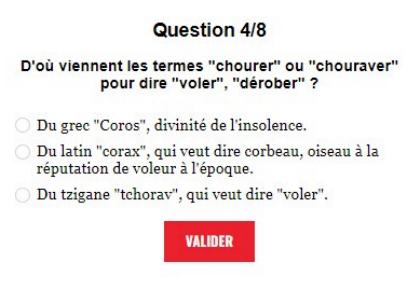
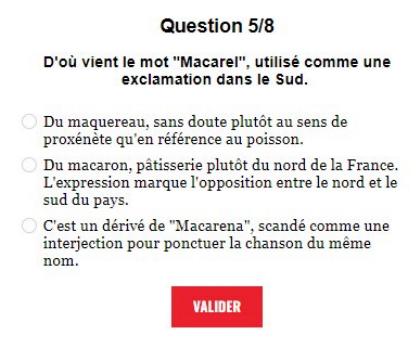
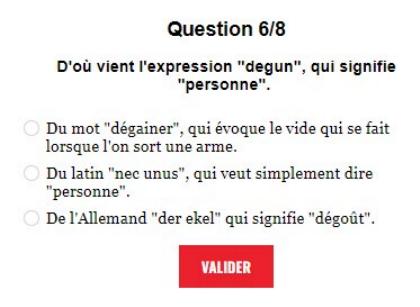
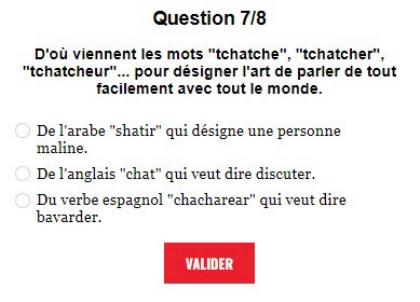
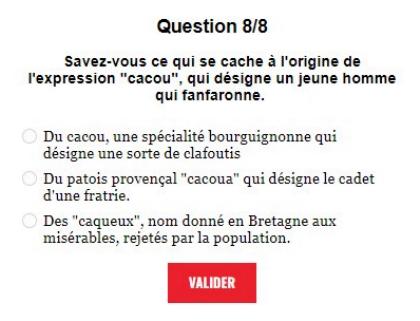
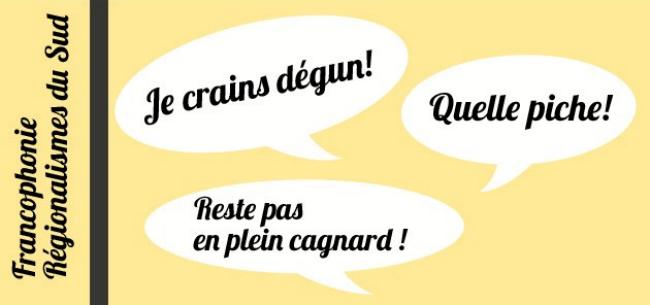


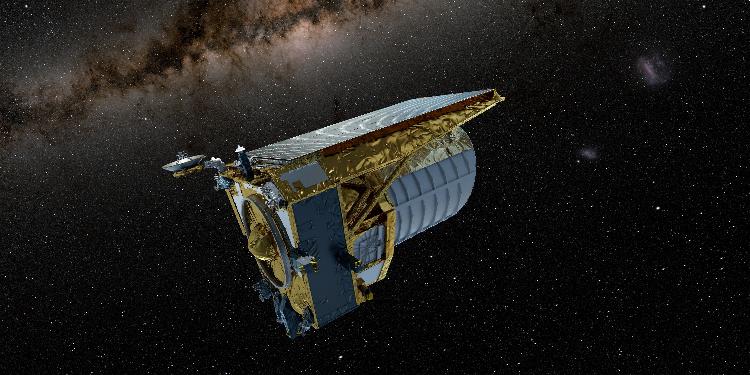

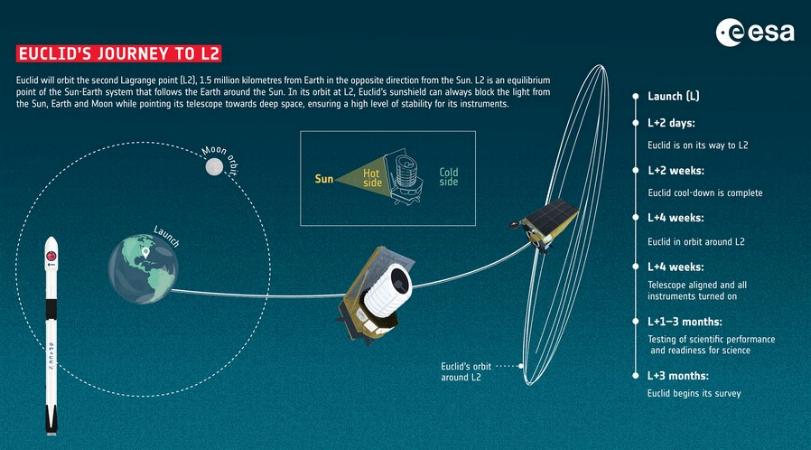
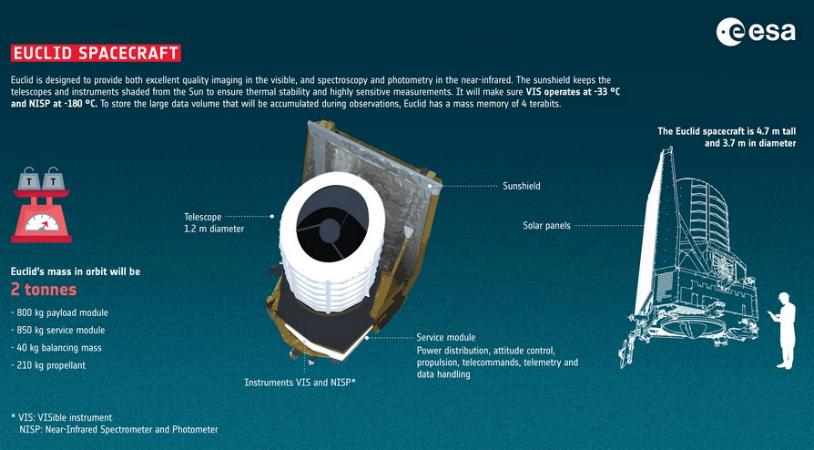
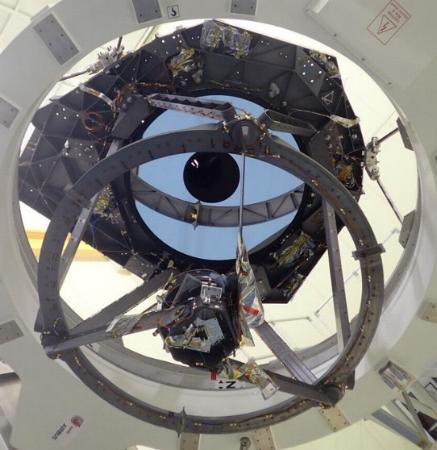





















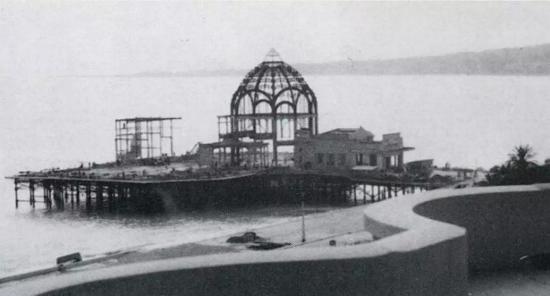
 .
. .
. .
. .
. .
.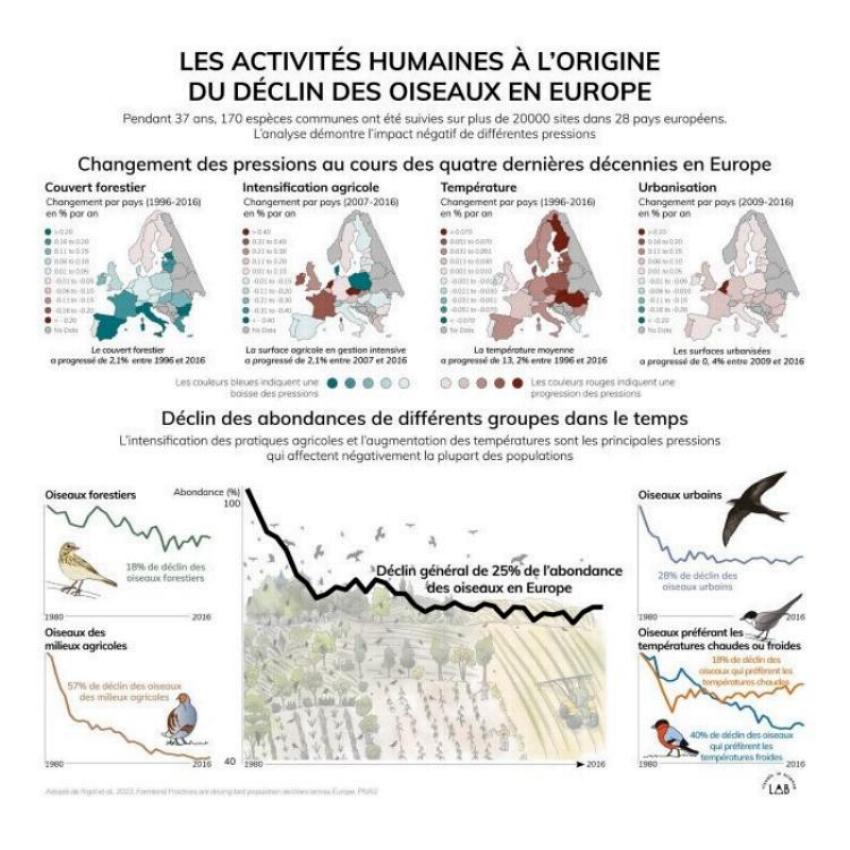
 .
.




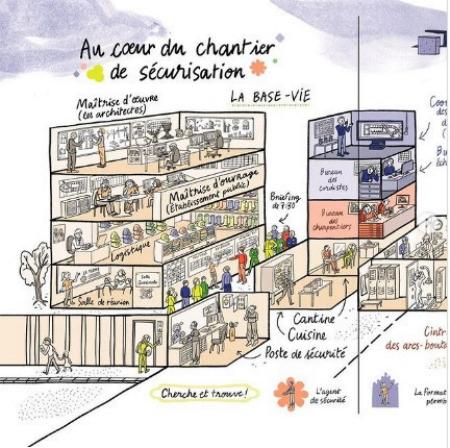


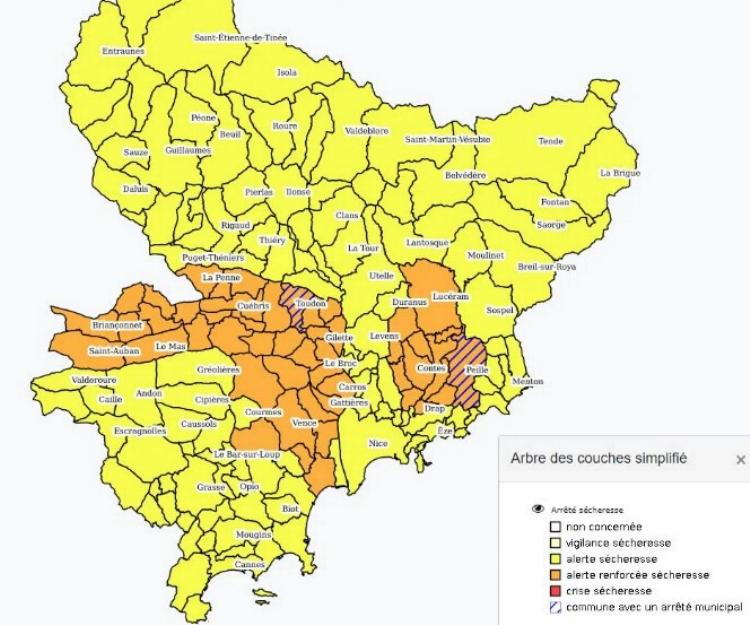















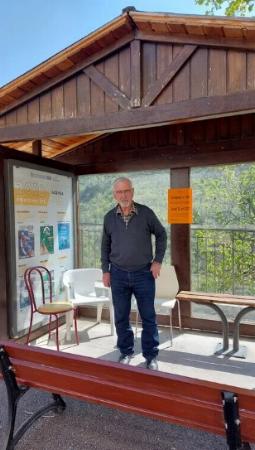
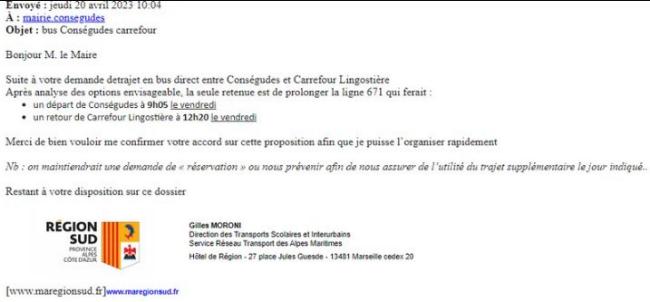





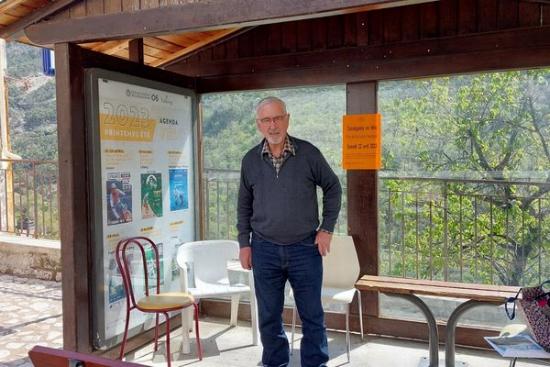
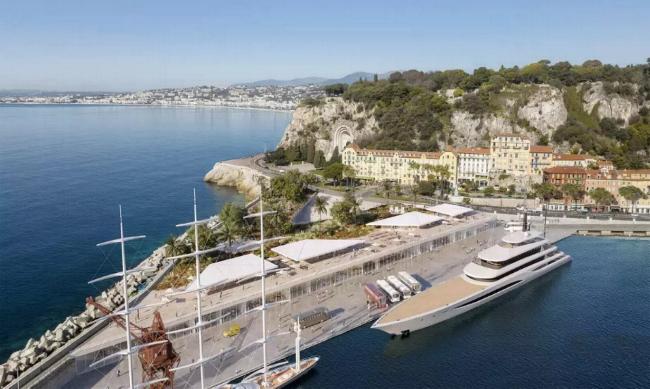



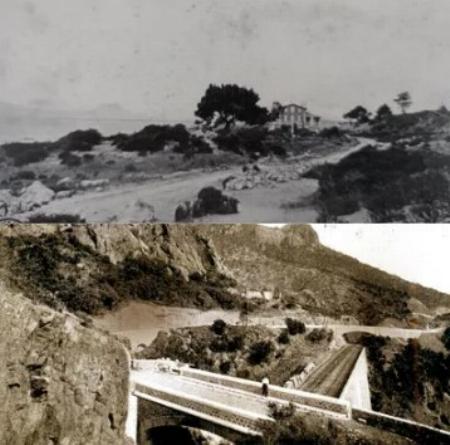
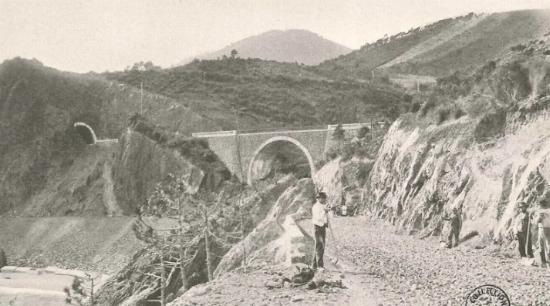


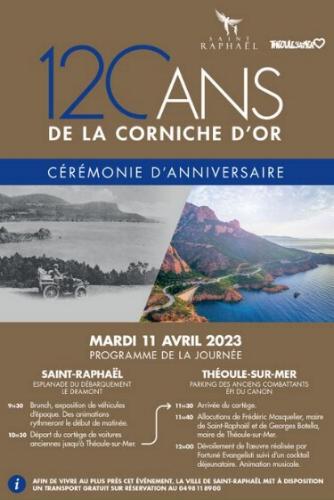
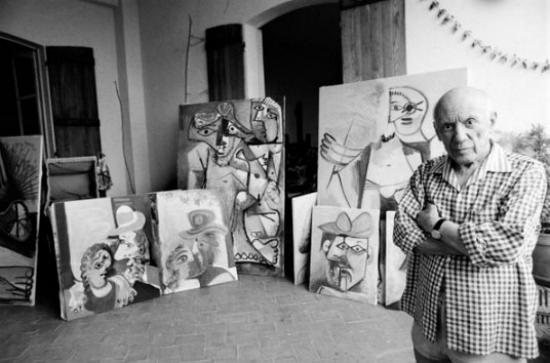
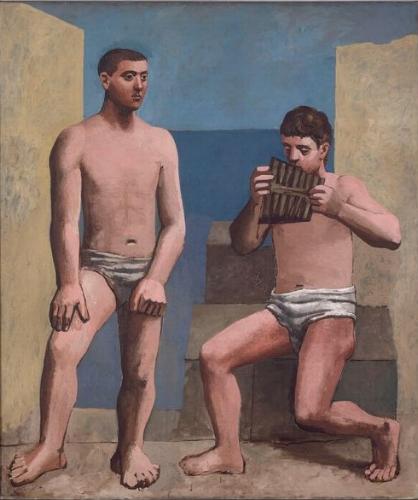


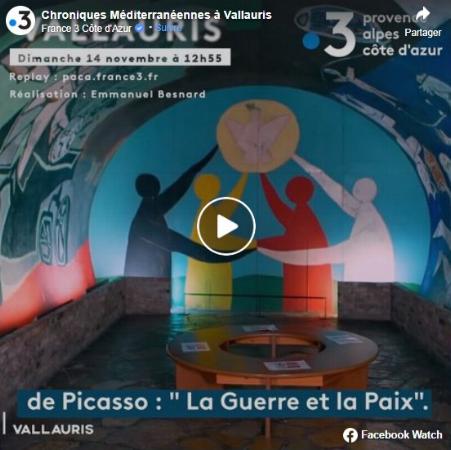
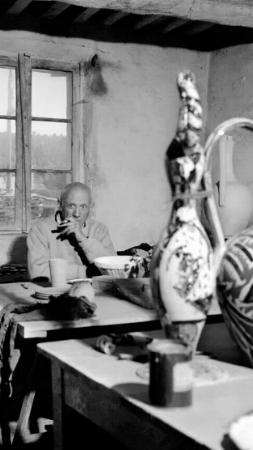



















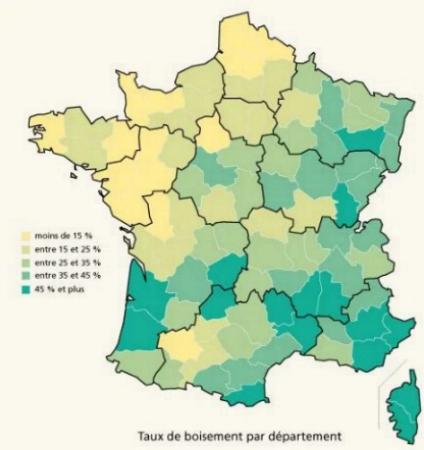
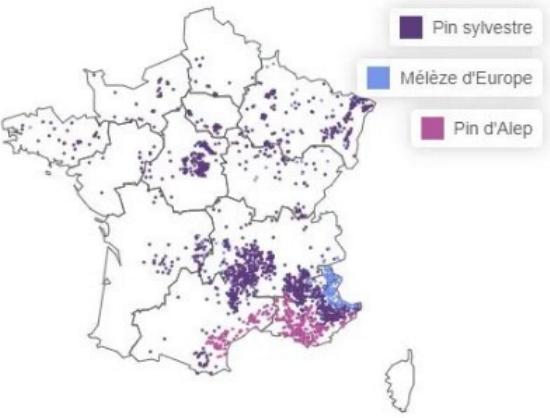

















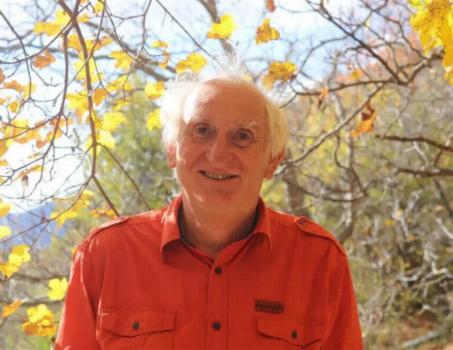















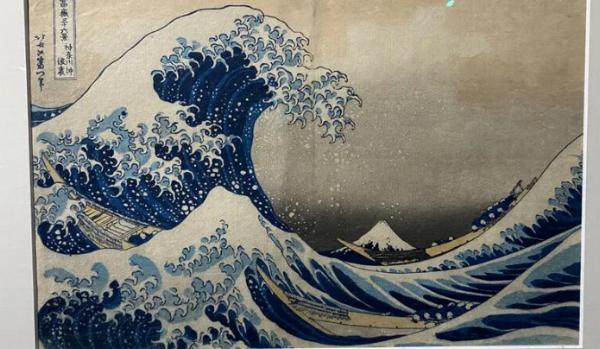








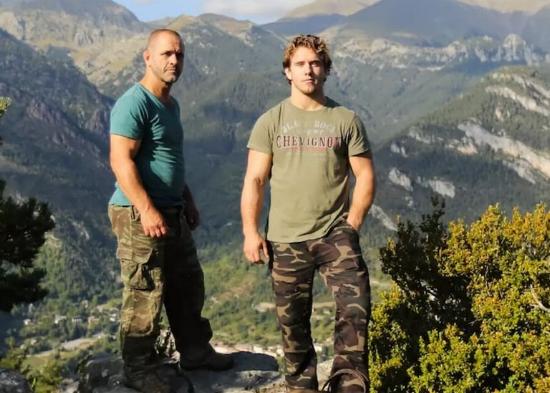











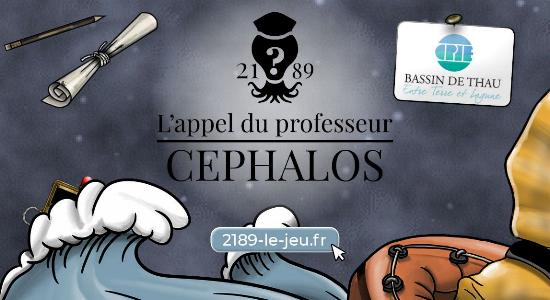







 .
.


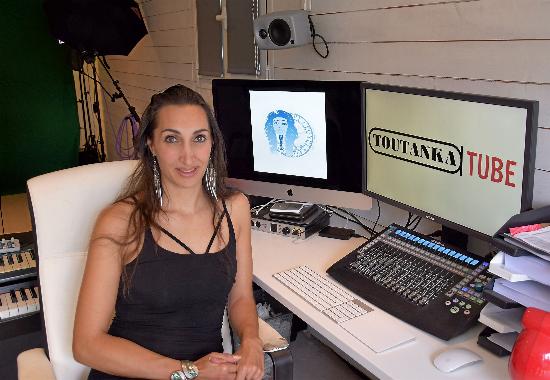


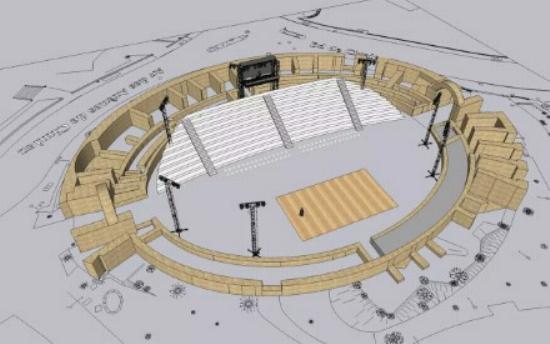
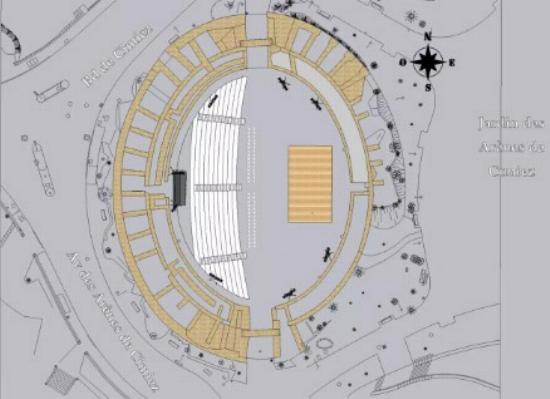
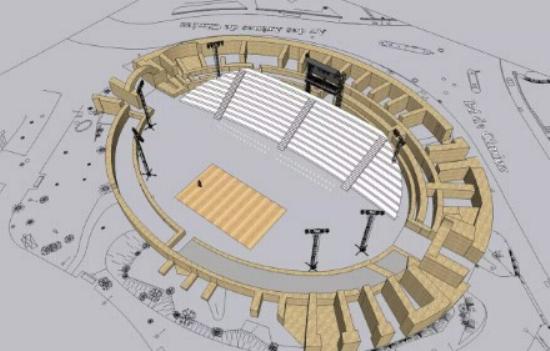
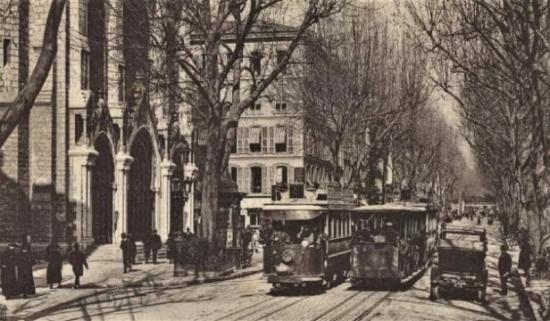

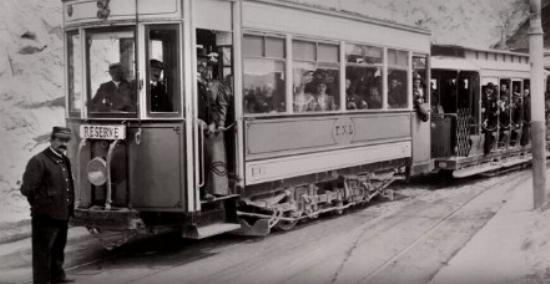








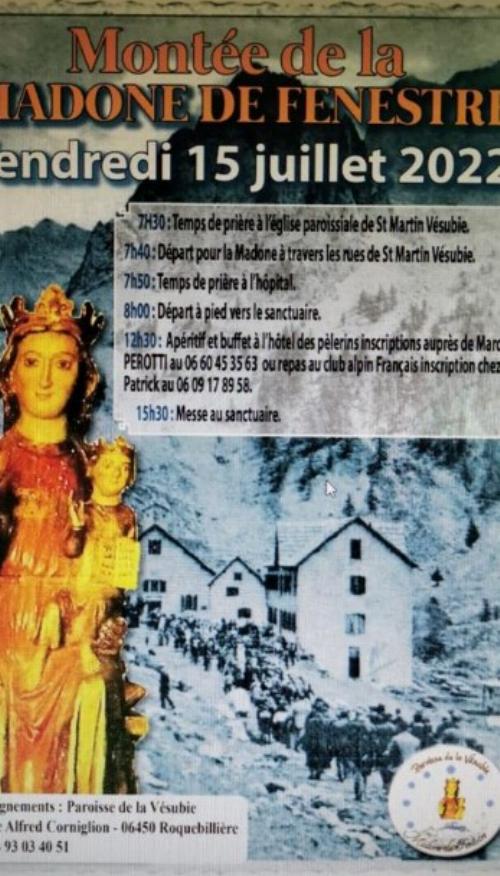













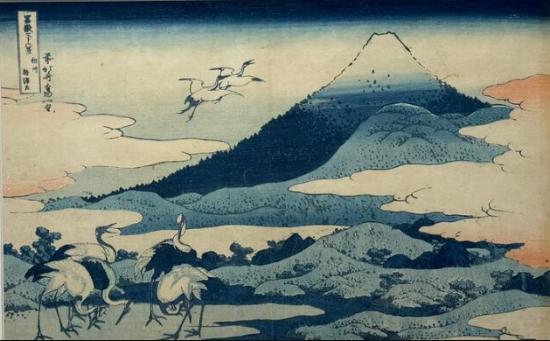
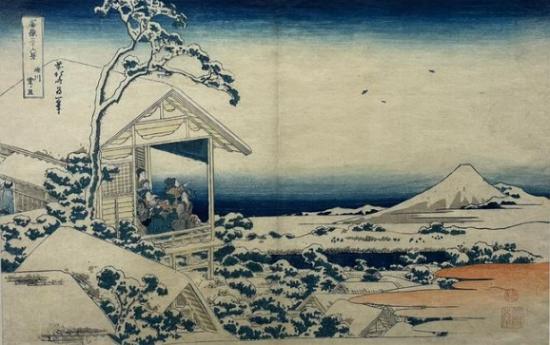

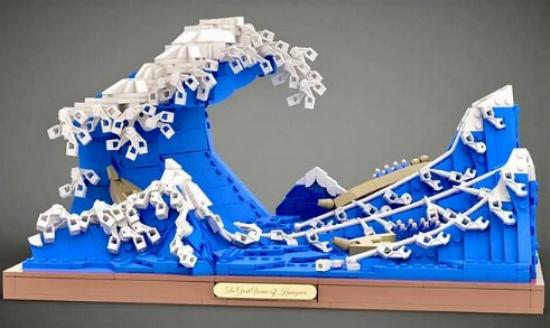












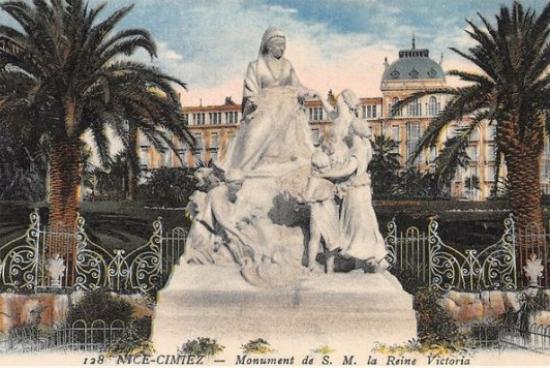
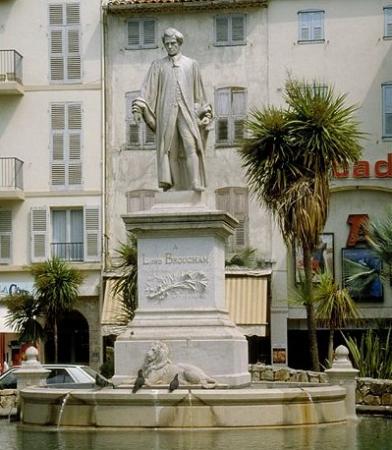

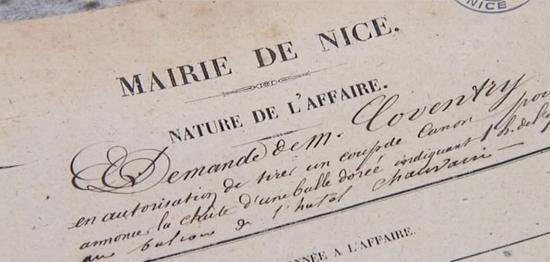











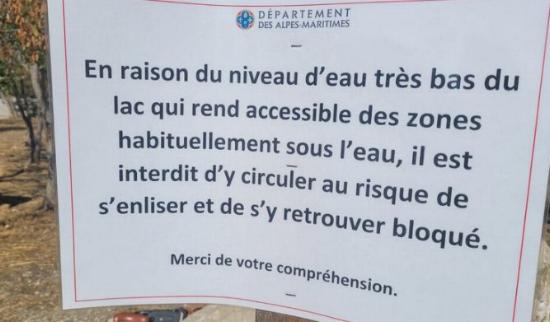













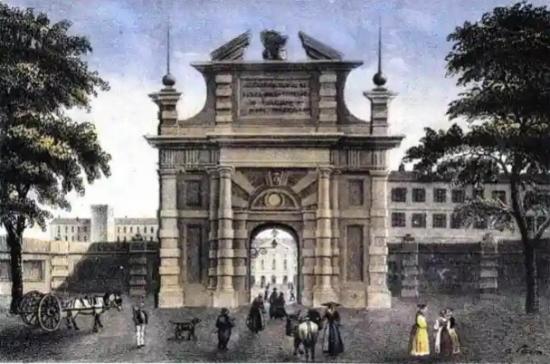
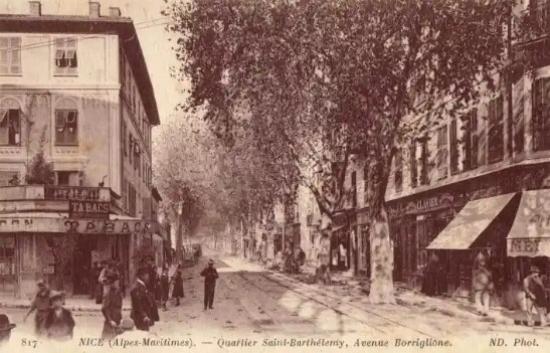

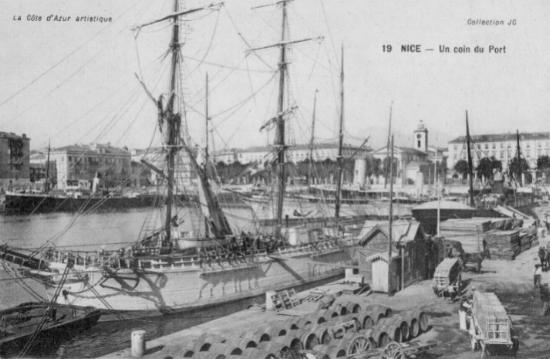


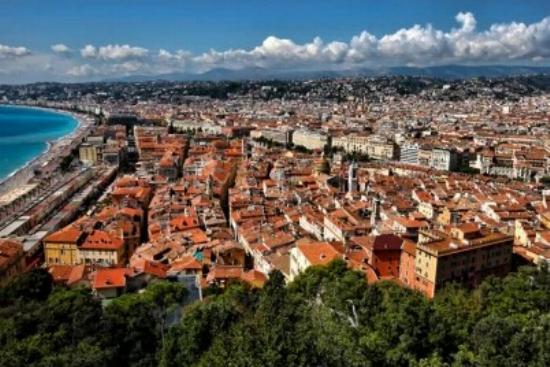




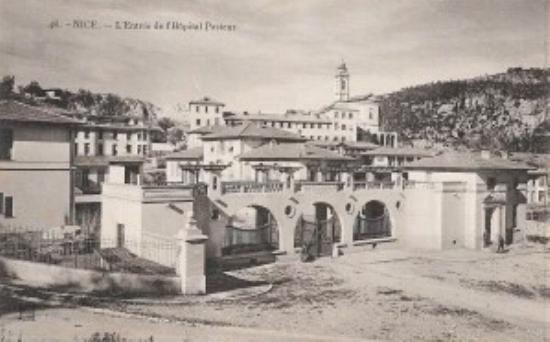
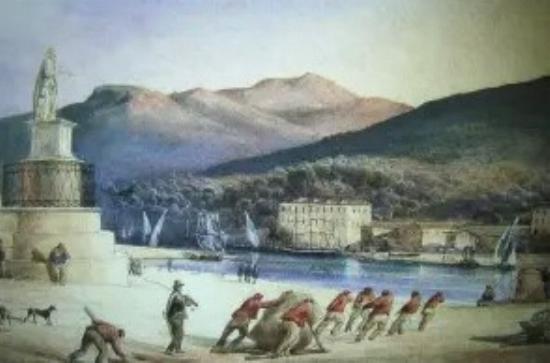

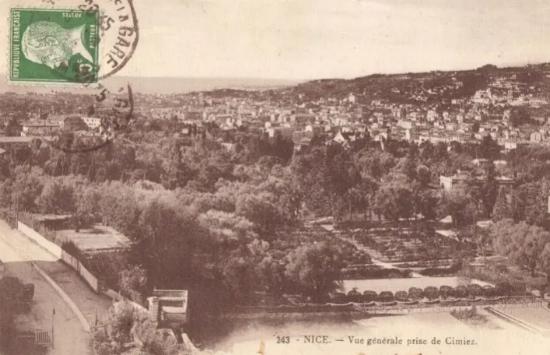
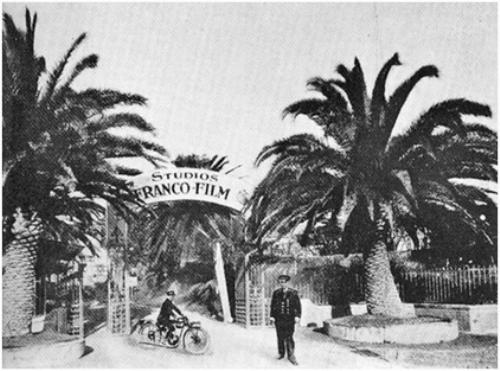

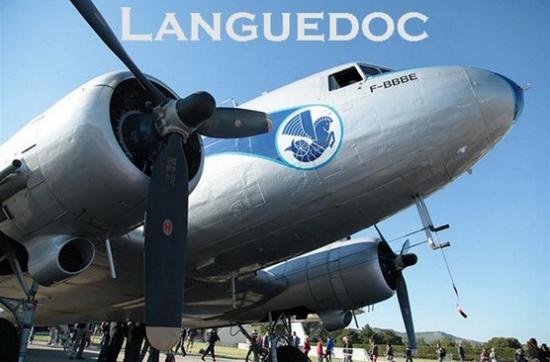
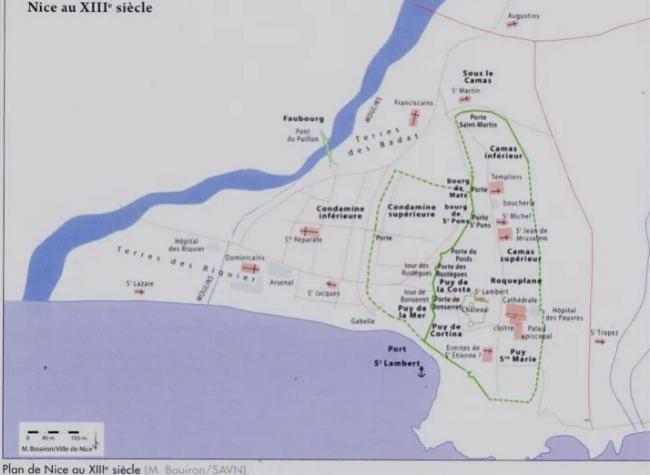
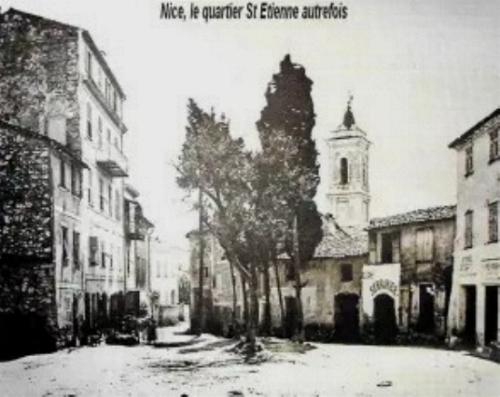

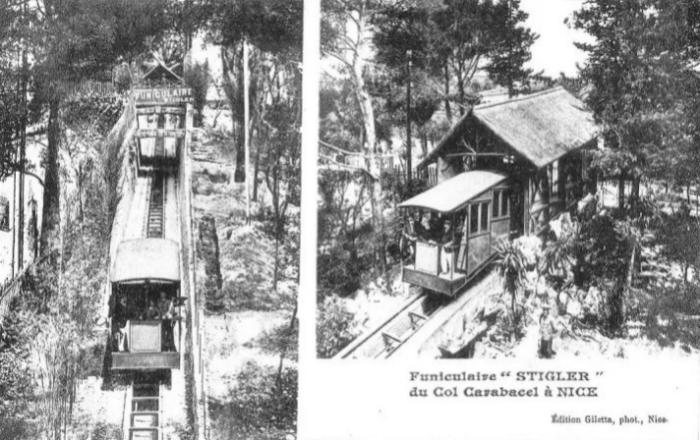

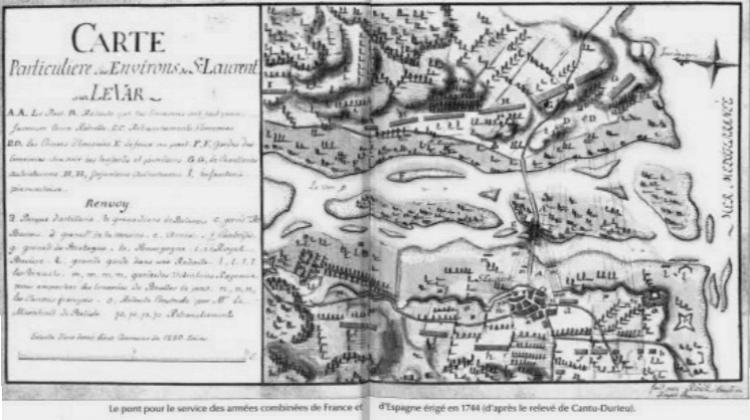
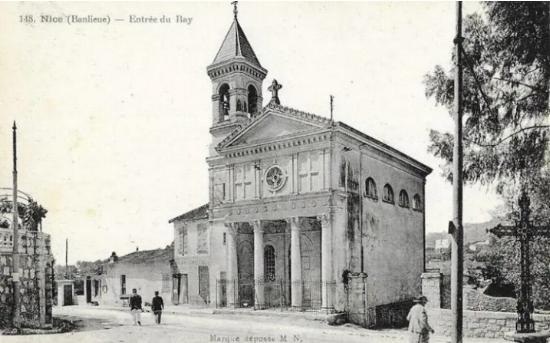




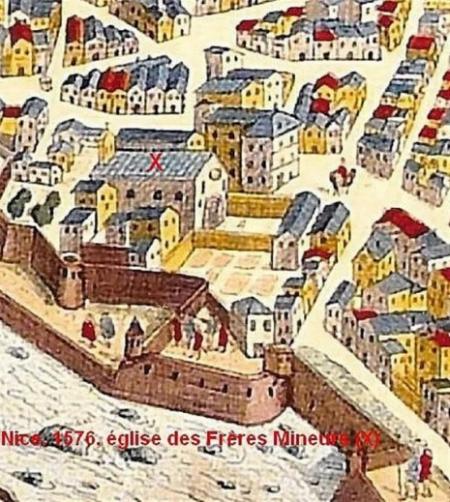
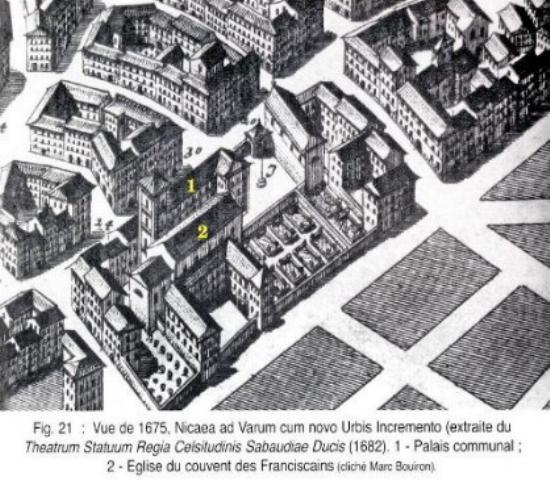
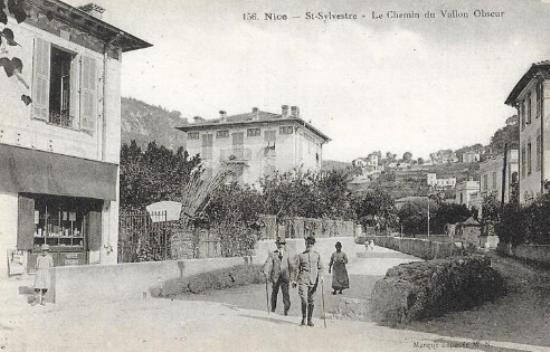


 .
.







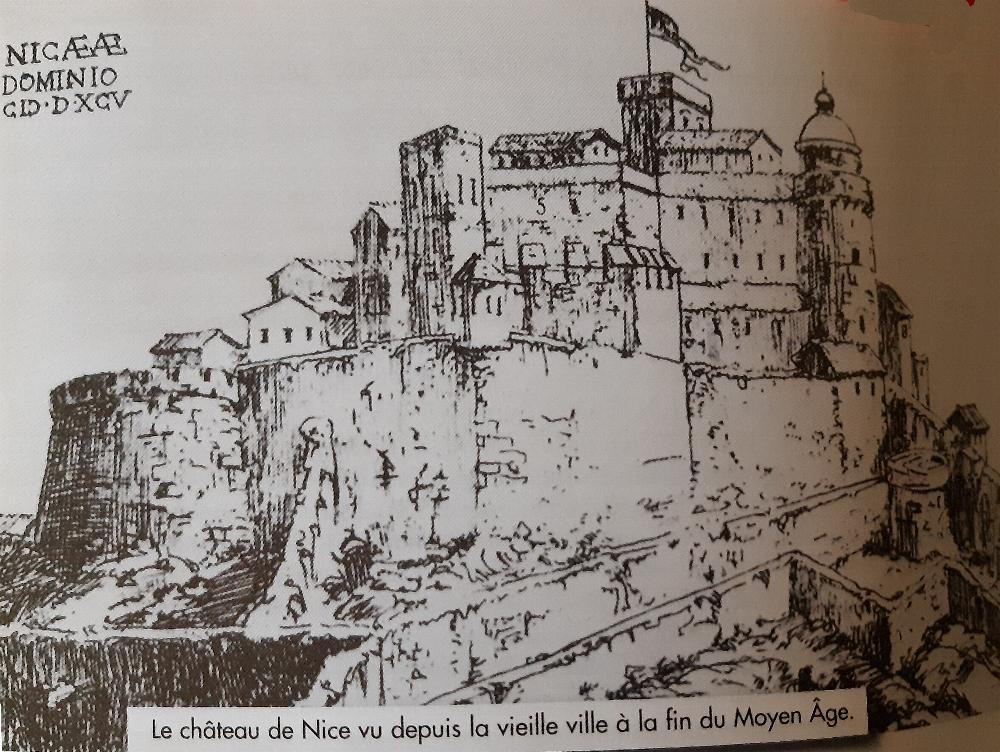

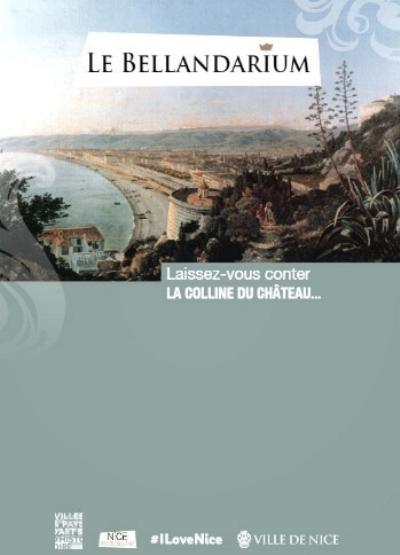

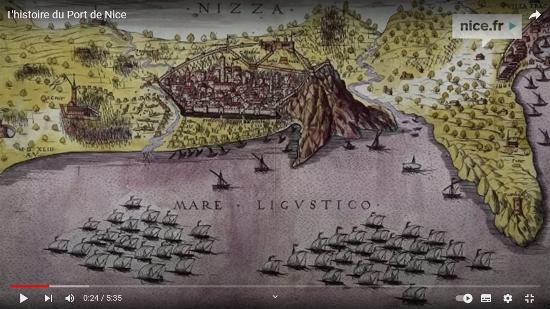













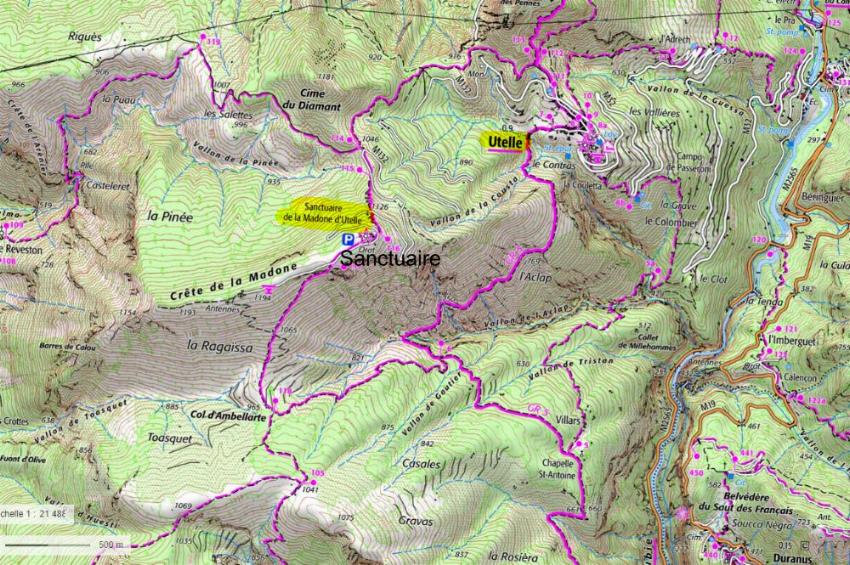


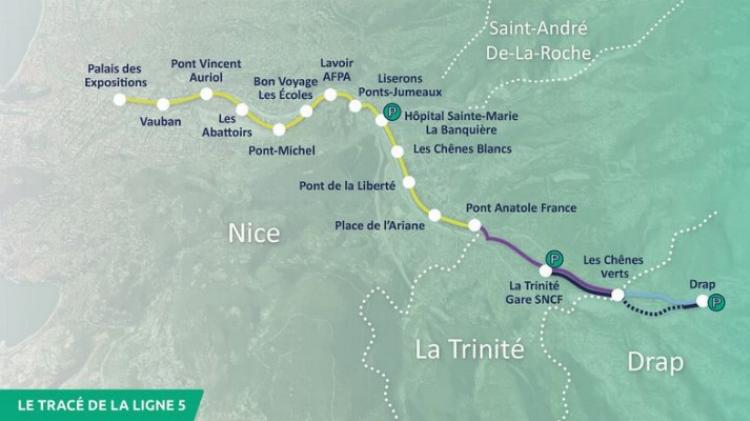




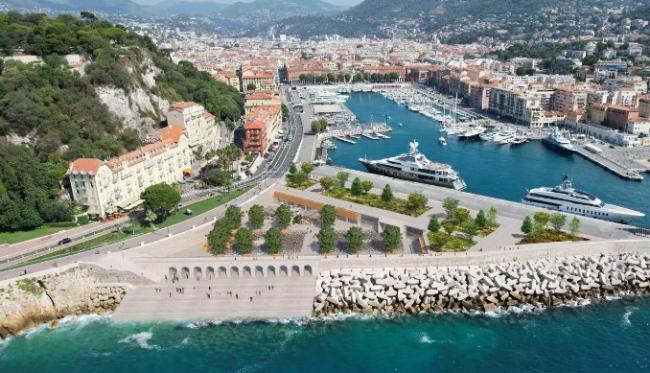













 .
.